Sommaire
8 | 2017
Juan Ramón Jiménez: tiempo de creación (1913-1917)
Ce volume recueille les communications présentées lors du colloque « Juan Ramón Jiménez: Tiempo de creación (1913-1917) » organisé par Annick Allaigre et Daniel Lecler (Laboratoire d’Études Romanes EA 4385) les 19 et 20 mars 2015 au Colegio de España de la Cité Internationale Universitaire de Paris et à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Coordonné par Daniel Lecler et Belén Hernández Marzal, l’ouvrage s’intéresse à une période de création particulièrement intense durant laquelle Juan Ramón a en partie forgé sa poétique. La réflexion s’articule en trois moments. Le premier est consacré à une figure décisive dans la vie du poète : celle de Zenobia Camprubí de Aymar, le second au poète comme traducteur, le troisième, enfin, à l’une de ses œuvres majeures, Platero y yo.
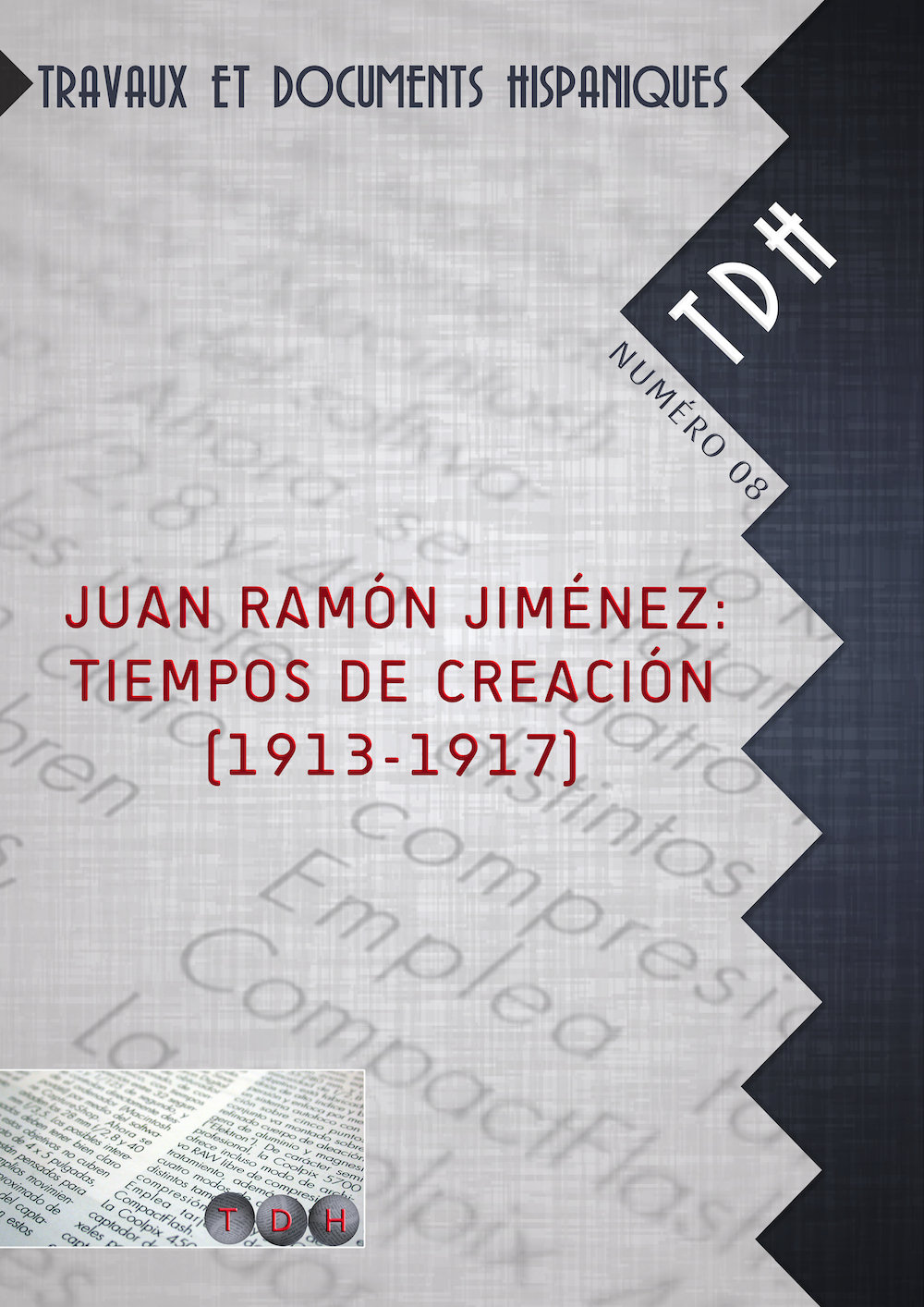
- Belén Hernández Marzal et Daniel Lecler Avant-propos
- Soledad González Ródenas « Pose de rareza » y « Hermana Risa ». Zenobia y la superación de la melancolía en la obra de Juan Ramón Jiménez
- José Julián Barriga Bravo et Nuria Rodríguez Lázaro Reivindicación intelectual de Zenobia Camprubí
- Annick Allaigre Mallarmé par Juan Ramón Jiménez, à rebours du splendide isolement ?
- Philippine Guirao Juan Ramón Jiménez, traducteur de Paul Verlaine
- Daniel Lecler Du visible à l’invisible dans Platero y yo et Don Quijote de la Mancha
- Jorge Urrutia Hacia la significación ideológica de Platero y yo
- Dominique Bonnet Un nuevo Platero, fruto de la influencias literarias comunes a Jean Giono y Juan Ramón Jiménez
- Belén Hernández Marzal Gilberto Owen a la sombra de Juan Ramón
- Virginie Giuliana « Un retrato es ante todo un documento » : la galerie des hommes illustres de Juan Ramón Jiménez et Joaquín Sorolla
- Bénedicte Mathios Amour, arts visuels, et rythmes(s) du journal dans Diario de un poeta recién casado
- Claude Le Bigot L’alternance poésie et prose dans le Diario de un poeta reciencasado de Juan Ramón Jiménez (1917) : une crise de croissance de la modernité poétique
- Marie-Claire Zimmermann Sur la genèse d’une écriture poétique : Piedra y cielo, de Juan Ramón Jiménez
8 | 2017
L’alternance poésie et prose dans le Diario de un poeta reciencasado de Juan Ramón Jiménez (1917) : une crise de croissance de la modernité poétique
Claude Le Bigot
1Du point de vue formel le Diario de un poeta reciencasado publié en 1917 est un recueil hybride qui réunit des textes en vers et en prose. Très tôt la critique s’est intéressé à ce voisinage problématique d’autant plus que l’auteur s’était montré hésitant sur le titre définitif de son livre. Il avait en effet songé à une réorganisation bipartite où les pièces en vers devaient former l’ensemble « El amor en el mar » et celles en prose « Viajes y sueños », le tout devant porter le titre général de Diario de poeta y mar, dessein qui n’a finalement pas été mené à son terme. Malgré le caractère à la fois rhématique et thématique de ce titre, tout à fait explicite, Juan Ramón Jiménez finit par l’écarter. Conscient de l’originalité formelle du recueil, le poète décidera de conserver en l’état son organisation et son titre primitif au moment de le remettre à l’éditeur Rafael Calleja en 1916. C’est précisément cette alternance poésie / prose dont le poète pressent les potentialités esthétiques puisqu’il parle lui-même de « versiprosa » ou de « prosiverso » que nous voudrions interroger. Que l’auteur ait voulu conserver dans le titre de son recueil le mot « Diario… » ne peut guère surprendre ; cette désignation oriente d’emblée le lecteur vers un ensemble de notes ou d’impressions fugitives à caractère intime, d’autant plus qu’elles sont nourries par l’expérience amoureuse et sentimentale qui le conduit à épouser en 1916 Zenobia Camprubí. Rédigé pendant la double traversée de l’Atlantique, le livre mêle impressions de voyage, effusion sentimentale discrète, découverte d’une société urbaine fort éloignée de son Andalousie natale, vie sociale intense. Mais ce qui retiendra notre attention, c’est la façon dont une parole lyrique s’est fondue dans une tentative signifiante aux prises avec une interrogation sur ce qui fonde le poétique, à un moment où le vecteur formel, que l’on croyait durablement stable, fait l’objet d’une remise en cause des frontières génériques. Nous procéderons selon deux axes : l’un esthétique en parlant de l’effet mosaïque que produit cette alternance, l’autre sémantique puisque le « verso desnudo » de Juan Ramón constitue un authentique dispositif critique.
Juan Ramón Jiménez entre vers et prose : l’effet mosaïque
2Si l’on veut apprécier l’apport de Juan Ramón à la poésie de l’année 1916, il ne s’agit pas tant d’identifier de possibles influences plus ou moins corroborées par le poète lui-même que de chercher à définir l’intérêt esthétique d’un voisinage textuel au sein d’un même recueil, relativement homogène du point de vue thématique. Une lecture cursive du Diario de un poeta reciencasado montre que vers et prose sont au service d’une même thématique et que la différence puise dans le régime discursif tourné vers la concision dans les pièces en vers et optant pour le narratif dans les poèmes en prose, qui ont tendance à fixer leur attention sur les circonstances de l’inspiration. Encore faudrait-il se méfier d’un tel critère et ne pas le considérer comme une valeur absolue tant le récitatif se glisse aussi dans les compositions en vers. Du côté des influences possibles, Juan Ramón Jiménez reconnaît avoir lu Baudelaire, Aloysius Bertrand, Claudel, mais qu’il avait aussi une connaissance précise de la poésie anglo-saxonne, en particulier de Emily Dickinson dont il se sentait proche. Par ailleurs, il ne sous-estime pas ses lectures de Rubén Darío, Valle-Inclán, Rosalía de Castro, voir même de la prose de Sainte Thérèse, chez qui il isole d’authentiques poèmes en prose. C’est dire qu’il existe chez Juan Ramón Jiménez des influences relevant d’aires culturelles bien différenciées, et que sa quête d’une prose poétique recouvre d’autres enjeux où le dialogue entre vers et prose tend à mettre en valeur l’éclat du « haut langage », au moment où les vers anciens, déjà malmenés par Bécquer, amorcent une véritable déshérence. L’histoire du modernisme hispanique est suffisamment connue pour qu’il ne soit pas utile d’y revenir. Mais l’histoire littéraire a-t-elle toujours bien perçu ce qu’impliquait la révolution formelle portée par un mouvement qui a donné un nouvel élan à une poésie lyrique encore trop chargée d’affects. Juan Ramón Jiménez aspire à une rupture formelle dont les contours se dessinent dans leur radicalité avec le Diario de un poeta reciencasado. Cette quête d’un nouveau langage passe en premier lieu par un remodelage du rythme, seule façon de mettre en phase l’affectivité et l’expression du Moi profond. Dans une interview plus tardive, puisqu’elle date de 1937, avec José Lezama Lima, Juan Ramón déclarait :
Yo creo que la emoción poética debe ser espresada, al nacer, en metros personales, inventados, al margen de las formas corrientes […] En España el uso repetido del octosílabo y el endecasílabo ha limitado el movimiento de muchos poetas. Todo poema necesita un ritmo, un tono, un estilo propios y que mueren con él1.
3Cherchant à personnaliser un dire, Juan Ramón Jiménez ne concède aucune supériorité aux vers face à la prose ; chaque formule développe son imagerie ou son symbolisme dans un déploiement narratif où l’économie de l’un (le vers) trouve un écho dans le flux syntagmatique que permet la prose. Il en va ainsi des nombreuses pièces consacrées à la lumière des différents moments du jour : l’aube, le midi, le crépuscule reviennent tel un leitmotiv dans le Diario…. Si nous laissons de côté le symbolisme attaché au cycle jour / nuit comme substitut métaphysique d’une renaissance vécue par le poète dans la perspective d’une conjugalité gratifiante, « l’or vif » (el oro vivo) dont il est question dans le poème en prose « Amanecer » est donné à voir comme une épiphanie radieuse :
Nubes de cobre grana ponen de cobre el mar azul de hierro. Metales líquidos. De oro vivo, el oriente fulgura irresistible, acercando con su duro límite listado de azul Prusia el horizonte de agua. En el confuso despertar, su derramamiento amarillo sobre el agua es como si se hubiera exaltado hasta un oro máximo, hecho grito, estallido, resurrección el derramamiento del diamante, alas blancas y platería que anoche, aquí mismo, esparcía la luna en el mar de acero2. (DPR, p. 215)
4Qu’en est-il lorsque le poète enserre la même vision dans la gangue d’une composition versifiée plus ramassée ? Rien d’autre qu’une concentration énonciative qui ménage ce qui est tu par le truchement de l’ellipse, de la segmentation syntaxique précipitée, de l’émotion contenue des tournures exclamatives ou encore dans l’indétermination :
Vamos entrando en oro. Un oro puro
nos pasa, nos inunda, nos enciende,
nos eterniza.
¡Qué contenta va el alma
porque torna al quemarse,
a hacerse esencia única,
a transmutarse en cielo alto!
… Sobre el mar, más azul, el sol, más de oro,
no libra el alma, nos dilata
el corazón tranquilo
hasta la plenitud de lo increado. (DPR, p. 245-246)
5Les pièces en prose ont beau faire place à des comparaisons ironiques, créant une distance avec la situation vécue, comme l’aube laiteuse assimilée au blanc d’œuf : « Parece que el cielo se ha roto como un gran huevo fresco y que una yema sorpendente y nunca presumida cuelga por doquiera del inmenso cascarón » (CLXXX, p. 245) ou encore la naissance avortée de Vénus, qu’a fait fuir un moine pudibond (poème XXXI), dès lors qu’il faut rendre compte de la nostalgie, de l’ennui, du spleen ou d’une angoisse, la pièce en vers par son raccourci et ses retournements inattendus cultive et stipule la même énergie langagière, exceptionnellement condensée dans la totalité de l’espace poématique comme dans le cas du poème II :
Raíces y alas. Pero que las alas arraiguen
y las raíces vuelen3. (DPR, p. 103)
6En va-t-il autrement dans ces autres chutes (remates) où affleure l’humour contenu de l’auteur ? :
¡Qué mala tienes
que ser, para ser buena. (DPR, p. 216)
Pues que estoy en la gloria,
ya no hay más que vivir. (DPR, p. 227)
7Des esprits chagrins pourraient soupçonner le poète dans ces deux exemples d’afficher des vers bien prosaïques, au moment où la prose est susceptible d’endosser tous les effets du haut langage, précieux dans le cas où elle transcende un paysage (« Mediodía », p. 242), sarcastique lorsque le regard du poète porte sur l’extravagance vestimentaire d’une femme de la haute société : « deja, tras su modesta sensualidad, la estela chillona de una gran alcachofa roja de trapo que lleva sobre el tope el traje negro, como la luz de la cola de un tren » (DPR, p. 280).
8À travers ce dialogue entre vers et prose, le lecteur aura reconnu la rivalité que se livrent deux formes d’organisation du discours dans leurs prétentions respectives pour rendre compte de la totalité du monde, à travers les perceptions diverses du poète et le sens unitaire qu’il s’efforce de construire. La poursuite de ce rêve chimérique est peut-être simplement marquée du sceau de l’impuissance. Cette tension accapare l’esprit du poète à son retour en Espagne. Le dernier texte de la section « España » fait état de la multiplicité des sollicitations sensorielles qui trouveront un point de convergence dans l’ultime réduit platonicien, à partir duquel tout s’éclaire. Le mouvement trouve une expression judicieuse dans l’épiphore, mais cette conciliation ne supprime pas pour autant le kaléidoscope sensoriel, dont l’ensemble du Diario… constitue le réceptacle :
¡Sencillez pura,
fuente del pardo tierno de mi alma,
olor del jardín grato de mi alma,
canción del mar tranquilo de mi alma,
luz del día sereno de mi alma! (DPR, p. 274).
9Le lecteur doit-il considérer que la métamorphose du poète à son retour d’Amérique est imputable à l’idylle sentimentale, au choc entre deux mondes (l’Andalousie de Moguer et l’effervescence citadine des villes nord-américaines) ou faut-il voir dans ce « renovado espíritu » qui le transporte, la liquidation d’une attitude face aux illusions lyriques ? (poème no CCVI). Le fait est que la dernière section du Diario… ne contient plus que des proses en dehors de la traduction en espagnol d’un poème d’Emily Dickinson.
10Enfin, considérée dans sa globalité, la distribution des poèmes entre vers et prose offre au regard une discontinuité spatiale que l’on pourrait désigner métaphoriquement comme un effet mosaïque, et pourtant la méthode de Juan Ramón Jiménez n’a rien du collage ou du ready made qui devaient se développer à la faveur des avant-gardes.
11Pour éviter tout malentendu sur la notion de mosaïquage, il nous faut écarter l’idée qu’il puisse exister dans le Diario une hétérogénéité de matériaux, (par exemple texte et dessin) : tout ici est strictement verbal, pas même de jeu avec la taille des caractères. Le télescopage des modes discursif et énonciatif (JE/IL) n’offre pas un critère décisif pour différencier les pièces en vers des poèmes en prose. En revanche, les masses scripturales impriment des mouvements de différentes natures, à la façon dont on parle de mouvement en peinture. La compacité des pièces en prose s’oppose d’un point de vue visuel au caractère ajouré des pièces en vers. Juan Ramón Jiménez a-t-il eu conscience que ce jeu scripto-visuel induisait une autre perception du sens ? Que d’une formulation à l’autre ne se jouait pas simplement des variations sémantiques et discursives, mais qu’il y avait une sorte de mise en scène du discours qui laissait voir des « fragments de pensée écrite » (liée à l’expérience existentielle, sentimentale, littéraire…). Si chaque pièce est autonome (à tel point que Juan Ramón Jiménez a pu songer à des agencements différents), la possibilité pour le lecteur d’établir des équivalences et des substitutions de sens rend crédible l’idée d’une syntaxe élaborée dans le discontinu, mais dont l’unité serait le fait du lecteur et non du narrateur. Cette façon de dévoiler le monde place le lecteur dans une situation comparable à celui qui contemple un tableau en s’ouvrant aux différents prismes de la rêverie. « Viajes y sueños », titre auquel avait pensé Juan Ramón pour les proses du Diario… traduit tout aussi bien une attitude générale face aux métamorphoses que permet l’écriture. Le dessein de Juan Ramón, s’il n’a pas la radicalité des Illuminations de Rimbaud, modifie en profondeur nos habitudes de lecture, bousculées par un travail verbal qui a voulu rendre au regard ses droits naturels sur la lecture.
Un dispositif critique : el « verso desnudo » de Juan Ramón Jiménez
12Selon les déclarations du poète lui-même faites en 1942 à Ricardo Gullón, la publication du Diario de un poeta reciencasado marque un avant et un après dans l’utilisation du vers libre, désigné sous la formule « mi verso desnudo ». Juan Ramón Jiménez laisse entendre qu’il a voulu se débarrasser de tout ce qui différenciait de façon trop voyante la prose et la poésie, préférant l’assonance à la rime, ou recherchant le phrasé le plus proche de la langue ordinaire. Cela explique le goût de Juan Ramón pour le romance ou la silva arromanzada, vecteur de fluidité et de spontanéité. Sur un ensemble de 243 compositions, on ne compte que 4 poèmes rimés, ayant recours à la redondilla, le reste des textes en vers affiche une dominante qui est celle de la silva assonancée ou le vers libre, le poème en prose représentant un corpus de 101 textes, soit environ 45 % du recueil. Mais la statistique ne livre pas de renseignement utile sur un sens possible de la distribution formelle. La première partie de notre exposé a mis en évidence que la porosité générique faisait qu’à tout moment l’univers de la prose peut s’élever à la poésie et inversement la poésie peut « tomber » dans la prose : il suffirait pour cela de comparer « Llegada ideal » (LIV) ou « Puerto » (CLIV) et du côté des pièces en vers, quelques rares exemples où la poésie n’a pas d’éclat comme dans « Aun cuando el mar es grande » (XXVI) ou « ¿no ves el mar? » (LI). L’hésitation face à la forme définitive est corroborée par le fait que Juan Ramón Jiménez a prosifié certains poèmes que l’édition d’Antonio Sánchez Barbudo a eu l’intelligence de citer dans son édition de 1970 du Diario…4 La polymétrie de la silva, débarrassée de toute forme de rime ou assonance, est déjà un pas vers le poème en prose. A l’inverse, le lecteur repère aisément dans tout poème en prose des « lambeaux de vers ». Cette simple remarque montre combien il est difficile pour le poéticien d’établir une distinction claire entre verset, vers libre et poème en prose. De ce point de vue une étude du poème « El mar » (CLXIII) serait tout à fait intéressante.
13Mais l’essentiel est ailleurs et ne tient pas dans l’impossible définition du poème en prose. En fait, ce choix d’ordre esthétique revient à récuser toute une conception de la poésie, celle qui a été portée pendant des siècles par la prosodie et la métrique. Qu’est-ce qui explique, alors que le modernisme hispanique d’un Rubén Darío ou d’un Salvador Rueda n’a pas ménagé ses efforts pour inventer de nouvelles combinaisons, qu’il ait été conduit à s’affranchir de toutes contraintes formelles, au point de voir dans le vers libre et le poème en prose le dispositif critique le mieux adapté à l’expression des individualités ? Si l’on admet la thèse que le poète est enclin à chercher la structure rythmique qui sert au mieux sa création, il aura tendance à considérer comme obsolète les traditions métriques du passé. Les adeptes du poème en prose défendent implicitement l’axiome « à chacun sa prosodie ». Chez un poète comme Juan Ramón Jiménez, préoccupé par l’expression de son intériorité et la traduction de ses états d’âme, le but est de trouver la forme la plus appropriée à un lyrisme purement intuitif et personnel, instable et imprévisible comme la pensée elle-même, donc à rebours de l’emploi de cadres établis à l’avance. C’est ainsi qu’on peut rendre compte à partir du Diario de un poeta reciencasado du reflux des formes fixes au profit d’une prosodie plus fluide, nécessairement unique, parce qu’elle cherche à s’adapter à chaque situation. Donc pas de rythme emprunté, mais invention à chaque instant, telle semblerait être la motivation des poètes du début du xxe siècle, qui se sont engouffrés dans une pratique conçue comme un affranchissement radical.
14Arrivé à ce point, faut-il regretter ce choix opéré à la faveur de la « crise de vers » sous prétexte qu’elle a mis en pièces la machinerie de l’ancienne versura ? La tentation est forte, mais elle peut nous égarer quant à la signification des orientations qui décident de l’avenir des formes poétiques. La porosité formelle n’est-elle pas le signe annonciateur de l’hybridité des genres qui prévaut aujourd’hui ?
15Ce questionnement recoupe un partage qui à son tour doit être reconsidéré ; c’est l’idée maîtresse qui sous-tendait la réflexion de Michael Predmore dans les pages qu’il consacre à Juan Ramón Jiménez : les poèmes en vers seraient voués à l’intimisme lyrique et la prose, quelles que soient ses qualités poétiques, réservée à l’expression d’expériences distanciées, voire superficielles5 (Gredos, p. 130), opposant en cela la prégnance du sentiment amoureux à la rugosité de l’ambiance citadine. La ville américaine, sauf dans ses confins arborés, serait devenue un étouffoir de l’idylle, schéma somme toute classique, auquel s’accroche l’exégète. Pourtant cette opposition n’est pas aussi tranchée, si l’on s’en tient à l’expression d’une tristesse diffuse qui accompagne le poète les jours de grisaille ou de tempête en mer (cf. XLV, XLVI)
¡Qué peso aquí en el corazón inmenso
como el cielo y el mar;
qué angustia, qué agonía;
oh, qué peso hondo y alto! (XLVI, p. 133)
16La sensation pénétrante du spleen est-elle si différente de la vision hivernale lorsque le paysage se défait sous l’effet du dégel pour laisser place au spectacle d’une débâcle ? : « Negros los árboles secos; negro el retrato de los cielos en los redondeles líquidos que va teniendo la riachuela al deshelarse; negros los puentes […] » (LXV p. 151). Sans doute pourra-t-on retenir une différence de phrasé entre le rythme des vers et des proses. Mais si l’on s’attache à l’expression du ressenti, il n’est pas fondamentalement différent parce que Juan Ramón Jiménez explore le double horizon, interne et externe, des lieux qu’il décrit. Ce qui l’intéresse, c’est la face cachée, les aspects les moins visibles qu’il faut sonder pour offrir de nouvelles perspectives : l’inquiétude que ne manque pas de susciter l’immensité marine dans un cas, de l’autre le dégoût qu’inspire un monde borné par la noirceur et la confusion, mais qui paradoxalement invite à en savoir davantage, parfois à notre corps défendant. C’est bien ce paradoxe qu’aborde le poète dans un système où quel que soit le vecteur formel, le lecteur assiste à des aller-retour permanents entre le global et le local. La différence de style que commente Predmore est secondaire, car le Diario… affiche dans ses variations un monde en creux, un horizon qui sans cesse déplace sa limite. Jamais la formule « le paysage est un état d’âme » ne s’est aussi bien appliquée qu’au Diario… dont la tentative pour rapprocher sujet et objet est tout à fait nouvelle et nous rappelle qu’au fond le sujet est indissociable de son environnement. Mais la langue aussi a un double horizon, interne et externe, que le poète explore ; elle lui propose un appareil assez souple pour lui permettre de créer son propre langage. Le va-et-vient entre prose et poésie est pour Juan Ramón Jiménez une façon de s’émanciper d’un ordre poétique trop rigide ; si la forme permet de créer un langage différent à l’intérieur de la langue, elle démultiplie son potentiel. Il est frappant de constater que dans une prose de la 5e section, le poète établit un parallèle entre la peinture et le spectacle de la nature pour mettre en évidence sa capacité à organiser le monde, sans jamais pouvoir le rendre intelligible. Au cœur même de l’art ou de la poésie gît sa condition aporétique. N’est-ce pas ce que Juan Ramón suggère :
Es cual una naturaleza enmendada por un pintor que le hubiese enseñado su hermosura y la pintara de nuevo con más jugo y más brío […] profusión de bienestares que dan a cada sentido su más aguda sensación, la cual, analizada, no se sabe de dónde viene hoy más que otro día, y que es poco suponer que mana del fondo sólo de la naturaleza. (CCII, p. 264-265)
17Faut-il voir dans ce constat le statutaire échec de toute figuration poétique et que dans le creux de cette impuissance s’édifie l’inéluctable volonté d’écrire ? Le Diario… narre un aller-retour avec ses sensations, ses émotions, ses inquiétudes. Il le fait de façon lacunaire, condensée dans les vers et éclatée sous forme de débris flashés par la logique de suspension dans les proses. Cette dynamique était en 1916 tout à fait inédite, parce qu’elle parvient à créer, contrairement à Rubén Darío dans Azul (1888) une mise en scène du discontinu par ses décalages (gravité vs humour), ses dédoublements polysémiques (le global et le local), les jeux de sonorités que ménagent et la prose et le vers, ouvrant l’espace sur le dehors infini ou sur l’intérieur abyssal.
18C’est sans doute par ce biais que Juan Ramón Jiménez établit le conflit qui oppose au sein même du littéraire le pouvoir de l’image et ce qu’elle donne à voir. Avec le Diario… le poète tente de dire l’indicible en faisant – si j’ose la métaphore – un « pas-de-côté ». Expliquons-nous, un certain nombre de figures sont propices à nommer l’écart : l’oxymore, certes, mais aussi la catachrèse. Recours à peu près inévitable pour parler de la mort ou bien de toute situation invérifiable. Il nous a semblé que Juan Ramón Jiménez avait su tirer profit des potentialités que permettait le seul langage poétique. L’un des poèmes les plus troublants du Diario […] est sans doute la pièce XXXVII, où le poète associe le spectacle de la mer et la mort. Un décor : « Los nubarrones tristes / le dan sombras al mar » ; puis le surgissement de l’oxymore prolongé par une comparaison lugubre que redouble un chromatisme de désolation : « El agua, férrea, / parece un duro campo llano, /de minas agotadas, / en un arruinamiento / de ruinas ». Rhétorique de l’apparition, suivie de l’effacement de l’image, puis de son rebondissement dans une impression de « déjà-vu » et qui cependant nomme l’inconnu : « ¡Nada! ¿La palabra? aquí, encuentra / hoy, para mí, su sitio, / como un cadáver de palabra / que se tendiera en su sepulcro / natural. // ¡Nada! » (XXXVII, p. 127). Le poème ouvre un espace passager, fugitif dont l’image reste le « foyer » et qui continue à nous donner le sentiment de l’ouvert, qui correspond à un infini intérieur, que nous éprouvons tous face aux questions sans réponse. Ce que suggère Juan Ramón est très proche de l’expérience du gouffre baudelairien, « ¡Nada! » renvoyant au vide ou encore à l’insatisfaction d’un dessein jamais accompli, parce que l’écriture peine à embrasser ce qui nous dépasse autrement que par le rêve ou les subterfuges de l’art. Si l’expérience de notre propre mort relève de l’impensable, le rêve de la mort est toujours possible et il est certainement un moteur de la création. Au moment où le poème s’applique à exprimer la mort, il ne peut l’assumer que sous la forme de la déconvenue, parce qu’il est condamné à développer son discours dans le mouvement de la vie. On retrouve alors la formule du poète français André du Bouchet : « L’image du néant contredit le néant ».
19Le « pas-de-côté » dont nous avons parlé est l’attitude du poète, qui pour conjurer l’irrémédiable, pour donner forme à l’indicible, pour fonder l’immunité de l’être est contraint d’épouser la déconvenue. Cette démarche trouve aussi une modalité d’expression dans la catachrèse. Or le poème en prose acceptant mieux le narratif, parce qu’il dispose de plus d’espace, fonde son « effort de style » sur une figure de rhétorique qui par définition implique une insuffisance du lexique pour désigner tel ou tel objet. La recherche de l’introuvable maison d’Edgar Allan Poe à New York par Juan Ramón pourrait relever de l’anecdote turistico-culturelle. Pourtant le poème en prose où est rapportée cette anecdote s’inscrit en creux comme la quête d’un Graal inaccessible. Après s’être heurté à l’incompréhension de jeunes gens, une vielle dame propose en vain ses services :
– Sí una casa chiquita, blanca; sí, sí, he oído de ella. Y quiere decirme dónde está; pero su memoria arruinada no acierta a caminar derecho. Nadie guía. Y vamos a donde nos semidicen, pero nunca la encontramos. (CCXLI, p. 296)
20Hésitation, doute, ignorance, oubli ? L’impossibilité d’atteindre le but, alors que le locuteur est convaincu de l’existence de cette maison, est une ouverture sur une existence réelle ou supposée, dont le manquement peut être compensé par l’imagination, mais un imaginaire tourné vers le passé – attitude qu’on ne peut pas confondre avec le souvenir et qui signifie un inlassable retour sur la vie :
Y sin embargo existe en New York, como en la memoria el recuerdo menudo de una estrella o un jazmín, que no podemos situar más que en un jazminero o en un cielo de antevida, de infancia, de pesadilla, de ensueño o de convalecencia. […] y sin embargo, yo la veo, yo la he visto en una calle […] (p. 297)
21Qu’est-ce que ce « cielo de antevida, de infancia, de pesadilla, de ensueño o de convalecencia » sinon les substituts lexicaux (métaphorique ou métonymique) qui désignent une existence devenue rupture, mais rupture qui n’est pas un terme, qui ne clôt pas l’énumération suffisamment explicite pour y lire le goût de vivre, envers et contre tout, avec un sentiment vif du néant.
*
22Pour conclure, deux observations s’imposent à propos du Diario…, l’une externe, l’autre interne. Il est publié à un moment où les poètes s’interrogent sur la viabilité du poème versifié. Le démantèlement que représente l’essor du poème en prose est un signe contestataire de l’ordre ancien, mais en même temps il est une réponse critique à l’épuisement de la poésie lyrique, dont les derniers feux ont été ceux du modernisme rubendarien et de ses épigones. Ce lyrisme a pour centre de gravité le Moi, alors que Juan Ramón initie une poésie de l’Être. L’état du poème en prose tel qu’il s’exprime en 1916 dans le Diario… n’est peut-être qu’expérimental, exprimant en quelque sorte une crise de croissance ou une étape de transition vers une pratique qui s’affirmera au cours du xxe siècle (jusqu’à aujourd’hui : cf. Sánchez Robayna, J. Talens, Leopoldo María Panero, Luis García Montero…). Le poème en prose est par essence malléable et rebelle à toute réduction à une matrice formelle rigide et s’accommode de toutes les variations qui fondent le fait poétique. Plus intéressante encore est la signification interne dont le Diario… est porteur par le dialogue qu’il instaure entre vers et prose, même si ces dernières n’accèdent pas toutes à un statut poétique. Predmore y voyait les atermoiements du poète qui abandonne le monde familier d’une longue adolescence pour découvrir la vie maritale ; il y voyait donc un passage et une métamorphose sans prêter toute l’attention nécessaire à un choix formel qui induit une étonnante circulation de l’altérité. Le Diario de un poeta reciencasado n’est-il pas construit du moins jusqu’à la fin de la 5e section sur un aller-retour, selon une double trajectoire où figurer le monde aussi bien que soi implique un faire tenir ensemble l’un et le divers ? Cet exercice est avant tout affaire de poésie.
1 Juan Ramón Jiménez, Por obra del instante. Entrevistas, Sevilla, Edición de Soledad González Ródenas, Fundación José Manuel Lara, 2013, p. 272-273.
2 Juan Ramón Jiménez, Diario de un poeta reciencasado (1916), Madrid, Cátedra, 2001, p. 244-245. Sauf avis contraire toutes les citations proviennent de cette édition que nous signalons avec l’abréviation DPR suivie du numéro de page. C’est nous qui soulignons.
3 Cet exemple de retournement n’est pas isolé ; cf. pages 124,167, 216, 227, 234, 237, 249, 252, 253.
4 Cf. le poème CCXVI « Elegía ». Version prosifiée dans Diario de una poeta reciencasado, éd. A. Sánchez Barbudo, Madrid, Labor, 1998 [1970], p. 247.
5 Michael Predmore, La obra en prosa de Juan Ramón Jiménez, Madrid, Gredos, 1966, p. 130.

Ce(tte) œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas dUtilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. Polygraphiques - Collection numérique de l'ERIAC EA 4705
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/eriac/157.html.
Quelques mots à propos de : Claude Le Bigot
Université Rennes 2 – CELAM
