Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
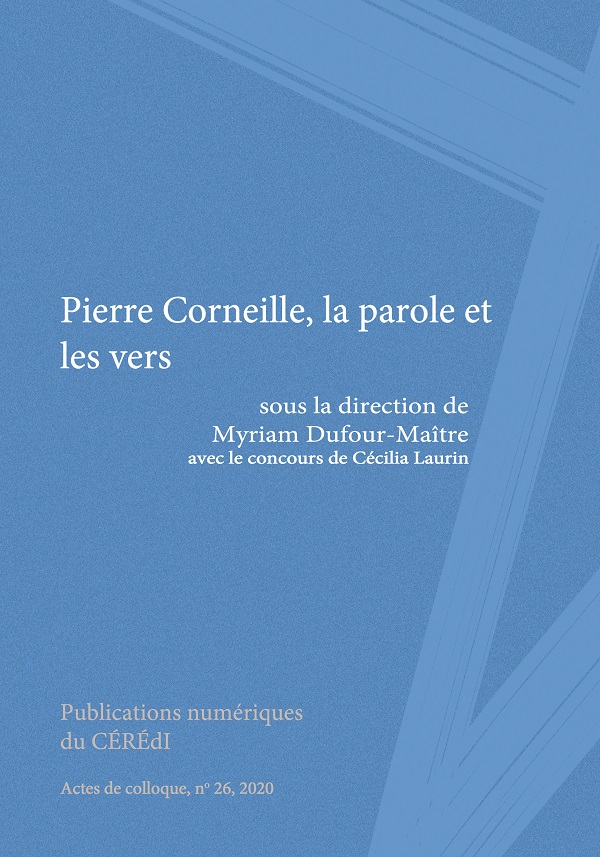
- Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Liliane Picciola, de Bénédicte Louvat et de Cécilia Laurin Introduction
- LA FABRIQUE DU VERS CORNÉLIEN
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Poétique
- Influence des versifications étrangères
- Matrices et formes-sens
- LE VERS DRAMATIQUE
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
- Le dialogue et le vers
- Parole, ethos et vers
- Vers lyrique, vers dramatique
Le dialogue et le vers
Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
Fabien Cavaillé
Cet article étudie l’usage des interruptions et des suspensions de la parole dans trois tragédies de Corneille, en montrant comment et à quelles fins cet usage se développe au cours de la carrière du poète. L’interruption ou la suspension mettent en action l’autorité d’un personnage sur les autres car elles lui assurent la domination des échanges par la violence de la prise de la parole ou, de manière antithétique, d’un silence menaçant. En jouant de la discontinuité entre alexandrins et répliques, Corneille crée des événements dramatiques qui définissent les personnages royaux, participent des constructions thématiques des pièces, produisent des effets sur l’écoute des spectateurs et interrogent le rapport de l’acteur à l’acte même de dire. Les vers interrompus et suspendus font alors percevoir ce qu’il y a de théâtral, plus encore que dramatique, dans l’alexandrin cornélien.
Trois petits points…
1Dans son livre sur la ponctuation théâtrale1, Alain Riffaud montre qu’entre le xvie et le début du xviie siècle, les imprimeurs de théâtre ont cherché des solutions typographiques pour marquer les moments où le vers court entre deux répliques et passe d’un personnage à l’autre, se trouvant ainsi désarticulé de la parole. Comment rendre sur la page l’unité métrique et la discontinuité du discours ? Les points de suspension offrent une réponse à cette tension. Absents de l’édition théâtrale des années 1620, ils se généralisent dès la décennie suivante et ce sont eux que l’on retrouve dans les éditions que Corneille donne de son œuvre. Cette généralisation s’accompagne d’une spécialisation. Les points de suspension ne signalent pas tous les vers incomplets d’une réplique ; ils désignent la désarticulation de la parole et du vers comme un inachèvement selon deux cas de figure que distingue Grimarest en 1707 :
le discours peut être interrompu par la personne qui parle, ou par celle à qui l’on parle. Au premier cas, c’est la réflexion qui fait que l’on s’interrompt : ainsi ce point demande un petit silence, & un ton de voix différent. Au second cas, c’est une raison subite qui engage celui qui écoute à interrompre celui qui lui parle ; c’est pourquoi il doit lui couper la parole sans pause2.
2Dans le second cas, que je nommerai interruption, l’obstacle à la parole est extérieur au locuteur alors qu’il est intériorisé dans le premier cas : la suspension marque alors l’émotion la plus forte mais aussi la réticence ou la prudence qui conduisent le personnage à ne pas vouloir dire.
3Qu’ils désignent l’interruption ou la suspension, les trois points fonctionnent comme une didascalie discrète qui porte l’attention des lecteurs sur des actions qui ont lieu à même la parole des personnages. Ils font entendre le frottement entre deux répliques ou le silence qui s’installe, imaginer des échanges de regard, des mains portées vers l’autre ou des corps qui se dégagent. Ils manifestent avec discrétion quelque chose du théâtre aux lecteurs.
4Étudier les vers inachevés en suivant leurs points de suspension aide à comprendre ce qu’il y a de dramatique, et plus encore, de théâtral dans le vers cornélien. Corneille est conscient de l’intérêt pour la scène de ces alexandrins inachevés, coupés ou étouffés3 ; il en fait même un effet privilégié dont Racine se montrera beaucoup moins prodigue que lui. Quelques chiffres pour asseoir le propos, en se fiant aux premières éditions4 : on ne compte que 7 interruptions / suspensions dans Horace et 9 dans Cinna ; cinq ans plus tard (1647, date de l’achevé d’imprimer), 18 dans Rodogune, 31 dans Héraclius ; en 1662, l’édition de Sertorius en contient 65, celle d’Othon en 1664, 67 ; Suréna en 1674, un peu moins en apparence : 56, mais il s’agit en fait d’un retour en force des interruptions après plusieurs pièces (Attila et Agésilas) qui revenaient à des niveaux plus bas (respectivement 25 et 34). À chaque fois, l’interruption apparaît plus fréquemment que la suspension de type aposiopèse5.
5On connaît depuis longtemps les silences de Racine qui nourrissent le traditionnel parallèle entre son aîné et lui. Comme le dit Grimarest parmi tant d’autres : « Les Tragédies de M. de Corneille demandent absolument un ton de voix plus noble, plus lié, plus élevé, que celles de M. Racine : Celles-ci le veulent plus naturel, plus coupé, plus touchant, que les autres6. » Or le décompte parle de lui-même : non seulement il y a bien un style coupé chez Corneille mais la chronologie montre que celui-ci découvre quelque chose dans l’inachèvement du vers, interrompu ou suspendu, qu’il amplifie peu à peu au cours de sa carrière. J’aimerais ici montrer la cohérence de cette recherche et sa spécificité qui oblige à l’interpréter en des termes différents de ceux que l’on applique d’ordinaire au théâtre de Racine. La versification coupée relève chez Corneille à la fois d’une autre manière d’inscrire les passions dans la parole et d’une violence d’un autre type. Le dramaturge, en effet, fait de l’interruption un des caractères de la parole du pouvoir à côté de la « pompe » ou de la « majesté » des vers. L’interruption met en jeu chez certains personnages ce que l’on pourrait appeler leur pouvoir de parler, obtenu par le rang mais exercé par la force : pouvoir de parler sur et contre les autres, de leur couper la parole, de la leur prendre et les réduire ainsi au silence. La discontinuité du vers témoigne donc des recherches de Corneille pour faire entrer la conflictualité et la violence dans la parole théâtrale, dans sa tension avec l’alexandrin. Elle témoigne aussi de la théâtralité propre à son œuvre, ou plus exactement, de ce qu’aime Corneille au théâtre : un goût pour le sublime qui transparaît jusque dans ces paroles inachevées, mais aussi un goût pour l’engagement de l’acteur dans le discours.
Tenir la parole : l’exercice de la domination dans Cinna
6C’est peut-être dans Cinna que Corneille expérimente les possibilités dramatiques de l’inachèvement du vers, non qu’il multiplie les interruptions (seulement trois de plus par rapport à Horace) mais parce qu’il découvre comment les inscrire dans le dialogue et l’interaction des personnages.
7À la différence des récits de Sénèque et de Montaigne à qui Corneille emprunte les grandes lignes de la première scène de l’acte V, Cinna coupe moins la parole d’Auguste qu’il ne lui réplique à la fin d’une étape logique de son discours. L’effet de clausule de la tirade (« Cinna, tu t’en souviens, et veux m’assassiner7. »), la complétude de la rime (s’imaginer / m’assassiner) rendent possible une pause, ménageant un espace pour que l’interlocuteur prenne la parole. Dans cette scène, la véritable interruption est le fait d’Auguste et se trouve marquée par le vers inachevé (« Qu’un si lâche dessein… / Tu tiens mal ta promesse8, »). Auguste coupe la parole à Cinna et le renvoie à la « loi » acceptée au départ : « garder [s]a parole9 », ce qu’il faut prendre au double sens de faire silence et promettre de faire silence. L’interruption de Cinna apparaît comme une transgression et celle d’Auguste comme un acte de justice, comme un châtiment immédiat et foudroyant, sans doute le plus théâtral de tous puisqu’il revient à priver le personnage, donc le comédien, de sa parole. Avant de pratiquer la clémence, Auguste démontre au conspirateur qui détient la force de réduire les autres au silence. Avec l’efficacité sèche d’un haussement de voix, l’interruption préfigure d’autres exécutions plus capitales. Après la seconde partie du discours d’Auguste, Cinna n’a plus de discours autonome, il ne peut plus rien dire, il ne peut plus prendre l’initiative d’entamer l’alexandrin ; il faut attendre que l’empereur lui donne la parole : « Auguste. […] Parle, parle, il est temps. / Cinna. Je demeure stupide10, ».
8En écrivant dans les marges de Sénèque et de Montaigne, Corneille comprend sans doute que l’interruption cristallise la tension entre deux personnages et trouve dans Cinna une évidente portée politique. S’il s’agit probablement là d’une scène matricielle pour les vers inachevés cornéliens, c’est ailleurs dans la pièce que le poète s’est montré le plus inventif. En effet, Cinna se fait déjà couper la parole un peu plus tôt, au cours de l’échange avec Émilie à l’acte III. Autrement dit, Corneille se sert de l’interruption pour traduire la violence entre les amoureux, comme s’il cherchait à dépasser la forme de la stichomythie qui avait pourtant fait le succès de la grande scène du Cid entre Rodrigue et Chimène11.
9Dans cette longue séquence de la fin de l’acte III, le discours s’interrompt à quatre reprises selon des modalités différentes et avec des effets variés qui témoignent des recherches de Corneille sur les possibilités dramatiques des vers inachevés. Tout commence par une suspension :
Cinna
Vous pouvez toutefois… ô Ciel ! l’osé-je dire !
Émilie
Que puis-je, et que crains-tu ?
Cinna
Je tremble, je soupire,
Et vois que si nos cœurs avaient mêmes désirs,
Je n’aurais pas besoin d’expliquer mes soupirs.
Ainsi je suis trop sûr que je vais vous déplaire,
Mais je n’ose parler, et je ne puis me taire12.
10Cinna s’interrompt lui-même de parler et désigne son silence comme un « soupir » qu’il regrette de devoir « expliquer » puisqu’Émilie ne peut pas l’interpréter (« Que puis-je, et que crains-tu ? »). Elle a bien compris que Cinna est terrifié mais elle ne parvient pas à en trouver la raison. L’aposiopèse est un signe trop peu clair, elle doit être explicitée, mise en mots pour qu’il y ait dialogue. Sans doute faut-il entendre dans l’incapacité d’Émilie à interpréter le « soupir » de Cinna une prévention de Corneille à l’égard de ces paroles suspendues par excès d’émotion. L’interruption, parce qu’elle consiste en un acte violent dans le cadre du dialogue, semble lui convenir davantage : il l’emploie à deux reprises dans la scène. Une fois que Cinna a « expliqu[é] [s]es soupirs », Émilie comprend les intentions de son amant et lui coupe la parole : « Il suffit, je t’entends, / Je vois ton repentir et tes vœux inconstants13. » Comme Auguste, elle empêche Cinna de continuer son discours, l’écrase sous sa réponse et l’humilie en déclarant son discours inutile. Pour Émilie aussi, l’interruption est affaire de domination : elle « tient la parole » de Cinna, le force à se soumettre puisqu’elle ne veut plus l’écouter.
11À la fin de la scène, Corneille essaie une nouvelle forme de suspension. Cinna quitte son amante après avoir renouvelé sa promesse de tuer Auguste ; Émilie ne dit rien et il faut que Fulvie l’interpelle pour qu’elle réagisse ; elle s’apprête à tout faire arrêter mais elle suspend sa parole avant de réaffirmer son désir de vengeance :
Fulvie
Il va vous obéir aux dépens de sa vie.
Vous en pleurez !
Émilie
Hélas ! cours après lui, Fulvie,
Et si ton amitié daigne me secourir,
Arrache-lui du cœur ce dessein de mourir,
Dis-lui…
Fulvie
Qu’en sa faveur vous laissez vivre Auguste ?
Émilie
Ah ! c’est faire à ma haine une loi trop injuste.
Fulvie
Et quoi donc ?
Émilie
Qu’il achève, et dégage sa foi,
Et qu’il choisisse après, de la mort, ou de moi14.
12La suspension diffère de celle de Cinna au début de la scène 4. En effet, Émilie n’est pas étouffée par l’émotion ; au contraire, elle parle sous le coup de l’émotion, ce que la suspension inopinée du vers vient arrêter. Le silence marque le contrôle de la volonté sur l’expression hâtive, inconsidérée, des passions. Il ne signifie pas le haut degré du pathos mais bien son reflux et sa maîtrise par le personnage qui « tient sa parole » pour reprendre l’expression d’Auguste. Avec cette scène entre Cinna et Émilie, Corneille développe des dimensions nouvelles de l’interruption et de la suspension qu’il n’y a pas dans la grande scène d’Auguste et de Cinna. Certes on y trouve la même façon de cristalliser le conflit des personnages et d’assurer la domination de l’un sur l’autre ; on y découvre aussi un goût pour l’imprévisibilité des paroles inachevées, la surprise qu’elles créent dans le cours du dialogue, les nouvelles orientations qui s’ouvrent aux personnages et font rêver à de possibles coups de théâtre.
Prendre la parole : le pouvoir de parler entre tyrans et résistants dans Héraclius
13Héraclius marque une nouvelle étape dans l’usage que Corneille fait des vers coupés pour trois raisons : d’une part, leur nombre augmente de manière significative (18 dans Rodogune, créée fin 1644, 31 dans Héraclius, joué pour la première fois deux ans plus tard) ; d’autre part, il invente une gradation dans la violence de l’interruption15 ; enfin, le dramaturge s’en sert pour construire les caractères. Plus que dans les pièces précédentes, couper la parole apparaît comme un trait distinctif de certains personnages, en lien avec leur rang et leurs passions. L’interruption les définit dans leur rapport à l’autorité à la fois en termes hiérarchiques (qui est autorisé à couper la parole à qui ?) et en termes pragmatiques (comment et à quelles fins interrompre les discours d’autrui ?). On voit alors apparaître des interruptions oppressives et d’autres légitimes qui dessinent des rapports au pouvoir différents. Corneille invente une manière dramatique, théâtrale, de faire parler les rois, non seulement par la « pompe des vers », mais aussi par la force des actes de discours, par des paroles qui claquent et foudroient, d’autant plus et d’autant mieux qu’elles tordent et disloquent les alexandrins.
14Très tôt dans la pièce, Corneille désigne l’interruption comme un comportement langagier caractéristique de Phocas (sept occurrences). Le tyran usurpateur coupe la parole à Pulchérie dès la scène 2 du premier acte, puis celle de son propre fils à la scène 316. Comme dans Cinna, l’interruption s’accompagne toujours d’un commentaire sur le propos interrompu, justifiant ainsi que l’on coupe la parole. Face à celui qu’il croit être son fils, pourtant élevé pour lui succéder, Phocas fait valoir son manque de sens politique. Plus souvent encore, les raisons convoquées par celui-ci déclarent l’inutilité, et pas seulement l’illégitimité, de la parole d’autrui. À plusieurs reprises, le tyran interrompt Héraclius et Pulchérie en déclarant que l’heure n’est pas à la parole mais à l’action (« J’ai prononcé l’arrêt, il faut que l’effet suive. » ou bien « Nous verrons à loisir, / Il est bon cependant de la faire saisir17. ») En interrompant le discours d’autrui, le tyran ne se contente pas de l’empêcher de parler : il nie la nécessité même de l’échange et se montre inaccessible au conseil. L’interruption sert à mettre en scène une façon solitaire, voire solipsiste, d’exercer le pouvoir.
15En elle-même, l’interruption n’est ni bonne ni mauvaise : c’est une force, liée au pouvoir de parler de certains personnages, force qui peut être légitime si elle vient d’une autorité authentiquement royale. Tel est le sens des interruptions de Pulchérie à l’acte I et à l’acte V qui coupe la parole à quatre reprises à Phocas et résiste ainsi à l’usurpateur en exerçant son pouvoir de prendre la parole. Dès les premières scènes, le personnage de Pulchérie est défini par sa capacité à s’élever contre Phocas : il n’est plus temps, dit-elle, de « [s]e défendre avec civilité », mais de « [s]e montr[er] entière à l’injuste fureur, » et de « parl[er] à [s]on tyran en fille d’empereur18 ». Suit alors une très longue tirade où elle ne cesse de le rabaisser et de le renvoyer à son origine misérable et à son usurpation. Alors que Phocas essaie de déconstruire l’argumentation de Pulchérie, la princesse lui coupe deux fois la parole pour rétablir les faits : « Va, je ne confonds point ses vertus et ton crime » et « Je sais qu’il est faux19 ; ». L’interruption vise à répondre à l’attaque et rappeler la vérité. Résister au tyran consiste moins à le faire taire qu’à ne pas le laisser dire le faux. À la différence de Phocas, cependant, le pouvoir que Pulchérie prend sur le discours du tyran naît de la légitimité de son autorité : elle peut parler, elle, « en fille d’empereur », ce que son attachement à la vérité atteste plus que tout.
16Qu’en est-il d’Héraclius qui est le seul personnage à couper la parole et à suspendre la sienne ? Il semble qu’avec lui, Corneille expérimente un autre rapport à ce pouvoir de parler qu’il met en scène à travers Phocas et Pulchérie, un rapport d’un autre ordre qui est moins dans l’effectivité du dire que dans la capacité de se retirer de la conversation et saisir l’occasion de se taire. Au cours de la scène la plus intense de la pièce, à l’acte V, lorsque le bourreau Octavian s’apprête à frapper Martian et qu’Héraclius est sommé de déclarer qui il est, Corneille fait enchaîner au personnage principal deux suspensions qui n’ont rien de vraiment pathétique :
Phocas
C’est trop perdre de temps à souffrir ces discours,
Dépêche, Octavian.
Héraclius
N’attente rien, barbare.
Je suis…
Phocas
Avoue enfin.
Héraclius
Je tremble, je m’égare,
Et mon cœur…
Phocas à Héraclius
Tu pourras à loisir y penser.
À Octavian.
Frappe.
Héraclius
Arrête, je suis… Puis-je le prononcer ?
Phocas
Achève, ou…
Héraclius
Je suis donc, s’il faut que je le die,
Ce qu’il faut que je sois, pour lui sauver la vie20.
17On peut analyser les deux suspensions d’Héraclius comme un temps de réflexion et de contrôle qui prépare ce que Corneille nomme avec satisfaction l’« équivoque ingénieuse », propre à tromper Phocas. On ne saurait réduire ici la suspension de la parole à l’expression de l’affect ; il conviendrait plutôt de la rapprocher de ce que fait Émilie à la fin de l’acte III : retenir la parole, justement parce que ce serait parler sous le coup de l’émotion, introduire un silence avant de passer à une révélation, quelle qu’elle soit – encore un de ces coups de théâtre du dialogue que Corneille affectionne. Ici, cependant, la suspension de la parole entretient un lien étroit avec le sujet de la pièce. Le prince caché qu’est Héraclius est aussi celui qui économise le discours, sait se taire ou jouer de l’équivoque quand il le faut. Le pouvoir de parler ne se résume donc pas dans la capacité du personnage à prendre la parole contre un autre, mais aussi, et peut-être plus profondément, à tenir sa parole, c’est-à-dire à saisir l’occasion de se taire. Il ne s’agit plus tant de force exercée sur les autres que de maîtrise de soi et de prudence, autant de qualités royales qui distinguent Héraclius de Phocas et Pulchérie.
Savoir se taire ? L’inquiétude du silence dans Suréna
18On a parfois vu dans Suréna une tragédie de l’inaction où le lyrisme prendrait une place inédite21. Pourtant, si l’on compte les très nombreux points de suspension de la pièce, Suréna se caractérise par la violence des interactions et montre que Corneille travaille plus que jamais la conflictualité entre les personnages. On ne compte pas moins de trente-neuf interruptions et dix-sept suspensions. Si le poète pousse certaines formes à l’extrême, deux éléments montrent que la dernière tragédie s’inscrit dans la continuité des recherches sur la désarticulation entre la parole et le vers. Comme on a pu le voir dans les autres pièces, interruptions et suspensions participent toujours de la construction d’un caractère de l’autorité puisqu’elles concernent les trois personnages de rang royal de la pièce : Eurydice au premier chef dont le rôle compte près de vingt-six interruptions et suspensions, Pacorus et Orode. Enfin, comme il l’avait déjà fait dans Cinna et Héraclius, Corneille exploite à nouveau les effets d’attente et de surprise que le vers inachevé peut produire sur le spectateur : il est remarquable que chaque acte de la pièce s’achève sur une interruption ou une suspension, qui fonctionne comme ce coup de théâtre langagier propre à foudroyer le spectateur. Autrement dit, dans Suréna, Corneille fait bien du Corneille, sans chercher à copier Racine, alors même que le nombre des suspensions de la parole, donc des silences, augmente.
19Telle est la principale nouveauté de la tragédie. Non seulement, les personnages s’arrêtent souvent de parler, bien plus que dans les pièces précédentes (Orode, deux fois ; Pacorus, quatre ; Eurydice, neuf fois), mais Corneille exploite une modalité spécifique de la suspension qui ne se laisse pas confondre avec l’aposiopèse. Certes, il y a bien des cas où la parole est suspendue parce que la passion empêche Eurydice de parler, au début et à la fin de la pièce22. Mais à bien y regarder, les suspensions pathétiques sont peu nombreuses. Souvent, Eurydice hésite à dire, ne veut pas dire, craint de trop en dire – autant de manifestations d’un contrôle de la volonté sur l’expression du sentiment. On pourrait ainsi faire un commentaire non pathétique de la dernière suspension de la pièce où le personnage résiste jusqu’au bout à donner son accord au mariage de Suréna et de Mandane :
Eurydice
Je n’y résiste plus, vous me le défendez.
Ormène vient à nous, et lui peut aller dire
Qu’il épouse… Achevez tandis que je soupire23.
20Si cette lecture est possible, c’est que Corneille a fait de l’aveu et du consentement l’enjeu de toute la pièce, conférant au silence, donc à la suspension de la parole, un rôle crucial. Deux lignes se croisent autour du personnage d’Eurydice : d’une part, pour Orode et Pacorus, il s’agit de découvrir le secret de la princesse et connaître le mystérieux objet de son amour, ce qu’elle refuse de dire et ce que ne veulent pas révéler Suréna et Palmis ; d’autre part, pour éviter la catastrophe, il faut qu’Eurydice dégage Suréna de sa foi pour que les mariages puissent se faire. D’un côté, Eurydice ne doit pas dire qui elle aime ; de l’autre, elle doit rompre avec celui qu’elle aime, ce qu’elle ne veut pas faire24. Garder le silence est donc la seule solution et toute la pièce repose sur la nécessité ou l’opportunité de parler ou de se taire, les personnages commentant sans cesse ce qu’ils disent en termes d’excès ou de manque d’informations25. Si l’on a pu trouver qu’il ne se passe rien dans Suréna, l’impression d’inaction et la déception que cela peut produire viennent sans doute du fait que tout tourne autour de ces silences qu’il faut, selon les personnages, maintenir ou briser.
21Puisque l’enjeu dans la pièce est de taire ou de faire avouer un secret, la suspension de la parole relève souvent d’un rapport de force entre deux personnages. Elle a à voir avec ce pouvoir de parler que Corneille met en scène dans ses pièces précédentes et qui devient ici le pouvoir de se taire. Le silence est une arme en ce qu’il dessine des sous-entendus, crée un implicite vague et inquiétant, propre à affaiblir l’interlocuteur. Il s’agit alors de suspendre sa parole au bon moment : il faut ne pas trop en dire, ou en dire juste assez pour que le silence se fasse menace. La suspension de la parole a bien à voir avec la force, peut-être plus terrifiante encore que l’interruption en ce qu’elle n’est que pressentie, invisible et, pourtant, présente. Orode, Pacorus et Eurydice font de la menace voilée leur arme privilégiée, qui passe toujours par une parole que l’on arrête au moment opportun. Ainsi le roi et le prince font pression sur Suréna et Palmis en laissant entendre sans les expliciter ce que pourraient être leurs intentions26. Mais ce sont surtout Pacorus et Eurydice qui utilisent entre eux la suspension de la parole avec le plus de cruauté. Clôturant une scène qui ne cesse de commenter l’aveu et le silence, Corneille donne à Eurydice la première menace voilée de la pièce :
Pacorus
À ces bontés, madame, ajoutez une grâce,
Et du moins attendant que cette ardeur se passe,
Apprenez-moi le nom de cet heureux amant
Qui sur tant de vertu règne si puissamment,
Par quelles qualités il a pu la surprendre.
Eurydice
Ne me pressez point tant, seigneur, de vous l’apprendre.
Si je vous l’avais dit…
Pacorus
Achevons.
Eurydice
Dès demain
Rien ne m’empêcherait de lui donner la main.
Pacorus
Il est donc en ces lieux, madame ?
Eurydice
Il y peut être,
Seigneur, si déguisé qu’on ne le peut connaître.
Peut-être en domestique est-il auprès de moi,
Peut-être s’est-il mis de la maison du roi,
Peut-être chez vous-même il s’est réduit à feindre :
Craignez-le dans tous ceux que vous ne daignez craindre,
Dans tous les inconnus que vous aurez à voir,
Et plus que tout encor, craignez de trop savoir.
J’en dis trop, il est temps que ce discours finisse,
À Palmis que je vois rendez plus de justice,
Et puissent de nouveau ses attraits vous charmer,
Jusqu’à ce que le temps m’apprenne à vous aimer27.
22La princesse ne dévoile pas le nom de l’amant mais laisse entendre sa présence à la cour ; elle glose ce que doit alors ressentir Pacorus : le soupçon, la crainte, l’inquiétude tenace de la jalousie. En guise de réplique, le prince emploie une arme similaire à l’acte IV, lors de sa seconde entrevue avec Eurydice :
Eurydice
Est-ce pour moi, seigneur, qu’on fait garde à vos portes ?
Pour assurer ma fuite ai-je ici des escortes ?
Ou si ce grand hymen pour ses derniers apprêts…
Pacorus
Madame, ainsi que vous chacun a ses secrets.
Ceux que vous honorez de votre confidence
Observent par votre ordre un généreux silence,
Le roi suit votre exemple, et si c’est vous gêner,
Comme nous devinons, vous pouvez deviner.
Eurydice
Qui devine est souvent sujet à se méprendre.
Pacorus
Si je devine mal, je sais à qui m’en prendre,
Et comme votre amour n’est que trop évident,
Si je n’en sais l’objet, j’en sais le confident.
Il est le plus coupable : un amant peut se taire,
Mais d’un sujet au roi, c’est crime qu’un mystère.
Qui connaît un obstacle au bonheur de l’État,
Tant qu’il le tient caché, commet un attentat.
Ainsi ce confident… vous m’entendez, madame,
Et je vois dans les yeux ce qui se passe en l’âme28.
23À la différence de la princesse, la suspension de la parole n’est pas seulement une manière de contraindre le personnage et de le dominer en instillant la crainte d’une catastrophe à venir ; elle sert aussi d’épreuve. Pacorus observe comment Eurydice réagit à la menace et en conclut qu’il a bien deviné son secret et trouvé le mystérieux amant. Autrement dit, les paroles suspendues de Suréna ne fonctionnent pas comme des signes pathétiques, des symptômes d’une affectivité indicible, mais comme des actes, des armes, des pièges tendus à l’interlocuteur. Dans la dernière tragédie, la suspension obéit aux mêmes finalités de domination que l’interruption que Corneille avait privilégiée au début de sa carrière.
L’énergie d’un acteur qui prend la parole
24L’étude de ces paroles inachevées apporte des éléments de réponse à la question posée par Larthomas sur la nature du vers dramatique. Le vers de Corneille peut être dit dramatique en ce que les actions du discours travaillent la matière de l’alexandrin, en particulier lorsque son cours est brisé par l’interruption ou la suspension de la parole. Il est d’autant plus dramatique chez Corneille que ces actions répondent peu souvent à un principe de rapidité ou d’économie dans le rythme de la scène29. Au contraire, parce qu’elles mettent en jeu la capacité des personnages à dominer l’échange, interruptions et suspensions participent de la représentation des rapports de force éthiques et politiques et de la construction des caractères royaux autrement que par la « pompe » du vers. Enfin, ce vers peut être qualifié de dramatique parce que le dramaturge s’en sert pour créer certains effets de surprise ou d’attente chez son auditoire au point que l’on pourrait appliquer aux vers interrompus et suspendus l’expression de « picoteries » que Corneille emploie dans une lettre à l’abbé de Pure pour évoquer les pointes de Cinna30.
25Ces vers coupés font entendre une musique bien différente, plus sèche, plus abrupte, plus saccadée que celle que l’on imagine d’ordinaire pour les alexandrins cornéliens : ils n’ont pas la noblesse, la liaison, l’élévation qu’attend Grimarest de la déclamation du théâtre de Corneille. Ils ont pourtant à voir avec ce sublime des paroles ramassées et des coups d’éclat qui caractérise aussi son œuvre. Les interruptions sont tout à la fois des coups et des éclats de voix, que l’on pourrait rapprocher du « Qu’il mourût. » du vieil Horace ou du « Va, je ne te hais point. » de Chimène. Pics d’intensité sonore ou trouées de silence, interruptions et suspensions donnent accès à la théâtralité de l’œuvre de Corneille et, sans doute, à ce que celui-ci aime au théâtre. En effet, elles supposent une vocalité et une incarnation particulières, plus physiques, plus nerveuses qu’à l’ordinaire. Elles chargent la diction d’une corporéité qui transparaît dans l’attaque du discours, la prise d’air avant de parler, la force d’un accent ou, au contraire, l’effacement des mots dans le souffle d’un soupir ou le hoquet des larmes, la densité, enfin, d’un silence menaçant. Toute cette matière sonore que l’on entend dans la suspension ou l’interruption force l’écoute des spectateurs et attire leur attention sur la relation de l’acteur à la parole et à l’acte de dire. Car pour le comédien aussi, le vers interrompu ou suspendu renvoie à son propre pouvoir de parler, à la fois dans son engagement intérieur (puisqu’il faut trouver en soi la force de prendre la parole ou de se taire) et dans la relation à son partenaire (puisqu’il faut soutenir son regard, dresser son corps face à lui ou au contraire lui céder le pas). Autrement dit, le vers coupé rend plus dense et plus intense la présence des comédiens sur scène, l’espace entre eux, le lien entre eux. Je verrais volontiers dans la multiplication des interruptions et des suspensions un aveu de ce qu’aime Corneille au théâtre : l’énergie d’un acteur qui se tient face à un autre et qui prend la parole.
1 Alain Riffaud, La Ponctuation du théâtre imprimé au xviie siècle, Genève, Droz, « Travaux du Grand Siècle », no XXX, 2007, p. 177-196.
2 Grimarest, Traité du récitatif dans la lecture, dans l’action publique, dans la déclamation et dans le chant, à Paris, chez Jacques LeFevre et Pierre Ribou, 1707, p. 68.
3 Je remercie chaleureusement Myriam Dufour-Maître de m’avoir incité à suivre le chemin de ces points de suspension chez Corneille. Voir en particulier Myriam Dufour-Maître, « La voix de l’admiration : le théâtre du “vieux Corneille” et l’éclat du public » dans La Voix du public en France aux xviie et xviiie siècles, dir. Julia Gros de Gasquet et Sarah Nancy, Rennes, PUR, 2019, p. 133-143.
4 « Au contraire, l’intérêt de ces signes typographiques n’a pas échappé à Pierre Corneille qui les adopta dès 1639 pour L’Illusion comique et Médée : l’imprimeur Nicolas Gasse qui n’avait rien noté de tel dans Le Cid, et malgré son manque de soin, les reporta dans les deux pièces de 1639. De même avec Horace en 1641, puis Cinna en 1643, première pièce qui sortit des presses rouennaises de Laurent Maurry. Aucun imprimeur normand, à notre connaissance, n’avait employé jusque-là les points de suspension dans l’impression du théâtre, preuve que le modèle vient de Paris et que l’initiative en revient à l’auteur. » Alain Riffaud, op. cit., p. 192.
5 On comparera ces résultats au décompte réalisé par Michael Hawcroft dans son article : « Points de suspension chez Racine : enjeux dramatiques, enjeux éditoriaux », Revue d’Histoire Littéraire de la France, no 106, 2006, p. 307-335.
6 Grimarest, op. cit., p. 89-90. Nous soulignons.
7 Pierre Corneille, Cinna, acte V, sc. 1, v. 1476. Les trois tragédies étudiées ici sont citées dans l’édition de Georges Couton pour la collection Bibliothèque de la Pléiade. Voir Pierre Corneille, Œuvres complètes, éd. G. Couton, 3 vol., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980-1987.
8 Ibid., v. 1477-1478.
9 « Prête sans me troubler l’oreille à mes discours / D’aucun mot, d’aucun cri n’en interromps le cours, / Tiens ta langue captive, et si ce grand silence / À ton émotion fait quelque violence, / Tu pourras me répondre après tout à loisir, / Sur ce point seulement contente mon désir. […] / Qu’il te souvienne de garder ta parole, et je tiendrai la mienne. » (Ibid., v. 1427-1434) « Tenir » ou « garder sa parole » sont des expressions polysémiques, préparées par « tenir [s]a langue captive ».
10 Ibid., v. 1541.
11 Sur ce point, voir les pages que Jacques Scherer consacre à la stichomythie (Jacques Scherer, La Dramaturgie classique, Paris, Nizet, s. d., p. 302 sqq.) et ici-même l’article de Michèle Rosellini consacré aux vers stichomythiques dans les comédies de Corneille. En un sens, la découverte des possibilités de l’interruption et de la suspension offre au poète un prolongement dans ses recherches d’une violence dialogique.
12 Pierre Corneille, Cinna, acte III, sc. 4, v. 917-922.
13 Ibid., v. 931-932.
14 Ibid., acte III, sc. 5, v. 1069-1076.
15 Tout dépend de l’endroit où elle intervient et qui est marqué par les points de suspension : elle peut arriver après une rime complète, elle peut couper la rime qui se trouve achevée dans la prise de parole de l’interlocuteur, elle peut couper le vers lui-même. Il existe ainsi des nuances dans l’agressivité de l’interruption.
16 Héraclius, acte I, sc. 2, v. 190 et sc. 3, v. 273, 292, 296, 304.
17 Ibid., acte I, sc. 3, v. 305 et acte IV, sc. 2, v. 1201-1202.
18 Ibid., acte I, sc. 2, v. 115-116.
19 Ibid., v. 206 et 239.
20 Ibid., acte V, sc. 3, v. 1702-1708. On appréciera aussi l’entremêlement des suspensions et des interruptions (Phocas à l’évocation du cœur ; Héraclius au moment de la révélation équivoque).
21 Voir par exemple le commentaire de Jacques Scherer : « Mais quand tout est dit, il faut mourir. Le drame sentimental et le drame politique convergent vers la même solution. Que Suréna soit tué par le roi ou qu’il meure de désespoir pour avoir accepté un mariage dynastique, la mort est au bout de toutes les avenues. Dans les tragédies d’un Corneille plus jeune, elle n’était qu’une menace, parfois écartée. Elle est maintenant inéluctable. Aussi la tragédie, dès son premier acte, est-elle un hymne funèbre. Les personnages ne luttent plus. Ils chantent l’acceptation de la mort. Il est évident qu’une conception si radicale ensevelit la tragédie sous sa propre ruine. » Jacques Scherer, Le Théâtre de Pierre Corneille, Paris, Nizet, 1984, p. 131.
22 Voir par exemple, ces deux suspensions successives d’Eurydice à la fin de la première scène : « S’il la voit, s’il lui parle, et si le roi le veut… / J’en dis trop, et déjà tout mon cœur qui s’émeut… » (Suréna, acte I, sc. 1, v. 119-120). Seule la seconde suspension est de nature pathétique ; la première correspond à un refus de dire.
23 Ibid., acte V, sc. 5, v. 1708-1710.
24 Jacques Scherer avait bien perçu le blocage de la parole dans la pièce : « Comme Phèdre un peu plus tard, Suréna démontre la nocivité du langage. Mais se taire n’est pas une meilleure solution que parler, et Suréna meurt parce qu’il ne dit rien. » Jacques Scherer, Le Théâtre de Pierre Corneille, op. cit., p. 131.
25 À plusieurs reprises, les personnages signalent qu’ils en disent trop ou, à l’inverse, juste assez pour être compris sans qu’il soit besoin de dire (Eurydice : « J’en dis trop et déjà tout mon cœur qui s’émeut… » ; « J’en dis trop, il est temps que ce discours finisse » v. 581 ; Pacorus : « Adieu, ce mot suffit, et vous devez m’entendre » v. 1377 ; ou encore, Eurydice : « Vous m’entendez, seigneur, et c’est vous dire assez », v. 1207).
26 Voir la fin de la scène 3 de l’acte III entre Orode et Palmis. La suspension du roi (v. 1051) est commentée par Palmis dans un vers qui pourrait s’appliquer à la pièce entière : « Et que ne me dit point cette menace obscure ! » (v. 1054). Voir aussi la fin de la scène 4 de l’acte IV entre Pacorus et Suréna, en particulier les vers 1376-1377 cités plus haut.
27 Ibid., acte II, sc. 2, v. 565-584.
28 Ibid., acte IV, sc. 3, v. 1161-1178.
29 Ce sont les principales raisons que P. Larthomas donne à la présence des interruptions ou des suspensions dans la parole dramatique. Voir Alain Riffaud, La Ponctuation du théâtre imprimé au xviie siècle, Genève, Droz, 2007, p. 219-223.
30 « Les vers de ceux-ci [Cinna et Maxime] me semblent bien aussi forts et plus pointilleux, ce qui aide souvent au théâtre où les picoteries soutiennent et réveillent l’attention de l’auditeur. » Pierre Corneille, lettre à l’abbé de Pure du 3 novembre 1661, dans Œuvres complètes, t. III, op. cit., p. 9.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/997.html.
Quelques mots à propos de : Fabien Cavaillé
Université de Caen Normandie – LASLAR EA 4256
Fabien Cavaillé est maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Caen Normandie. Spécialiste des théâtres de ville français entre les guerres de religion et la Fronde, il travaille sur la dimension émotionnelle des représentations (dramaturgie, réception), et plus largement sur les témoignages et les formes de l’expérience spectaculaire à l’époque moderne. Parmi ses publications récentes : Alexandre Hardy et le théâtre de ville français au début du xviie siècle, Garnier, 2016 ; Récits de spectateur. Raconter le spectacle, modéliser l’expérience, PUR, 2018 (volume co-dirigé avec C. Lechevalier).
