Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
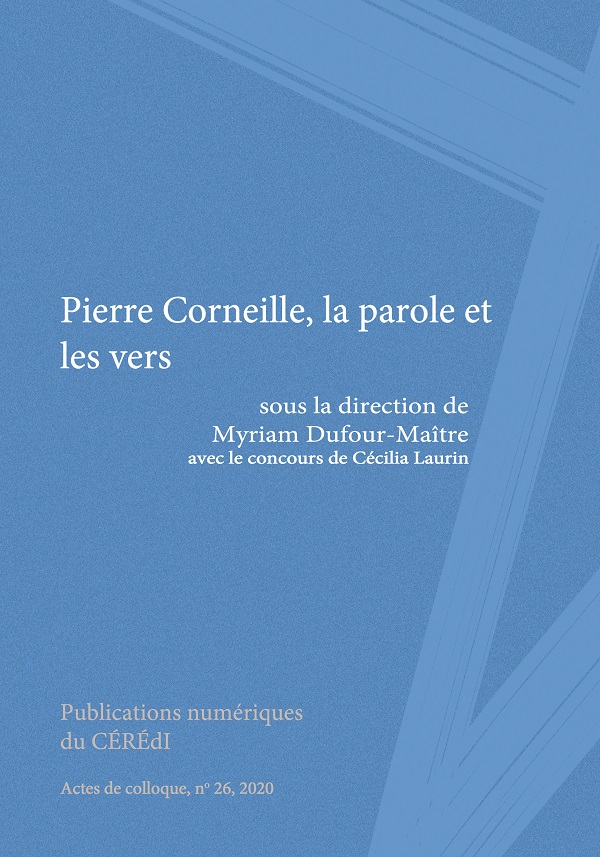
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Matrices et formes-sens
« Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
Jean-Yves Vialleton
La présence dans le théâtre classique de vers romantiques avant la lettre a longtemps préoccupé les études. Aujourd’hui, cette question semble obsolète. Elle ne relève pourtant pas du tout de l’anachronisme. En outre, elle a l’intérêt de faire voir que la pensée du vers chez Corneille ne peut se comprendre hors d’un cadre rhétorique. Enfin, elle est au cœur des réflexions les plus actuelles sur la diction du vers de théâtre, réflexions qui se dessinent en fait dès le xviie siècle.
1Quelques pièces de Corneille illustrent le fameux départ « en falaise » qui selon Péguy donne « la frappe d’entrée des grandes œuvres classiques », avec un premier vers qui crée « instantanément le climat qu’il s’agit de créer1 ». La première scène de Cinna (« Impatients désirs d’une illustre vengeance… ») tout en remplissant parfaitement sa fonction d’exposition nous plonge d’emblée dans une orageuse délibération d’Émilie. Cette entame est d’autant plus significative que Corneille dans sa première tragédie, Médée, avait refusé une ouverture par un monologue de haut style. Tout en recourant à un prestigieux sujet sénéquéen, il y avait voulu rompre avec l’écriture sénéquéenne de l’autre siècle en utilisant une exposition empruntée à la tradition comique, le dialogue avec un personnage absent du reste de la pièce, ce que Donat à propos de Térence appelle le personnage protatique2. Médée commence par une conversation naturelle et vivante entre amis qui se retrouvent et s’informent de la situation, début analogue à celui par exemple de La Suite du Menteur, selon un procédé que Racine reprendra au début d’Andromaque. Ce qui frappe en fait dans le théâtre de Corneille, c’est moins le début « en falaise » que l’extrême diversité des ouvertures. Cette diversité est d’autant plus remarquable que pour la clôture des pièces se discernent facilement des types récurrents, par exemple la rupture humoristique de l’illusion3, l’ouverture vers le futur4, ou encore le procédé du « Allons » (c’est-à-dire d’une invitation faite par un des personnages, dans les derniers vers, à quitter le lieu de la scène pour accomplir une tâche parachevant le dénouement, rite funèbre ou mariage5). Une des ouvertures les plus déroutantes est peut-être celle d’Attila :
Ils ne sont pas venus, nos deux Rois ? qu’on leur die
Qu’ils se font trop attendre, et qu’Attila s’ennuie,
Qu’alors que je les mande ils doivent se hâter6.
2Le vers d’attaque se signale par sa trivialité et par de fortes discordances entre la structure métrique et la syntaxe. L’analyse traditionnelle y repère un rejet à la césure et un contre-rejet en fin de vers. Ce vers pourrait entrer dans le relevé par lequel Louis Herland a fini son beau livre sur Corneille, celui des vers de Corneille qui ne sont pas « cornéliens7 ». Pour illustrer l’« étonnante variété des styles de Corneille », Louis Herland avec humour relevait dans le théâtre de celui-ci des vers de « Racine avant Racine », de la « poésie philosophique dans le goût de Voltaire », du « romantisme à la Hernani », de « Hugo deuxième manière », de Musset, et même de Péguy, d’Aragon ou de Meilhac et Halévy. Le premier vers d’Attila pourrait facilement illustrer le « romantisme » de Corneille : il est en effet ce qu’au xixe siècle on a théorisé sous le nom de « vers brisé ». La théorie du « vers brisé » est aujourd’hui délaissée, voir jugée anachronique. Elle pose cependant des problèmes intéressants, touchant notamment la question de la diction.
La notion romantique de « vers brisé »
3C’est à un poète romantique « mineur » à la biographie étrange8 qu’on doit la première théorisation du vers romantique, Wilhelm Ténint (1817-1879), auteur de la Prosodie de l’école moderne, paru en 18449. L’ouvrage s’ouvre par une lettre élogieuse de Victor Hugo datée de mai 1843 :
Vous expliquez à tous ce que c’est que le vers moderne, ce fameux vers brisé, qu’on a pris pour la négation de l’art, et qui en est au contraire le complément. Le vers brisé a mille ressources, aussi a-t-il milles secrets. […] Vous démontrez qu’il y a une foule de règles, dans cette prétendue violation des règles10.
4Théophile Gautier fait un compte rendu du livre11 qui fait comprendre que Ténint emprunte l’expression de « vers brisé » aux ennemis des romantiques :
L’on se souvient de toutes les agréables plaisanteries débitées dans le temps sur les vers brisés ou cassés, comme disaient les classiques, avec leur aimable atticisme ; l’idée que les vers romantiques ne sont que de la prose plus ou moins rimée est encore restée à plusieurs esprits judicieux sur d’autres points, lesquels s’imaginent que le vers droit, à période carrée, est beaucoup plus difficile que le vers moderne.
5Gautier rappelle la modernité en leur temps des classiques : par son goût du « roman » et du « jargon du jour », « Racine, loin d’être un classique, est au contraire un novateur, un romantique dans la force du terme12 ». Il assimile ainsi le classicisme des antiromantiques à un postclassicisme décadent : « À partir de Racine, les secrets de la versification se perdent, la science des coupes disparaît13 […]. »
6L’idée centrale de Ténint, développée dans le chapitre iii, est que, outre l’alexandrin avec une « césure du milieu », le « vers césuré », « intact » (6 | 6), on peut aussi user du « vers brisé », en plaçant ailleurs la césure. Il inventorie systématiquement les possibilités : 1 | 11, 2 | 10, etc. jusqu’à 11 | 114, ce qui donne douze types d’alexandrins, en y incluant le vers à double césure (trois séquences de quatre syllabes, ce qu’on appellera plus tard le « trimètre romantique »). Il illustre chaque type par des exemples pris à des poètes romantiques contemporains (Deschamps, qui signe la préface du livre, Hugo, Gautier, Vigny, Nodier, Lamartine), mais aussi à des classiques : Corneille, et surtout Molière, Racine et La Fontaine. Ainsi le vers 1 | 11, dont Ténint reconnaît qu’il est « très rare », est illustré par un exemple pris à Marion Delorme, mais aussi par un autre pris à Cinna : « Ciel, à qui voulez-vous désormais que je fie15 », le 2 | 10 par ce vers du Cid : « Ma fille, il ne faut point rougir d’un si beau feu16 ».
7Nombreux sont les ouvrages universitaires du xixe siècle qui essaient de rendre compte du vers brisé, même s’ils ne reprennent pas l’expression. Ils le font en s’appuyant soit sur la théorie des accents du vers soit sur la notion de discordance métrique, deux approches devenues aujourd’hui courantes dans les analyses scolaires du vers (même si des études linguistiques ont remis récemment en question la première17).
8C’est, on le sait, Louis Quicherat (1799-1884), grand latiniste, auteur en particulier d’un dictionnaire latin-français longtemps utilisé, qui impose l’analyse accentuelle du vers français. Énoncée dès 1826 dans un traité de versification latine, sa théorie est développée dans son Traité de versification française (185018) et vulgarisée dans un Petit traité souvent réédité19. C’est cette théorie qui lui permet de rendre compte des vers brisés, qu’il appelle alexandrins « mal cadencés20 ». L’alexandrin a deux accents nécessaires, accent de fin de vers et accent médian sur la sixième syllabe, et un accent « secondaire » de place variable dans chacun des hémistiches. On a un vers « mal cadencé » quand l’accent final ou médian est trop peu marqué, quand il y a plus ou moins de quatre accents ou quand deux accents se suivent immédiatement. Pour le premier cas, Quicherat note que ce manque d’harmonie peut-être recherché par le poète : dans le vers où « le repos à l’hémistiche n’est pas […] le repos le plus marqué », « le poëte évite la monotonie en arrêtant la prononciation après deux, trois ou quatre syllabes » ; il peut aussi par là chercher à « produire quelque effet d’harmonie imitative21 ». Pour le deuxième cas, un accent secondaire peut manquer à cause de l’usage d’un mot long (même s’il arrive que l’on donne deux accents à ce mot long) : « Tout ce que l’autre avait par inclination22 », ou à cause d’une suite de e muets numéraires : « Vous le mieux révéler, qu’il ne me le révèle23 ! ». Pour le troisième cas, Quicherat donne comme exemple : « Je suis Romaine, hélas ! puisque mon époux l’est24. » Le vers est blâmable selon lui non parce que « époux l’est » est prosaïque, comme le croyait Voltaire, mais parce que « l’est » « détaché et finissant la phrase détruit toute l’harmonie25 ».
9L’analyse en terme de « concordance ou discordance entre vers et syntaxe », de « décalages syntactico-métriques », est aujourd’hui dominante (même si ces termes introduisent une confusion : le mot syntaxe invite à considérer les groupes fonctionnels, alors que sont en réalité en jeu les groupes prosodiques26). Elle est illustrée par la grande étude sur la versification française du xviie siècle publiée en 1893 par Maurice Souriau27. Souriau y appelle le vers brisé « vers amorphe » et introduit la notion de « césure grammaticale ». Quand celle-ci est plus forte que la césure du vers, une partie du vers est un membre de plus de six syllabes et le vers est « amorphe ». Un chapitre du livre est consacré à Corneille28. Souriau y affirme qu’« en laissant de côté quelques exceptions très rares, on peut dire que c’est du Malherbe29 ». Il ne fait commencer l’« assouplissement » du vers qu’avec Racine. Chez Corneille, selon lui, se trouvent peu de vers mal césurés et le plus grand nombre sont des trimètres (l’exemple donné est : « Voyez le Roi, | voyez Cotys, | voyez mon père30 »). Mais il y a des vers « amorphes31 » : « Ah ! grands Dieux ! que je suis plein de confusion32 ! », ou « La vaillance, et l’honneur de son temps ? le sais-tu33 ? » Dans l’analyse de Ténint, il s’agirait de 3 | 9 et de 9 | 3.
10Dans certains vers, Souriau note que c’est la nécessité de ne pas nuire à la compréhension qui impose un vers amorphe :
Il y a dans Corneille, comme dans tous les grands poètes du xviie siècle, des césures grammaticales, supérieures à toutes théories de l’hémistiche, parce que, en suivant cette théorie, on perdrait la clarté de la pensée, comme dans les exemples suivants où le vers devient obscur si on le coupe en deux parties égales, et très clair si l’on déplace la césure34.
11Les exemples donnés par Souriau sont hétérogènes35. Certains sont contestables : « Ma passion | en est la cause, | et non l’effet36 », d’autres sont plus convaincants, par la cohésion d’un groupe syntaxique : « Oubliant | le respect du sexe, et tout devoir37 », ou par la nécessité de faire comprendre le vers malgré une inversion poétique : « Mon visage | du vôtre emprunte les couleurs38 », ou « Mon Royaume | d’argent, et d’hommes affoibli39 », nécessité qui apparaît comme évidente dans un vers comme « La Reine, | de l’Égypte a rappelé nos Princes40 ».
Le vers brisé classique existe-t-il ?
12Dans le champ des études actuelles, la question du vers brisé classique est plus ou moins abandonnée, pour deux raisons.
13La première est que le point de vue sur l’histoire de la versification s’est déplacé. À l’époque romantique, on fait de l’« école de l’Empire » et de l’« école de la Restauration » les deux grandes époques, Chénier apparaissant comme un précurseur. Plus tard, ces époques deviennent celles du classicisme et du romantisme, avec comme tournant la proclamation de la « dislocation » de l’alexandrin par Hugo. Aujourd’hui l’opposition cruciale est celle entre la tradition et la modernité de la fin du xixe siècle. Le vers romantique est rangé du côté de la tradition et l’événement crucial est constitué par les transgressions métriques de Verlaine et Rimbaud (césure en milieu de mot par exemple) préparant la « crise de vers » et l’obsolescence de toute la poésie en vers réguliers, ce que Jacques Roubaud appelle « l’assassinat de l’alexandrin dans les années 1870-188041 ».
14À cette première raison s’en ajoute une seconde. L’existence du vers brisé est carrément niée : « À des rares exceptions près (les genres poétiques mineurs, en général dans des contextes où la discordance est un trait comique), la poésie classique, de la Renaissance au xixe siècle, ne semble pas contenir de discordances aussi énergiques que celles qui précède, voire aucune42. »
15L’analyse de certains vers classique comme vers brisés serait l’effet d’une illusion rétrospective, d’une lecture anachronique due à une fausse « perception syntaxique » des « énoncés et de leur segmentation » dans l’ancienne langue43. Cette deuxième raison semble toute différente de la première, mais lui est en fait liée : c’est le changement du scénario de l’histoire du vers qui rend peu sensible au vers brisé classique. Un des arguments de ce point de vue est la lecture des traités de versification anciens, pour lesquels l’importance de la césure est une évidence. Mais, quand Ténint théorise le vers brisé, et alors même qu’il admet des alexandrins en 5 | 744, il ne remet pas en question la structure de l’alexandrin. Dans une remarque à la fin du chapitre cité45, il note que la « césure du milieu » est certes « souvent supprimée », mais qu’« il en reste toujours quelque chose, ou du moins il faut que le premier hémistiche se termine par un son plein », « complet comme son, sinon comme sens » et rappelle l’impossibilité d’un e en sixième position. On déplace la césure du vers, mais on « tient encore compte de sa césure primitive ».
16En réalité, les jeux de discordance ne sont pas rares dans la poésie classique : les déclarations de Boileau prônant la parfaite concordance dans l’Art poétique n’empêchent pas bien des fantaisies dans ses Satires et ses Épîtres. D’ailleurs, l’idéal classique de transparence de l’expression n’empêche pas la vive conscience de la poéticité qui résulte des écarts du vers par rapport à la prose, comme on le voit par le goût pour les inversions poétiques46. Quand on rit du maître de philosophie du Bourgeois gentilhomme, ce n’est pas parce que « d’amour mourir me font » est du galimatias, mais parce que c’est l’utilisation dans un billet en prose d’une construction qui n’est possible que dans les vers. Il y a ici la même confusion d’ordres carnavalesque que lorsque Toinette veut mutiler Argan d’un de ses bras ou d’un de ses yeux pour fortifier le reste du corps, appliquant au règne animal des règles valant pour l’ordre du végétal (la taille).
17Souriau explique certains enjambements hardis de Corneille par la « facilité47 ». Il est cependant difficile d’admettre l’explication pour le tout premier vers d’une tragédie, comme c’est le cas dans Attila. Mais Souriau mentionne lui-même un texte qui permet de mieux comprendre ce qu’il en est du vers brisé au xviie siècle48. Dans les Observations sur le Cid, Scudéry, dans la partie qu’il consacre à la « versification », c’est-à-dire à la critique des « méchants vers » de la pièce, ne parle pratiquement pas de la versification49 : les critiques portent en fait plutôt sur la langue et sont souvent d’ordre lexical. Une remarque de versification est cependant faite à propos du vers : « Parlez-en mieux, le roi fait honneur à votre âge50. » Il s’agit d’un vers brisé 4 | 8 dans l’analyse de Ténint, d’un vers où sont « contrariés d’une manière désagréable les accents de la prose » dans l’analyse de Quicherat, d’un « vers amorphe » dans l’analyse de Souriau. Scudéry indique quant à lui : « La césure manque à ce vers. » Corneille répond ou fait répondre : « Vous avez épluché les vers de ma pièce jusques à en accuser un de manque de cezure : Si vous eussiez sceu les termes du mestier dont vous vous meslez, vous eussiez dit qu’il manquoit de repos en l’Émistiche51 ». L’Académie tranche ainsi : « L’Observateur a repris ce vers avec trop de rigueur, pour avoir la cesure mauvaise, car cela se souffre quelquefois aux vers de theâtre, et mesme en quelques lieux, a de la grace dans les interlocutions, pourveu qu’on en use rarement52. »
18Ces textes doivent ici être lus de près, ce sont de précieux documents sur la pensée du vers au xviie siècle.
19Corneille reproche à Scudéry de confondre césure et repos à l’hémistiche. Le mot césure désigne aujourd’hui la coupe principale du vers après la sixième syllabe, et il pouvait être employé ainsi déjà au xviie siècle (en conformité avec l’étymologie, coupure53) ; mais dans son sens le plus répandu et qui était considéré comme son vrai sens depuis le xve siècle, il désignait la sixième syllabe elle-même, comme l’a bien mis en évidence Georges Lote54. En toute rigueur, Scudéry ne peut donc pas dire que manque la césure, c’est-à-dire la sixième syllabe, mais que manque la possibilité d’une pause après la césure, que la sixième syllabe ne peut servir de point d’appui au vers. Prévaut donc ici une conception dynamique du vers (proche de celle promue par le formaliste russe Tynianov55) plutôt qu’une conception spatiale (qui domine aujourd’hui, ce que montre la définition de la césure comme « coupe » ou comme « frontière rythmique56 »). Une image classique courante pour parler du vers est d’ailleurs celle de la marche, présente dans de nombreux textes. Les alexandrins « march[e]nt, s’il faut ainsi dire, avec plus de train, et plus de pompe que les autres » (Vaugelas57), « il faut que les vers ne marchent pas toujours deux à deux » (Voltaire58), etc. Déjà, quand Ronsard impose le mot enjambement (pour désigner d’ailleurs plutôt le rejet), il joue sur l’image de la marche interrompue par un saut59.
20Le jugement de l’Académie est lui aussi riche de signification. Il montre d’abord qu’elle ne blâme pas le vers brisé. Quand elle condamne cet autre vers brisé « Cet hyménée à trois également importe », c’est seulement par le risque de burlesque involontaire : « Ce vers est mal tourné, et à trois apres hyménée, dans le repos du vers, fait un fort mauvais effect60. ». Ensuite, ce jugement assure de la conscience d’une spécificité du vers dramatique. Il accorde même une valeur esthétique au vers brisé dans les « interlocutions ». Le mot ne semble pas désigner ici de façon générale les vers dialogués (sinon il serait synonyme de « vers au théâtre »), mais les passages où le vers est éclaté en plusieurs répliques, peut-être encore plus particulièrement lorsqu’un personnage en interrompt un autre. Il s’agit en somme de parler de ce que Sorel nommera les « vers démembrés », qui « délasse[nt] l’esprit des Auditeurs après de longues traites [= tirades]61 ». De fait, on pourrait relever dans le théâtre classique des fragmentations de l’alexandrin en y appliquant la grille de Ténint : vers découpé par le changement d’interlocuteur en 6 | 6 (« Vous en savez beaucoup. – Je sais comme il faut vivre62 »), mais aussi en 1 | 11 (« Seuls ? – Seuls, et qui semblaient tout bas se quereller63. » ; « Le… – Ne réplique point, je connais ton amour64 »), 2 | 10 (« Hélas ! – Que cet hélas a de peine à sortir65 »), etc. Dans Sophonisbe, on trouve deux 8 | 4 rimant et avec une construction identique, formant ce beau passage :
– Mais Seigneur, m’aimez-vous encor ?
– Si je vous aime ?
– Oui, m’aimez-vous encore, Seigneur ?
– Plus que moi-même66.
21Il faudrait y ajouter les cas où le même alexandrin est coupé en trois, quatre, voire cinq répliques (« Hé bien ! – Si… – Taisez-vous. (À Exupère) Depuis quand ? – Tout à l’heure67. »). Ces cas ne manquent pas de fournir des exemples de vers à double césure selon Ténint (« Et je le garde… – À qui, Carlos ? – À mon vainqueur68. »). On va jusqu’à trouver des vers chevauchant deux scènes (« Adieu. – Madame, enfin une vertu parfaite69… »). Resterait à déterminer si, dans les découpages non médians, la pause à l’hémistiche en est affaiblie ou au contraire renforcée avec soulignement du mot en début de second hémistiche. Quand c’est un appellatif qui fait enjamber à la césure (« Quel énigme est-ce ici, Madame ? – Sa grande âme70 »), l’effet de soulignement est rendu probable par comparaison avec ces nombreux vers dramatiques où l’appellatif est en rejet sur le vers suivant. L’effet de démembrement est parfois renforcé par des rejets :
– Son Amant en a-t-il plus de droit que son frère,
Prince ?
– Je vous en plains et ne puis concevoir,
Seigneur…
– La vérité ne se fait que trop voir71.
22Que le traitement du vers fragmenté est le même que le vers non fragmenté est en tout cas évident par le fait qu’un e reste numéraire en fin de réplique quand celle-ci ne correspond pas à la fin du vers (« Parle. / Ce n’est point lui, mais il vit en ces lieux72. »), y compris quand une indication scénique implique une pause entre les deux répliques, comme cela arrive dans Œdipe73.
23Mais la remarque de l’Académie porte une autre leçon : en parlant de « grâce », elle renvoie à une esthétique particulière, celle de l’agrément, fondée sur le plaisir de la monotonie évitée (varietas), traditionnellement liée au style moyen. Elle invite non à un jugement binaire portant sur la régularité ou non du vers (bon vers / vers faux), mais à un jugement sur le degré de sa « force », c’est-à-dire sur son caractère, et donc sur son adéquation au registre de style visé. Un vers qui a de la « pompe » », de l’« éclat » n’est pas un vers plus régulier, mais un vers digne du style élevé. Un vers « faible » n’est pas un vers irrégulier, mais un vers qui convient au registre « simple et familier », au « style naïf » [= naturel] ou au style moyen en ce qu’il introduit de la variété, et non au style élevé où il apparaîtrait comme « rampant74 ». Ce n’est pas la versification, mais d’abord la rhétorique qui permet de penser le vers75, et en particulier le genus dicendi, le registre visé, ce que Corneille appelait « façon d’écrire » ou « style », ou, dans le latin de son Excusatio, modus, « ton76 ». Les vers brisés du début d’Attila valent justement pour leur ton : la trivialité presque burlesque mêlée d’une impérieuse brutalité font entendre la voix du tyran et rappelle même la « plaisanterie terrifiante » de Polyphème s’adressant à Ulysse dans l’Odyssée (chant IX, v. 369-370), telle que la commente Démétrios dans son traité Du style (§ 13077).
La question de la diction
24L’Académie française de 1637 partage avec Hugo la conscience d’un vers spécifiquement dramatique et l’exigence de souplesse de celui-ci. Dans la lettre donnée à Ténint, Hugo écrit : « Le vers brisé est en particulier un besoin du drame ; du moment où le naturel s’est fait jour dans le langage théâtral, il lui a fallu un vers qui pût se parler78. » Ténint en effet oppose nettement deux sortes de vers, celui soigneusement césuré, qu’il appelle le « vers chanté », et celui admettant la brisure, le « vers parlé ». Même s’il trouve des exemples de vers brisés chez les auteurs classiques, il oppose par polémique deux esthétiques, celle des modernes associée au vers parlé et celle des auteurs classiques au vers chanté. Dans une note, il va même jusqu’à reprocher aux acteurs de jouer les tragédies classiques en les disant de façon anachronique comme des vers modernes, alors qu’ils ne devraient adopter pour ces textes qu’une diction « chantée » :
Ici nous ferons remarquer que les grands acteurs, abandonnant la mélopée, ne chantent plus les vers tragiques, mais les parlent. C’est reconnaître la vérité des doctrines de la nouvelle école, et dénaturer la tragédie. Ces vers sont écrits pour être chantés, et ce n’est pas une des moindres sottises des partisans de la vieille école, que d’applaudir la diction de l’acteur qui les brise79.
25Ténint est le fondateur inconnu, en tout cas le précurseur, de ceux qui sont partisans aujourd’hui de la « diction baroque », rebaptisée depuis peu « diction historiquement informée », démarche qui paradoxalement, on le voit, doit plus à l’historicisme romantique qu’à l’universalisme classique.
26Mais, malgré ce qu’il prétend, Ténint s’inscrit dans une tradition qui date de bien avant le romantisme. Les témoignages sur une diction au théâtre fondée sur ce qu’il appelle le « vers parlé » existent pour le siècle précédent. Plusieurs textes sur le jeu de l’acteur préconisent de ne pas toujours s’arrêter « ni à la rime ni à la césure » (Grimarest, 1703), de marquer une césure ailleurs qu’au milieu du vers, de façon à éviter une déclamation « enflé et chantante » (Louis Racine, 174780). Georges Lote a étudié ces témoignages et en a tiré l’idée que c’est le vers de théâtre qui a pu faire évoluer la versification, que déjà chez Quinault le vers se disloque, préparant le passage d’une versification numérique à une versification accentuelle81. Mais en réalité dès le xviie siècle même Sorel indique que certains comédiens peuvent « prononc[er] les Vers comme si c’était de la Prose », particulièrement dans les « Entretiens familiers » et « pour exprimer plus naïvement [= naturellement] les passions82 ».
27La question de la diction de l’alexandrin se formule aujourd’hui souvent comme un dilemme : faire sonner le vers ou viser le naturel en le réduisant à la prosodie prosaïque. Mais le critère du naturel est trompeur. Quicherat83, pour étayer sa théorie de l’unique accent secondaire par hémistiche, indique que le vers de Racine « Oui, je viens dans son temple adorer l’éternel » peut être lu : « Oui, je viens dans son temple adorer l’éternel », ou « Oui, je viens dans son temple adorer l’éternel », mais que « personne ne le récitera de façon à mettre trois accents dans le premier hémistiche » : « Oui, je viens dans son temple adorer l’éternel ». Que le lecteur en fasse l’expérience à haute voix, cette troisième solution est bien possible et pourrait même passer sur scène pour une trouvaille d’acteur. Si, comme l’ont montré les formalistes russes, la poésie du vers vient de la déformation réglée de la prosodie prosaïque, impliquant un changement de « dominante », c’est-à-dire de principe de construction84, l’art de l’acteur ne peut que procéder de même, par une déformation réglée du vers, d’où peuvent se créer les « manières » qu’on admire chez les grands acteurs (utilisation savante de l’accent affectif par Gérard Philipe dans Le Cid, intonations languides de Jany Gastaldi dans les mises en scène de Vitez, phrasé rock de Philippe Demarle dans La Place royale mise en scène par Brigitte Jaques-Wajeman…) et qui sont même parfois une signature de metteur en scène (le « style Anne Delbée », si bien parodié par Michel Fau85). Choqué par la diction lourdement scandée d’Apollinaire ou d’Aragon lisant leurs poèmes, on dit parfois qu’ils sont de l’âge de Sarah Bernhardt, mais les enregistrements de cette dernière montrent qu’elle était bien loin de souligner systématiquement césure et fin de vers. La question de la diction du vers serait mieux posée, si l’on était plus conscient que, comme le remarquait Eichenbaum, on ne lit pas les vers comme on les joue86.
1 « L’“Éve” de Péguy », dans Charles Péguy, Œuvres poétiques et dramatiques complètes, éd. Claire Daudin et al., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2014, p. 1520 et p. 1523.
2 Evanthius, De fabula, iii, 2 ; Donat, Praefatio in Adriam Terentii, i, 9, à propos du personnage de Sosie (textes et traduction en ligne sur le site Hyperdonat - Collection d’éditions numériques de commentaires anciens avec traduction, commentaire et annotation critique. Accédé en ligne le 30 septembre 2017, à http://hyperdonat.tge-adonis.fr/).
3 La Galerie du Palais, La Suite du Menteur.
4 L’Illusion comique, Le Cid, Le Menteur.
5 Mélite (dernière réplique de Tircis : « Entrons donc… »), Polyeucte (« Allons à nos martyrs donner la sépulture… »), La Mort de Pompée (« Allons par là commencer votre Empire… »), Héraclius (« Allons lui rendre hommage et d’un esprit content… »), Don Sanche d’Aragon (« Allons et cependant qu’on mette en liberté… »), Œdipe (« Allons voir cependant ce prince infortuné… »), La Conquête de la toison d’or (« Allons ensemble, allons, sous de si doux auspices »), Sertorius (« Allons donner votre ordre à des pompes funèbres… »).
6 Attila, I, i, v. 1-3. Pour les citations de Corneille, nous suivons ici et plus loin le texte (y compris dans sa ponctuation) et la numérotation des scènes et des vers de l’éd. G. Couton des Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, 1984, 1987, 3 vol.
7 Louis Herland, Corneille par lui-même, Paris, Éditions du Seuil, « Écrivains de toujours », 1968 [première éd. 1954], p. 180‑184.
8 Voir Patricia Joan Siegel, Wilhelm Ténint et sa Prosodie de l’École Moderne, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1986.
9 Wilhelm Ténint, Prosodie de l’école moderne, précédé d’une lettre à l’auteur par Victor Hugo et d’une préface d’Émile Deschamps, Paris, Comptoirs des imprimeurs-unis, 1844.
10 Ibid., p. ij.
11 La Presse, lundi 15 janvier 1844, « Feuilleton de la presse », rez-de-chaussée de la une et de la p. 2, sur trois colonnes ; le compte-rendu commence à la une dans la troisième colonne (consulté dans Gallica).
12 Ibid., p. 2, col. 1.
13 Ibid., p. 2, col. 2.
14 Pour illustrer ce dernier cas, on peut citer les étonnants vers du Menteur, dans lesquels elle semble avoir un emploi tonique : « Il monte à son retour, il frappe à la porte : elle / Transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle » (II, v, v. 621-622).
15 Cinna, IV, ii, v. 1121, premier vers de la scène. Ténint omet la suite de la phrase dans le vers suivant : « Les secrets de mon âme, et le soin de ma vie ? ».
16 Le Cid, V, vi, v. 1789.
17 Voir notamment Dominique Billy, Benoît de Cornulier et Jean-Michel Gouvard (dir.), Langue française : métrique française et métrique accentuelle, no 9, 1993 ; Benoît de Cornulier, Art poétique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995, et Jean-Michel Gouvard, Critique du vers, Paris, Champion, 2000.
18 Louis Quicherat, Traité de versification française où sont exposées les variations successives des règles de notre poésie et les fonctions de l’accent tonique dans le vers français, 2e éd., Paris, Hachette, 1850. Le chapitre qui concerne particulièrement notre propos est le chapitre xii, « Nombre, cadence, rhythme [sic], accent », p. 133-144.
19 Louis Quicherat, Petit traité de versification française, Paris, Hachette, 1866, et huit rééditions jusqu’en 1915 référencées dans le catalogue de la BnF.
20 Louis Quicherat, Traité de versification française, op. cit., p. 135.
21 Ibid., p. 139, p. 141. La question de l’harmonie imitative est développée longuement dans le chapitre suivant, chap. xiii, p. 145-176.
22 Polyeucte, I, iii, v. 216. Nous reprenons les exemples de Quicherat, en ne retenant que ceux de Corneille.
23 Héraclius, V, ii, v. 1564.
24 Horace, I, i, v. 25, vers corrigé en 1648 : « puisqu’Horace est Romain ».
25 L. Quicherat, Traité de versification française, op. cit., p. 139.
26 Pour une approche conceptuelle plus rigoureuse que la conception courante, voir par exemple Jean-Claude Milner et François Regnault, Dire le vers. Court traité à l’intention des acteurs et des amateurs d’alexandrins, Paris, Éditions du Seuil, 1987, nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Verdier « Poche », 2008. Les auteurs conservent la théorie accentuelle du vers, mais fondent leur approche sur la notion de « mot phonologique » (voir en particulier l’intéressante notion de « mot phonologique en puissance », p. 156).
27 Maurice Souriau, L’Évolution du vers français au xviie siècle, Paris, Librairie Hachette et Cie, 1893.
28 Ibid., chap. 2, p. 108-194. On trouve aussi une analyse de la manière dont Corneille traite la césure dans le grand livre de Louis Rivaille, Les Débuts de Pierre Corneille, thèse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres de l’Université de Paris, Caen /Paris, Impr. J. Robert / Boivin, 1936, reprod. en fac-sim., Genève, Slatkine Reprints, 2003, III, chap. II, « L’art de Corneille », p. 561-775.
29 M. Souriau, op. cit., p. 110.
30 Agésilas, IV, i, v. 1349.
31 M. Souriau, op. cit., p. 157.
32 Mélite, IV, viii, v. 1550.
33 Le Cid, II, ii, v. 402.
34 M. Souriau, op. cit., p. 154.
35 Ibid., p. 154-157.
36 Mélite, I, iv, v. 275.
37 Ibid., IV, vii, v. 1517.
38 Ibid., I, ii, v. 168.
39 Sophonisbe, I, iv, v. 273. La virgule après argent suit l’éd. G. Couton, elle est absente de la citation telle que la donne Souriau.
40 Rodogune, I, iv, v. 279.
41 Jacques Roubaud, La Vieillesse d’Alexandre. Essai sur quelques états du vers français, Paris, F. Maspero, 1978, rééd. Paris, Ramsay, 1988, et Paris, Ivrea, 2000, p. 10. Voir la même perspective dans Benoît de Cornulier, Théorie du vers. Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Paris, Éditions du Seuil, « Travaux linguistiques », 1982. J. Roubaud prend en compte la « révolution hugolienne », mais note que celui-ci ne laisse « jamais complétement la possibilité d’un marquage de la position 6, au moins égal à celui des positions voisines » (op. cit., Ivrea, p. 103 et suiv., passage cité p. 105).
42 Guillaume Peureux, La Fabrique du vers, Paris, Éditions du Seuil, « Poétique », 2009, chap. 5, p. 175-215, passage cité p. 176.
43 Ibid., p. 177. G. Peureux soutient que les tournures rompues par la césure (par exemple la locution tandis que) n’ont pas dans l’ancienne langue la coalescence d’aujourd’hui. Mais on pourrait lui objecter qu’elles étaient tout de même assez coalescentes pour ne pas être partagées entre une fin de vers et le vers suivant : voir l’analyse de J. Roubaud, op. cit., p. 99.
44 W. Ténint, op. cit., p. 66. Il ne donne pas d’exemple de Corneille, mais aurait pu utiliser celui-ci : « L’un et l’autre est à vous, si… | N’achève pas, traître » (La Conquête de la toison d’or, III, iii, v. 1268).
45 Ibid., chap. 3, p. 76-77.
46 Le P. du Cerceau théorise l’inversion poétique dans ses Réflexions sur la poésie françoise, Paris, Michel Gandouin, 1742, et en fait un des traits qui donnent son « caractère propre » au « Vers français » et « le distingue essentiellement de la Prose » (titre du chapitre premier).
47 M. Souriau, op. cit., p. 164.
48 Ibid., p. 155-156.
49 Georges de Scudéry, Observations sur le Cid, dans La Querelle du Cid, éd. J.-M. Civardi, Paris, Honoré Champion, « Sources classiques », 2004, p. 404-422, expressions citées p. 372 et 404.
50 Ibid., p. 410. C’est le vers 215 du Cid, I, iv.
51 Lettre apologétique du sieur Corneille, dans La Querelle du Cid, éd. citée, p. 514-515.
52 Remarques sur les vers, dans La Querelle du Cid, éd. citée, p. 1013.
53 Cf. L. Quicherat, Petit traité, op. cit., chap. ii, p. 11 : « Le mot césure veut dire coupure. La césure est l’endroit où il est coupé ».
54 Georges Lote, Histoire du vers français, Paris, 1949-1955, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 1988-1996, consulté en ligne sur le site https://books.openedition.org/pup/1788 le 30 septembre 2017, t. I, première partie, livre deuxième, chap. 1, § 9-11 et t. IV (https://books.openedition.org/pup/1301), deuxième partie, livre premier, chap. 7, i, § 7-17.
55 Iouri Tynianov, Le Vers lui-même [Problema stikhotvornovo iazyka, Moscou, 1924], traduit du russe par J. Durin et al., Paris, UGE, « 10/18 », 1977.
56 Expression devenue courante et due à Benoît de Cornulier.
57 Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue française, « Du vers dans la prose », Paris, Augustin Courbé, quatrième éd., 1659, p. 81 (argument pour proscrire les alexandrins de la prose).
58 Cité par L. Quicherat, Traité, op. cit., p. 141.
59 Pierre de Ronsard, « Préface à La Franciade, touchant le poème héroïque », 1587, posthume, dans Œuvres complètes, éd. Jean Céard, Daniel Ménager et Michel Simonin, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, 1993, p. 1169.
60 Remarques sur les vers, dans La Querelle du Cid, éd. citée, p. 1014. C’est le vers 139 (I, iii).
61 Charles Sorel, De la connaissance des bons livres, Paris, André Pralard, 1671, p. 218-219.
62 Pertharite, I, ii, v. 187.
63 Le Cid, II, iv, v. 503.
64 Le Cid, I, v, v. 283.
65 Polyeucte, IV, iii, v. 1253.
66 Sophonisbe, I, iv, v. 283-284.
67 Héraclius, II, v, v. 585.
68 Don Sanche d’Aragon, I, iv, v. 328.
69 Nicomède, III, i-ii, v. 807.
70 Othon, II, iii, v. 561.
71 Œdipe, V, vi, v. 1866-1868.
72 Œdipe, V, iii, v. 1751.
73 Œdipe, I, i, v.117. Mégare dit « Madame. » à Dircé et elle « lui parle à l’oreille. ». Dircé continue le vers en s’adressant à Thésée : « Adieu, Seigneur, la Reine qui m’appelle »…
74 Pour ce vocabulaire rhétorique utilisé dans les préfaces et Examens de Corneille, voir dans ce volume les articles de Bénédicte Louvat et de Sylvain Garnier.
75 Sur le lien entre style grave et usage particulier du vers à la Renaissance, voir Olivier Halévy, « L’invention de l’“enjambement” ? La discordance métrique chez Ronsard autour de 1555 », dans Jean-Charles Monferran (dir.), L’Expérience du vers en France à la Renaissance, Paris, PUPS, « Cahiers L. V. Saulnier », 30, 2013, p. 125-139, en particulier p. 128-129.
76 « Et simul oppositis docta placere modis », « et plaire, savante, en même temps par des tons opposés », Excusatio, v. 24.
77 De même, le vers « frappé », typiquement cornélien selon L. Herland pourrait être analysé comme organisé sur ce qu’Hermogène appelle les figures de période (L’invention, § 13). Voir Kees Meerhoff, Rhétorique et Poétique au xvie siècle en France : Du Bellay, Ramus et les autres, Leyde, E. J. Brill, 1986, qui a montré que la rhétorique a été une des sources de la pensée du vers.
78 W. Ténint, op. cit ., p. ij-iij.
79 Ibid., note 1, p. 58.
80 Textes cités dans Sabine Chaouche, « La poésie racinienne : chant ou déclamation ? », dans La Licorne, no 50, 1999, p. 235-256, en ligne : https://licorne.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=4384, consulté le 2 novembre 2020. Le texte de L. Racine fournit des indications de diction pour un extrait d’Andromaque et le début d’Athalie ; il est commenté par M. Souriau, op. cit., p. 441-442.
81 G. Lote, op. cit., t. VI, deuxième partie, livre septième, « La réforme de la déclamation dans la seconde moitié du xviie siècle. ».
82 Ch. Sorel, op. cit., III, p. 217.
83 L. Quicherat, Traité, op. cit., p. 134, note 1.
84 I. Tynianov, op. cit., chap. 1, en particulier p. 76.
85 Récital emphatique, Théâtre des Bouffes du Nord, 2011.
86 Boris Michailovitch Eichenbaum, De la récitation des vers, cité par I. Tynianov, op. cit., note 18, p. 161.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/964.html.
Quelques mots à propos de : Jean-Yves Vialleton
Université Grenoble Alpes
UMR 5316 Litt&Arts
Jean-Yves Vialleton est maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes et membre au sein de l’UMR Litt&Arts de l’atelier « Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution » et de l’ANR « L’invention du théâtre antique dans le corpus des paratextes savants du xvie siècle ». Il a travaillé sur le théâtre français du xviie siècle, dont il a édité plusieurs pièces (Hardy, Rotrou, Du Ryer, Rayssiguier).
