Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
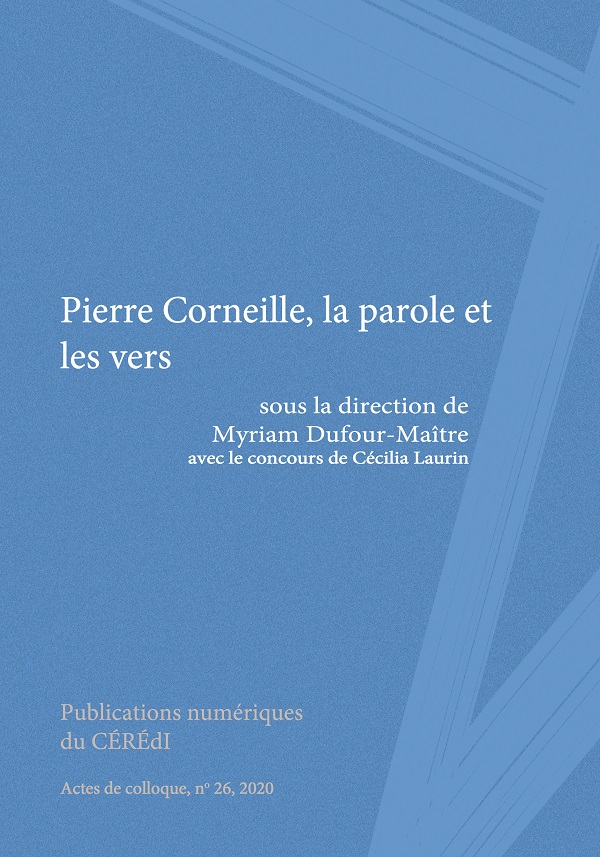
- Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Liliane Picciola, de Bénédicte Louvat et de Cécilia Laurin Introduction
- LA FABRIQUE DU VERS CORNÉLIEN
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Poétique
- Influence des versifications étrangères
- Matrices et formes-sens
- LE VERS DRAMATIQUE
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
- Le dialogue et le vers
- Parole, ethos et vers
- Vers lyrique, vers dramatique
Matrices et formes-sens
La prose de mes vers
François Regnault
« J’écris la prose de mes vers », dit un hétéronyme de Fernando Pessoa. Selon l’abbé d’Aubignac, les grands alexandrins sont, au théâtre, l’équivalent de la prose. Corneille considère que ce point de vue est une convention française, qu’il ne partage guère. Il ne veut, au début, que faire « la peinture de la conversation des honnêtes gens ». L’article revient d’abord aux thèses de Jean-Claude Milner sur le vers français, aux thèses de Corneille lui-même sur le rapport des stances, à ses yeux « moins vers » que les alexandrins, à la question de la prose poétique (qui répugne aux vers selon Vaugelas), enfin à quelques propriétés assez générales de la poésie, en les référant à celle de Corneille : l’inversion, l’enjambement, voire la prose d’art et le vers libre. Pour conclure que Corneille écrit de beaux vers (il le dit, il le sait), et que les bien dire y doit faire entendre la langue qui les inspire, autrement dit la prose qu’ils ne sont pas.
1Ainsi écrit en vers portugais le premier hétéronyme de Fernando Pessoa, le grand poète portugais qui les inventa tous un beau jour de mars 1914, révélant Caeiro comme son maître et lui donnant deux disciples, Ricardo Reis et Alvaro de Campos, sans parler d’autres hétéronymes après ces trois-là. La particularité d’Alberto Caeiro, c’est qu’il ne croit pas à la poésie au sens où tout le monde y croit : au fond, de l’art ajouté à la nature. « La Nature a lieu, on n’y ajoutera pas », dit Mallarmé2.
2Lorsque je pris connaissance du thème : « Corneille : la parole et les vers », je ne pus m’empêcher de me rappeler l’allusion que le poète fait, non sans ironie, à la thèse de l’abbé d’Aubignac, que l’alexandrin est parmi les vers le vers qui se rapproche le plus de la prose, allant à l’encontre du préjugé général – si c’en est un – selon lequel l’alexandrin est le vers par excellence de la langue française, le plus rigoureux et le plus contraignant, tandis que le vers de Shakespeare, n’est-ce pas, disent les acteurs français qui n’y ont pas regardé à deux fois, est si souple et si libre.
3Je me suis d’abord dit que Corneille, commençant à écrire du théâtre eût pu se dire que lui aussi, comme Alberto Caeiro, il se contentait de reproduire ce qu’il appelle dans l’Examen de Mélite, « la peinture de la conversation des honnêtes gens3 », des honnêtes gens, sans rien y ajouter, comme l’autre parle de l’arbre qui n’est qu’arbre. Alors Rodrigue ne serait que lui-même, et Médée, qu’elle-même : « Il n’est pas vraisemblable que Médée tue ses enfants, que Clytemnestre assassine son mari, qu’Oreste poignarde sa mère ; mais l’histoire le dit, et la représentation de ces grands crimes ne trouve point d’incrédules4 »… L’Histoire serait au théâtre comme la Nature est à la poésie. Le poète comprendrait alors ses personnages, les héros, les femmes, du dehors, et non du dedans. Mais cela n’est pas vraisemblable, car les personnages ne sont pas des arbres ni des rivières.
4Et ce serait oublier que Corneille dit au contraire qu’il faut comme s’identifier aux personnages qu’on invente :
J’honore les Modernes sans les envier, et n’attribuerai jamais au hasard ce qu’ils auront fait par science, ou par des règles particulières qu’ils se seront eux-mêmes prescrites. Outre que c’est ce qui ne me tombera jamais en la pensée, qu’une pièce de si longue haleine où il faut coucher l’esprit à tant de reprises, et s’imprimer tant de contraires mouvements, se puisse faire par aventure. Il n’en va pas de la Comédie comme d’un songe qui saisit notre imagination tumultuairement et sans notre aveu, ou comme d’un Sonnet ou d’une Ode, qu’une chaleur extraordinaire peut pousser par boutade, et sans lever la plume5.
5Mais revenons, comme j’imagine que la plupart d’entre vous l’auront fait, à cette idée de l’alexandrin moins vers que le vers, de l’abbé d’Aubignac :
J’avoue que les vers qu’on récite sur le théâtre sont présumés être prose : nous ne parlons pas d’ordinaire en vers, et sans cette fiction leur mesure et leur rime sortiraient du vraisemblable. Mais par quelle raison peut-on dire que les vers alexandrins tiennent nature de prose, et que ceux des stances n’en peuvent faire autant ? Si nous en croyons Aristote, il faut se servir au théâtre des vers qui sont les moins vers, et qui se mêlent au langage commun, sans y penser, plus souvent que les autres. C’est par cette raison que les poètes tragiques ont choisi l’iambique, plutôt que l’hexamètre qu’ils ont laissé aux épopées, parce qu’en parlant sans le dessein d’en faire, il se mêle dans notre discours plus d’iambiques que d’hexamètres. Par cette même raison les vers de stances sont moins vers que les alexandrins, parce que parmi notre langage commun il se coule plus de ces vers inégaux, les uns courts, les autres longs, avec des rimes croisées et éloignées les unes des autres, que de ceux dont la mesure est toujours égale, et les rimes toujours mariées. Si nous nous en rapportons à nos poètes grecs, ils ne se sont pas tellement arrêtés aux iambiques, qu’ils ne se soient servis d’anapestiques, de trochaïques et d’hexamètres même quand ils l’ont jugé à propos. Sénèque en a fait autant qu’eux, et les Espagnols ses compatriotes changent aussi souvent de genre de vers, que de scènes. Mais l’usage de France est autre, à ce qu’on prétend, et ne souffre que les alexandrins à tenir lieu de prose6.
6Rappelons l’hypothèse de d’Aubignac : « Les grands vers de douze syllabes, nommés Communs dans les premiers Auteurs de la Poësie française, doivent être considerez au Théâtre comme de la prose7. »
7Et Aristote : « Lorsque le parlé [lexis] fut introduit [dans la tragédie], la nature trouva d’elle-même le mètre approprié : de fait le mètre iambique [une brève, une longue] est celui qui s’accorde le mieux au parlé, et la preuve c’est que nous prononçons beaucoup de mètres iambiques dans la langue de la conversation8. » Ceci est contesté par les métriciens modernes. De même, on peut contester ce que dit Corneille qu’il se « coule » tant de vers inégaux dans le langage courant. Sauf à supposer que nous parlions en vers, à condition de laisser peut-être de côté rimes croisées et éloignées, et peut-être – je suggère cette hypothèse – d’aller jusqu’à ce que dit Claudel du vers, et précisément du vers français. J’y reviendrai.
8C’est que la question – dirai-je, récurrente – est toujours pour un poète de se rapprocher du langage parlé, qu’il le veuille ou non. Introduire les bocks et la limonade dans la poésie française, aller jusqu’au vers libre ! De même que l’éternelle question du chant musical, chanson, madrigal, Lied, opéra, est de se rapprocher du langage parlé, qui sert d’idéal toujours inatteignable, depuis la seconda prattica de Monteverdi jusqu’au Sprechgesang d’Arnold Schönberg et d’Alban Berg, mais à chaque fois par des moyens différents. Pour Corneille, c’est donc la conversation des honnêtes gens, qui sert de modèle, du moins dans la comédie, et quoi que nous en pensions.
9Aussi bien dois-je avouer d’entrée de jeu que c’est la question qui me retiendra, mais que j’évoquerai moins la parole que tout simplement la prose. Parole et prose sont peut-être d’ailleurs en exclusion interne.
Le vers français
10Je voudrais repartir de deux propositions tirées de l’article de Jean-Claude Milner : « Réflexions sur le fonctionnement du vers français », qui servit de base au court traité Dire le vers que nous publiâmes en 1987 et 20089. La première, je pense, se laisse aisément saisir : « Un vers français est une suite de barres ordinaires, précédées par une première barre et suivies par une dernière barre. » J’en viendrai plus loin à la seconde. Une barre, c’est un signe qui marque ce qui sépare ce que nous appelons un mot phonologique (soit les groupes nominal, verbal, adjectif, prépositionnel, appelés parfois unité de souffle) d’un autre. Le principe en est que le vers est un mot phonologique à lui seul, ou, comme le dit Mallarmé (cité par Milner) : « Le vers qui de plusieurs vocables, refait un mot total10. » Alors, une barre le précède et une barre le suit, mais à l’intérieur de lui, il peut y avoir et, dans le cas général, il y a d’autres barres, commandées par la syntaxe :
// Je sais/ ce qu’est un songe/ et le peu de croyance //
// Qu’un homme/ doit donner/ à son extravagance. // [Polyeucte, v. 5 et 6]
11Je puis en prose faire une phrase aussi longue qu’on voudra, on la divisera selon la grammaire en mots phonologiques, mais à aucun moment on n’aura d’effet métrique, et, si longue soit la phrase – Proust – on n’aura rien en principe qui ressemble à un enjambement, dont la notion est intuitive. Sauf si s’insinuent en elle le nombre (ainsi les constants octosyllabes dans la prose de Michelet), ou des effets de rime, d’assonance, de consonances, d’allitérations, etc., voire une déclamation qui viendrait mettre en évidence la séparation des phrases, et en faire en somme des vers libres. Ainsi le vers claudélien, qu’on appelle parfois verset, mais que Claudel appelle vers. Il peut marquer un passage à la ligne, qui ne correspond pas à une limite syntaxique :
Telles sont les choses dans son délire qu’elle dit et elle ne s’aperçoit pas qu’elles sont déjà passées et qu’elle-même pour toujours en un moment
Passe en ce lieu où elles sont passées –. [Le Soulier de satin, Deuxième journée, Scène XIV, La Lune]
12La phrase continue, mais le vers s’est arrêté. Enjambement et rejet. Une parenthèse sur Claudel, éclairante. D’abord sa définition mallarméenne du vers : « une idée isolée par du blanc » (on reconnaît la typographie). Puis cette autre : « Le vers composé d’une ligne et d’un blanc est cette action double, cette respiration par laquelle l’homme absorbe la vie et restitue une parole intelligible11. »
13Définition théologique, sans doute, de laquelle on pourrait tirer l’idée d’unité de souffle, et le fait que l’absorption renvoie à la prosodie, et la parole intelligible, à la langue. Il dit encore : « La phrase française est composée d’une série de membres phonétiques [le mot phonologique] ou courtes ondes vocales avec accentuation et insistance plus ou moins longue de la voix sur la dernière syllabe12. » (Il veut désigner l’accent tonique). Ou encore : « Le phonème se compose d’une longue qui est toujours la dernière syllabe et d’un nombre variable et à peu près indifférent de syllabes neutres qui sont par rapport à elle toujours brèves quel que soit leur titre orthographique13. » Le mot de phonème, ici utilisé par lui, désigne en somme le mot phonologique, Claudel ignorant sûrement à Tokyo, en 1925, le concept saussurien de phonème.
14Nous comprendrons alors le paradoxe suivant, ou plutôt l’entrecroisement entre les points de vue respectifs de Corneille et de d’Aubignac sur l’alexandrin et les stances. Je le résume de la façon la plus claire possible : pour d’Aubignac, l’alexandrin doit être considéré comme de la prose. Bien entendu, cela n’est pas vrai, sauf au théâtre, et parce que l’alexandrin, qui est long, peut contenir toutes sortes de phrases ou membres de phrases de la langue qu’on peut y ranger, autrement dit, de « mots phonologiques ». Exemples :
Mais vous ne savez pas / ce que c’est / qu’une femme. [Polyeucte, v. 9] [principale, complétive et relative]
Pour elle, / rien n’est sûr : / Qui peut tout / doit tout craindre. [Cinna, v. 1129] [3 phrases, 4 mots phonologiques]
15Pour Corneille, dans l’exacte mesure où il laisse planer un doute – c’est le moins qu’on puisse dire – sur l’hypothèse de d’Aubignac (que ce dernier ne semble pas avoir inventée), on ne parle absolument pas en alexandrins, qui sont au fond des vers sans variations, assez contraignants, et dont les rimes sont plates. En revanche, d’Aubignac trouve les stances artificielles, et donc plus « poétiques », dans la mesure où pour procéder à la composition de belles stances, il faut être poète, ou que le personnage ait le temps de rimailler, ce qui sied mal à la tragédie.
16Corneille rapproche au contraire les stances du langage courant, en quoi elles sont « moins vers », comme on vient de voir, – car il y a selon lui, des vers plus ou moins vers, et s’il en vient parfois à condamner les stances, ce n’est que dans la mesure où la répétition strophique, l’alternance calculée de vers nombrés comme hexamètres, octosyllabes et alexandrins qui en général les composent, et bien que leur variété se rapproche du langage courant, contribuent, par leurs rigueurs intrinsèques, à donner l’effet d’un vrai poème où Rodrigue, par exemple, sommé par Don Diègue de le venger du Comte, se livre à des refrains artificiels qui heurtent la vraisemblance :
La diversité de la mesure, et la croisure des vers que j’y ai mêlés, me donne l’occasion de tâcher à les justifier, et particulièrement les stances dont je me suis servi en beaucoup d’autres poèmes, et contre qui je vois quantité de gens d’esprit et savants au théâtre témoigner aversion. […] Je demeure d’accord que c’est quelque espèce de fard, mais puisqu’il embellit notre ouvrage, et nous aide à mieux atteindre le but de notre art qui est de plaire, pourquoi devons-nous renoncer à cet avantage14 ?
17D’où sa conclusion : « Sur quoi je ne puis m’empêcher de demander qui sont les maîtres de cet usage et qui peut l’établir sur le théâtre, que ceux qui l’ont occupé avec gloire depuis trente ans, dont pas un ne s’est défendu de mêler des stances dans quelques-uns des poèmes qu’ils y ont donnés15. » Autrement dit : tout le monde a fait des stances, que donc d’Aubignac qui n’en a pas fait, ni écrit de théâtre, bien qu’il se soit avisé d’aller même jusqu’à écrire du théâtre en prose, sans y parvenir, se taise ! Il ajoute :
Je ne dis pas dans tous [de mêler des stances dans tous les poèmes], car il ne s’en offre pas d’occasion en tous, et elles n’ont pas bonne grâce à exprimer tout. La colère, la fureur, la menace, et tels autres mouvements violents ne leur sont pas propres, mais les déplaisirs, les irrésolutions, les inquiétudes, les douces rêveries, et généralement tout ce qui peut souffrir à un acteur de prendre haleine, et de penser à ce qu’il doit dire ou résoudre, s’accommode merveilleusement avec leurs cadences inégales, et avec les pauses qu’elles font faire à la fin de chaque couplet. La surprise agréable que fait à l’oreille ce changement de cadences imprévu rappelle puissamment les attentions égarées, mais il y faut éviter le trop d’affectation. C’est par là que les stances du Cid sont inexcusables, et les mots de peine et Chimène, qui font la dernière rime de chaque strophe, marquent un jeu du côté du poète qui n’a rien de naturel du côté de l’acteur. Pour s’en écarter moins, il serait bon de ne régler point toutes les strophes sur la même mesure, ni sur les mêmes croisures de rimes, ni sur le même nombre de vers. Leur inégalité en ces trois articles approcherait davantage du discours ordinaire, et sentirait l’emportement et les élans d’un esprit qui n’a que sa passion pour guide, et non pas la régularité d’un auteur qui les arrondit sur le même tour. J’y ai hasardé celles de la Paix dans La Conquête de la Toison d’or, et tout le dialogue de cette pièce, qui ne m’a pas mal réussi16.
18Si on regarde cependant ce monologue de la Paix, certes, les strophes diffèrent, mais sans la variété souhaitée par Corneille – que nous n’entendons peut-être plus avec l’oreille du xviie siècle – parce que cette variation est tout de même restreinte par la stricte alternance de vers pairs : exclusivement des alexandrins et des octosyllabes.
19On n’a jamais là ce qu’on trouvera chez La Fontaine (Première édition des Fables, 1668). Et dans Psyché (1671), par exemple, Molière se permet de plus grandes variations que Corneille lui-même, se livrant, mais il est vrai dans des chœurs chantés, à des vers de 5, ou 7 syllabes : le « Préfère l’impair » de Verlaine17 ?
20Reste que Corneille aura lentement abandonné lesdites stances, et on ne notera plus ensuite que l’exception d’Agésilas, dite « en vers libres rimés ». Au demeurant, il faut ajouter que les vers des stances, si variés soient-ils, sont toujours pairs : 6, 8, 10, 12 (strophes de Rodrigue), et qu’Agésilas même, sauf erreur, n’alterne que l’alexandrin et l’octosyllabe18.
Prose poétique
21On pourrait aussi se demander si la prose peut toujours se distinguer, elle aussi, des vers. On sait, ou on devine, qu’une prose qui serait truffée d’octosyllabes ou d’alexandrins, ne serait pas sans surprendre, ou inquiéter, voire importuner ! La prose de Michelet, à laquelle je faisais allusion, en est un bon exemple : elle contient, entre autres vers, de nombreux octosyllabes, nombrés ou parlés, selon un décompte exact de 8, ou faisant un effet de 8 selon les élisions de la langue parlée, notamment la chute du e muet, même devant consonne19.
22Je ne me suis pas proposé d’examiner selon cette pertinence la prose de Corneille, mais je fais l’hypothèse qu’il évite les vers dans la prose (ce que pour inverser la formule de Pessoa, on pourrait appeler : « les vers de ma prose », mais ce qui, en principe, ne se rencontre pas). Le célèbre grammairien du xviie siècle, Vaugelas, traite de la question dans ses Remarques de la langue française20. Dans son articulet « Des vers dans la prose », il déclare :
J’entends [par là] que la prose même fasse des vers, et non pas que dans la prose on mêle des vers. Exemple : « Qui se peut assurer d’une persévérance ? » Je dis qu’une période en prose qui commence ou finit ainsi, ou avec cette même mesure, est vicieuse. Il faut éviter les vers dans la prose autant qu’il se peut, surtout les vers alexandrins et les vers communs [les décasyllabes], mais particulièrement les alexandrins comme est celui dont j’ai donné un exemple, parce que leur mesure sent plus le vers que celle des vers communs, et que marchant, s’il faut ainsi dire, avec plus de train et de pompe que les autres, ils se font plus remarquer21.
23Ce en quoi il s’oppose à d’Aubignac – au sens où il refuse l’hypothèse, la fiction, de l’alexandrin comme prose. Et s’il y a deux alexandrins qui se suivent par hasard, et si de plus l’un est avec une dernière syllabe masculine et l’autre avec une féminine, selon lui, c’est pire, car on se trouve en poésie. Et de citer une phrase de Malherbe dans un texte en prose, et qu’il réprouve : « Ce ne fut pas à faute, ni de le désirer avecque passion, ni de le rechercher avecque diligence. » Avec, écrit avecque, accomplit le second alexandrin, et la mesure, du coup, qui ne se rompt pas, fait entendre aussitôt des vers22. Vaugelas ajoute même qu’« il se pourrait que la tissure du vers aurait corrompu celle de la prose23 ».
24Soit la prose de Corneille. Je feins seulement l’hypothèse qu’il évite, lui aussi, les vers dans sa prose. Cela demanderait d’innombrables analyses. Je me contenterai d’un exemple, qui, bien sûr, ne prouve rien à lui tout seul. Soit cet extrait de l’Examen de Nicomède :
Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au-dehors, et comme ils agissaient impérieusement avec les rois leurs alliés, leurs maximes pour les empêcher de s’accroître, et les soins qu’ils prenaient de traverser leur grandeur quand elle commençait à leur devenir suspecte à force de s’augmenter et de se rendre considérable par de nouvelles conquêtes24.
25Presque pas de nombre pairs de syllabes (je saute les e muets qu’on élide en prose, ou dans le langage parlé) : à moins de compter comme alexandrin, « Et comme ils agissaient im-pé-ri-eu-se-ment », le reste est plutôt fait de 3, 5, 7. Si le pair apparaît, l’impair s’y préfère vite ! « Préfère l’impair » dit encore Verlaine.
26Vaugelas dit aussi : « Quant aux petits vers [l’octosyllabe par exemple], ils ne paraissent presque pas parmi la prose si ce n’est qu’il y en ait deux de suite de même mesure, comme : “On ne pouvait s’imaginer / qu’après un si rude combat” » ce qui selon Vaugelas est encore plus « vicieux » si on y ajoute : « ils eussent encore dessein / d’attaquer nos retranchements ». Soit quatre octosyllabes de suite. Il prend ensuite l’exemple d’un ensemble de ces même phrases augmentées chacune d’une syllabe, ce qui ferait alors une période de quatre mesures de neuf syllabes25 !
Inversion
27Ces remarques, qui mettent en évidence une des propriétés de la poésie dans les langues, et qui sont ce que Vaugelas appelle aussi, dans son article « l’arrangement de mots », la « transposition », peuvent aussi s’appliquer à l’inversion : « Plusieurs attribuent aux vers la cause de ces transpositions qui sont des ornements de la poésie, quand elles sont faites, comme celle de Monsieur de Malherbe dont le tour des vers est incomparable26 ». De là ne suit pas que Malherbe, malgré la limpidité de ses phrases suivant souvent la syntaxe de la langue, évite les inversions. Soit dans son poème le plus célèbre, les stances de la Consolation à Du Périer, cette strophe (reprise de la Consolation à Cléophon), qui, par contraste, en contient au moins trois :
Puis quand ainsi serait, que selon ta prière
Elle aurait obtenu
D’avoir en cheveux blancs terminé sa carrière
Qu’en fût-il advenu27 ?
28(Pour : Puis quand ce serait ainsi qu’elle aurait obtenu, selon ta prière, d’avoir terminé sa carrière en cheveux blancs, qu’en fût-il advenu ?)
29Pourquoi aborder ce point ? C’est que l’inversion, rencontrée si souvent dans le vers, est une marque du vers, et, plus généralement, de la poésie. Malherbe écrit naturellement en vers : « J’ai su de son esprit la beauté naturelle… », ou : « Leur camp qui la Durance avait presque tarie / De bataillons épais28 », etc. De même, dans le vers de Phèdre : « Ariane ma sœur de quelle amour blessée » (Phèdre, vers 253), l’inversion marque la poésie, là où « Ariane ma sœur blessée de quelle amour » ne l’eût pas ainsi marquée ; d’autant moins que « blessée » devant « de quel amour » eût produit cet e muet après voyelle et devant consonne qui n’est plus possible à partir de Malherbe, mais qui était permis au xvie siècle.
Enjambement
30On retiendra que l’inversion, mais aussi l’enjambement sont, semble-t-il, des marques de poésie dans un grand nombre de langues. Jean-Claude Milner fait sur ce point des remarques décisives dans son article sur le fonctionnement du vers français (c’est la seconde proposition annoncée au début) :
Il y a vers dans une langue, dès qu’il est possible d’insérer des limites phonologiques sans avoir égard à la structure syntaxique.
Il en suit une conséquence : la notion d’enjambement, qui n’est rien d’autre que la possibilité d’une contradiction entre limite syntaxique et limite poétique, se trouve analytiquement contenue dans celle du vers29.
31Si bien qu’on pourrait dire, contre d’Aubignac, que plus il y a d’enjambements, qui sont des marques du vers, moins on en peut conclure que l’alexandrin fasse figure de prose ! (Ou encore, plus les alexandrins sont stricts, plus l’enjambement se remarque).
32Rappelons que, comme le dit Grammont, il y a enjambement quand une proposition [concept de la syntaxe], commencée dans un vers, se termine dans le suivant, [concept de la prosodie] sans le remplir tout entier, la partie rejetée dans le vers suivant s’appelant justement rejet. « Autrement dit, dit encore Grammont, une discordance entre la syntaxe et le rythme30. » Autrement dit encore, en prose, on n’a pas cette discordance.
33Soit ces vers de Corneille, dans le début de la première version du Cid. Elvire, la suivante de Chimène, dit que sa maîtresse est très courtisée, mais que seuls Don Rodrigue et Don Sanche se signalent tout particulièrement. Le Comte, père de Chimène, lui répond :
Elle est dans le devoir, tous deux sont dignes d’elle,
Tous deux formés d’un sang noble, vaillant, fidèle,
Jeunes, mais qui font lire aisément dans leurs yeux
L’éclatante vertu de leurs braves aïeux. (Le Cid, v. 11-14)
34Comment ne pas entendre que « jeunes », au pluriel, qui débute le vers suivant, et s’attribue à « Tous deux », tandis que les adjectifs précédents qualifient les vertus du sang, au singulier, des deux jeunes gens, est ainsi mis en valeur. Ce mot, placé ici, fonctionne comme un emblème de la jeunesse des héros de la pièce, de la jeunesse du Cid, et pourquoi pas, de la jeunesse d’un nouveau théâtre ! En prose, je ne remarquerais pas d’enjambement et tiendrais ce « jeunes » pour la suite de la phrase. Malherbe proscrit les enjambements, fréquents dans la Pléiade, et ils vont donc devenir rares31. Jusqu’à ce que les Romantiques, et principalement Victor Hugo, y recourent. Raisons de plus de les remarquer chez Corneille.
35La question est en vérité complexe, si l’enjambement, perçu comme tel, est la marque de la poésie : la phrase, objet de la grammaire, dépasse le vers, objet de la métrique. D’où le problème présenté sous le nom de « grammetrics » (grammétrique) donné par certains théoriciens. Je songe à l’article d’un linguiste anglais (Université de Manchester), P. J. Wexler, intitulé Distich and Sentence in Corneille and Racine, et paru dans un recueil intitulé Essays on style and language, publié à Londres en 196632. Ce linguiste étudie les rapports entre le distique, unité par excellence de la métrique du théâtre classique, puisqu’elle privilégie les alexandrins qui riment deux par deux, mais qui coïncident la plupart du temps, pour ne pas dire constamment, avec la phrase ou la proposition, éléments de la syntaxe, selon des procédures évidemment complexes, qui obéissent au fond, en lui donnant son sens, à cet axiome de Corneille lui-même, exprimé dans le premier des trois Discours du poème dramatique : « La diction dépend de la grammaire33. » (« Diction » renvoie, selon cette acception, à l’auteur qui écrit, non à l’acteur qui déclame).
36Je donne un exemple immédiat du lien des deux : dans un Traité de la poésie française, de 1724, le Père Mourgues, cité par Wexler, fait état d’exigences assez draconiennes concernant cette coïncidence : « La césure ne doit jamais tomber entre la préposition, et le nom qui s’y rapporte [vers inventés par moi F. R. : « *Je vous ai croisé dans / la ville de Paris »], ni entre les auxiliaires et le participe [« *Dans Paris je vous ai / rencontré l’autre jour »]34… » Ni le substantif et son adjectif, etc. Ou entre le verbe et son attribut, ce qui en reviendrait à proscrire chez Molière ce beau vers de Tartuffe : « Oui, mon frère, je suis / un méchant, un coupable. » [Tartuffe, III, 6, v. 1074]. Je n’insiste pas.
37Aussi bien Wexler examine-t-il avec une grande précision les cas, si fréquents dans la tragédie, où le vocatif « dépasse » évidemment le vers, ou le distique, et constitue donc un enjambement : les cas multiples de « Seigneur », de « Madame », ou du nom de l’interlocuteur :
Le jugement de Rome est peu pour mon regard,
Camille, [Horace, v. 1065]
38Ou :
Je ne viens point ici demander ma conquête :
Je viens tout de nouveau vous apporter ma tête,
Madame. [Le Cid, v. 1777-1779]
39Il raisonne donc sur les distich-junctures, les jointures, ou les limites, dans le distique lui-même ou entre deux distiques, et s’interroge sur la question de savoir si la sentence-juncture suit la distich-juncture, ou si c’est l’inverse. Je n’entrerai pas dans le détail de la question, sauf à vérifier une fois encore que la notion d’enjambement, ou, pour généraliser le problème, de la discrépance entre le vers et la phrase, est propre à la poésie, avec l’inversion35.
40Deux exemples extrêmes d’enjambements. On connaît le risque incroyable que prend Racine dans ces vers de Phèdre qu’Aricie adresse à Thésée :
Vos invincibles mains
Ont des Monstres sans nombre affranchi les humains.
Mais tout n’est pas détruit. Et vous en laissez vivre
Un… Votre Fils, Seigneur, me défend de poursuivre. [Phèdre, v. 1443-1446]
41(Ce Monstre, c’est Phèdre elle-même !)
42On connaît moins cet autre risque que prend Corneille dans Le Menteur (et que je dois à Benoît de Cornulier36). Dorante est chez sa maîtresse et voici que le père survient :
Un soir que je venais de monter dans sa chambre, […]
Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé
Ce soir même son père en ville avait soupé,
Il monte à son retour, il frappe à la porte, elle
Transit, pâlit, rougit, me cache en sa ruelle, [Le Menteur, v. 617-622]
43Différent syntaxiquement de celui de Racine, où le verbe « rejette » son complément d’objet, chez Corneille le pronom-sujet « rejette » son verbe, mais l’effet est rythmiquement semblable. Difficile de savoir, d’ailleurs, si ce « elle », accentué en fin de vers, est le pronom atone ou le pronom emphatique.
Prose d’art, vers libre, etc.
44Restent deux exceptions patentes aux descriptions précédentes, et qui mêlent syntaxe et métrique, et que cite Milner : ce qu’on appelle la prose d’art (Chateaubriand), et le vers libre.
45On remarque en effet, ce que je ne puis développer, que la « prose d’art », comme le vers, est régie par le décompte des voyelles, suivant des principes analogues à ceux du vers. (De même Michelet). Quant au vers libre, comme il le fait remarquer, il « renonce à la plupart des insignes conventionnels de la versification – excepté précisément la typographie37 ».
46Je laisse de côté d’autres problèmes à examiner d’un point de vue prosodique, métrique, phonétique, phonologique, etc. Par exemple la lettre de Constantin Huygens à Corneille tentant de repérer des iambes, des dactyles, des anapestes, des trochées, etc. dans ses vers. Corneille lui a-t-il répondu ? Il semble que non. La question pour lui n’avait sans doute pas de sens38. Ce qui ne l’empêcha pas d’écrire de beaux vers, avec assonances, consonances, allitérations, et tout ce que vous voudrez… sans parler du trimètre de Suréna dans toutes les mémoires : « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. » [Suréna, v. 268]. Et citons ce beau vers allitératif pour finir. Corneille avait d’abord écrit : « Les Mores et la mer entrèrent dans le port » ! [Le Cid, IV, 3, v. 1286, éd. de 1637 à 1660]. Puis il corrigea : « Les Mores et la mer montent jusques au port. » [éd. de 1663 à 1682]
Le vers ornement
47Si on sort de ces problèmes de métrique et de prosodie, on ne saurait oublier que ni Corneille ni Racine ne considèrent que le problème du vers soit la question principale. Bien davantage comptent pour eux la composition et les effets de la fable, du récit, de l’intrigue, des passions, mais ceci est une autre histoire.
48On a gardé de Racine, semble-t-il, un texte en prose, scénario d’un premier acte d’une Iphigénie en Tauride qu’il n’a pas écrite. On aura donc là la prose de vers à venir, ou les paroles de vers encore à faire. Cela donne : « Iphigénie vient avec une captive Grecque, qui s’étonne de sa tristesse. Elle demande si c’est qu’elle est affligée de ce que la fête de Diane se passera sans qu’on lui immole aucun étranger. Tu peux croire, dit Iphigénie, si c’est là un sentiment digne de la fille d’Agamemnon. Tu sais avec quelle répugnance j’ai préparé les misérables que l’on a sacrifiés depuis que je préside à ces cruelles cérémonies. » Etc. On passe donc du style indirect à des répliques en prose. Aucun vers dans ce texte. Comme le dit Louis Racine de son père dans ses Mémoires : « […] quand il entreprenait une Tragédie, il disposait chaque acte en prose. Quand il avait ainsi lié toutes les scènes entre elles, il disait : “Ma Tragédie est faite, comptant le reste pour rien39.” » Nous n’avons rien de tel de Corneille, ce qui ne prouve évidemment rien.
49Comme nous gardons des idées souvent très romantiques sur l’inspiration poétique, nous sommes surpris de cette prétention, et nous réputons Racine un trop grand poète pour avoir dû d’abord passer par la prose, la prose de ses vers à venir. C’est encore oublier, je crois, que la dramaturgie d’une pièce de théâtre est, pour les Classiques, pour Corneille comme pour Racine qui le suit en cela rigoureusement, sans parler de bien d’autres poètes de ce temps-là, la question principale. Le vers vient ensuite, il est un ornement. Cela ne les a pas plus empêchés d’écrire parmi les plus beaux des vers français, que Victor Hugo, Baudelaire, ou Rimbaud, qui ont bien dû se dire, au contraire, à un moment ou à un autre de leur longue ou courte existence, que la Poésie était tout de même, selon l’expression de Mallarmé, l’« unique source40 » !
50Pour reprendre le vers de l’hétéronyme de Pessoa, je conclurai que Corneille n’écrivait donc pas plus la prose de ses vers que n’importe quel grand poète. Autrement dit, que la prose des vers de Corneille, ce sont ses vers. Et qu’alors, la condition essentielle est qu’ils soient bien dits, pour qu’on y entende aussi la prose qu’ils ne sont pas.
2 Stéphane Mallarmé, « La musique et les lettres », dans Œuvres complètes, éd. Georges Jean-Aubry et Henri Mondor, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1945, p. 647.
3 « Examen » de Mélite, dans Pierre Corneille, Œuvres complètes, éd. Georges Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1980, p. 6. Pour les citations de Corneille, nous nous bornerons à indiquer le tome de ses Œuvres complètes dans cette édition, suivi de la page.
4 Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique, Œuvres, III, p. 118.
5 Préface de Clitandre, I, p. 96
6 Examen d’Andromède, II, p. 455.
7 François Hédelin abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, Genève, Slatkine Reprints, 1971, livre III, chapitre X, « Des Stances », p. 241 sq.
8 Aristote, Poétique, chap. 4, 1449a. Voir La Poétique, trad. Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, Paris, Éditions du Seuil, 1980, p. 47 et notes 16 et 17, p. 174.
9 Jean-Claude Milner, « Réflexions sur le fonctionnement du vers français », dans Ordres et raisons de langue, Paris, Éditions du Seuil, 1982. Jean-Claude Milner et François Regnault, Dire le vers, Court traité à l’intention des acteurs et des amateurs d’alexandrins, Paris, Le Seuil, 1987 ; Paris, Verdier/poche, 2008, notamment p. 299.
10 Mallarmé, « Crise de vers », dans Œuvres complètes, éd. citée, p. 368.
11 Paul Claudel, « Réflexions et propositions sur le vers français », dans Positions et propositions, Œuvres en prose, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1965, p. 32.
12 Ibid., p. 32-33.
13 Ibid., p. 33.
14 Examen d’Andromède (1651), II, p. 454.
15 Ibid., II, p. 455-456.
16 Examen d’Andromède, ibid., p. 456 ; La Conquête de La Toison d’or, tragédie, Prologue, scène 3, Œuvres, III, p. 215.
17 Paul Verlaine, « De la musique avant toute chose, / Et pour cela préfère l’Impair », « Art poétique », dans Jadis et Naguère, Paris, Le Livre de poche, « Classiques », p. 83.
18 Agésilas, « tragédie en vers libres rimés », Œuvres, III, p. 563.
19 Par exemple, Michelet, ce début du chapitre XIII, « Les Sirènes », dans La Mer : « J’aborde, et me voici à terre. / J’ai assez et trop de naufrages. /Je voudrais des races durables. / Le cétacé disparaîtra. / Réduisons nos conceptions, / et de cette poésie gigantesque /des premiers-nés de la mamelle, /du lait et du sang chaud, /conservons tout, moins le géant. », Jules Michelet, La Mer, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1980, p. 141. Soit 7 octosyllabes en italiques (si on admet la diérèse à « concepti-ons ») entourant 2 non-octosyllabes (en romaines). Encore « du lait et du sang chaud » est-il un hexamètre.
20 Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire [1647], Paris, Éditions Champ Libre, 1981.
21 Ibid., p. 94.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 272.
24 Examen de Nicomède, II, p. 641.
25 Vaugelas, op. cit., p. 95-96.
26 Ibid., p. 272.
27 « Consolation à Monsieur Du Périer », dans Malherbe, Poésies, Paris, Poésie/Gallimard, 1999, p. 69.
28 « Consolation funèbre à un de ses amis… », dite « à Cléophon », Malherbe, op. cit., p. 52 ; « à Monsieur Du Périer », p. 71.
29 Jean-Claude Milner, « Réflexions… », dans Ordres et raisons de langue, op. cit., p. 300.
30 Maurice Grammont, Petit traité de versification française, Paris, Armand Colin, 1965, p. 24 et 109.
31 « Mais Malherbe vint, puis Boileau, qui les proscrivirent absolument. » (M. Grammont, op. cit., p. 25).
32 P. J. Wexler, Distich and Sentence in Corneille and Racine, dans Essays on style and language, Londres, Roger Fowler Routledge & Paul Keegan, 1966, rééd. 1967, 1970.
33 Corneille, Discours, III, p. 134.
34 Wexler, art. cité, p. 103.
35 Ibid., p. 105 sq.
36 Benoît de Cornulier, Art Poëtique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995, p. 108.
37 Jean-Claude Milner, art. cité, p. 300.
38 Lettre de Constantin Huygens à Pierre Corneille, du 30 mai 1663, Œuvres, III, p. 299.
39 Plan du premier acte d’une Iphigénie en Tauride, dans Racine, Œuvres complètes, éd. Georges Forestier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, tome I, p. 765.
40 Mallarmé, Préface à « Un coup de dés… », Œuvres complètes, éd. citée, p. 456.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/943.html.
Quelques mots à propos de : François Regnault
François Regnault, ancien élève de l’ENS (Ulm) et agrégé de philosophie, a été maître de conférences à l’Université de Paris VIII (Philosophie, Psychanalyse), puis professeur au Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris (Diction, Poétique, 1994-2001). Collaborateur théâtral de Marcel Bozonnet à la Comédie-Française (2002-2007), de Patrice Chéreau, de Brigitte Jaques-Wajeman (avec qui il a fondé la Compagnie Pandora) et d’Emmanuel Demarcy-Mota (Théâtre de la Ville), il est l’auteur de nombreuses traductions de théâtre et d’écrits sur le théâtre (Le Spectateur, Le théâtre et la mer, La doctrine inouïe, Théâtre – Equinoxes, Théâtre – Solstices, Percé jusques au fond du cœur, Une Mémoire).
