Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
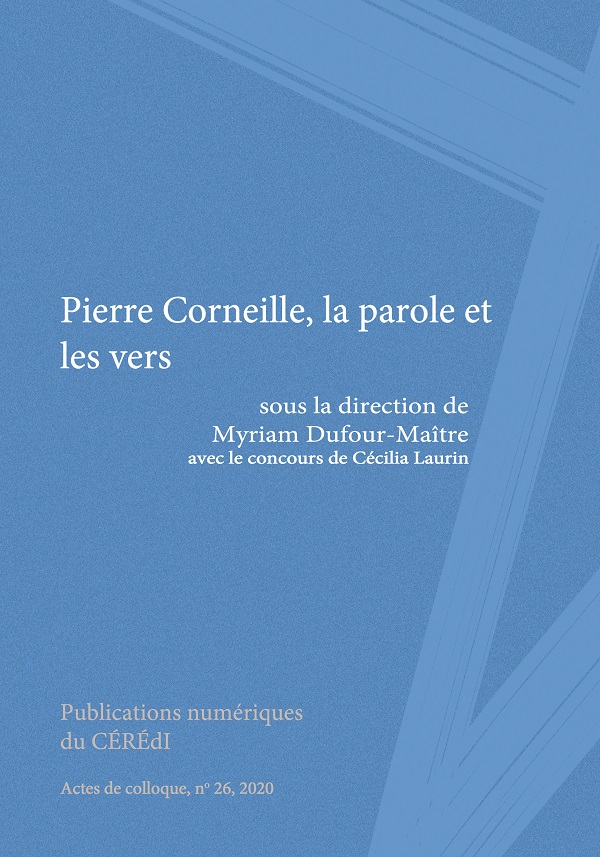
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Influence des versifications étrangères
Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
Liliane Picciola
Le Corneille du Cid nie avoir réalisé de simples traductions à partir de sa source espagnole. Le relevé de ses imitations (1648) permet d’apprécier son art de la réécriture, vouée à compenser l’impossible reproduction d’éléments historiques ou spectaculaires et des vers brefs du modèle. L’alexandrin s’enrichit d’éléments affectifs et imagés absents des octosyllabes. Bon analyste de la poésie spécifique des temps forts de la comedia, Corneille écrit des stances aux mètres et à la structure plus complexes que le monologue de Rodrigo ; le sémantisme puissant et les figures d’insistance restituent aussi en alexandrins l’émotion d’autres moments poétiques.
1Si les Espagnols, par ailleurs taxés d’ignorance ou de barbarie parce qu’ils n’avaient cure des poétiques de l’Antiquité, voyaient reconnaître quelque mérite à leurs œuvres dramatiques, c’était celui de l’invention. On sait que Le Métel de Boisrobert était particulièrement sensible à ce talent et que les intrigues des comédies composées par son frère, Le Métel d’Ouville, eussent été peu de chose sans les comedias. Rotrou et Thomas Corneille empruntèrent des actions plaisantes, aux multiples rebondissements, l’un à Lope de Vega, l’autre à Calderón, et, dans la préface du Menteur, Pierre Corneille rendit même un hommage très appuyé à l’invention de La Verdad sospechosa d’Alarcón, qu’il crut d’abord de Lope de Vega. Néanmoins le même Pierre Corneille et Jean de Rotrou, à son instar, avaient montré qu’ils savaient aussi apprécier la force du théâtre d’outre-Pyrénées dans le registre beaucoup plus grave qu’exigeaient les sujets d’histoire profane ou sacrée : Le Cid du premier comme Le Véritable Saint Genest et le Venceslas du second constituent des remaniements de beaux drames tragiques espagnols et en préservent le caractère à la fois grandiose et touchant.
2En revanche, nos adaptateurs d’en deçà des Pyrénées sont restés très discrets sur l’écriture de leurs modèles. D’une manière générale, on reprochait aux Espagnols leur grandiloquence et la complication de leurs manières dans la vie quotidienne car on les jugeait mal adaptées ; détonnant dans des circonstances ordinaires, elles ne s’accordaient cependant pas mal aux caractères bien trempés qu’on prête aux imposants acteurs d’événements historiques : les mots peuvent au fond servir de cothurnes, dont les spectateurs de l’Antiquité ne semblent pas avoir contesté la présence sur scène. Tout est cependant affaire d’échelle : la jactance dont le Comte de Gormas fait preuve dans Le Cid, et qui fut la cible des critiques de Scudéry, est moins espagnole qu’excessive par rapport au discours des autres personnages car la démesure des propos du Conde se perçoit aussi sous la plume de Guillén de Castro. Pour les autres personnages, ne convient-il pas de penser que l’expression verbale était en fait toujours proportionnée aux situations étranges, voire extrêmes, que créaient les dramaturges du Siècle d’or, à moins que la parole elle-même n’eût induit la création de ces situations : il n’est guère d’action d’éclat sans la pensée verbalisée de celle-ci. Baltasar Gracián estimait ainsi que, chez ceux qui pratiquaient l’art de l’esprit et du génie, l’acuité (agudeza) était à l’œuvre dans tout ce qu’ils faisaient et notamment dans la manière dont ils dénouaient les situations difficiles, comme les personnages des comédies et des tragédies1. Toutefois dans les comedias, la pratique d’un style élevé cohabite souvent avec l’insertion, parfois étendue, de répliques d’un style beaucoup plus humble et même se trouve mis en valeur par elles, leur dépouillement même leur conférant paradoxalement une force singulière.
3En 1648, quand il a réuni pour une édition collective la deuxième partie de ses œuvres2, Corneille a souligné, dans l’avertissement précédant Le Cid, ses emprunts à Las Mocedades del Cid de Guillén de Castro3, tout en ayant refusé avec véhémence, dans sa lettre dite « apologétique » à Scudéry4, de les considérer comme des traductions5. Il a alors fait imprimer en caractères différents6 les vers qu’il estimait, lui, avoir été tirés de ceux de Guillén de Castro7. En note, il a également fourni, en langue originale, le texte censé leur correspondre. Parfois des vers espagnols non mentionnés comme imités, et plus ou moins spatialement proches de ceux qui sont présentés comme tels, nous paraissent avoir alimenté certaines expressions cornéliennes bien que l’auteur français ne signale pas l’imitation. On se trouve alors tenté de penser que l’imitation n’était pas toujours consciente de la part d’un auteur imprégné d’un texte qu’il appréciait et comprenait en profondeur. Quoi qu’il en soit, ces précisions de l’édition de 1648 permettent non seulement d’apprécier les écarts qui existent entre le texte espagnol et le texte français mais de nous interroger sur l’origine des similitudes qui se révèlent entre eux.
4Des raisons techniques, qui seront exposées plus loin, doivent toutefois faire mesurer les écarts à leur juste valeur. Par ailleurs, même en l’absence de tout obstacle technique, une réécriture minimale s’imposait souvent, sans qu’elle pût signifier une divergence : en effet, un vers se ressent forcément du contexte dans lequel il doit être prononcé ; or les pièces respectives de Guillén de Castro et de Corneille présentent des différences importantes quant à l’ampleur et la complexité de l’action, et, du moins pour ce qui est du ressenti, quant à l’époque à laquelle les événements portés à la scène semblent se situer. Ainsi, l’union de Rodrigo et Ximena n’est nullement envisagée par leurs pères respectifs, qui vivent dans une rude Castille sentant son xiie siècle8, tandis que le rideau se lève sur la scène cornélienne à la veille de fiançailles officielles et dans une Cour dont le siège est à Séville, en Andalousie : autrement dit, pour les honnêtes gens des années 1630, le berceau de la galanterie. Dans une telle atmosphère, qui laisse l’impression que, malgré la présence du Cid, les événements se situent plus tard qu’ils n’ont eu lieu dans l’histoire de la Reconquête, le roi de Castille semblant bien installé au sud de l’Espagne, la réécriture de certaines répliques s’opérait forcément dans le sens de l’adoucissement ; mais, du fait même de cet adoucissement général, il pouvait se révéler utile de durcir occasionnellement certaines formulations afin de maintenir l’impression de grandeur et de puissance.
5Après quelques rappels concernant la métrique pratiquée dans les pièces espagnoles, on se propose donc d’étudier ici les réactions de Corneille aux vers qu’il a trouvés. A-t-il simplifié la matière verbale ? L’a-t-il resserrée (resserrer n’étant pas l’équivalent de simplifier) ? L’a-t-il étendue ? Il saute aux yeux que la plupart du temps, distingués des autres par une graphie particulière9, ces vers signalés comme imités débordent largement par leur nombre le cadre de la citation en langue originale, à laquelle un numéro de note renvoie ; de surcroît, l’inexactitude de ces citations en espagnol se révèle très fréquente. Ce surplus en nombre de vers et l’allongement de ceux qui sont imités constituent-ils des indices de la créativité cornélienne, stimulée, certes, par une expression espagnole précise, mais aussi par la situation de celle-ci dans un ensemble de vers ? Marquent-t-ils une volonté constante d’éviter une excessive concentration, telle qu’on la reprochait, par exemple, à Sénèque10 ? En réalité, Corneille opère parfois une condensation de la matière verbale, notamment en réduisant deux octosyllabes à un alexandrin.
6Il avait fortement défendu contre l’accusation de plagiat de Scudéry « soixante et douze vers […] que ceux qui s’y connaissent n’appelleront jamais de simples traductions » : avec raison, car il nous est apparu à travers cette étude que, dès l’instant que notre poète se situe dans un espace de vers différent de celui que nous allons décrire dans un premier temps, et dans un autre type de spectacle11, qui concerne moins les yeux que les oreilles et l’imagination, la meilleure manière de traduire plusieurs mots trouvés « en situation » ne consistait pas à fournir un nombre de mots équivalent mais de choisir des expressions qui s’adaptaient le mieux au nouveau contexte créé, dans lequel les mouvements intérieurs des personnages se mettaient en mots plus qu’ils ne se trahissaient par des extérieurs non verbaux. Les alexandrins cornéliens pouvaient également, selon l’émotion à susciter dans le public, servir de caisse de résonance à tel vers espagnol imité pourvu qu’il apparût au poète français comme véhicule d’une idée forte. Par ailleurs, c’est aussi aux accents, aux rythmes, à la musicalité, bref à la prosodie qui véhicule un sens, que le poète pouvait souhaiter fournir des équivalences. Aussi nous intéresserons-nous, parce qu’elle constitue un exemple frappant de ce type de recherche sur les effets des vers, à cette forme particulière que sont les stances du Cid : leur composition semble correspondre à une fine appréciation de l’effet produit par le monologue du Rodrigue espagnol et à un réinvestissement créateur de l’écriture émotive de la comedia. Ce réinvestissement ne se limite, au reste, pas aux stances.
La polymétrie et la versification espagnoles : un matériau pour la vivacité des alexandrins français
7Le théâtre français du xviie siècle se caractérise par l’usage généralisé des alexandrins, exception faite des stances, des lettres ou de billets enchâssés lus à haute voix, voire des prières. Au contraire, c’est la polymétrie qui règne dans la comedia. Le vers le plus utilisé y est toutefois l’octosyllabe, c’est-à-dire le plus long des vers de ce que l’on désigne comme « l’art mineur ». C’est le vers du dialogue théâtral, considéré comme voisin de la prose, ce qui contredit, au reste, la réputation de grandiloquence des personnages espagnols. Quand les échanges sont vifs, ces vers déjà courts sont, de surcroît, partagés entre plusieurs acteurs. Néanmoins, notamment pour exprimer une émotion, il arrive que les poètes aient recours à des vers plus brefs encore : les tétrasyllabes. En alternance avec des octosyllabes, Guillén de Castro en place dans la bouche de Rodrigo puis de Ximena, dans la scène qui a inspiré à Corneille l’émouvant dialogue entre les amants à la scène 4 de l’acte III du Cid. Il convient aussi de noter qu’à la lecture, certains vers peuvent apparaître comme des heptasyllabes ou des trisyllabes, mais n’en sont pas : c’est que, lorsqu’une dernière syllabe est accentuée – on a, bien entendu, affaire à des accents toniques – elle est considérée en métrique comme l’équivalent de deux syllabes. Ces vers d’apparence plus courts sont appelés agudos (aigus). Les vers qui se terminent par un mot proparoxyton semblent en revanche plus longs, d’une syllabe. Compte tenu de ces différences fondamentales, la « traduction » en français ne peut être que réécriture.
8Cependant il ne s’agissait pas toujours d’étoffer des vers a priori un peu grêles pour la déclamation française. En effet, l’on trouve parfois des vers plus longs dans les comedias car les poètes dramatiques y font un usage somme toute assez fréquent des endécasyllabes, notamment lorsque le contenu d’une réplique se révèle grave ou empreint d’émotion. C’est ainsi le cas, dans Las Mocedades del Cid, des vers prononcés par Diego Laínez quand il attend son fils après la mort du Conde ainsi que du dialogue qui suit et dans lequel il engage le jeune Rodrigo vers la bataille historique contre les Maures, le passage à l’endécasyllabe faisant alors inévitablement penser au « romance héroïque ». Un endécasyllabe espagnol porte généralement trois accents mais il peut même en porter quatre, comme l’alexandrin français. Par ailleurs, comme Jean-Marie Villégier l’a souvent souligné12, à l’épreuve de la diction, les alexandrins français se révèlent d’une souplesse à toute épreuve et il serait erroné de penser que, dans la bouche des comédiens, toutes leurs syllabes aient jamais été égales en durée, certaines pouvant même s’effacer quasiment au profit d’un rejet ou enjambement au vers suivant.
9Aussi l’incompatibilité de la versification espagnole13, telle qu’elle était pratiquée dans les comedias, avec l’écriture en alexandrins semble-t-elle largement illusoire, surtout lorsque c’est un Pierre Corneille qui s’attelle à transposer en français l’émotion et la « dramaticité » de certains vers bien frappés. Au reste, nous verrons plus loin que les endécasyllabes espagnols peuvent, en de certaines occasions, se marier avec un autre type de vers, dans un système assez subtil qui a retenu toute l’attention de Corneille.
10Le dialogue en octosyllabes se révélait souvent très libre en matière de rimes car la pratique du romance était fréquente : comme elle permettait l’usage des assonances dans les vers pairs, son naturel s’approchait de la prose dans ses effets. On y recourait essentiellement pour les narrations. Corneille n’eut néanmoins pas à se poser la question d’une éventuelle traduction pour le célèbre récit de la bataille du Cid puisque, chez Guillén de Castro, une partie du combat de Rodrigo contre les Maures se trouve racontée sur le vif par un amusant berger juché sur un promontoire tandis que l’autre se déroule jusque sur la scène. Notre poète, en plaçant au contraire le récit dans la bouche d’un Rodrigue devenu le Cid et en le faisant écouter par le roi Fernand, s’éloignait résolument de l’écriture de Guillén de Castro.
11Tra los montes, le groupement des vers était également très travaillé par les poètes dramatiques, particulièrement depuis Lope de Vega : sans qu’elles soient soulignées dans la disposition graphique, on trouvait dans les répliques des redondillas, quatrains le plus souvent constitués d’octosyllabes, mais parfois aussi de six ou sept syllabes, aux rimes embrassées ; les quintillas, groupements de cinq octosyllabes, présentaient deux rimes, jamais plus de deux vers successifs ne pouvant rimer ; l’octavilla, strophe de huit vers qui enchaînait deux redondillas, un vers de la première rimant avec un vers de la seconde était également employé. Nous évoquerons plus loin la strophe très particulière que constitue la silva. Enfin, il convient de noter le recours à l’estribillo, c’est-à-dire à la reprise régulière et à l’identique d’un vers ou de plusieurs vers, voire seulement, d’un fragment de vers, comme d’un refrain de chanson : la poésie dramatique se révèle alors plus que jamais proche de la musique par ses sonorités et son rythme14. En quelque sorte, malgré la simplicité des dialogues que nous avons soulignée, la pratique de la poésie au théâtre semble avoir été nettement assumée par les auteurs espagnols et bien reçue du public.
12On verra que Corneille a perçu quels avantages pouvaient en être tirés.
Traduire des vers espagnols : éviter la dilution dans l’alexandrin
Des décalques aux apparences de décalques
13Il arrive – c’est très rare – que notre poète traduise mot pour mot une brève expression. Qu’il le signale semble parfois dérisoire, vu la brièveté de l’emprunt, comme dans les trois exemples15 qui suivent :
|
|
|
|
|
|
|
|
14On note toutefois que l’expression française est moins saccadée, que, dans sa brièveté, elle se révèle moins familière (ajout de « Madame »), un peu plus pathétique (introduction de « misérable », transformation de « je meurs » en « je me meurs ») ; en quelque sorte, elle est adaptée au public huppé du théâtre du Marais19.
15À d’autres moments, on remarque, malgré une première impression d’avoir affaire à un décalque, une certaine recherche non dénuée d’intention. On peut l’apprécier dans la traduction de « Justicia, justicia pido » par « Sire, Sire, justice » au vers 653, prononcé par Chimène, au début de la scène 7 de l’acte II, qui, alors que la scène espagnole est écrite en octosyllabes, est entièrement composée en alexandrins. En effet, le demi-vers français ne fait pas porter la répétition sur le même mot que le vers espagnol, une traduction littérale20 posant un problème de métrique21 ; en revanche, le mot « justice » résonne aussi fort que « Justicia, justicia » puisqu’il est accentué par sa place avant la césure de l’alexandrin, réparti entre l’héroïne et Don Diègue. Au demeurant, la répétition de « sire » équivaut au vocatif « rey », placé à l’initiale des octosyllabes espagnols suivants, comme on peut le voir plus loin dans notre commentaire du vers 654.
16On peut encore apprécier cette recherche dans l’infime modification qu’opère la traduction de « Como Cavallero hiciste » (II, v. 293) par « Tu n’as fait le devoir que d’un homme de bien » (v. 921). Qu’un chevalier (caballero) soit « homme de bien », syntagme qui connote le souci de l’honneur et de l’estime d’autrui ainsi qu’une certaine piété (filiale ici), justifie évidemment la traduction. Cependant la formule prêtée à Ximena prenait surtout en compte le fait que Rodrigo venait à peine d’être adoubé, la cérémonie constituant le lever de rideau dans la comedia ; rien de tel dans la dramaturgie cornélienne, ce qui fait que rien ne se perd, objectivement, lorsque l’expression « homme de bien » se substitue au « chevalier » de l’auteur espagnol.
17Au vers 654 (« Chimène. – Je me jette à vos pieds. / Dom Diègue. – J’embrasse vos genoux »), le remplacement par deux hémistiches d’alexandrin d’une succession de deux octosyllabes (II, v. 27-28 : « Ximena. – ¡Rey, a tus pies he llegado! / D. Laínez. – ¡Rey, a tus pies he venido! ») a pour effet de maintenir à la fois la parfaite symétrie des répliques en octosyllabes et de renforcer la rapidité de leur enchaînement, ce qui permet aussi, et comme insensiblement, de changer respectivement dans chaque hémistiche le verbe, puis le verbe et le complément : néanmoins, la graphie de ces vers dans l’édition de 1648 les présente comme des « traductions ». Ce soin extrême apporté à d’infimes détails révèle que Corneille ne s’est pas contenté de faire passer des mots dans une autre langue. Il affiche notamment son goût de la variété, mais de la variété signifiante. En effet, embrasser les genoux est le geste du suppliant grec, de l’homme qui a commis un crime et qui arrive dans un lieu étranger, voire un temple, et y demande protection, accueil et parfois purification : il est parfaitement adapté à Dom Diègue, qui, au reste, demande moins la purification pour lui que pour son fils. Se jeter aux pieds de quelqu’un est surtout le geste de la plus grande humilité, de celui qui n’est rien et qui attend tout de l’aide d’autrui : c’est bien la situation de Chimène, désormais sans appui, et à laquelle le roi dira servir désormais de père. Corneille, par le choix des mots, assigne à chacun sa juste place.
18Notre poète pouvait assurément traduire sans contrarier le moins du monde la métrique « A mi padre han muerto » (I, v. 31) par « On a tué mon père » ou « Ils ont tué mon père » (six syllabes, en français comme en espagnol) ; or on lit : « Il a tué mon père » (v. 658). Le choix du pronom, dont la présence est indispensable en français, se révèle significatif : Ximena accusait conjointement Rodrigo et Diego Laínez, ce qui pouvait être considéré comme une manière d’atténuer la culpabilité de son amant ; Chimène, elle, ne vise que Rodrigue, ce qui rend le vers plus offensif dans ce qu’on regarde comme la Cour de justice du roi Fernand, mais qui exprime aussi l’insupportable de la douleur de l’amante : que Rodrigue soit l’auteur du meurtre. Par ailleurs, comme l’inversion se pratique couramment tra los montes en poésie et dans la comedia versifiée et que l’ordre des mots ne pouvait être respecté sans contrarier le naturel, le « il » lancé par Chimène impose d’abord l’image de Rodrigue, exprimant la souffrance de l’amante blessée avant celle de l’orpheline.
Des alexandrins pour davantage de sentiments
19Comme souvent, Corneille profite de la nécessité d’allonger un vers – en l’occurrence le vers 506 de la journée I de Guillén de Castro, qui a quelque chose de neutre et d’expéditif – pour recourir à de courtes périphrases qui personnalisent la formulation et, par-là, la rendent plus sensible à l’interlocuteur. Ainsi, sous la plume de notre poète, Dom Diègue transforme le « poderoso es el contrario » de Diego Laínez en « Je te donne à combattre un homme à redouter » au vers 278. L’adversaire, el contrario, devient « je te donne à combattre », qui impose fortement aux yeux de Rodrigue le duel à venir ; sa difficulté spécifique est mieux exprimée par « un homme à redouter22 » que par « poderoso ». En effet, la situation dans laquelle ces deux vers sont respectivement introduits dans les deux pièces n’est pas la même, et Corneille en tient compte. D’emblée, le vieillard espagnol a désigné à Rodrigo le Conde de Orgaz comme son offenseur et il énonce ensuite la conduite à tenir dans le seul souci de sa vengeance ; Dom Diègue, en revanche, n’a pas encore prononcé le nom de son offenseur, et il prépare lentement son fils non seulement à une rude épreuve d’épée mais à une pénible épreuve morale : cette attention se vérifie dans le reste de la scène où il évoque l’amour de Rodrigue pour Chimène, alors que Diego Laínez le passe sous silence23. Dans cette perspective, l’allongement du vers aboutit à une sorte d’éloignement d’un réel trop dur.
20Au cours de la même tirade espagnole, il a été par deux fois question de la tache (mancha) que le soufflet du Conde a laissée sur la joue du vieux guerrier et, alors qu’après la mort de l’offenseur le vieillard exhibera sa joue imprégnée du sang d’Orgaz, et ainsi « lavée » de son infamie, le discours de Diego Laínez à son fils se conclut, dans un style incisif : « Aquí ofensa y allí espada24 » (I, v. 513) ; compte tenu de ce contexte, les adverbes de lieu semblent indiquer que le vieillard porte une main à sa joue en prononçant le mot « ofensa », avant de désigner de l’autre main l’épée devenue trop lourde pour lui. Dans le vers 288 du Cid, « Enfin tu sais l’affront et tu tiens la vengeance », la relative sollicitude paternelle du senex cornélien se traduit dans l’atténuation de l’urgence que crée le verbe « savoir », la polysémie de « tu tiens », dans le remplacement de la concrète « épée » par « la vengeance », et dans l’effacement des contraignants adverbes25.
21L’enrichissement de la personnalité prêtée aux personnages pour lequel l’allongement des octosyllabes est mis à profit se remarque également dans les vers 980-982 que Corneille place dans la bouche de Chimène :
Et je veux que la voix de la plus noire envie
Élève au ciel ma gloire et plaigne mes ennuis,
Sachant que je t’adore et que je te poursuis.
22Ils sont censés traduire les vers 309-311 de la journée II :
Disculpará mi decoro
con quien piense que te adoro
el saber que te persigo26.
23L’accroissement de la matière verbale paraît ici plus conséquent ; en fait, à y regarder de plus près, l’allongement ne porte que sur le premier octosyllabe, qui débouche sur la composition de deux alexandrins, le contenu des deux octosyllabes suivants se trouvant au contraire concentrés dans le troisième vers français, selon un procédé que nous verrons plus loin. L’héroïne espagnole formulait une simple idée d’excuse (« disculpará mi decoro ») ; sous la plume de Corneille, la crainte d’un jugement défavorable (« noire envie ») porté sur sa trop grande lenteur à châtier Rodrigue se retourne en revendication27 d’une brillante réputation de femme forte : « élève au ciel ma gloire ». Grâce à l’ajout, la démarche se révèle ainsi beaucoup plus complexe et valorisante pour l’héroïne féminine. On peut parler ici d’une sorte de durcissement compensateur de l’héroïne.
Matière verbale et dramaticité des vers
24Lisant dans la deuxième journée la scène au cours de laquelle Elvira découvre avec stupéfaction Rodrigo qui s’est introduit dans la demeure de Ximena, Corneille trouvait deux octosyllabes extrêmement expressifs (v. 180-181 : « ¿quándo fue casa del muerto / sagrado del matador28? ») qui, dans un jeu de rimes croisées, faisaient se succéder en fin de vers muerto et matador (rimant avec le vocatif du tétrasyllabe précédent : « Pues, Señor ») et assuraient une symétrie syntaxique entre casa del muerto et sagrado del matador ; pas d’articles, comme si la camériste parvenait à peine à parler, une situation résumée à l’essentiel dans une question. Une telle puissance dans la brièveté était difficile à restituer. Corneille a alors choisi paradoxalement de composer deux dodécasyllabes, ce qui lui a permis de rapprocher l’expression « maison du mort » du mot « meurtrier », tous deux mis en relief par leur position respective à la fin du premier vers et au milieu du second, et ainsi séparés par seulement trois syllabes – contre quatre dans le texte espagnol. Par ailleurs, la présence de Rodrigue chez Chimène est si étonnante pour Elvire qu’il n’est pas déplacé de lui faire dupliquer l’image de l’« asile » du vers 758 par celle du « refuge » dans le vers suivant, le terme « sagrado », qui désigne un refuge sacré, méritant bien ce redoublement. L’adverbe « jamais » souligne l’extraordinaire de l’action, dont le caractère volontaire est souligné par « chercher » ; une interrogation succédant à une exclamation rend compte de la stupéfaction qui s’exprimait dans l’économie précipitée des mots espagnols.
25Tout en excluant les gestes et la stimulation verbale d’images trop rudes, Corneille cherchait néanmoins à susciter le plus de pitié possible, voire, comme l’écrit Aristote dans le chapitre VI de La Poétique, des émotions qui ont quelque rapport avec elle29. Ainsi, dans la logique d’une relation de la maîtresse et de sa gouvernante plus confiante et affectueuse que dans Las Mocedades del Cid30, Corneille, tout en présentant ses vers comme une traduction, prête en réalité à Elvire une présentation de Chimène beaucoup plus sensible que celle d’Elvira. Là où, selon lui, Guillén de Castro lui faisait dire, de manière très factuelle : « Ximena está / cerca Palacio, y vendrá / acompañada31 », le poète du Cid ajoute dans la réplique d’Elvire un hémistiche exprimant l’émotion et destiné à la communiquer à Rodrigue : « Chimène est au Palais de pleurs toute baignée » ; par ailleurs, la mention de l’obstacle technique à la rencontre des deux amants se trouve complétée par l’image de la sollicitude dont l’héroïne a besoin quand il écrit : « Et n’en reviendra point que bien accompagnée ».
26C’est sans doute aussi pour faire paraître toute la violence de la douleur de Chimène que Corneille, dans les vers 665-666, lui fait évoquer dans ces termes la découverte de son père mort : « […] mes yeux ont vu son sang / Couler à gros bouillons de son généreux flanc ». Il signale alors qu’il a traduit Guillén de Castro : « Yo vi con mis propios ojos / teñido el luziente azero32 ». C’est peu de dire que, hormis pour la mention du regard effaré, l’imitation manque d’évidence. Là où l’héroïne espagnole insiste sur l’épée souillée de sang, et incrimine donc Rodrigo, l’héroïne française considère la seule blessure : la reprise ici laisse sceptique. En revanche, l’image sera reprise par notre auteur, sans qu’il le signale cette fois, quand Rodrigue remet son épée à Chimène et qu’elle s’exclame : « Quoi du sang de mon père encore toute trempée33 ? ». Corneille confond-il ses emprunts, qu’il n’a dû récapituler qu’après coup, et de mémoire ? L’évocation de l’abondance du flux de sang exprime la violence, voire l’exagération, du souvenir chez Chimène. Corneille ne se montrerait-il pas ici plus expressif34 que Guillén de Castro ? Il convient sans doute de corriger cette impression en considérant les didascalies du texte espagnol, auxquelles Corneille ne semble pas être resté indifférent. En effet, au début de la scène, Guillén de Castro précise que Ximena entre avec « un pañuelo lleno de sangre ». Tout au long de la scène, l’exhibition de ce « mouchoir imprégné de sang » impose l’image du flux qui l’a teinté et dit la force du souvenir laissé sur la fille par la blessure du père. Corneille, encore une fois, ménage les regards de ses spectateurs, mais sans renoncer pour autant à frapper leur imagination afin de faire comprendre la douleur, voire l’horreur, qui saisit son héroïne : on peut considérer que le vers « Couler à gros bouillons de son généreux flanc » est bien inspiré par cette didascalie et l’image scénique qu’elle induit. Ainsi la réécriture des vers nous semble souvent viser, par d’infimes ajouts ou modifications, à restituer par les mots un contexte visuel précis et non reproductible.
27Au cœur d’une dramaturgie délibérément moins épique mais plus susceptible d’incursions dans l’intime, la traduction, dans les alexandrins cornéliens, se révèle donc suffisamment plastique et fidèle pour restituer la simplicité de certaines conversations en l’adaptant, mais aussi porteuse de nuances pour suggérer en maints endroits des sentiments délicats, et enfin riche d’images pour émouvoir par ce qui ne peut être imposé aux yeux.
28Néanmoins ce sont les stances de Rodrigue et sa confrontation avec Chimène, une fois le Comte tué et la plainte pour meurtre déposée, qui semblent à la fois avoir été le plus inspirées par le texte de Guillén de Castro et avoir débouché sur la réécriture la plus subtile. C’est que Corneille n’entendait pas se priver des avantages que donne sur le public tout ce qui concourt à la création du « poignant », ce terme très polysémique étant entendu comme l’équivalent de ce que Baltasar Gracián appelle la agudeza et que son traducteur, Benito Pelegrín, nomme l’acuité35.
Une réécriture guidée par la recherche du poignant
Des silvas aux stances
29Il nous paraîtrait aventureux d’affirmer que c’est la présence de nombreux vers longs et par-là le sentiment d’une certaine ressemblance avec la versification tragique française qui aurait incité Corneille à suivre de vraiment près le texte de Guillén de Castro à ce moment précis de l’action. L’intérêt marqué pour cette scène semble dû essentiellement aux effets produits par la diversité et la musicalité de ces vers espagnols.
30Corneille semble cette fois avoir imité non seulement des expressions mais une macrostructure, s’étendant sur plusieurs dizaines de vers, pour mieux saisir l’auditoire. Il se trouvait en présence d’un moment singulier, d’une triade d’octains rimés, correspondant à la forme poétique des silvas36, à laquelle succédait une longue suite de quarante-quatre octosyllabes tantôt en consonance, tantôt en assonance. La comedia de Guillén de Castro étant le plus souvent composée d’octosyllabes, il saute aux yeux, quand on lit le début de la méditation de Rodrigo, qu’on se trouve en présence d’un morceau de rupture émotive, d’une sorte de pause en faveur de l’intensité réflexive. D’abord, l’examinant, Corneille ne se trouvait pas seulement en présence d’endécasyllabes comme nous l’évoquions plus haut mais devant une alternance de vers de onze syllabes (vers 2, 4-5, 7-8) et de vers qui n’en comptent que sept (vers 1, 3, 6). Dans la première silva, l’on trouve quatre vers aux rimes embrassées, puis deux vers aux rimes suivies, et deux autres vers aux rimes suivies ; dans la seconde on a seulement affaire à des rimes plates ; la troisième reprend le schéma de la deuxième. On perçoit que toute monotonie est ainsi évitée.
31La scène 5 de l’acte I du Cid vise assurément aussi la singularité par sa forme, d’autant plus que, contrairement au monologue de Rodrigo, elle est immédiatement suivie de l’entracte, qui lui sert ainsi de caisse de résonance. Le niveau d’expressivité obtenu par Guillén de Castro pour ce moment tenait beaucoup à l’emploi, inhabituel, de l’endécasyllabe, qui ne commence qu’au deuxième vers, le premier vers, un heptasyllabe, semblant d’abord se différencier peu des octosyllabes courants. Pour faire détonner les propos par rapport au reste de l’écriture de l’acte I, Corneille a d’abord jugé nécessaire d’écourter d’emblée le vers français, coupant en quelque sorte le souffle à son héros dans l’octosyllabe « Percé jusques au fond du cœur ». Puis on croit à un retour aux alexandrins, à la normale, en quelque sorte, pour favoriser l’analyse de la situation ; mais voilà que Rodrigue s’exprime en hexasyllabes, puis en décasyllabes. L’hétérométrie se révèle, et bien plus complexe que celle que recèlent les silvas de Guillén de Castro. De toutes les stances que le poète a composées, ce sont celles qui présentent les mètres les plus variés37. Par ailleurs, les rimes suivies du reste de la tragi-comédie sont ici remplacées par un ensemble complexe : quatre vers aux rimes embrassées, deux vers aux rimes suivies, quatre vers aux rimes croisées. Sans être identiques à ceux de l’auteur espagnol, les choix de Corneille s’en approchent ici, le poète ayant voulu donner un signe fort à Montdory qui allait incarner Rodrigue. Il convient de noter que, dans sa dramaturgie, le jeune héros vient tout juste d’apparaître sur scène, pour se voir confier sa mission vengeresse : en quelque sorte le Cid naissait sous les yeux du public quand l’acteur prononçait ces vers.
32Cependant, pour composer ces stances, le travail de Corneille ne s’est pas borné à introduire la variété dans les mètres et dans les rimes. L’effort a également porté sur les rythmes et sur les sonorités. L’importance de ce travail avait été critiquée par d’Aubignac car le caractère ouvertement poétique de ce moment aurait succédé trop vite, selon lui, au choc que venait de provoquer en Rodrigue la demande de son père et la conscience de son propre déshonneur38. C’est que l’abbé n’était sans doute pas sensible à la souplesse de parole qu’en réalité offrent ces stances et qui reproduit, mutatis mutandis, celle que le poète trouvait chez Guillén de Castro.
33Un endécasyllabe espagnol peut porter jusqu’à quatre accents, comme l’alexandrin français et il appartient à ce qu’on appelle l’arte mayor : en soi, il en impose. Toutefois, dans le cas de ce monologue de Rodrigo, l’on peut considérer que la présence des heptasyllabes atténue l’effet des endécasyllabes et les déstabilise. La structure rythmique de l’endécasyllabe peut être a minore de 5-6 et de 4-7, a majore de 6-5 ou de 7-4. Le vers de sept syllabes peut donc constituer une reprise, ou une première formulation rythmique, d’une partie de l’endécasyllabe : c’est pourquoi on le désigne comme le pie quebrado, le « pied divisé » de ce vers d’arte mayor. L’utilisation du pie quebrado de l’endécasyllabe était considérée comme particulièrement musicale car elle rendait les ictus très sensibles, valant en même temps pour deux vers. Le cours des pensées se perd dans des jeux de miroirs. On peut le constater dans l’alternative de découpage que semblent offrir pour la diction les vers du premier octain de Rodrigo :
|
|
|
|
34Chez Corneille, l’hexasyllabe peut également être considéré comme le quebrado de l’alexandrin ; l’enchaînement du deuxième hémistiche du vers 297 et de l’hexasyllabe suivant formerait un vers de douze syllabes, porteur de quatre accents tandis que le premier hémistiche du vers 297 deviendrait hexasyllabe :
Je demeure immobile
Et mon âme abattue cède au coup qui me tue.
35De surcroît, l’hexasyllabe est aussi le quebrado du décasyllabe ; au plan rythmique, Montdory pouvait dire :
Ô Dieu, l’étrange peine ! En cet affront
Mon père est l’offensé
Et l’offenseur le père de Chimène.
36On peut donc dire que Corneille a renchéri sur le lyrisme et la musicalité du monologue espagnol. Le refrain du Cid s’étend mélancoliquement sur trois vers (26 syllabes) au lieu de deux (22 syllabes) et donne plus d’importance à une sorte de parlé-chanté. Le poète renforce ainsi l’effet de l’estribillo repéré dans le texte espagnol et signalé comme imité. Néanmoins, grâce au jeu des rimes croisées, le refrain ne peut être séparé du reste de la strophe.
37Corneille se montre attentif aux détails de son modèle. S’il a imité le retour de la rime pena / Ximena, il a également noté que Guillén de Castro pratique la variété au sein même de la monotonie nécessaire du refrain car ce dernier écrit successivement « extrãna pena », « brava pena » puis « amarga pena41 » : Corneille, quant à lui, emploie deux fois « étrange peine », puis trois fois « ma peine », et enfin seulement « peine », comme si l’affliction devait obligatoirement s’éloigner au profit de la décision et de l’action. De fait, après la forme « amarga pena », le refrain disparaît soudain chez Guillén de Castro, en même temps que le recours à l’émotive silva, car les quarante-quatre vers qui suivent constituent une suite d’octosyllabes présentant seulement des consonances à de certains moments. Ainsi dans la comedia on perçoit nettement que la prise en compte de la douleur amoureuse s’interrompt après trois silvas. Chez Corneille elle ne s’éteint au contraire que très progressivement, toute la scène étant composée de six stances.
38Peut-on dire pour autant que le poète français a renchéri sur le lyrisme ? En réalité, s’ils semblent s’arrêter au même moment que ceux de Rodrigue, les déchirements de Rodrigo reprennent quand il va provoquer le Compte d’Orgaz sous le double regard de son père et de Ximena. Il emploie alors une expression proche d’un vers des silvas (I, 532 : « ¿y he de verter su sangre?… ¡brava pena! ») : « Que he de verter / sangre del alma42 » (I, v. 684-685) et la répète aux vers 712-713. Le prolongement des stances de Rodrigue bien au-delà de la limite des silvas correspond à ces ultimes hésitations du héros. En prolongeant ces couplets, Corneille, au fond, traduit encore, mais dans le sens large d’une transmutation de la matière.
39Il nous semble par ailleurs que les stances font entendre leurs échos beaucoup plus tard dans l’action. Alors, à l’effusion musicale, Corneille préfère l’intensité sémantique des mots. Quand Rodrigue retrouve Chimène, la souffrance est toujours là, mais elle est plus raisonnée, ayant en quelque sorte mûri dans l’épreuve : le poète opte pour la relative régularité des alexandrins, qui n’en sont pas moins poignants.
L’acuité espagnole parmi les alexandrins
40Dans la scène 4 de l’acte III, Corneille signale parmi ses emprunts le célèbre vers 900 : « Qui m’aima généreux me haïrait infâme ». Cet alexandrin est le résultat de la contraction de deux octosyllabes : « Por infame aborrecieras / quien quisiste por honrado43 » (II, v. 270-271). Certes, notre poète ne restitue pas le chiasme, qui fabriquait une formule saisissante, constituant une clôture propre à refléter le piège tendu par l’honneur à l’amour. Cependant traduire ces deux vers en utilisant une tournure impersonnelle aboutit, sinon à imposer l’idée du piège, du moins à énoncer comme une loi la haine associée à l’infamie, les deux hémistiches restituant au reste assez bien la symétrie des deux octosyllabes espagnols. Gracián a souligné l’efficacité des formules sentencieuses44. Par ailleurs, comme on va le voir, Corneille ne se contente pas d’une brève traduction pour donner toute sa force à l’idée exprimée.
41En fait, dans l’édition de 1648, le poète réfère en note à trois octosyllabes et un tétrasyllabe, mais, comme la graphie l’indique, c’est un ensemble de cinq alexandrins qu’il aurait composés à partir d’eux. Toutefois ainsi que nous l’avons déjà supposé, Corneille semble souvent renvoyer plus à une zone de texte qu’aux lignes précises qui l’ont inspiré. Ainsi, sans le dire explicitement, dans l’alexandrin « Et ta beauté sans doute emportait la balance », qui naît essentiellement de la fusion de quatre octosyllabes (II, v. 264-267),
[Lucharon a mi despecho,
contrapuestos en mi pecho
Mi afrenta y tu hermosura]
Y tú, Señora, vencieras45,
42il emprunte à Guillén de Castro l’idée de la pesée comparative, qu’il reprend quelque peu dans « opposé contre tous tes appas ». Mais sous la plume de Corneille, cette idée prépare les trois vers suivants :
Qu’un homme sans honneur ne te méritait pas,
Qu’après m’avoir chéri quand je vivais sans blâme
Qui m’aima généreux me haïrait infâme.
43Cette triade forme un nœud verbal dans lequel se ré-énonce et se répète ce que le héros ne concluait de ses stances qu’en filigrane dans les vers 337-338 (« Respecter un amour dont mon âme égarée / Voit la perte assurée ! ») et 342 (« Puisqu’aussi bien il faut perdre Chimène ») : l’absence de vengeance, donc le déshonneur, signifiait le mépris de Chimène. Cette confrontation du déshonneur et du regard de l’héroïne ne s’effectue qu’une fois chez Guillén de Castro, dans le vers 271, cité plus haut. Rodrigue, lui, rappelle sous toutes ses facettes46 la situation telle qu’elle lui est apparue avant d’avoir provoqué le Comte en duel : en fait l’absence de choix, qui impliquait la solution, pénible, mais à la fois unique et brillante, une fois le problème bien posé. C’est le « dénouement » cher à Gracián : on peut considérer que Rodrigue a d’abord donné à son cas un « dénouement par le faire », et qu’a posteriori, devant Chimène, il lui donne un « dénouement par le dire47 ». Une telle concentration d’idées très proches fait apparaître ces alexandrins comme une fixation douloureuse des pensées sur un point indépassable, une sorte d’abcès. D’où l’idée d’acuité à laquelle nous référerons sous le terme de « poignant » dans le titre de cette partie. Ce sont les stances qui résonnent dans ces alexandrins.
L’exagération poignante : la densité sémantique de l’alexandrin
44Dans la même scène, le texte se révèle également poignant par une indéniable exagération, que Gracián qualifierait d’ingénieuse48, et qu’on ne trouve pas dans le modèle espagnol, bien que Corneille s’en éloigne peu en apparence :
|
|
45Deux alexandrins semblent constituer ici l’équivalent des quatre vers espagnols mais la répartition de la matière verbale attire l’attention. Si le premier vers du distique cornélien apparaît comme un équivalent du quatrième vers prêté à Rodrigo par Guillén de Castro – un peu renforcé par l’ajout neutre de « Eh bien » et la présence anticipée du non moins neutre verbe « vous donner » dans une expression figée –, le second se révèle beaucoup plus expressif : en effet, gusto n’est pas le terme le plus fort pour dire le plaisir (placer, ou gozo seraient plus éloquents), et il ne semble présent que pour contrebalancer pena, les deux mots occupant exactement la même place dans l’octosyllabe, vers bref qui, en l’absence de ponctuation, n’a pas à être coupé en son milieu ; or Corneille, qui accorde au mot « plaisir » une place privilégiée, sous l’accent de fin d’hémistiche – à marquer dans la diction malgré l’absence de virgule car il existe une assonance entre « plaisir » et « vivre » –, le fait précéder d’un verbe qui connote une pleine jouissance : « saoulez-vous » ; il se révèle d’autant plus saisissant qu’il s’agit d’un impératif placé en début de vers.
46La tournure employée par Rodrigo, qui avait déjà insisté sur sa soumission (« rendirme »), met en valeur le don de la vie du jeune cavalier à celle qu’il aime par l’expression « te da », à l’indicatif, placée en tête de vers ; par ailleurs, la triple rime firme / rendirme / seguirme oppose discrètement une sorte de stoïcisme à la fois fidèle et immobile à la poursuite de Ximena50. On garde de ces trois vers l’impression d’une hâte, peu éloquente, d’en finir, d’une émotion insupportable, que portent les tétrasyllabes (pie quebrado des octosyllabes) dont le discours est émaillé.
47Le vers du héros cornélien se révèle porteur d’autant d’émotion, mais par la force même du signifié : l’association de deux mots connotant la jouissance suggère en Chimène un comportement de bourreau, en contradiction avec ce qu’elle vient d’avouer à Elvire dans la scène précédente, Rodrigue recherchant ou semblant rechercher une punition. Par ailleurs, l’expression « m’empêcher de vivre » n’est pas plus une litote que le fameux « Va, je ne te hais point » : ce second hémistiche dit la peur de Rodrigue de devoir vivre encore (il dira plus loin « vivre avec ta haine »). Autrement dit, l’expression de la douleur se trouve encore ici portée à un paroxysme.
48Corneille se révèle un excellent lecteur, qui s’est laissé imprégner par la force du texte qu’il a découvert ; il entendait de toute évidence la conserver dans le cadre nouveau qu’offrait à l’action la scène française. Des scènes retenues, il n’a pas laissé perdre de matière, investissant ici ce qu’il avait là laissé de côté, mais s’autorisant à changer quelques couleurs de mots et de caractères. Imitant par réminiscence et non en composant à partir d’un décalque, il s’est senti libre à l’égard de sa source. S’il n’a pas relevé assez d’emprunts par rapport à la réalité de ce qu’ils sont, c’est assurément parce qu’il s’était sincèrement réapproprié certaines formules, notamment les formules autoréférentielles, parfaitement adaptées aux réactions de tel ou tel personnage à la situation qui lui était faite. Ce sont en effet les situations, les cas, qui retenaient l’attention de Corneille : se les réappropriant, il était amené à employer les mots qui, dans l’univers créé par sa poésie dramatique, les disaient le plus fortement ; les rencontres entre les mots espagnols et les siens, exceptionnelles et d’une brièveté désarmante, ne peuvent être que coïncidences.
49On dira de sa réécriture qu’elle révèle en lui un fin observateur et un fin praticien de la versification, qu’elle ne se développe jamais sans le souci de la dramaticité ni celui de la cohérence des rôles, qu’elle cherche constamment à plier le discours aux nouveaux auspices donnés à l’action, que, si elle vise à faire entendre des paroles quasiment performatives et non des vers, c’est en les faisant prononcer par des personnages puissamment poétiques et d’une sensibilité aussi exceptionnelle que les actes dont ils sont capables : « si percevoir l’acuité est d’un aigle, la produire est d’un ange », écrit Gracián51.
1 Baltasar Gracián, Art et figures de l’esprit [Agudeza y arte de ingenio, Huesca, Nogues, 1648] dans Traités politiques esthétiques, éthiques, présentés et traduits par B. Pelegrín, Discours XLV, p. 643-646.
2 Œuvres de Pierre Corneille, Seconde partie, Paris, Toussaint Quinet, 1648, mais aussi également dans les éditions de 1652 et 1655.
3 Nous référons à l’édition fournie par le site de la « Biblioteca virtual Miguel de cervantes », www.cervantesvirtual : http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-mocedades-del-cid--0/html/, consulté le 4 novembre 2020. Elle a été établie d’après la toute première édition de Las Mocedades del Cid (dans Primera parte de las obras de Don Guillén de Castro, Valencia, Felipe Mey, 1618). La numérotation des vers, donnée journée par journée, a été effectuée en suivant l’édition critique de Luciano García Lorenzo (Madrid, Cátedra, 1998, 3e éd).
4 Nous donnons le texte de cette lettre dans l’édition du Cid qui figure dans Pierre Corneille, Théâtre, tome II, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 830-834.
5 Néanmoins, en 1648, une fois la querelle apaisée, et après avoir écrit « ce que j’ai emprunté », Corneille emploie le mot « traduit » quelques lignes plus loin.
6 Expression exacte employée par Corneille pour désigner cette graphie particulière pour les vers imités : « dans une autre lettre ».
7 Il avait déjà permis à Richelieu de constater d’éventuels emprunts en lui apportant l’original espagnol en 1637. Voir la lettre apologétique citée dans notre note 4.
8 Sur ces différences d’atmosphère historique séparant Le Cid et sa source dramatique voir notre Corneille et la dramaturgie espagnole (Tübingen, Gunter Narr Verlag, Biblio 17, 2002), p. 194-195.
9 Voir notre note 6.
10 Sénèque était d’origine espagnole.
11 Les comedias étaient composées pour être représentées dans des corrales fréquentés par un public très mêlé, et souvent populaire, qui avait peu à voir avec le milieu des officiers qui assistait aux représentations du théâtre cornélien dans le quartier du Marais.
12 On peut se référer à Jean-Marie Villégier et Marion Chénetier-Alev, « La déclamation de Julia Bartet ou l’encodage de la mémoire vocale. Échange avec Jean-Marie Villégier autour de l’écoute de deux archives sonores », Revue Sciences / Lettres [En ligne], 5 | 2017, mis en ligne le 02 octobre 2017, consulté le 12 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/rsl/1130 ; DOI : https://doi.org/10.4000/rsl.1130, et notamment au propos du metteur en scène au paragraphe 34.
13 Voir le détail dans Leah Marmolejos, Métrica española, Madrid, Ariel, 2001 (14e éd.).
14 Sur le rapport entre la comedia nueva et la musique voir notamment Lola Josa, « Reflexiones sobre la música como principio rector en el teatro de Luis Vélez de Guevara », Criticón [En línea], 129 | 2017, publicado el 10 mayo 2017, consultado el 07 febrero 2020. URL : http://journals.openedition.org/criticon/3336 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criticon.3336.
15 Dans nos citations, nous plaçons entre crochets les informations ou compléments de vers qui ne sont pas donnés par Corneille. Par ailleurs, nous fournissons en note une traduction juxtalinéaire des expressions ou vers cités afin de mieux faire apprécier le travail du poète dramatique, qui, lui, ne pratique pas ce type de traduction.
16 « Qu’as-tu fait, Rodrigue ? »
17 « Parle. Repose-toi ».
18 « Écoute – Je meurs ».
19 Voir notre note 10.
20 « Justice, justice, je demande ».
21 Une traduction en deux syllabes de « pido » par « pour moi », par exemple, eût abouti à créer un octosyllabe. Mettant à part le caractère peu esthétique du vers ainsi obtenu, on voit mal comment aurait pu être maintenue la symétrie entre la réplique de l’héroïne et celle de Dom Diègue.
22 Dans la comedia, Rodrigo reprendra à son compte l’expression « poderoso contrario » employée par son père dans son propre monologue.
23 Diego Laínez ne mentionne l’amour de Ximena pour Rodrigo que lorsqu’elle réclame justice au roi pour la deuxième fois.
24 « Ici l’offense, là l’épée ».
25 Ce n’est pas seulement dans l’allongement des vers qu’on peut noter chez Corneille la pratique d’une sorte d’éloignement qu’on pourrait qualifier de bienséant. On peut la remarquer aussi dans la fusion de deux octosyllabes en un alexandrin. Au début de la scène 6 de l’acte I du Cid, quand Dom Diègue pique l’honneur de son fils en lui demandant s’il a du cœur, et non pas comme son homologue espagnol en l’humiliant par une morsure au doigt, la verbalisation de l’orgueilleuse colère du jeune chevalier est proportionnée à la provocation de son père. En effet, là où Rodrigo s’exclame aux vers 470-471 de la première journée : « ¡Si no fuérades mi padre / diéraos una bofetada! » (« Si vous n’étiez pas mon père / Je vous donnerais un soufflet »), Corneille fait dire à son héros : « Tout autre que mon père l’éprouverait sur l’heure » (v. 263-264), ce qui n’inflige pas une image trop fâcheuse à l’esprit du spectateur. Peut-être à cause du changement général d’atmosphère subtilement opéré, le poète a, au reste, oublié de mentionner au moins l’emprunt littéral du premier hémistiche au texte espagnol, mais ce n’est pas le seul oubli qu’on peut remarquer.
26 « Excusera mon honneur, / auprès de quiconque pensera que je t’adore, / l’idée que je te poursuis ».
27 Comme on peut le constater, le « je veux » n’apparaît nullement dans la formulation espagnole.
28 « Quand maison du mort / fut-elle sanctuaire pour le meurtrier ? »
29 « τοιούτων παθημάτων » (Aristote, La Poétique, édition et traduction de Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, Paris, Le Seuil, 1981, p. 53 ; dans leurs commentaires des lignes 49b27, les critiques emploient l’expression « troubles apparentés »).
30 Elvira apparaît pour la première fois sur scène quand Rodrigo s’introduit dans la maison de Ximena. La scène dans laquelle, après avoir sondé le Comte sur ses intentions à l’égard du mariage de sa fille, Elvire s’entretient avec sa maîtresse n’existe nullement dans la comedia. Par ailleurs, la scène au cours de laquelle Elvira console sa maîtresse sous les yeux de Rodrigo caché est beaucoup plus courte chez Guillén de Castro (25 octosyllabes et 2 tétrasyllabes contre 56 alexandrins).
31 La citation est inexacte car le nom de Ximena n’est pas prononcé par Elvira. On lit dans les vers 191-193 de la journée II de Las Mocedades del Cid : « ¿Qué dizes? Vete, y reporta / tal intento ; porque está / cerca Palacio, y vendrá / acompañada » ([« Que dis-tu ? Va-t’en, et renonce / à une telle idée ; car elle se trouve / vers le Palais, et reviendra / accompagnée »].
32 « J’ai vu de mes propres yeux / teinté de sang le luisant acier ». Selon le Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia española, le verbe teñir, s’il a bien le sens général de « teindre », évoque aussi le fait de tacher (manchar) et se dit particulièrement pour la maculation par le sang.
33 Dans la comedia, ce n’est pas l’épée qui lui a servi à tuer le Comte que Rodrigo tend à Ximena, mais sa dague : le mouvement d’horreur qui saisit Chimène devant l’affreux objet est donc de l’invention de Corneille. Cette fois, c’est lui qui provoque l’émotion par un élément quasiment visuel (car l’épée de Rodrigue ne dégouttait certes pas sur scène du sang du Comte). En effet, du fait de la mention de cette dague, Ximena, beaucoup plus loin dans le dialogue, use plus nettement de son imagination quand elle fait ces reproches à Rodrigue : « Sólo te culpo, agraviada, / ver que a mis ojos vienes / a tiempo que aún fresca tienes / mi sangre en mano y espada » [« Tout ce que je te reproche, qui m’offense, / C’est de te voir à mes yeux te présenter / alors qu’encore tout frais tu portes / mon sang sur l’épée et les mains »]. Voir l’introduction à notre édition du Cid citée plus haut, p. 637-643.
34 Nous écartons volontairement l’emploi du qualificatif de « baroque », car nous considérons cette notion comme un fourre-tout en matière d’esthétique.
35 Voir notre note 1.
36 Sur cette question, voir l’ouvrage fondamental de Susana Cantero, Dramaturgia y práctica escénica del verso clásico español, Madrid, Editorial Fundamentos, Colección Arte, 2006.
37 Les stances d’Égée dans Médée présentent une alternance de décasyllabes et d’alexandrins, au reste groupés en deux blocs ; celles de Polyeucte une alternance d’alexandrins et d’octosyllabes, groupés en deux blocs également ; celles d’Héraclius sont constituées de simples octains d’octosyllabes. Un peu plus complexes mais ne reposant que sur deux mètres différents se révèlent les stances de l’Infante dans Le Cid, celles de l’héroïne éponyme d’Andromède, celles de Dircé dans Œdipe et celles de Médée dans La Conquête de La Toison d’or.
38 Voir sur ce sujet la mise au point de Mariette Cuénin-Liéber, Corneille et le monologue : une interrogation sur les héros, Tübingen, Gunter Narr Verlag, « Biblio 17 », 2002, p. 79-85.
39 « Incertain, autant qu’affligé / je suis… Ô Fortune ! Est-ce réalité ce que je vois ? / Si cruel pour moi a été / Ton changement, si propre à toi, que je n’y crois pas ! / Est-il possible que tu aies permis / Dans ton inclémence que soit / Mon père l’offensé ? – étrange peine ! – / Et l’offenseur le père de Chimène ? ». Nous donnons la traduction fournie par nous en annexe à notre édition du Cid, citée, p. 796.
40 « Incertain, autant qu’affligé / je suis… Ô Fortune ! Est-ce réalité ce que je vois ? / Si cruel pour moi a été ton changement, / Si propre à toi, que je n’y crois pas ! / Est-il possible que tu aies permis / Dans ton inclémence que soit / Mon père l’offensé ? – étrange peine ! – / Et l’offenseur le père de Chimène ? ». Nous donnons la traduction fournie par nous en annexe à notre édition du Cid, citée, p. 796.
41 Successivement, « étrange peine », « atroce peine », « amère peine ».
42 « Dois-je verser / le sang de mon âme ? »
43 « Qu’infâme tu abhorrerais, / qui tu aimas considéré ».
44 Baltasar Gracián, Art et figures de l’esprit, op. cit, Discours XXIX, « De l’acuité sentencieuse », p. 581.
45 « Luttèrent à mon grand dépit /se contrebalançant dans mon cœur / mon offense et ta beauté / et toi, ma Dame, tu l’aurais emporté ».
46 Le second vers de la triade, bien qu’évoquant une époque heureuse, oppose cependant « le blâme » à « chéri », l’imparfait n’étant pas seulement impliqué par la concordance des temps mais prenant une forte valeur de passé révolu.
47 B. Gracián, Art et figures de l’esprit, op. cit, Discours XLV, « Des dénouements ingénieux par le dire » et XLVI, « Des dénouements ingénieux par le faire » (p. 643-648).
48 Ibid., Discours XIX, « Des figures par exagération », p. 532.
49 « Il vaut mieux que mon amour constant / par ma reddition / te donne la satisfaction de me tuer / sans la peine de me poursuivre ».
50 On notera en effet que le terme employé, seguir, n’est pas particulièrement virulent. Perseguir l’eût été davantage.
51 B. Gracián, Art et figures de l’esprit, op. cit, Discours II, « Essence illustrée de l’acuité », p. 442.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/935.html.
Quelques mots à propos de : Liliane Picciola
Université Paris-Nanterre
EA 1586
Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre, Liliane Picciola préside actuellement Le Mouvement Corneille. Auteur d’une thèse d’État sur Corneille et la dramaturgie espagnole (Narr, 2002) et de nombreux articles sur le théâtre du xviie siècle, elle a coordonné un ouvrage collectif, Baroque ou bizarre ? aux P.U.N (2015) et réalisé l’édition critique de La Galerie du Palais, L’Illusion comique, Le Cid, dans le Théâtre de Pierre Corneille qu’elle dirige pour les Classiques Garnier. Collaboratrice du projet ENCCRE patronné par l’Académie des Sciences, elle a fourni l’édition critique électronique de plusieurs articles de l’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt sur le théâtre.
