Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
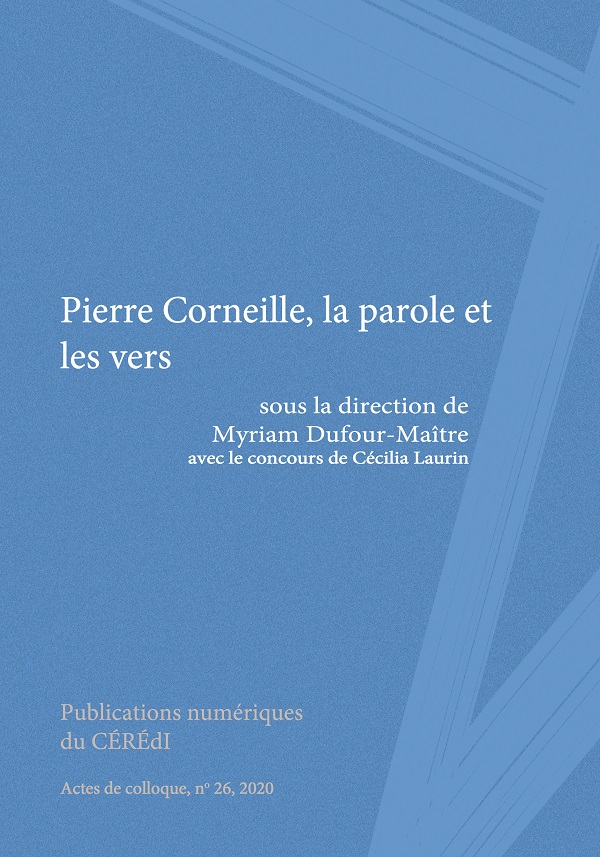
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Influence des versifications étrangères
Corneille poète néo-latin
Jean-Marc Civardi
La poésie néo-latine est un aspect peu connu de l’œuvre de Corneille mais qu’il a pratiqué tout au long de sa carrière avec dextérité à des fins personnelles ou officielles. En effet, il a utilisé des mètres variés et des genres différents (élégie au sens antique, tombeau poétique, lettre, poésie encomiastique) et sa prosodie est d’une bonne latinité ; des emprunts aux grands anciens s’y retrouvent mais sans pédantisme. Ces poèmes sont le fruit de son éducation et il faut aussi les mettre évidemment en rapport avec son activité de traducteur.
Latiosque premit nox alta Pœtas,
Nullus honos Latiis, gratia nulla modis.
Jean-Baptiste de Santeul1
Æterna esse præmia pœtarum qui latine scribunt.
Jean Commire2
1La formation donnée par les jésuites à Corneille a été largement étudiée ainsi que les échos, souvenirs, traces, que l’on peut trouver dans son œuvre dramatique. Nous ne reviendrons pas sur d’éminents travaux précédents (par G. Mongrédien, O. Nadal, A. Stegmann, M. Fumaroli, G. Forestier). Corneille est avant tout un dramaturge pour nous mais au xviie siècle, on employait plutôt le terme de poète. Et Corneille l’a été aussi en latin, en « un siècle parfaitement poli en l’une et l’autre langue », comme disait l’abbé de Marolles. Évidemment aujourd’hui, ses quelques poèmes en latin sont délaissés au milieu des œuvres complètes (ses pièces et ses discours), tout comme les poésies encomiastiques d’ailleurs, qui formaient tout un pan de la poésie du Grand Siècle. Pourtant, en dépit des jugements de valeur que nous avons placés en épigraphes, il ne faut pas oublier que « almost every major French author from Rabelais to Racine was able to write fluent Latin verse and prose3 ». Corneille a obtenu un prix de versification latine en 1618 (classe de troisième) et en 1620 (classe de première). On sait le rôle que jouait l’imitation / émulation des Anciens dans l’éducation, au niveau de l’inventio comme de l’elocutio, et l’abbé Vissac rappelle avec raison que les élèves apprenaient la quantité des syllabes et des mots latins par leur position dans les vers des auteurs antiques4. Corneille écrit effectivement à une période où l’enseignement et la maîtrise de la prosodie ont fait bien des progrès depuis les débuts de l’humanisme. Le même Vissac signale aussi que « les jésuites se plaisent à parcourir toute l’étendue du Parnasse5 », ne délaissant aucun genre ; c’est peut-être une autre leçon que Corneille a retenue. Nous allons donc étudier les cinq textes néo-latins de Corneille en examinant ses choix prosodiques. Puisqu’il s’agit de latin moderne, où l’imitation tant « macroscopique » que « microscopique6 », selon la distinction de Jozef Ijsewijn, était très présente, nous verrons quelle est la part d’originalité du poète.
2Pour son premier texte en latin, une excusatio, Corneille a choisi la forme poétique de l’élégie. En effet, rien de triste dans ce qu’il exprime – ce n’était pas spécialement la tonalité dans l’Antiquité ni à l’âge classique –, mais tout simplement l’emploi d’une forme bien précise : le distique élégiaque, composé d’un hexamètre puis d’un pentamètre dactyliques, forme inaugurée par les poètes grecs pour un usage gnomique ou pour des épitaphes, et surtout largement répandue par les Latins à la suite des poètes alexandrins. D’Ennius à la fin de l’Empire, le distique élégiaque, qui est donc avant tout « un rythme7 », a exprimé toutes sortes de sentiments ou d’arguments, dans les domaines amoureux, moral, didactique, épistolaire (les Héroïdes d’Ovide), épigrammatique (Martial), etc.
3Corneille aurait pu s’en tenir à l’hexamètre dactylique que l’on rencontre dans l’épître, au contenu assez proche en général de ce qu’il exprime ici à un haut dignitaire religieux. Mais c’était aussi le vers très solennel et pompeux – au sens du xviie siècle – de l’épopée. Or Corneille définit sa poésie théâtrale, là où il excelle, comme « modeste » (« exiguis viribus », v. 6), « enjouée » (« non tristis », v. 9), « familière » (« vulgare », v. 15) ; et même s’il est capable de faire pleurer, c’est, à cette date, dans des comédies (références à La Galerie du Palais et à La Place Royale). Ce mélange des genres ne peut s’élever au niveau de la célébration officielle du roi et du cardinal ministre, sa muse qui bégaie (« blæsa », v. 38) sur des mètres légers (« levibus metris », v. 62) n’a pas les capacités d’un Virgile (v. 85). Voilà pourquoi Corneille a pu choisir le distique élégiaque, forme plus légère avec son décalage métrique, simple et répandue sans être non plus irrespectueuse, entre « lyrisme d’apparat » et « lyrisme mineur », pour reprendre des expressions de Pierre Grimal8. L’élégie convenait donc pour un texte qui oscille entre l’épître9 (cf. chez Ausone), la justification (comme Ovide dans les Tristes et les Pontiques) et l’évocation des succès de Louis XIII et Richelieu, entre rhétorique et poésie. D’ailleurs, dans le recueil d’origine, les Epinicia Musarum Eminentissimo Cardinali Duci de Richelieu, d’autres auteurs avaient fait le même choix prosodique que Corneille et toutes sortes de genres se côtoient (récit épique, prosopopée, plaintes, ode, et même des anagrammes sur le nom ou les titres de Richelieu !). Corneille ne prend guère de risque avec cette série de distiques : l’élégie néo-latine a servi de support à toutes sortes de sujets, avec une longueur plus ou moins variable10.
4Du point de vue de la scansion, Corneille se montre parfaitement respectueux des règles (quantité des syllabes et coupes11). La seule nouveauté réside dans le fait que la phrase s’étend souvent sur quatre ou six vers, voire davantage, alors que les traités insistent sur le sens complet du distique, sans enjambement (bien qu’il existât dans l’Antiquité). Le rythme des vers est régulier, sans monotonie ni excès : pas de vers entièrement spondaïque, c’est-à-dire très solennel, ralenti, grave, ni complètement dactylique, plus léger et sautillant. On compte peut-être un peu plus de spondées lorsque Corneille évoque les pleurs d’Angélique et du public (v. 31-32). Il sait aussi mettre en valeur à la césure Richelieu (v. 61) ou le roi (v. 76), surtout vainqueur (v. 47). Au vers 47, l’antithèse asyndétique « Victores dominum, victi sensere parentem » peut être rapprochée de la célèbre formule de Lucain (La Pharsale, I, v. 129) du même type : « Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni12 ».
5Mais cette pièce en vers s’offre aussi comme texte argumentatif. Pour la résumer, rappelons que le refus poli de Corneille se présente ainsi : son art se limite au théâtre et est inapte au chant héroïque ; le dramaturge rouennais règne certes sur les planches mais il ne tentera pas d’égaler les poètes sublimes en chantant les exploits du roi et du cardinal. La veine encomiastique n’est cependant pas totalement absente : Corneille montre qu’il connaît les hauts faits royaux, rappelés du vers 43 au vers 62, utilisant au passage le lieu commun comparant Richelieu à Nestor et Louis XIII à Achille (v. 62) comme l’indique Georges Couton13.
6Dans la tradition rhétorique l’excuse n’est pas une figure des plus marquantes ou recensées. D’après le dictionnaire de Félix Gaffiot, excusatio est un terme tout à fait classique, largement présent chez Cicéron, au sens d’« excuse » (justifiée ou non), de « motif d’excuse », voire de « prétexte », d’« échappatoire ». De la même famille existe l’adjectif excusatorius, qui sert par exemple à qualifier le carmen IX de Sidoine Apollinaire. Dans ce poème de 343 vers (qui ne sont pas des distiques élégiaques) il s’adresse au consulaire Félix, son maître et ami et consent à contrecœur à publier des œuvres de jeunesse. Il passe surtout beaucoup de temps à décliner ce que l’on n’y trouvera pas : la poésie épique, la geste des héros et des dieux, la grande histoire, la fable, l’ode, la comédie ou la tragédie, l’élégie amoureuse, la satire, l’épigramme, etc. Il ne reste que l’aveu d’une « muse stérile » et un appel à l’indulgence. Tout cela n’en fait pas une source de notre texte, le seul point commun étant la fausse modestie. Si l’on se rapproche de l’époque moderne, le Dictionnaire historique de la langue française14 indique que « s’excuser » prend le sens de « se dispenser, refuser » au xvie siècle et Littré, en plus d’« excuse » comme « motif légal pour se dispenser d’une charge imposée par la loi », renvoie à « excusation » (xiie, xive, xve siècles), « ancien terme de jurisprudence. Se disait des excuses qu’on allègue pour être dispensé d’une tutelle, d’une charge ». Ce terme technique se trouvait déjà dans Furetière, chez qui « s’excuser » « signifie aussi refuser honnêtement ». La formation de juriste de Corneille peut donc s’ajouter à la préoccupation poétique et diplomatique dans le choix de la forme.
7Pour revenir à l’Antiquité, excusatio n’a qu’un sens très juridique chez Quintilien (VII, iv, 14-15). Les poètes ont eu davantage recours à ce qui s’apparente à l’excuse. Horace, au début de sa première Épître (v. 1-9), n’accède pas à la requête de Mécène : il ne reviendra pas à la poésie lyrique fougueuse de sa jeunesse. S’adressant au même dans la douzième ode du livre II, il ne veut ni ne peut s’engager à chanter l’histoire romaine ou les exploits divins, à cause de sa muse qui se complaît dans la douceur et la beauté féminine. Dans le domaine de l’élégie, Properce (III, 3) se détourne du vers héroïque sur ordre d’Apollon et de Calliope : les discours qu’il leur prête sont une forme de récusation, au profit de sa lyre plus propre à célébrer l’amour et les plaisirs de la vie. Ovide, lui, dans le tout premier poème des Amours, fait intervenir Cupidon qui critique vivement chez lui une orientation épique sur un « rythme majestueux » et le contraint à des poèmes d’amour de six et cinq pieds. Corneille n’innove donc pas mais adapte une forme ancienne à un sujet sérieux sans être trop relevé.
8L’excusatio relève de la topique de la réticence et de l’humilité presque coupable, au moins intimidée. Ernst Robert Curtius a retracé l’histoire de cette « modestie affectée » de Cicéron au Moyen Âge15. Il donne par exemple comme argument complémentaire que « si l’auteur se risque à écrire, c’est uniquement parce qu’un protecteur ou un supérieur l’en a prié, en a exprimé le désir ou donné l’ordre16 ». Le refus poli sous forme de « prétérition17 » devient alors l’excusatio propter infirmitatem, relevée depuis longtemps et jusqu’à naguère par Gérard Genette qui y voit un « paratonnerre18 ». On peut la rencontrer chez les traducteurs, conscients des difficultés de la tâche19. Pour Juste Lipse, dans l’Institutio epistolica (1591), l’excusatio se place dans les sept types de lettres avec les « consolatio, admonitio, petitio, objurgatio, suasio, laudatio20 ». Plus près de nous, Bernard Dupriez est un des rares à proposer dans son Gradus une entrée « Excuse » : « Argument touchant la bonne foi ou la bonne volonté du locuteur, allégué contre un reproche possible21. » Il associe ce procédé à l’aveu et à la concession, ainsi qu’à l’impasse et à la prétérition.
9Toutes ces considérations peuvent se retrouver dans l’Excusatio de 1634. Le choix du latin est certes un gage de tradition et de respect, mais surtout un vecteur obligé à l’intérieur d’un long recueil dans cette langue. De la justification à l’éloge, le glissement plus ou moins progressif est aisé. Corneille n’y manque pas et son Excusatio relève du discours judiciaire avant de prendre la voie de l’épidictique et de se rapprocher du genre épistolaire. Un peu plus tard, en 1637, Corneille écrivit, cette fois en français, une Excuse à Ariste qui fut lourde de conséquences. Cette forme littéraire, à défaut d’être un genre, n’est pas des plus représentées, pourtant elle ne figure pas dans le Dictionnaire raisonné de la caducité des genres littéraires22.
10La deuxième création néo-latine de Corneille se situe à la limite du domaine poétique. En effet l’épitaphe de Dom Jean Goulu (mort en 1629), attestée en 164223, n’est pas exactement en vers, Charles Marty-Laveaux la classe d’ailleurs dans les « œuvres diverses en prose24 ». Néanmoins la disposition centrée évoque la forme concrète d’un texte gravé : alinéas et variété du nombre de syllabes font penser à des vers hétérométriques. De plus certains procédés sont proches des rythmes poétiques : constructions parallèles avec homéotéleutes aux vers 3 et 14 – avec même quantité en finale, un dactyle, pour les deux derniers verbes – ainsi qu’au vers 19 où conjonction et verbe forment à chaque fois un trochée suivi d’un dactyle ; pour des Français, effet de rimes avec les accusatifs en –em / -am (v. 9, 11, 13) et les affixes verbaux en –erit / -it (v. 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19). Enfin la formule « Quippe dignum laude virum fama vetat mori » est l’adaptation d’un vers d’Horace dans ses Odes (IV, viii, 28) : Corneille a cependant remplacé « Musa » par « fama ». Le vers d’Horace était un asclépiade mineur ; avec l’ajout du mot de liaison en tête, on peut considérer que c’est un sapphique majeur catalectique, ce qui reste dans les rythmes éoliens, c’est-à-dire ceux pratiqués par les poètes de l’île de Lesbos. La coupe de ce vers donne d’ailleurs un sens fort à « virum ». De même, la troisième ligne forme un sénaire iambique catalectique et l’expression ubique notus se trouve dans Hercule furieux de Sénèque (v. 1330)25.
11Le tombeau poétique a été très pratiqué au xvie siècle et jusque dans la première moitié du xviie siècle. Ici le modèle n’est pas celui d’une épitaphe à portée morale (sur la vanité du monde par exemple) ou consolante, mais bien celui de la pratique épigraphique, une activité, pas encore une science, qui se développait depuis le xvie siècle. Malgré l’apostrophe initiale, il ne s’agit pas tant d’une épitaphe à l’antique (aucune formule ne provient de ce qui se pratiquait sur les tombeaux romains) que de la tradition humaniste de l’hommage littéraire. De plus, dans la Ratio studiorum jésuite, l’épitaphe, ainsi que quelques autres formes, faisait partie des « questions qui touchent à l’art poétique » que l’on pouvait aborder les jours de congé26. Ces lignes furent bien gravées sur le tombeau de marbre noir au couvent des Feuillants de la rue Saint-Honoré27. Tournée vers la gloire du défunt, cette épitaphe prend valeur d’exemplum pour la carrière de Jean Goulu, avec l’appui de ses protecteurs. L’expression de sentiments personnels est absente ; ce pourrait être le résumé d’un éloge funèbre officiel ou prononcé en chaire. D’ailleurs le jeu sur « exemplo » et « imperio » (l. 16) provient du Panégyrique de Trajan de Pline28. Le choix du latin ajoute évidemment au caractère savant de l’hommage et du personnage, helléniste, lui-même fils d’un professeur de grec et dont le grand-père maternel était Jean Dorat, grand helléniste aussi. Nous sommes proches des « vers héroïques29 » que décèle Jean-Pierre Chauveau dans certains tombeaux poétiques en français de l’époque. Pour les épitaphes latines du xviie siècle, il n’existe pas d’étude. Le recueil le plus célèbre, Hortus epitaphiorum selectorum, date de 1648 (réédité en 1666) ; précédant le texte de Corneille, nous n’avons trouvé que l’ouvrage Epitaphia ioco-seria […] de François Sweerts (Cologne, B. Walther, 1623), anthologie antique et moderne. Quant au choix de Corneille par le duc et la duchesse de Vendôme, on ne sait, selon Georges Couton, s’il est dû « à une considération particulière […] ou à des liens particuliers entre Corneille et les feuillants30 ».
12Vers la même époque (10 février 1643), trois vers latins sont donnés à Corneille et cités par Guez de Balzac dans une réponse à ce dernier. Ceux-ci figurent dans une lettre où l’ermite de la Charente, auteur de vers latins, badine sur les surnoms de poètes latins qu’on a pu lui donner ; au début il remercie donc Corneille du « rang » qu’il lui avait octroyé :
… Tibi carmine ab omni
Cedetur, jurique tuo Natura relinquet
Quis vatum esse velis…
13c’est-à-dire : « Tout genre de poésie te cédera le premier rang et la nature te laissera décider qui tu veux être parmi les poètes31. » Georges Couton en déduit que « la lettre [perdue] de Corneille à Balzac était donc en entier ou partiellement en vers latins32 ». En fait, il pouvait s’agir d’une simple plaisanterie car ces lignes sont un pastiche de La Pharsale de Lucain (I, v. 50-52)33. Dans l’éloge de Néron en tête de son épopée, le poète latin évoquait l’accueil céleste fait à l’empereur placé au-dessus des dieux mêmes :
… Tibi numine ab omni
Cedetur, iurisque tui natura relinquet,
Qui deus esse velis…
14« toute divinité te cédera le pas ; la nature te laissera le libre choix du dieu que tu voudras être34. » Tout en respectant la scansion de l’hexamètre, Corneille a substitué facilement carmine à numine (la puissance divine) et vates (le poète inspiré) à deus – ce qui n’est pas rien dans l’hyperbole ! Difficile de dire s’il y avait une pointe d’ironie dans le propos de Corneille, les hommages entre confrères étant souvent dithyrambiques et Balzac familier du procédé fondé sur l’excès. Corneille pratiquera le même jeu d’adaptation, cette fois de manière très sérieuse, à la fin de son ode « Au R. P. Delidel » en 1668. L’hommage à son maître s’exprime par la formule « Quod scribo, et placeo, si placeo, omne tuum est » (« Que j’écrive et que je plaise, si du moins je plais, tout cela te revient »), est une démarcation d’un vers d’Horace (Odes, IV, iii, v. 24) « Quod spiro et placeo, si placeo tuum est35 » (« Que j’aie du souffle et que je plaise, si je plais, l’honneur est à toi36 »), où le poète antique remerciait sa muse, Melpomène.
15Le 3 mars 1649, c’est dans une lettre à Constantin Huygens, seigneur de Zuylichem, que Corneille glisse 28 vers latins. Il ne faut pas s’en étonner : le destinataire est un grand savant, qui avait lui-même dédié une vingtaine de vers latins au Menteur en 1645 – Corneille les a conservés en tête de plusieurs éditions dès 1648 – ; et le contexte de la lettre fait appel à Lucain, « mon bon ami », à la Médée de Sénèque et, par fausse modestie et politesse, à « une langue qu’il y a trente ans que j’ai oubliée37 ».
16Le lecteur s’aperçoit vite que ce n’est pas le cas puisque Corneille a choisi de versifier en hendécasyllabes phaléciens, c’est-à-dire en logaédiques simples. Les onze syllabes d’un tel vers, qui tire son nom de son inventeur, le poète grec alexandrin Phalaikos (Phalaecus38), se répartissent ainsi : spondée, dactyle, trois trochées (voire un spondée à la dernière place). Catulle, Martial, Stace, les poètes chrétiens l’ont largement utilisé. Quant aux vers logaédiques, leur définition éclaire le choix de Corneille : « Ces mètres sont appelés logaédiques ainsi parce qu’ils tiennent à la fois de la prose (λόγος) par le mouvement rapide du trochée, et de la poésie (ἀοιδή) par la marche harmonieuse du dactyle39. » La forme n’est donc pas trop solennelle pour une lettre de remerciement à un ami de renom dans laquelle Corneille revient sur sa Médée, davantage tributaire de Sénèque que d’Euripide. De plus, une poésie fondée sur un système de pieds devait plaire à un érudit féru de versification ; en effet, c’était un de ses sujets de conversation et de discussion avec Corneille et d’autres, puisque, selon Georges Couton, « Huygens avait son idée : que la prosodie française – comme celle de toutes les langues modernes – ne reposait pas seulement sur le nombre des syllabes, mais aussi sur la place des accents qui déterminent des trochées et des iambes40 », comme il l’a développé plus tard dans une lettre à Corneille du 30 mai 166341, où il relève iambes, trochées, anapestes et dactyles dans des pièces de son correspondant. La réponse de Huygens dès mai 1649 est, elle, truffée de citations latines. L’examen du vocabulaire montre que Corneille n’a en rien plagié le vocabulaire de Sénèque. Les termes communs aux deux poètes restent ceux qui sont inévitables avec un personnage tel que Médée : « furentem » (v. 673), « scelus », « ferox » (quatre occurrences dans la tragédie latine), « minax » (v. 187), « ultio » (deux occurrences), « impetus » (trois occurrences), « fluctuatur » (v. 943), « induere » (v. 43, idée de revêtir la férocité) et bien sûr « dolor » (onze occurrences). Quelques termes sont donc repris, mais pas de groupes nominaux ou de vers entiers.
17Après l’avènement de Louis XIV, Corneille a bien oublié les termes de son excusatio de 1634 et sa muse ne bégaie plus. En effet, en 1668, il offre un poème « Au Roi, sur sa conquête de la Franche-Comté », immédiatement suivi d’un poème latin qui en est l’imitation (cf. le titre « Idem Latine »), avec le même nombre de vers42. Corneille retrouve la forme de l’élégie, sur laquelle nous ne revenons pas, ayant montré que le distique élégiaque convenait à toutes sortes de célébration, mais nous proposons une traduction moderne. Là encore, le poète respecte les codes de la prosodie. Dans les hexamètres la coupe lui permet de mettre par exemple en valeur l’action du roi (« fulmen », v. 3) tout comme dans les pentamètres (« triumphandi », v. 2 ; « nutu », v. 4). Le vers 13 comporte un peu plus de spondées pour souligner le fardeau qui consiste à rendre compte des exploits royaux si nombreux. Nous n’avons trouvé trace que de quelques emprunts. Au vers 7, le groupe nominal « avida aure » se rencontre chez Santeul ou Huet ; « præcipiti cursu » (v. 11) peut se rencontrer en prose chez Quinte Curce et Velleius Paterculus (au sens propre, pour un fleuve par exemple) et chez Lucain (La Pharsale, II, v. 70) dans un cadre militaire déjà, au sujet des soldats de César ; l’opposition forte et asyndétique du superlatif et du comparatif (renforcé par un chiasme) dans « arripiat plurima, plura videt » (v. 12) n’est pas une pure invention : on la rencontre au moins chez Ovide (Ibis, v. 120), Martial (X, ii, v. 8) voire dans une lettre de Sidoine Apollinaire (IX, 3) ; et enfin l’expression « turpe silere » (v. 17) est proverbiale depuis les Adages d’Érasme (no 1604) et remonte même au grec. Donc Corneille a encore effectué un travail original et a su tenir son rang dans « une manière de tournoi poétique » (G. Couton43), puisque ce poème encomiastique était suivi par plusieurs pièces latines écrites par le P. Charles de La Rue, le P. Claude Santeul, Charles Du Périer et quelques autres. Le lecteur averti aura aussi reconnu dans la dernière phrase une source, ou au moins une inspiration pour la formule de Boileau au début de son épître VIII, quelques années après : « Grand Roi, cesse de vaincre, ou je cesse d’écrire. »
18Pour sa dernière production latine en 1672, Corneille a offert vingt-quatre vers à Louis XIV, tout à la gloire de son retour de campagne en Hollande. Tout autant que le poète pensionné, c’est peut-être le chrétien qui s’exprime puisque la gloire du roi s’appuie sur la volonté et la puissance divines ; le souverain est bien le lieutenant de Dieu sur terre, comme le reflète le titre de l’épître : Au roi, pour le rétablissement de la foi catholique chez les Hollandais. Corneille a traduit, nous dirions plutôt adapté, son texte en six strophes d’alexandrins ; voilà pourquoi nous proposons une traduction (voir annexe), puisque ni Charles Marty-Laveaux ni Georges Couton n’en donnent une version moderne et plus proche de l’original.
19Corneille est revenu à un choix prosodique plus classique : l’hexamètre dactylique, le grand vers de la haute poésie et entre autres du panégyrique. La scansion n’offre aucune irrégularité et Corneille sait varier la coupe ; en majorité elle est penthémimère, selon la règle, mais le poète place aussi des coupes ephthémimères ; une seule est trihémimère. Ce peut être l’occasion de mettre un mot en valeur, comme « (Deus) ille » (v. 5), « victor » (v. 16), « invicto » (v. 24). L’expression est bien sûr noble et dans un latin qui fait appel au vocabulaire épique. Ce genre d’« epinicium » abonde au cours du siècle et particulièrement sous le règne de Louis XIV. Pour le coup Corneille renoue avec un exercice rhétorique très répandu (comme le généthliaque, l’épithalame, etc.).
20Corneille ne s’est pas essayé à la poésie religieuse au travers du latin, il n’a rien d’un Mathias Casimir Sarbiewski en Pologne, d’un Jacob Balde en Autriche et en Allemagne, tous deux jésuites et fort savants, ou d’un Jean-Baptiste de Santeul. C’est par la traduction en vers qu’il a fait œuvre de poète chrétien. Plus encore que les quelques œuvres en latin, la traduction a été parfois sa seule activité, par exemple entre 1652 et 1658, justement quand il se consacrait à l’Imitation de Jésus-Christ. Roger Zuber a montré que le travail de traducteur était fort bien considéré, à l’égal de la création littéraire, et il estime qu’« on pourrait même dire qu’il [Corneille] accompagne, dans la courbe de sa carrière, l’évolution des “Belles infidèles44” […] ». Ensuite Corneille est revenu à la poésie chrétienne avec les Louanges de la Sainte Vierge en 1665, L’Office de la Sainte Vierge en 1670, la Version des Hymnes de saint Victor vers 1680. Par ailleurs on trouve de petits poèmes latins traduits dès les Mélanges poétiques de 1632 et Corneille a également transcrit des vers à la gloire de diverses entreprises royales en 1667 et 1676. Ceux de 1667 ont d’ailleurs été salués par Saint-Évremond :
Je vous suis fort obligé de m’avoir envoyé la traduction de M. de Corneille sur le petit Poëme Latin des Conquêtes du Roy ; je loüerois extremement le Latin, si je n’étois obligé en conscience à loüer davantage le François. Notre langue est plus majestueuse que la Latine, et les vers plus harmonieux, si je me puis servir de ce terme. Mais ce n’est pas merveille que celuy qui a donné plus de force et plus de majesté aux pensées de Lucain, ait eu le même avantage sur un Auteur Latin de notre temps ; avec cela j’admire encore plus ce que Corneille a fait de luy-même sur le retour du Roy, que sa traduction toute admirable qu’elle est. Je n’ay jamais vû rien de plus beau45.
21Où l’on voit que le travail de traduction et celui de création ne sont guère séparés et où l’on repère peut-être un écho du débat sur la langue la plus apte à louer le roi. Ainsi nous ne pensons pas qu’il faille conclure à une adéquation, à une concomitance particulière chez lui entre l’œuvre latine et les traductions, imitations et paraphrases du latin. Celui-ci, sous sa forme versifiée, semble en tout cas constamment présent tout au long de la carrière de Corneille, et n’oublions pas la traduction, attestée au moins pour les deux premiers livres, de La Thébaïde de Stace, mais impossible à trouver depuis le xviiie siècle, hormis trois vers46.
22Corneille est donc un poète néo-latin parmi tant d’autres au xviie siècle. Sa production est limitée. Il n’est pas un virtuose : il ne s’est pas risqué, par exemple, à la complexité métrique d’odes imitées de celles d’Horace ; on ne relève pas non plus de néologismes dont certains humanistes et savants étaient friands dès la Renaissance. Depuis le livre IV des Élégies de Properce, l’élégie, loin de servir seulement à célébrer l’amour, s’était tournée vers des thèmes religieux (il suffit de feuilleter la belle anthologie La Lyre jésuite47) ou politiques, ainsi que Corneille le pratique dans son Excusatio. De même, l’hendécasyllabe cher à Catulle avait été largement utilisé depuis le début de la Renaissance en Italie (par Giovanni Pontano et bien d’autres48). Si l’on veut déceler une différence ou une originalité, elle réside dans le fait que Corneille ne procède pas à des allusions et à des références, mythologiques ou autres, en grand nombre, qu’il n’emprunte pas énormément aux auteurs anciens – à la différence de nombreux auteurs néo-latins. Nous n’avons pas relevé spécialement « [a] dense intertextuality, especially with the classical authors, but also with other Neo-Latin poets » ni « a patchwork of quotations49 ». Dans l’Excusatio par exemple, il est juste mentionné « l’épais laurier du mont d’Aonie » (v. 2) et « Virgile » (v. 3 et 85) ; il ne s’étend pas sur Apollon, les Muses (ces doctes sœurs), la source Hippocrène, etc., comme il est d’usage lorsqu’un auteur néo-latin traite de son art poétique. Corneille sait s’adapter à son destinataire et choisir le type de vers idoine dans l’énorme catalogue antique de rythmes.
23Finalement, malgré le goût qu’on lui connaît pour Lucain et Stace, Corneille se montre plutôt atticiste – il est vrai que ces deux auteurs antiques ont œuvré dans le genre épique. La latinitas et l’elegantia chères à la Rhétorique à Hérennius, à Cicéron comme à Quintilien ne sont pas absentes de nos textes. Dans les lettres au P. Boulard au sujet de L’Imitation de Jésus-Christ, si Corneille « croi[t] savoir assez de latin pour comprendre le sens d’un auteur dont le style n’est pas fort obscur50 », il se montre capable de repérer que le latin d’un jésuite allemand « sen[t] le flamand ou pour mieux dire le wallon », que l’on se servait dans les anciennes ordonnances françaises d’un « latin grossier51 » et que certains termes de Thomas a Kempis tiennent davantage de l’italien ou du français que de la bonne latinité52. Alors Corneille : ancien ou moderne ? Par sa propension à utiliser la langue vernaculaire aux dépens de « cette langue illustre qui sert de truchement à tous les savants de l’Europe53 », il se rapproche des seconds et laisse la langue de Virgile aux doctes. Cependant, il est loin de la critique mordante de Boileau contre les latiniseurs dans le Dialogue des poètes. En fait, quand on découvre l’étendue de la production néo-latine au xviie siècle, en particulier dans le domaine de la poésie de circonstance, le nombre de poèmes que nous avons étudiés n’est pas grand. Néanmoins ils couvrent un domaine assez représentatif de la production du siècle dans les choix prosodiques comme dans les sujets abordés (personnels, contemporains et panégyriques), domaine qu’il ne faut pas séparer de celui de la traduction, où s’élève la poésie religieuse. Classique ? Dans ce cas au sens étymologique et scolaire (à l’usage des classes) : au sens de bon élève de ses maîtres. Mais, pour reprendre une distinction de l’époque entre « haut et bas Latium54 », nous pouvons placer Corneille dans la première catégorie et non dans celle des régents et pédants de collège, souvent décriés. De même, selon les critères de Gérard Vossius, le travail de Corneille relève tout de même de l’« imitatio virilis », accomplie et consciente, et non de l’« imitatio puerilis », celle du débutant encore maladroit55 – distinction que l’on pourrait également appliquer à son œuvre de traducteur. Corneille ne se pense cependant pas Romain, à l’instar d’un Balzac : il est, plus simplement, poète latin, selon l’expression de l’époque qui ne raffinait pas tant sur les distinctions séculaires et les préfixes. Ni « langue savante », ni « langue mondaine » (pour reprendre le titre d’un ouvrage56), le vers latin est pour lui est un vrai moyen d’expression personnelle et originale.
Annexe
Regi,
pro restituta apud batavos catholica fide57
Quid mirum rapido tibi si Victoria cursu
Tot populos subdit facilis, tot mœnia pandit ?
Vix sua cuique dies urbi, nec pluribus horis
Castra locas, quam justa vides tibi crescere regna.
Nempe Deus, Deus ille, sui de culmine cœli
Quem trahis in partes, cui sub te militat omnis
In Batavos effusa phalanx, Deus ille tremendum
Ponere cui properas communi ex hoste tropæum,
Ipse tibi frangitque obices, arcetque pericla
Fidus, et æterna tecum mercede paciscens,
Prævia pro reduce appendit miracula cultu.
Jamque fidem excedunt, jam lassis viribus impar
Sub te fama gemit, rerumque interrita custos
Te pavet historia, it tantorum conscius ordo
Fatorum, ac merito eventu spem votaque vincit.
Perge modo, et pulsum victor redde omnibus aris,
Victis redde Deum, fac regnet et ipse, tibique
Quantum exempla præire dedit, tantum et sua cunctas
Et belli et pacis præeat tibi gloria curas.
Interea totus dum te unum suspicit orbis,
Dum Musæ fortemque animum, mentemque profundam,
Tot regnandi artes certatim ad sidera tollent,
Fas mihi sit tacuisse semel, Rex magne, Deique
Nil nisi in invicto mirari principe donum.
Au roi, pour le rétablissement de la foi catholique aux Pays-Bas.
Qu’y a-t-il d’étonnant si la Victoire, en un cours rapide, te soumet facilement tant de peuples, t’ouvre des brèches dans tant de remparts ? À peine le jour se lève-t-il sur une ville que tu établis ton camp en aussi peu d’heures que tu vois croître ton juste royaume.
C’est un fait : Dieu, ce Dieu illustre, du haut de son ciel que tu attires de ton côté, et pour qui toute l’armée déployée contre les Hollandais se bat sous tes ordres, ce Dieu illustre à qui tu te hâtes d’élever un trophée redoutable provenant de l’ennemi commun, lui-même brise pour toi les obstacles, fidèle, il détourne les périls et, te promettant une récompense éternelle, il accomplit des miracles à l’avance pour prix du rétablissement du culte.
Déjà tes soldats relèvent la foi, déjà la renommée, affaiblie et dépassée, gémit sous ton action, l’histoire, gardienne impavide du passé te redoute, le destin inexorable, découvrant tant de hauts faits, s’avance et surpasse l’espoir et les souhaits par un succès mérité.
Continue désormais, et, vainqueur, rends à Dieu tous les autels dont il avait été chassé, rends Dieu aux vaincus, fais-en sorte qu’il règne et, autant lui-même t’a donné d’actions exemplaires qui te précèdent, qu’autant sa gloire précède tes tâches dans la guerre comme dans la paix.
Mais pendant que le monde entier t’admire, que les Muses admirent ton esprit courageux, ton intelligence profonde, qu’à l’envi elles élèveront au ciel un si grand art de régner, qu’il me soit donné de me taire une fois pour toutes, Grand Roi, et d’admirer seulement dans un prince invaincu le don de Dieu.
1 « Une nuit profonde recouvre les poètes latins. Aucun honneur, aucune faveur pour les rythmes latins », « À Charles Perrault, académicien. Les poètes latins ne sont pas en honneur auprès de la cour », 1694, v. 3-4 (cité dans Andrée Thill et Gilles Banderier, La Lyre jésuite. Anthologie de poèmes latins (1620-1730), Genève, Droz, 1999, p. 257).
2 « Les récompenses des poètes qui écrivent en latin sont éternelles. », sous-titre de l’« Ode à J.-B. de Santeul », 1694 (cité dans A. Thill et G. Banderier, La Lyre jésuite, op. cit., p. 257).
3 Jozef Ijsewijn, Companion to Neo-Latin Studies, Louvain, Leuven University Press et Peeter Press, 1990, t. I, p. 136.
4 Abbé J.-A. Vissac, De la poésie latine en France au siècle de Louis XIV, Paris, A. Durand, 1862, p. 5.
5 Op. cit., p. 18.
6 Op. cit., t. II, p. 3.
7 Pierre Grimal, Le Lyrisme à Rome, Paris, PUF, 1978, p. 117.
8 Op. cit. Voir p. 254 au sujet de la période impériale : « Il semble que la forme lyrique devienne alors un mode d’expression de plus en plus naturel. Tout Romain cultivé, sous l’effet d’un sentiment soudain en présence d’un spectacle ou d’une situation inhabituels, se met à parler en vers. »
9 « L’élégie […] permet aussi l’expression d’un point de vue personnel sur d’innombrables sujets. Cet aspect fait de l’élégie un genre ouvert, commode, proche du genre épistolaire. » (A. Thill et G. Banderier, La Lyre jésuite, op. cit., p. 3).
10 « The elegiac couplet was the single most popular meter for Neo-latin. It has been used for poems of almost all forms and lengths […]. » (Sarah Knight et Stefan Tilg (dir.), The Oxford Handbook to Neo-Latin, Oxford University Press, 2015, p. 45).
11 Ch. Marty-Laveaux émettait une légère réserve à l’encontre du v. 80 : « On peut voir que Corneille n’a aucun égard au conseil que donnent nos prosodies latines, qui veulent qu’on évite de placer après une finale brève un mot commençant par sp, st, et généralement par deux consonnes dont la seconde n’est pas une liquide. Il y a dans cette pièce quatre exemples de cette licence, aux vers 12, 29, 44 et 81. […] Au reste les poètes latins du dix-septième siècle ne tenaient en général aucun compte de cette règle. On verra d’assez nombreux exemples de la même licence dans les pièces du P. de la Rue, de Santeul […]. » (Charles Marty-Laveaux, Œuvres de P. Corneille, Paris, Hachette, 1862, t. X, p. 72, n. 1).
12 Signalé par Louis Rivaille, Les Débuts de P. Corneille, Paris, Boivin, 1936, p. 700.
13 Pierre Corneille, Œuvres complètes, éd. Georges Couton, 3 vol., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980-1987, t. I, 1980, p. 1349.
14 Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, 2 vol.
15 Ernst Curtius, La Littérature et le Moyen Âge latin, trad. Jean Bréjoux, Paris, Presses Pocket, « Agora », 1991, p. 154-158.
16 Op. cit., p. 157.
17 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. I, p. 1347.
18 Gérard Genette, Seuils, Paris, Seuil, « Essais », 1987, p. 211 : « C’était, dans l’éloquence classique, le pendant inévitable de l’amplificatio du sujet. Face à l’importance de son thème, parfois exagérée au-delà de toute mesure, l’orateur plaidait son incapacité à le traiter avec tout le talent nécessaire, comptant apparemment sur le public pour établir une juste moyenne. »
19 Par exemple Blaise de Vigenère dans l’épître « Aux lecteurs » en tête des Commentaires de César, des guerres de la Gaule, [Genève], J. Chouët, 1594.
20 Selon Francis Goyet, « Le problème de la typologie des discours », Exercices de rhétorique, no 1, 2013, n. 13, en ligne : http://rhetorique.revues.org/122, consulté le 16 juillet 2020.
21 Bernard Dupriez, Gradus. Les procédés littéraires, Paris, Union Générale d’Éditions, 1984, p. 207.
22 Saulo Neiva et Alain Montandon (dir.), Dictionnaire raisonné de la caducité des genres littéraires, Genève, Droz, 2014.
23 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. I, p. 1697.
24 Œuvres de P. Corneille, éd. citée, t. X, p. 396.
25 Le vers complet avait été cité dans une lettre de Balzac à Chapelain du 10 septembre 1631.
26 Ratio Studiorum. Plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus, Adrien Demoustier, Dominique Julia et al., Paris, Belin, 1997, p. 171.
27 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. I, p. 1695.
28 § XLV : « nec tam imperio nobis opus est, quam exemplo » (« nous n’avons pas tant besoin du pouvoir que de son exemple »).
29 Jean-Pierre Chauveau, « Tombeaux poétiques au xviie siècle », La Licorne, 1994, p. 182.
30 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. I, p. 1695.
31 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. I, p. 1393. Repris de Ch. Marty-Laveaux, op. cit., t. X, p. 442.
32 Ibid.
33 G. Couton ne semble pas l’avoir repéré dans son édition.
34 Trad. A. Bourgery, Paris, Les Belles Lettres, 1976, t. I, p. 4.
35 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. III, 1987, p. 722.
36 Horace, Odes, trad. François Villeneuve, Paris, Les Belles Lettres, 1981.
37 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. II, 1984, p. 626.
38 Voir Ausone, Épîtres, IV, v. 85-93, pour la description.
39 G. Grumbach et A. Waltz, Prosodie et métrique latines, Paris, Garnier frères, 1893, p. 63.
40 Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. II, p. 1451.
41 Ibid., t. III, p. 299-306.
42 Ibid., t. III, p. 724.
43 Ibid., t. III, p. 1576.
44 Roger Zuber, « Corneille traducteur », Linguistica Antwerpiensia, VII, 1973, p. 160.
45 Lettre au comte de Lionne, février 1668, Lettres, éd. René Ternois, Paris, M. Didier, 1967, t. I, p. 131.
46 Voir la notice de G. Couton, dans Pierre Corneille, O. C., éd. citée, t. III, p. 1637-1641.
47 A. Thill et G. Banderier, La Lyre jésuite, op. cit., XXIII-, 284 p.
48 « The most popular verses were the dactylic hexameter and pentameter, the Catullan hendecasyllables, the Horatian sapphics and other lyrical forms […] » (J. Ijsewijn, op. cit., t. II, p. 427).
49 S. Knight et S. Tilg, The Oxford Handbook of Neo-Latin, op. cit., p. 51.
50 Lettre du 10 juin 1656, dans Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. II, p. 1201.
51 Lettre du 12 avril 1652, dans ibid., t. II, p. 1196.
52 Lettre du 23 avril 1652, dans ibid., t. II, p. 1199.
53 « Au lecteur » dans le Remerciement au cardinal Mazarin (1644), dans ibid., t. I, p. 1065.
54 Par l’abbé de Saint-Geniez (1654). Cité par Vissac, op. cit., p. 28.
55 Cité par J. Ijsewijn, op. cit., t. II, p. 4.
56 Emmanuel Bury (dir.), Tous vos gens à latin. Le latin, langue savante, langue mondaine (xive-xviie siècles), Genève, Droz, 2005, 463 p.
57 Voir Pierre Corneille, O. C., éd. citée de G. Couton, t. III, p. 1644.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/928.html.
Quelques mots à propos de : Jean-Marc Civardi
Université Paris-Saclay, UVSQ, DYPAC, Versailles
Jean-Marc Civardi est maître de conférences en littérature française à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Spécialiste du théâtre et de la poétique théâtrale au xviie siècle et auteur de plusieurs éditions critiques, il a travaillé sur les querelles dramatiques, la naissance de la critique et les spectacles de collèges. Il a également traduit des textes néo-latins (xvie-xviie siècles).
