Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
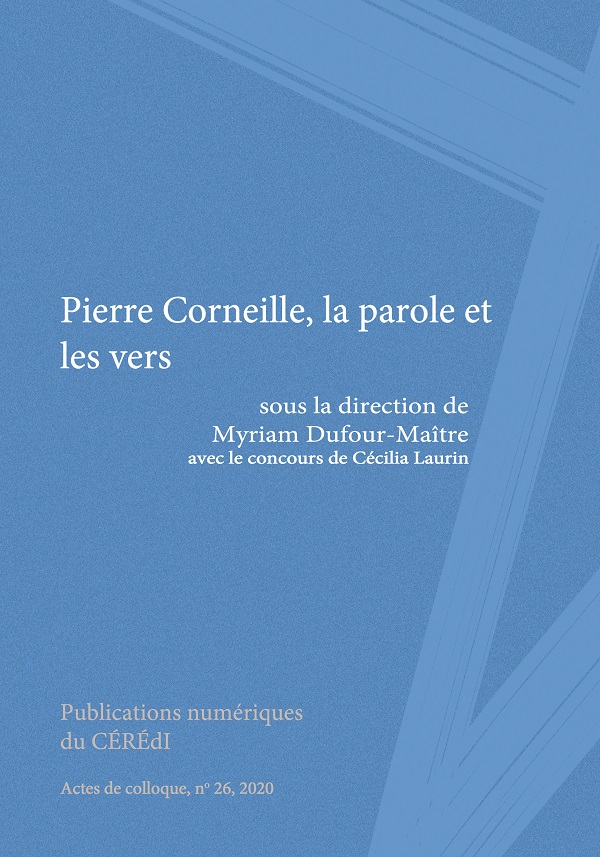
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Poétique
Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
Jean de Guardia
On sent intuitivement à l’écoute du théâtre de Corneille que l’engendrement de la quantité de vers dans les répliques de l’œuvre dramatique est sous-tendu par des règles précises, et qu’il n’y a pas d’aléatoire en la matière. Le problème est que ces principes ne sont guère formulés par le dramaturge (pourtant terriblement théoricien), sans doute parce qu’ils sont trop évidents. Le présent article se propose ainsi d’expliciter les règles d’amplification du dialogue cornélien.
Un prince admirablement éloquent n’emploie pas sa rhétorique à un valet de pied qu’il aille quérir tel Seigneur à cinquante lieues de la Cour.
La Mesnardière, La Poétique, 1640.
1Dans un passage célèbre de sa Pratique, d’Aubignac écrivait à propos de l’alexandrin dramatique :
Il faut présupposer que les grands vers de douze syllabes, nommés communs dans les premiers auteurs de la poésie française, doivent être considérés au théâtre comme de la prose : car il en est de ces sortes de vers comme des iambes, qui selon la doctrine d’Aristote furent choisis pour les tragédies par les anciens, à cause qu’ils approchent plus de la prose que tous les autres, et qu’ordinairement en parlant grec ou latin, on en fait sans y penser1.
2Le raisonnement est bien connu : l’alexandrin est le vers le moins poétique qui soit, parce qu’il est le plus long, donc le moins sensible à l’oreille et le plus proche de la prose. Mais on voudrait ici en tirer toutes les conséquences. Si le vers dramatique est pour l’âge classique une prose mesurée, il est du même coup la mesure de la prose : une unité de compte. Il sert (entre autres choses), à mesurer les longueurs relatives des discours, à objectiver le long et le bref. Faisant appréhender au spectateur – et encore plus au lecteur – la durée des discours, il rend les comparaisons possibles et précises. Ce n’est certes pas sa fonction la plus noble, mais c’est bien une fonction essentielle. Le fait que cette unité de mesure existe a une incidence pratique sur la vie des troupes : tout au long de l’âge classique, pour un comédien, le « bon » rôle se détermine objectivement à son nombre de vers. De plus, la question a une importance générique considérable au moment précis qui nous occupe : à l’époque de Corneille, la tragédie devient progressivement un genre très réglé en « étendue » : une tragédie doit durer entre 1800 et 2000 vers, ni plus, ni moins.
3Dans tout théâtre versifié, le vers crée une objectivité des durées des prises de parole, que l’on peut comparer aisément entre elles. Il faut prendre toute la mesure de la bizarrerie pragmatique que constitue un théâtre versifié, c’est-à-dire une interlocution versifiée – que nous ne percevons plus à cause de notre extrême familiarité avec ces textes. Imaginons un instant que dans la vie réelle, à chaque fois que nous prenons la parole, nous déclenchions un chronomètre. Quand bien même ce chronomètre n’aurait aucune conséquence contraignante sur les échanges, quand bien même les temps de parole ne seraient nullement limités, une telle prise de conscience aurait des conséquences massives sur la nature même des échanges – probablement désastreuses. La conscience précise des durées change la nature des échanges verbaux – c’est précisément le cas dans le théâtre du xviie siècle.
4On sent intuitivement à l’écoute du théâtre de Corneille que l’engendrement de la quantité de vers est sous-tendu par des règles implicites2, et qu’il n’y a pas d’aléatoire en la matière. La poétique de Corneille est comme on sait fort réglée, et s’il existe une possibilité de mesurer les durées des répliques, on peut raisonnablement penser qu’il existe chez lui des règles de copia, ou d’amplification3. Il s’agit donc ici, simplement, d’expliciter certaines de ces règles.
Persuasion et amplification
5Corneille se montre sensible au problème dès ses premiers textes, même dans le genre comique (pourtant moins soumis a priori à ce genre de règle). Dans une scène de La Place Royale4, Phylis, au cours d’une tirade de quarante vers (v. 45-85), développe une conception paradoxale de l’amour, pour convaincre son amie Angélique qu’il vaut mieux passer d’amant en amant qu’en avoir un seul :
Dans l’obstination où je te vois réduite
J’admire ton amour et ris de ta conduite.
Fasse état qui voudra de ta fidélité,
Je ne me pique point de cette vanité,
[…]
Pour moi j’aime un chacun, et sans rien négliger
Le premier qui m’en conte a de quoi m’engager,
Ainsi tout contribue à ma bonne fortune,
Tout le monde me plaît, et rien ne m’importune,
De mille que je rends l’un de l’autre jaloux
Mon cœur n’est à pas un en se donnant à tous5.
6Et Phylis de poursuivre durant plusieurs dizaines de vers. Mais Angélique lui répond ensuite en ces termes très précis :
Voilà fort plaisamment tailler cette matière
Et donner à ta langue une longue carrière.
Ce grand flux de raisons dont tu viens m’attaquer
Est bon à faire rire et non à pratiquer6.
7Tel est le texte de l’édition originale, mais à partir de celle de 1663, Corneille corrige « longue carrière » en « libre carrière » – adjectif désignant plutôt la qualité du discours que sa quantité. Le dramaturge essaie probablement de dissimuler quelque chose que le spectateur ressent (et qu’il a souligné lui-même dans la première version) : la réplique de Phylis est trop longue, c’est un « grand flux de raisons ». D’ailleurs, dès l’édition de 1660, trois ans avant cette correction, Corneille avait déjà supprimé les vers 69 à 72 de la tirade. Pourquoi pense-t-il qu’il y a ici « trop » de vers ? Au regard de quelle norme s’établit ce trop ?
8Comme le dit Angélique, c’est l’effet de la réplique qui pose problème ici. Le discours produit bien un effet comique (il est « bon à faire rire ») mais pas d’effet persuasif (il n’est certainement pas « bon à pratiquer ») : il a bien un effet perlocutoire mais pas d’effet illocutoire. Angélique souligne au fond que Phylis elle-même ne peut pas considérer un instant sa tirade comme virtuellement persuasive sur l’interlocuteur. C’est pour une réplique non persuasive qu’elle est beaucoup trop longue. Phylis « taille » la matière qu’est cette « question d’amour » galante, comme l’artisan tailleur taille son drap à son gré : elle se comporte ici comme une artiste et pas comme un personnage agissant. Ainsi, les amplifications discursives de Phylis sont hors-structure dans la stricte mesure où elle ne peut vraisemblablement pas les considérer elle-même comme aptes à persuader. C’est un problème technique assez important pour que Corneille revienne dessus dans les éditions ultérieures et qu’il tente de le dissimuler.
9Si l’on suit le raisonnement d’Angélique jusqu’au bout, l’on aboutit à l’un des principes fondamentaux de la poétique rhétorisée qui est celle de Corneille : si la parole de Phylis avait été virtuellement persuasive, alors l’amplification de quarante vers aurait été parfaitement légitime. Par exemple, si le cadre avait été celui d’une pièce libertine, et que Phylis était en train d’essayer de pervertir Angélique, il n’y aurait pas eu de problème particulier. Ainsi, à l’oreille de Corneille, la capacité persuasive du discours autorise l’amplification : à partir du moment où la parole est fonctionnelle, où elle est dramatique, non seulement elle a sa place dans le poème dramatique, mais de plus elle peut être ornée et le nombre de vers peut se multiplier. C’est là sans doute un principe fondamental du théâtre de Corneille, par opposition à celui qui le précède immédiatement, mais aussi par opposition à celui qui le suit immédiatement – celui de Racine7.
10Apparemment, ce raisonnement ne connaît dans l’esprit de Corneille aucune limite à son application, puisqu’il l’a autorisé à engendrer plusieurs monstres. La scène la plus monstrueuse de Corneille est une séquence de Conseil oratoire : la scène 1 de l’acte II de Cinna, dans laquelle Auguste consulte ses deux conseillers, pour savoir s’il doit ou non abandonner le pouvoir. Dans cette scène, les conseillers peuvent « donner libre carrière » à leur discours, autant qu’ils le souhaitent : elle compte près de trois cents vers (355-646), c’est-à-dire à peu près l’étendue traditionnelle d’un acte entier. Cinna y prononce quatre tirades : trente-sept vers (405-442), vingt-deux vers (499-521), onze vers (545-556), et cinquante-cinq vers (565-620). Au total, cette scène de délibération est littéralement interminable, et difficilement supportable à l’oreille moderne. Qu’est-ce qui l’autorise au xviie siècle ?
11D’abord, bien sûr, elle fait partie de la matière historique de Cinna8. Mais surtout, cette scène est « nécessaire » au sens que le xviie siècle donne au terme, c’est-à-dire fonctionnelle. Parce qu’elle est d’essence rhétorique, elle est en prise sur le drame : elle est la cause d’un événement de la fable. Si, par le fameux test aristotélicien d’amovibilité cher aux classiques9, l’on retire la scène du tissu dramatique, l’on rend la suite incompréhensible. Sans cette scène de conseil, la décision d’Auguste – rester au pouvoir alors qu’il voulait le quitter – devient incompréhensible. Mais il faut bien remarquer que ce test aristotélicien justifie la scène uniquement en tant qu’événement (en tant qu’« incident », comme on disait alors) et non en tant que discours : ce n’est qu’en tant qu’événement qu’elle est « nécessaire ». La longue série des vers qui la composent n’en est pas justifiée pour autant. En réalité, il est loisible de faire rejouer le test aristotélicien, non plus au niveau global mais sur le plan des vers, et de montrer que la scène contient nombre de vers « non nécessaires ». Par exemple dans cette séquence :
Depuis qu’elle [Rome] se voit la maîtresse du monde,
Depuis que la richesse entre ses murs abonde,
Et que son sein, fécond en glorieux exploits,
Produit des citoyens plus puissants que des rois.
Les grands, pour s’affermir achetant les suffrages,
Tiennent pompeusement leurs maîtres à leurs gages,
Qui, par des fers dorés se laissant enchaîner,
Reçoivent d’eux les lois qu’ils pensent leur donner.
Envieux l’un de l’autre, ils mènent tout par brigues,
Que leur ambition tourne en sanglantes ligues10.
12On voit ainsi apparaître les vers qui sont de purs « ornements », au sens précis que le xviie siècle donne au terme : des expansions verbales, belles mais structurellement amovibles (par distiques) – vers de doublons redondants11, maximes, exempla historiques, etc. En les ôtant, il est possible de récrire une scène intelligible en beaucoup moins de vers, et cela sans altérer ni le système syntaxique ni le système rimique.
13Cet exercice pervers cher aux classiques12 montre que la règle qui préside aux autorisations d’amplification dans la parole persuasive n’est pas la règle d’inamovibilité des vers. Le discours de conseil – le discours de délibération au sens originel13 – jouit bien d’une autorisation d’ornement. On le voit à la même époque chez d’Aubignac :
Bien loin donc de condamner ces délibérations, et de les exclure du poème dramatique, j’exhorte autant que je le puis, tous les poètes d’en introduire sur leur théâtre tant que le sujet en pourra fournir, et d’examiner soigneusement avec combien d’adresse et de variété elles se trouvent ornées chez les anciens et, j’ajoute, dans les œuvres de Monsieur Corneille ; car si on y prend bien garde, on trouvera que c’est en cela principalement que consiste ce qu’on appelle en lui, des merveilles, et ce qui l’a rendu si célèbre14.
14Pourquoi la capacité d’amplification de la parole délibérative est-elle infinie ? Pourquoi est-elle autorisée à engendrer des « merveilles » interminables ? Sans doute parce que la loi d’informativité (que votre contribution ne contienne pas plus d’information qu’il n’est requis) n’y a pas cours. La parole persuasive a atteint son effet lorsqu’elle a persuadé, et non quand elle a informé. Cinna ne dit littéralement à Auguste que des choses qu’il sait déjà – on peut imaginer que l’empereur connaît un peu son histoire romaine, et que les exempla sanglants de Cinna ne lui apprennent rien. C’est ainsi qu’un orateur délibératif, contrairement à un narrateur d’événements, a droit à la redondance factuelle (donner plus d’information que nécessaire) et à tous les ornements figuraux – cela sans heurter l’esthétique dramatique fonctionnaliste sévère qui est celle de Corneille. Certains éléments « superflus » du point de vue de l’information (ou même du raisonnement) peuvent évidemment être très « nécessaires » du point de vue de la persuasion. En ce sens, la parole de conseil apparaît comme le lieu naturel de l’amplification discursive dans un théâtre « fonctionnaliste ». C’est sans doute la raison pour laquelle on trouve dans Cinna cette délibération monstrueuse, alors même que la pièce est le manifeste d’une esthétique de l’unité et de la dramaticité. Même si le spectateur la trouve terriblement ennuyeuse (« froide », aurait dit Sévigné), parce que redondante et beaucoup trop ornée de métaphores et de prosopopées, il devra bien admettre qu’elle fait partie du « tout » de l’œuvre. Si un conseiller peut vraisemblablement penser que tout cela est de nature à convaincre un empereur, tout cela est motivé. Au total, la règle d’amplification du discours persuasif en régime fonctionnaliste pourrait se formuler ainsi : Les ornements du discours sont autorisés dans la stricte mesure où ils peuvent être perçus par le locuteur comme persuasifs sur l’interlocuteur intra-scénique. C’est là simplement un principe d’argumentation suffisante : dès que le personnage ne peut plus considérer son amplification comme persuasive, le discours doit s’arrêter. Ce principe est toujours posé du point de vue du locuteur et non du spectateur : nous percevons comme normal le fait que le personnage dise tout ce qu’il estime nécessaire pour atteindre son but, et non pas tout ce que nous estimerions nécessaire.
15Chez Corneille, ce principe est très bien appliqué. L’orateur va rarement au-delà de ce qu’il perçoit comme une argumentation suffisante. Mais on trouve nombre d’infractions chez des auteurs qui ont moins de métier, et moins de conscience des règles les plus fondamentales (car implicites) de leur art. D’Aubignac par exemple, dans sa fameuse tentative de tragédie, Zénobie, a beaucoup de mal à appliquer le principe d’argumentation suffisante. Dès la deuxième scène, Zénobie donne des ordres à ses généraux mais elle les développe très longuement, sur une page entière. Ses généraux réagissent ainsi :
Zabas : Il semble, Madame, que vous ayez quelque défiance de nous, puisque vous ajoutez à vos ordres tant de considérations pour nous émouvoir. Nous n’avons pas accoutumé d’attendre des raisons pour obéir, quand Zénobie commande.
[Discours du général Timagène dans le même sens]
Mais c’est trop discourir. Allons, Timagène, où le devoir nous appelle, selon les ordres de la Reine, j’aurai soin de la bataille, prenez garde à la ville15.
16D’Aubignac, soucieux de « remplir » les cinq actes de sa tragédie, enfreint brutalement le principe d’argumentation suffisante. La faute est si voyante qu’il devient nécessaire de la souligner, pour montrer que l’auteur en a conscience et s’en faire maladroitement excuser.
Information et amplification
17Nous avons uniquement envisagé jusqu’ici les discours de conseil fonctionnels dans l’intrigue – fondamentaux au théâtre, où la parole doit constituer le drame. Mais qu’en est-il dans les discours non persuasifs, notamment ceux qui sont purement informatifs ? Par exemple, quelles sont les règles d’amplification dans les narrations au théâtre ?
18En poétique régulière, pour motiver une narration aux yeux du spectateur, il faut motiver le désir de savoir de l’interlocuteur – c’est la partie la plus claire du système de Corneille et de d’Aubignac. Mais, une fois de plus, motiver l’existence d’un discours et motiver son étendue sont deux démarches différentes. Admettons par hypothèse qu’une narration donnée réponde à la première condition, c’est-à-dire que l’interlocuteur désire effectivement recevoir l’information. Dans ce cas, jusqu’où Corneille s’autorise-t-il à développer la narration, quel degré de détail peut-il lui donner ? La question semble très ponctuelle mais c’est une véritable obsession technique du dramaturge, qui y revient sans cesse dans les « Examens » de ses pièces :
Il faut que celui qui la fait [la narration] et celui qui l’écoute aient l’esprit assez tranquille, et s’y plaisent assez pour lui prêter toute la patience qui lui est nécessaire. Émilie a de la joie d’apprendre de la bouche de son amant avec quelle chaleur il a suivi ses intentions ; et Cinna n’en a pas moins de lui pouvoir donner de si belles espérances de l’effet qu’elle en souhaite ; c’est pourquoi, quelque longue que soit cette narration, sans interruption aucune, elle n’ennuie point16.
Il ne me reste qu’un mot touchant les narrations d’Achorée [personnage de La Mort de Pompée], qui ont toujours passé pour fort belles, en quoi je ne veux pas aller contre le jugement du public, mais seulement faire remarquer de nouveau que celui qui les fait et les personnes qui les écoutent ont l’esprit assez tranquille, pour avoir toute la patience qu’il y faut donner17.
19Corneille veut ainsi que le narrataire ait « l’esprit assez tranquille » pour accorder sa « patience » à la narration : pour justifier les vers nombreux, il faut motiver la patience de l’interlocuteur. Nous retrouvons ici la question de « thermodynamique » du dialogue abordée ailleurs dans ce volume18 : pour justifier l’étendue de la réplique, il est nécessaire que les personnages soient « froids ». Le problème vient du fait que toute narration, parce qu’elle a pour but l’information et non la persuasion, est par essence résumable. Parce qu’un narrateur peut19 toujours faire plus court, un interlocuteur impatient (« chaud ») est a priori en droit, du point de vue des règles implicites de l’échange verbal, de demander une version plus brève.
20Dans les exemples de Cinna et de La Mort de Pompée donnés par Corneille, les personnages sont effectivement assez froids pour justifier une longue narration, mais ce n’est pas toujours le cas chez le dramaturge. À la première scène de l’acte IV de Médée, Nérine raconte à la démoniaque héroïne comment Jason a libéré Créuse de ses ravisseurs, et capturé Égée :
Nérine
Du bonheur de Jason et du malheur d’Égée,
Madame, peu s’en faut, qu’il ne vous ait vengée.
Ce généreux vieillard, ne pouvant supporter
Qu’on lui vole à ses yeux ce qu’il croit mériter,
Et que sur sa couronne et sa persévérance
L’exil de votre époux ait eu la préférence,
A tâché par la force à repousser l’affront
Que ce nouvel hymen lui porte sur le front.
Comme cette beauté, pour lui toute de glace,
Sur les bords de la mer contemplait la bonace,
Il la voit mal suivie, et prend un si beau temps
À rendre ses désirs et les vôtres contents. […]
Médée
Je devine la fin, mon traître l’a sauvée.
Nérine
Oui, madame, et de plus Égée est prisonnier ;
Votre époux à son myrte ajoute ce laurier :
Mais apprenez comment.
Médée
N’en dis pas davantage :
Je ne veux point savoir ce qu’a fait son courage ;
Il suffit que son bras a travaillé pour nous,
Et rend une victime à mon juste courroux20.
21Corneille commente ainsi dans son « Examen » de la pièce :
Dans la narration que fait Nérine au quatrième acte, on peut considérer que quand ceux qui écoutent ont quelque chose d’important dans l’esprit, ils n’ont pas assez de patience pour écouter le détail de ce qu’on leur vient raconter, et que c’est assez pour eux d’en apprendre l’événement en un mot ; c’est ce que fait voir ici Médée, qui, ayant su que Jason a arraché Créuse à ses ravisseurs, et pris Égée prisonnier, ne veut point qu’on lui explique comment cela s’est fait. Lorsqu’on a affaire à un esprit tranquille, comme Achorée à Cléopâtre dans La Mort de Pompée, pour qui elle ne s’intéresse que par un sentiment d’honneur, on prend le loisir d’exprimer toutes les particularités ; mais avant que d’y descendre, j’estime qu’il est bon, même alors, d’en dire tout l’effet en deux mots dès l’abord. Surtout, dans les narrations ornées et pathétiques, il faut très soigneusement prendre garde en quelle assiette est l’âme de celui qui parle et de celui qui écoute, et se passer de cet ornement, qui ne va guère sans quelque étalage ambitieux, s’il y a la moindre apparence que l’un des deux soit trop en péril, ou dans une passion trop violente pour avoir toute la patience nécessaire au récit qu’on se propose21.
22Si le désir de savoir est trop puissant, donc trop pressé, il faut renoncer à la narration ornée. Mieux vaut « apprendre l’événement en un mot », « dire tout l’effet en deux mots dès l’abord », ne pas « exprimer toutes les particularités » : bref, renoncer à étendre le matériau verbal et ne pas engendrer trop de vers. On voit ici apparaître un problème dramaturgique assez fondamental : les deux règles qui encadrent la transmission de l’information au théâtre selon Corneille sont en réalité contradictoires, et ont des intérêts inverses. Pour justifier l’existence de la narration, il faut qu’il y ait un vif désir de savoir du côté du narrataire, et des conséquences immédiates sur sa vie : il faut que le personnage soit « chaud ». Ce n’est que de cette manière que la narration devient une action et s’intègre au drame. Mais plus la narration respecte cette règle, moins elle peut respecter celle qui concerne la « patience » de l’interlocuteur. En effet, si le narrataire est dans un péril pressant, alors il n’a plus la patience d’écouter : à partir du moment où il sait les faits, les « particularités » n’ont plus d’importance et il court à la suite de l’intrigue. Ainsi, dans le système de Corneille, la narration au théâtre ne saurait être à la fois longue et fonctionnelle, car pour cela le narrataire devrait être à la fois « chaud » et « froid ». En réalité, plus l’information est importante (fonctionnelle dans l’intrigue), moins elle doit être ornée, et moins l’information est importante (non-fonctionnelle), plus elle peut être ornée. Formulons donc la règle ainsi : Moins le discours informatif est utile, plus il peut être long. Cette règle est contre-intuitive : on accepte bien plus aisément l’idée que plus un élément a d’importance, plus il a droit au développement. C’est la règle qui prévaut en matière de discours persuasifs comme nous l’avons vu, et c’est surtout la règle qu’impose une esthétique néo-aristotélicienne du rapport entre drame et discours. En effet, dans une conception organiciste du théâtre, une partie du « bel animal » doit s’amplifier à proportion exacte de sa fonction. Plus un « membre » du « corps » qu’est l’œuvre a d’importance, plus il peut et doit se développer. Est « monstrueux », chez Aristote, ce qui se développe au-delà de sa fonction, l’ex-croissance.
23Pourtant, la logique paradoxale que nous venons de retracer est bien présente dans le discours critique du temps. Lorsque La Mesnardière tente d’établir une typologie des discours théâtraux (qu’il nomme, comme toute son époque, « sentiments »), il pose cette distinction importante :
Les sentiments […] se divisent en nécessaires et en ceux qui ne le sont pas. Les sentiments nécessaires sont ceux qui contiennent des choses que l’on est obligé de dire dans la tissure du poème, comme les commandements qu’un roi fait à ses lieutenants ou à d’autres officiers, dont il faut de nécessité qu’il se décharge sur eux dans la conduite de la fable, à cause de quelque incident de grande considération qui naîtra de leur négligence. […] Nous appelons en ce lieu sentiments non nécessaires ceux qu’il est permis à l’auteur d’employer si bon lui semble, ou de laisser en arrière dans la tissure du poème22.
24Les « sentiments nécessaires » sont ainsi les discours fonctionnels : ceux qui auront des conséquences sur l’histoire, et sont donc inamovibles, sous peine de la rendre incompréhensible. Inversement, les « sentiments non nécessaires » sont ceux que l’on peut supprimer sans rendre l’intrigue incompréhensible. Le critique se sert alors de cette typologie pour tenter de comprendre la place de l’ornementation dans le discours théâtral, et donc son « étendue23 » :
Si parmi les plus beaux corps, il s’en trouve quelques-uns qui ne seraient point agréables sans le secours des ornements que l’art ajoute à la nature, s’il y en a quelques autres qui n’ont pas besoin d’artifice pour paraître merveilleux, il se trouve aussi des choses parmi les ouvrages d’esprit qui veulent être relevées par la force de l’écrivain à cause que d’elles-mêmes elles n’ont pas assez de charmes : et il s’en rencontre d’autres qui demandent pour toute grâce d’être seulement exprimées, d’autant qu’elles peuvent plaire par leurs beautés essentielles, et que de leur nudité elles tirent leurs agréments24.
25Quels sont donc les discours qui peuvent être « ornés » par « l’artifice » et ceux qu’il faut laisser tout « nus » ? Notre intuition (ou notre aristotélisme inconscient) nous dit que ce sont logiquement les sentiments « nécessaires » qui peuvent être amplifiés, car ils sont fortement ancrés dans l’intrigue. Grâce à leur « liaison » essentielle avec le drame, leur développement ne paraîtra jamais étrange – c’était le cas par exemple des conseils de Cinna à Auguste. Mais selon La Mesnardière, c’est précisément le contraire :
Il est aisé de juger que ce genre de sentiments [les nécessaires] ne doit point être exprimé par des manières figurées, que les embellissements ne peuvent y trouver place, et que par exemple un prince admirablement éloquent n’emploie pas sa rhétorique à un valet de pied qu’il aille quérir tel Seigneur à cinquante lieues de la Cour, et qu’il parle tout simplement dans l’enclos de son cabinet aux officiers de la couronne. […] De même, lorsque notre poète sera obligé d’exprimer toutes ces choses nécessaires sur lesquelles on fait force, qui servent de liaison aux incidents de la pièce, qui font naître les aventures, ou qui servent dans le discours pour passer d’un lieu à l’autre, qu’il les dise, s’il est possible, d’une manière très simple, toute droite et naturelle, puisqu’il suffit en ces endroits de s’expliquer nettement, et qu’ils ne peuvent être fleuris sans paraître ridicules. Ambitiosa recidet ornamenta [Horace]25.
26Ainsi, étrangement, la parole nécessaire, celle qui fait effet sur le drame, ne doit pas être objet d’amplification, sous peine de « ridicule ». Le fonctionnel doit rester « simple », « droit », « naturel » et sans « fleurs ». C’est en fait une conception strictement inverse à l’organicisme, et une généralisation (avant la lettre) de la théorie cornélienne des discours informatifs.
27Comment donc va-t-on pouvoir amplifier le discours et remplir les cinq actes de la pièce ? Justement, selon La Mesnardière, par les sentiments « non nécessaires » :
Qu’il se souvienne donc alors que les sentiments nécessaires portent leur beauté avec eux, pour ce qu’ils contiennent des points qui sont assez considérables dans la relation de l’histoire pour être toujours bien reçus dans leur expression toute simple. Mais que ces autres sentiments, que j’ai nommés non nécessaires, demandent d’être relevés de toutes les grâces de l’art, d’autant que leur seule beauté peut rendre recommandables les choses qui d’elles-mêmes ne sont pas fort nécessaires. […] C’est l’avis que le Philosophe [Aristote] donne au poète dramatique lorsqu’en examinant les manières qui doivent être suivies dans la conduite du discours, il lui ordonne d’embellir de toutes les grâces de style ces endroits qu’il appelle vides26.
28Ainsi, pour La Mesnardière, qui se fonde sur une lecture bien personnelle d’Aristote, les discours superflus sont justement ceux que l’on peut et que l’on doit orner et amplifier. Son raisonnement – terriblement contre-intuitif – mêle en fait le jugement de goût et l’analyse structurale. Le discours « nécessaire » n’a pas besoin d’ornements car sa nécessité constitue sa « beauté », et inversement le discours superflu, justement parce qu’il est superflu, a besoin des ornements (de la beauté) pour faire oublier sa non-fonctionnalité. La conclusion est en fait très étrange, car dans l’esprit des classiques, pour qu’il y ait beauté, il faut qu’il y ait ornement, donc développement. Ainsi, un élément non fonctionnel, pour faire oublier sa non-fonctionnalité (structurale) doit se faire remarquer (esthétiquement) : ce qui ne sert à rien ne doit surtout pas rester discret ! C’est là, probablement, une logique fondamentale de l’écriture dramatique classique.
1 Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, Paris, Antoine de Sommaville, 1657, livre III, chap. 10 (« Des stances »).
2 Les spectateurs comme les praticiens appliquent intuitivement ce type de règle. Il arrive ainsi fréquemment qu’un metteur en scène ou un acteur supprime un morceau perçu comme trop amplifié. Cela est arrivé par exemple au monologue inaugural d’Émilie dans Cinna comme le rappelle Voltaire : « Plusieurs actrices ont supprimé ce monologue dans les représentations. Le public même paraissait souhaiter ce retranchement. On y voyait de l’amplification. » (Voltaire, Commentaires sur Corneille, cité par Gilles Declercq dans « Poéticité versus rhétoricité », dans Ronald W. Tobin (dir.), Racine et/ou le classicisme, Tübingen, Gunter Narr, 2001, p. 19-53, citation p. 34).
3 Nous utilisons ici le terme d’amplification dans son sens quantitatif : l’augmentation du matériel verbal, qui se traduit par l’augmentation du nombre de vers – ce que les rhétoriciens du xvie siècle appelaient la dilatatio (mais le terme est sorti d’usage au xviie). Il est bien entendu qu’amplificatio a par ailleurs un sens qualitatif. Sur ce point, voir les travaux récents de Stéphane Macé, et notamment « L’amplification, ou l’âme de la rhétorique », Exercices de rhétorique 2014/4, en ligne : http://journals.openedition.org/rhetorique/364, consulté le 6 septembre 2018..
4 Voir dans ce volume la contribution de Ludivine Rey, « La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers ».
5 La Place royale ou l’Amoureux extravagant, éd. Jean de Guardia, dans Pierre Corneille, Théâtre complet dir. L. Picciola, vol. II, Paris, Classiques Garnier, 2017, I, 1, v. 45-48 et 63-68.
6 Ibid., v. 85-88.
7 Notre propos n’est pas de souligner ici après tant d’autres la nature rhétorique du dialogue cornélien, qui est une évidence. Une chose est de dire que la présence de la réplique est autorisée par son enjeu illocutoire (parce que dans le cas contraire elle devient amovible), autre chose que la dilatation de la réplique – l’augmentation du nombre de vers – est autorisée par son enjeu illocutoire.
8 Le débat d’Auguste avec ses conseillers est pris chez l’historien Dion Cassus, mais chez lui l’Empereur consulte Mécène et Agrippa, non pas Maxime et Cinna.
9 « Les parties que constituent les faits doivent être agencées de telle sorte que, si l’une d’elles est déplacée ou supprimée, le tout soit disloqué et bouleversé. Car ce dont l’adjonction ou la suppression n’a aucune conséquence visible n’est pas une partie du tout. » (La Poétique, éd. et trad. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil, « Poétique », 1980, ch. 8, 51 a 30).
10 Cinna, II, 1, v. 574-583.
11 Sur la manière dont Corneille crée des vers redondants dans la récriture de ses sources, voir la contribution de Liliane Picciola dans le présent volume : « Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures ».
12 « On gagne beaucoup en perdant tous les ornements superflus, pour se borner aux beautés simples, faciles, claires et négligées en apparence. Pour la poésie, comme pour l’architecture, il faut que tous les morceaux nécessaires se tournent en ornements naturels. Mais tout ornement qui n’est qu’un ornement est de trop. Retranchez-le ; il ne manque rien ; il n’y a que la vanité qui en souffre. » (Fénelon, « Lettre à l’Académie » [1716] dans Œuvres, éd. Jacques Le Brun, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1997, t. II, p. 1151).
13 Rappelons que dans le lexique rhétorique du xviie siècle, l’expression discours délibératif ne désigne pas un discours d’hésitation, mais bien un discours de conseil.
14 Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. citée, livre IV, chap. 4 (« Des délibérations »). Nous soulignons.
15 Zénobie, tragédie, où la vérité de l’histoire est conservée dans l’observation des plus rigoureuses règles du poème dramatique, Paris, A. Courbé, 1647, I, 2, p. 15.
16 « Examen » [1660] de Cinna [1642], dans Corneille, Œuvres complètes, éd. G. Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, t. I, p. 911.
17 « Examen » [1660] de La Mort de Pompée [1643], dans Corneille, Œuvres complètes, éd. G. Couton, éd. citée, t. I, p. 1077-1078.
18 Voir, dans le présent volume, la contribution de Gilles Declercq : « Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens ».
19 Comme le notait malicieusement Gérard Genette dans son Discours du récit (dans Figures III, Paris, Seuil, 1972), le mode sommaire permet aisément de réduire les milliers de pages de La Recherche du temps perdu à la phrase « Marcel devient écrivain ». Le récit, par définition, est ce qui se résume.
20 Médée [1639], IV, 1, v. 1013-1040.
21 Pierre Corneille, « Examen » [1660] de Médée, dans Œuvres complètes, éd. G. Couton, éd. citée, t. I, p. 538-539.
22 La Mesnardière, La Poétique, Paris, Antoine de Sommaville, 1640, p. 328. Avant ce passage, La Mesnardière a distingué les sentiments « passionnés » des « sentiments indifférents » et c’est au sein de cette seconde catégorie qu’il distingue les « sentiments nécessaires » des « sentiments non-nécessaires ».
23 Rappelons qu’au xviie siècle le terme d’ornement, comme celui d’amplification s’entend toujours à la fois au sens « qualitatif » (mettre en valeur) et « quantitatif » (augmenter le volume du matériau verbal, dilater). Sur ce point, voir les travaux récents de Stéphane Macé, et en particulier « L’amplification, ou l’âme de la rhétorique. Présentation générale », art. cité.
24 La Mesnardière, La Poétique, op. cit., p. 327-328.
25 Ibid., p. 328-329.
26 Ibid., p. 333.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/922.html.
Quelques mots à propos de : Jean de Guardia
Université Grenoble-Alpes
Jean de Guardia est Professeur de Littérature du xviie siècle à l’Université Grenoble-Alpes. Il est spécialiste du théâtre classique. Il a notamment publié : Poétique de Molière. Comédie et répétition, Genève, Droz, 2007 et Logique du genre dramatique, Genève, Droz, 2018.
