Sommaire
Journée des doctorants 2018
organisée par Aurélien d'Avout et Alex Pepino à l’Université de Rouen le 30 mai 2018
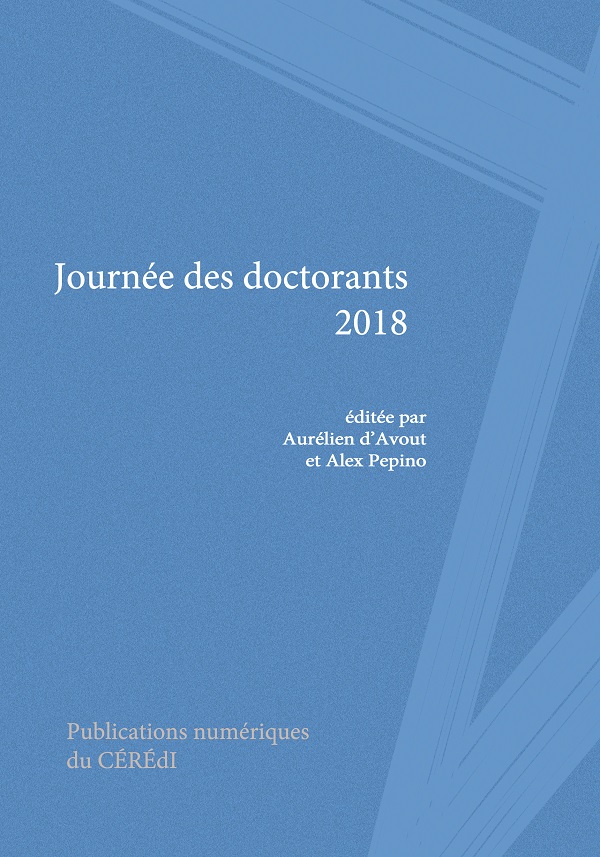
- Alexandra Vinogradova Renier son credo quia absurdum : Autocritique (1959) d’Edgar Morin
- Thibault Vermot M le Maudit de Fritz Lang (1931), ou la Ville inquiète
- Daniel Paterson Kitsch et modernisme : histoire d’un fratricide ?
- Angélique Salaun Portraits des femmes guerrières : des descriptions romanesques aux planches de bandes dessinées, entre clichés et variations
Journée des doctorants 2018
M le Maudit de Fritz Lang (1931), ou la Ville inquiète
Thibault Vermot
En mémoire d’Olivier, epic PhD.
Morales du film
1Pleine de mauvaises promesses, une comptine cruelle ouvre M le Maudit : « Le tueur va venir et te transformer en hachis » ; et c’est une phrase lourde de toute la fatalité qui entoure un meurtre d’enfant qui clôt le film, prononcée par la mère d’Elsie Beckmann : « À l’avenir, nous devrions surveiller nos enfants. » La première phrase est prophétique ; la dernière phrase, regard presque nostalgique jeté en arrière sur les événements de la diégèse, en propose une morale. Cette morale n’a rien de métaphysique, elle ne tient compte d’aucune progression de la pensée qui aurait été donnée à construire par les personnages ou le spectateur au cours du récit ; elle est simplement forgée à l’aune du bon sens. La certitude exprimée au début (« Le tueur va venir ») et la fatalité de la fin (« Il faudra surveiller nos enfants ») nous donnent le sentiment d’une sorte d’affaire réglée par avance. Dans M le Maudit, rien de nouveau sous le soleil ; l’assassin viendra. En conséquence, nous devrons mieux prendre garde à nos enfants. Si aucun enseignement moral supérieur ne vient boucler ce récit, de quoi parle donc M le Maudit ? Fritz Lang, dans un entretien avec le critique et réalisateur Peter Bogdanovich1 paru en 1969, nous donne une série de clefs :
S’il y a une couche inférieure dans le public – cela n’existe pas, mais admettons seulement qu’il y en ait une – M n’est qu’une histoire de gendarmes et de voleurs. Pour une couche un peu supérieure, ce serait : « Qu’est-ce que la brigade criminelle fait pour arrêter les assassins ? » Pour une autre encore ce sera (et c’est en fait pour cela que j’ai réalisé ce film) : « Quels dangers un enfant affronte-t-il dans la société contemporaine ? Qu’est-ce qu’on fait des criminels sadiques (si cela existe – si ce ne sont pas simplement des malades) ? » Et pour la couche supérieure (si l’on veut bien l’appeler comme cela), c’est une discussion pour ou contre la peine capitale. Dans ce cas, heureusement – cela n’arrive pas souvent (je ne suis pas très humble, j’en conviens) – on a un film qui plaît à toutes les couches à la fois2.
2Bien sûr, le film traite dans une certaine mesure du meurtre et du meurtrier ; le meurtre d’enfant n’est d’ailleurs pas anecdotique : il est la forme la plus monstrueuse et la moins acceptable du crime3 ; c’est vrai en 20184, c’était vrai déjà en 1931 ; qu’on se souvienne de l’émotion qui entoura l’affaire du bébé Lindbergh, de portée internationale, survenue en 1932. Ce crime place M hors de la sphère des hommes. Au cours du film, Schränker, figure la plus proéminente des bandits, appelle M un outsider. Lors de la parodie de procès populaire, une femme hurle « À mort le monstre ! ». M le Maudit est aussi à certains égards un film policier ; il relate une enquête, ses moyens, ses impasses. Mais la substance du film ne correspond ni à la nature du meurtre (incluant probablement le viol, comme l’indique l’obscène photogramme 71), ni au progrès de l’enquête – ni d’ailleurs à son résultat.
Dialectiques
3Puisque la traduction française de M – Eine Stadt sucht einen Mörder le veut, appelons donc M le meurtrier ; une fois que M tombe dans l’escarcelle de la police et qu’il est déféré devant le parquet, les événements sont elliptiques. Dans la version restaurée de 2000, ils tiennent pour ainsi dire dans une minute de film (ce dernier en compte 104). Ce n’est donc pas, à ce qu’il semble, le devenir de M qui importe à Fritz Lang, alors qu’il importe pourtant au spectateur. Le montage sonore coupe la parole à la justice : on arrête M avec une main sur l’épaule, et cette main est sans visage ; une voix tombe sur le meurtrier : « Au nom de la loi… » et se suspend ; le plan d’après montre le vide d’un tribunal, peu à peu rempli par les figures des juges qui rendent leur verdict : « Au nom du peuple… », et la suite inaudible se fond dans la litanie de Frau Beckmann, parée en mater dolorosa (ph. 117) : « Jamais nous ne reverrons nos enfants… Il faudra davantage veiller sur nos enfants… ». Que se passe-t-il donc au nom de la loi, au nom du peuple ? Seul le vide répond à cette question. Ce n’est donc pas la sentence de mort, probable, mais demeurant une hypothèse, qui compte. M le Maudit n’est pas un film de vengeance. Il n’est pas non plus un film d’explication : M rend compte de ce qu’il ressent quand le prend l’envie de tuer, mais la relation voulue poignante qu’il fait de sa hantise ne convainc pas le tribunal improvisé des bandits. Les bandits, et Schränker au premier chef, sont capables de prédire ce qui attend M s’il est livré à la police : « C’est ça. Pour qu’on te déclare irresponsable et qu’on te cajole dans une maison de santé. Y aura peut-être même une amnistie. Tu zigouilleras encore des fillettes ? Non, plus jamais. » Si, selon ce que dit Fritz Lang dans son entretien avec Bogdanovich, M le Maudit pose la question de ce que l’on doit faire de tels meurtriers, un certain sens de la fatalité habite déjà, en 1931, les solutions qu’on propose ; on a doublé l’emprisonnement de soins cliniques, et les soins cliniques ne fonctionnent pas. Existe-t-il d’ailleurs une solution ? Laquelle ? Cette question surgit à chaque fois que notre société est confrontée à un meurtre d’enfant ; en 2018, on est capable d’affirmer que le taux de récidive, malgré les soins et un suivi régulier, atteint tel pourcentage ; on n’a pas accès encore – faute d’histoire statistique – en 1931 à un tel chiffre5 ; mais on sait déjà que le soin clinique n’est pas un remède sûr ou systématique. Le film porte un tel discours via la figure de Schränker, rendue à demi crédible parce que Lang est fasciné par les super villains des serials à la Louis Feuillade, mais à demi crédible seulement parce que Schränker est, lui aussi, un assassin. L’ethos de Schränker éclipse quelque peu sa parole ; et à l’égard de la peine de mort requise contre les meurtriers d’enfants, le film de Lang ne fournit pas de thèse claire ; ce mouvement dialectique, fécond de contradictions, est fréquent lorsqu’on examine de près le propos donné à lire dans M le Maudit. La question de ce que doit faire de M la société, Fritz Lang l’évacue, de façon assez désinvolte, et assez cruelle ; la solution n’est pas dans l’œil qu’on devrait porter sur le tueur, mais dans l’œil qu’on devrait porter sur la victime potentielle ; « Nous devrions surveiller nos enfants », puisque nous ne pouvons ni contrôler, ni prévenir, ni soigner les M qui hantent la ville. Nous savons ce qu’M le Maudit n’est pas ; alors de quoi parle M le Maudit ?
Biais du titre français
4La traduction française du titre place le personnage de M au premier plan et entoure son cas d’une aura sombre ; M est un meurtrier, mais un meurtrier malgré lui, victime d’une sorte de malédiction, de hantise, qui le pousse à tuer ; à chaque crime commis, les fantômes qui l’entourent se font plus nombreux et plus pressants ; le seul moyen de s’en débarrasser, c’est de tuer ; alors seulement pour un court instant le meurtrier retrouve sa plénitude d’âme.
Mais je n’y suis pour rien ! Ce n’est pas de ma faute. […] Je porte en moi cette malédiction. Cette brûlure, cette voix… Ce supplice ! Quelque chose me pousse à errer par les rues, je sens que quelqu’un me suit sans arrêt. C’est l’autre qui me poursuit ! Sans bruit, mais je l’entends quand même. Et parfois j’ai l’impression de me poursuivre moi-même. Je voudrais m’enfuir, mais je ne peux pas m’échapper. [Hochements de têtes de quelques malfrats.] Cette force qui me pousse… Je cours, je cours, par des rues sans fin, je veux résister – et je cours, entouré des fantômes, des mères, des enfants. Ils se collent contre moi, toujours, toujours, toujours ! – Et seulement quand je cède… Alors tout s’évanouit autour de moi. Puis je me trouve devant une affiche, et je lis ce que j’ai fait. Je n’en crois pas mes yeux. C’était moi ? Je ne me souviens de rien ! Qui me croira ? Qui sait ce qui se passe en moi ? Ces cris, ces hurlements ! Cette force qui me pousse… Je résiste, elle me pousse ! Je résiste, elle me pousse encore ! Puis cette voix stridente. Je n’en peux plus de l’entendre… ! Au secours ! Je n’en peux plus !
5Telle est la malédiction qui frappe M. Ce titre, M le Maudit, s’avère dans une certaine mesure une fausse piste. Pour ce qui est du M, dans l’esprit de Lang, la treizième lettre de l’alphabet renvoie d’abord à la section berlinoise criminelle dans laquelle officie Ernst Gennat, Kriminalrat, directeur de la police criminelle en 19316, et non au personnage. Pour ce qui est du Maudit, la confession finale de M dans laquelle il décrit sa prétendue malédiction, même si elle forme la plus longue ligne de dialogue du film, est relativement convenue, même en 1931 (en y ajoutant le passage à l’acte, M a tous les symptômes d’un homme hanté par son Horla) ; cette confession n’a que peu d’effet sur l’assistance auprès de qui il la fait. M est Maudit, soit ; et alors ? Il mérite quand même la mort, nous dit-on. Dans les faits, le film escamote l’idée de malédiction, car il ne reconnaît pas la part grandiose ou exceptionnelle du meurtrier, même dans son caractère ignoble. Quelle grandeur dans cette confession, quand on relit la lettre écrite par M à la presse, où il clame son intention de continuer ses crimes ? Il y a là une contradiction qui empêche (une fois de plus) de tirer des conclusions claires quant à la sincérité du meurtrier. Le titre français donne à mots couverts une explication – et même peut-être une excuse – à la pulsion meurtrière de M ; il voudrait conférer au meurtrier une dimension mythique ; M comme Maudit, M comme Mörder ou Matador (le mot apparaît dans une inscription publicitaire au cours du film sur un étal de jouets), M comme le Moloch de Metropolis ; M comme Mabuse, incarnation du Mal universel7 ; M enfin comme la grande figure française des mythologies noires, Maldoror. Ne lit-on pas dès les premières pages des Chants :
J’établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années, où il vécut heureux ; c’est fait. Il s’aperçut ensuite qu’il était né méchant : fatalité extraordinaire ! Il cacha son caractère tant qu’il put, pendant un grand nombre d’années ; mais, à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle, chaque jour le sang lui montait à la tête ; jusqu’à ce que, ne pouvant plus supporter une pareille vie, il se jeta résolument dans la carrière du mal… atmosphère douce ! Qui l’aurait dit ! Lorsqu’il embrassait un petit enfant, au visage rose, il aurait voulu lui enlever ses joues avec un rasoir, et il l’aurait fait très souvent, si Justice, avec son long cortège de châtiments, ne l’en eût chaque fois empêché. […] Ainsi donc, il est une puissance plus forte que la volonté8…
6Le titre français amène également le spectateur à se focaliser sur la performance de Peter Lorre, dont les yeux exorbités composent un jeu des plus éloquents (ph. 20.5, 20.6 ; ph. 57, reflet ; 60 ; 72, 80, 93, 97, 114). Mais entre le moment où, peu après la fin du prologue, on voit M de dos écrire à la presse en sifflotant, et sa première apparition de face, on doit attendre que passent près de 40 minutes, et plus de la moitié du film (57 minutes environ) pour que le meurtrier soit effectivement marqué d’un M à l’épaule.
Une ville cherche un assassin
7Pour envisager le propos essentiel du film, nous devons nous tourner vers le second sous-titre original donné par Fritz Lang à M le Maudit : Eine Stadt sucht einen Mörder, soit, littéralement, Une ville cherche un assassin. Le grand mérite de ce sous-titre est de placer au premier plan la ville et au second le meurtrier ; ce n’est, dans la confection du titre allemand, pas tant le meurtrier même qui importe dans M le Maudit, que le comportement d’une ville entière vouée au progrès, à l’étalage de marchandises et de mots d’ordres publicitaires lorsqu’elle est confrontée au grain de sable qui vient enrayer son grand rouage – à savoir M, bien entendu. Après le prologue, qui montre comment Elsie Beckmann rencontre M, il faut attendre un long moment pour retrouver le personnage de M dans un plan moyen qui le montre sortant de son appartement, bourgeoisement habillé ; impossible à reconnaître au premier regard, à vrai dire. Le film montre surtout la réaction de la ville face au meurtre. Ce qui pose un problème dans M, ce n’est pas tant que l’assassin tue des enfants, mais qu’il empêche la Ville de vaquer à ses occupations en toute quiétude, ou dans ce qu’on pourrait appeler une normalité de la quiétude, si l’on considère, comme le dit Schränker lorsqu’il évoque les rapports entre police et syndicats du crime, que « se faire refroidir par la police, c’est réglo ». Il en va de même pour les descentes de police dans les fumeux troquets : « Tiens, c’est le gros Lohmann ! » dit-on quand le commissaire paraît dans les escaliers d’un bar à filles. Aucune surprise, aucune indignation dans ce constat ; voir débarquer « le gros Lohmann » procède de l’habitude, ou du prévisible. « Réglo » également les contrôles d’identité, le panier à salade. On a trouvé souvent dans M des relents du nazisme florissant : c’est vrai en partie, mais de façon anecdotique, puisque la figure picturale la plus claire, c’est Schränker en pardessus de cuir qui surveille l’attribution aux mendiants de leurs quartiers de surveillance. Mais tout ce qui traite des exactions policières et des rapports entre police et bandits semble en vérité « réglo ». Ce qui hérisse le crime, c’est M et l’inquiétude qu’il apporte. Évidemment, avec la venue de M, le petit jeu du chat et de la souris se dérègle. « Nous sommes exposés aux vexations policières, affirme Schränker. Il faut que tout rentre dans l’ordre. » La police, qu’on soupçonne corrompue, qu’on devine indolente, est sommée de fournir des résultats ; ses recherches, d’abord cantonnées aux quartiers pauvres ou populaires, gagnent peu à peu le monde plus tranquille de la bourgeoisie ; au cours d’une réunion des chefs de police, l’un d’entre eux observe que ce qui fait la marque du meurtrier d’enfants, c’est justement qu’il n’a pas laissé de trace notable. Le meurtrier est donc probablement quelqu’un qui en temps normal passe inaperçu : « C’est probablement un homme qui, lorsqu’il ne tue pas, a la même vie que n’importe quel bourgeois, souligne le Ministre. Il joue peut-être aux billes avec les enfants de sa logeuse. » On envoie donc enquêter dans toutes les pensions bourgeoises, chez tous les particuliers. L’inquiétude gagne la Ville tout entière, et M le Maudit fournit à la faveur du meurtre, qui est pour Fritz Lang une sorte de prétexte, un voyage à travers la Ville et une longue énumération des objets et des personnes qui la constituent ; tous prennent une teinte inquiétante à la lumière étrange de cette série de crimes non élucidés. Pourquoi une telle énumération ? Parce que la découverte de l’identité du meurtrier passe par une fouille systématique du détail social. C’est la méthode développée non seulement par la police, mais aussi par le syndicat du crime ; mais aussi par les mendiants. Quand la police suggère d’intensifier les rafles dans les bas-fonds et de passer au peigne fin les intérieurs bourgeois, les syndicats du crime ajoutent : « Faisons travailler nos mouchards. Chaque mètre carré doit être surveillé en permanence. » Importance donc des détails les plus infimes. Le meurtrier fume des cigarettes Ariston (Lohmann se souvient de ce détail, lu à travers la pléthorique paperasse accumulée au cours de l’affaire) ; il écrit avec un stylo rouge sur une table de bois ; il sifflote l’air de l’« Antre du Roi de la Montagne » tiré du Peer Gynt de Grieg (le mendiant aveugle vendeur de ballons se souvient de cet autre détail). Découvrir l’identité de l’assassin est une chose ; c’est l’affaire de la police, qui donne enfin à M son nom : Hans Beckert. Le capturer en est une autre ; ce sera l’affaire des Criminels au terme de la longue séquence du Bâtiment 314. Avant de parvenir à de tels résultats, M le Maudit procède donc à l’accumulation des choses et des hommes, à un déploiement des méthodes, des angles de vue et des objets ; dans cette botte de foin, avec un peu de chance, on trouvera peut-être l’aiguille. Quand dans Metropolis la ville inquiète les hommes, dans M le Maudit un homme inquiète la Ville : « Les faits sont là, martèle le Ministre au Préfet : un meurtrier est en train de terroriser quatre millions d’hommes ! »
Système de renseignement
8M le Maudit, ou plutôt Eine Stadt sucht einen Mörder, nous donne à voir le paroxysme d’une civilisation moderne et de ses objets entassés dans le film ; une civilisation de l’ordre obsédée par le quadrillage des lieux, le classement des choses et des gens. Sans insister outre mesure sur la dimension prophétique du film quant aux exactions à venir, soulignons cependant que c’est une telle manie bureaucratique qui va donner aux Nazis les moyens d’exterminer méthodiquement les opposants politiques, les inaptes, les Juifs. Dans M le Maudit, la méthode sert autant la police que le crime. Relisons Stefan Zweig pour nous en convaincre, qui se suicide hanté par la terreur d’une telle fin de l’Histoire, où le plus haut degré de civilisation a entraîné le plus haut degré d’inhumanité :
Contre ma volonté [écrit Zweig], j’ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu’atteste la chronique des temps ; jamais – je ne le note point avec orgueil, mais un sentiment de honte – une génération n’est tombée comme la nôtre d’une telle puissance intellectuelle dans une telle décadence morale9 […].
9M le Maudit exhibe déjà cet état des choses, car M, s’il est inhumain, apparaît aussi comme un produit de la civilisation urbaine moderne. La terreur qu’il sème et l’enquête à double hélice – d’une part la Police, d’autre part le Crime – qu’il déclenche, met en lumière l’aspect mécaniste d’une telle civilisation, où tout individu devrait être traçable et réductible à une fiche, à un numéro. Qu’on revoie pour s’en convaincre les gros plans récurrents d’empreintes digitales regardées à la loupe ou démultipliées jusqu’à couvrir un mur (ph. 20.2, 20.3), de plans de ville (ph. 23, 23.2, 39, 43), de grilles de matricule ou d’adresses de particuliers (44, 51), de rapports de police (49), de fiches cliniques (50), de fiches-alertes10 (95), de plan de ronde, celui du Bâtiment 314 (86) qui doit être pointé « à la minute près », de procès-verbaux (104). Plus largement, on remarque l’importance de la transmission de l’information, qui a lieu via la presse, les rapports, le téléphone. Dans M le Maudit, on a le souci de l’heure exacte et de la ponctualité : quand Frau Beckmann attend sa fille, quand un grigou demande l’heure à l’horloge parlante, quand Schränker planifie l’assaut du Bâtiment 314 pour 23 h, quand, une fois l’alarme déclenchée, les malfrats ont cinq minutes pour trouver M. Cet aspect d’un monde moderne qui synthétise le réel en fiches ou en schémas rencontre au passage l’obsession personnelle de Fritz Lang, qui a pris l’habitude de consigner systématiquement ses propres faits et gestes dans un carnet qui ne le quitte pas, après avoir subi de longues heures d’interrogatoires policiers successifs au meurtre ou au suicide de sa femme, laquelle avait découvert sa liaison avec la romancière et scénariste Thea von Harbou. Au-delà de l’obsession personnelle, Lang et von Harbou ont amassé une documentation précise au sujet des procédures de police, qui incluent en 1931 les enquêtes de voisinage (d’abord dans un rayon de deux kilomètres, puis au-delà), la reconstitution du crime, l’étiquetage des pièces à conviction, le recours à l’anthropométrie judiciaire, les dépositions (dans le cadre de l’affaire Kürten, il y en eut plus de 900 000), les battues, l’usage de chiens policiers, les contrôles de vagabonds, les surveillances des gares, les rafles de criminels, les interrogatoires de police menés à la lampe. Menées fiévreuses d’un État policier ou minutieuse enquête ? Et au détour du film, qui déroule cette double enquête des policiers et des malfrats, une question nous heurte soudain : comment dans une telle société commettre un crime en toute quiétude ? Quelle part de liberté, même ignoble, demeure-t-il à l’homme ?
10Du reste, la question de savoir si Lang dénonce ou se contente de montrer cet aspect bureaucratique de la surveillance et de l’action policière, serait à poser ; il n’est pas certain que la finalité de M le Maudit soit de dénoncer. Lang était un lecteur compulsif de faits divers, et avec M le Maudit il raconte l’une de ces histoires, s’inspirant des crimes commis par Peter Kürten, le Vampire de Düsseldorf, tueur en série avant l’heure (l’expression apparaît dans les années 1970), monomane homicide11. Lang, à plusieurs reprises, se dédouane cependant du propos inquiétant de son film par l’humour, humour visuel : le petit vieux à lunettes et le gros mastard (ph. 19 à 19.5), le faux aveugle et son chien (ph. 47) ; un unijambiste suivant M (ph. 69) se transforme, à la faveur d’une colonne Litfaßsäule12, en homme alerte sur ses deux jambes. Pur gag visuel que l’image du malfrat descendant trois étages d’escalier à toute vitesse parce qu’il a entendu un bruit dans les combles du Bâtiment 314, où se cache M. On note aussi un humour de situation avec les amis qui s’écharpent à table (ph. 18.5 à 18.7), les deux témoins qui en viennent aux mains lors de leur déposition devant la police pendant que tout le Crime réuni prétend faire sauter les portes de l’immeuble 314 et creuser ses plafonds à grands renforts de chalumeaux (ph. 87) et d’imposantes perceuses (ph. 88). M crochète également la serrure de son grenier à l’aide d’un clou tordu (ph. 92). Franz peste : « Mais qui est le crétin qui a retiré l’échelle ? » ; on lui lance une échelle ; il grimpe – et se trouve cueilli par la police (ph. 99). Lohmann, exténué par une nuit blanche, exhibe son entrejambe à l’œil de la caméra placée sous son bureau, en contre-plongée (ph. 103). Fritz Lang allume des mèches qui conduisent à une bombe – l’état de santé d’une civilisation obsédée par la surveillance et tenue en échec par un simple particulier – ; et tout à la fois, il la désamorce.
Une civilisation de l’entassement
11Parallèlement à cette manie du classement qui nourrit l’action de la police, et d’apparence plus innocente, se déploie à l’écran une fascination pour les objets qui forme ce qu’à la suite de Walter Benjamin on pourrait appeler une fantasmagorie13 : l’adoration des marchandises, des « spécialités », des « nouveautés ». Comment attirer une enfant, sinon à l’aide de choses attirantes ? « Quelques bonbons, un jouet, une pomme… sont des tentations auxquelles un enfant succombe vite », nous dit-on dans M le Maudit. M achète à Elsie Beckmann un ballon, à sa prochaine proie une orange. Les petites filles, inconscientes de ce marché de dupes, vendent leur âme et leur vie pour un objet. La définition même de fantasmagorie renvoie aux images des lanternes magiques que l’on projetait sur des nuages de fumée : elles n’ont aucune consistance, aucune substance. La fumée, les fumeurs sont du reste un élément récurrent au cours du film (ph. 33.2), motif baroque de la vanité humaine. Voilà peut-être la vraie leçon à retenir de M le Maudit : surveillons nos enfants, soit, mais apprenons-leur à se méfier des objets. Le film exhibe dans de longs travellings un invraisemblable attirail d’objets servant à fumer lors d’une réunion d’amis qui tourne au pugilat ; les corps alignés et endormis d’un asile de nuit ; les outils de cambrioleurs entassés dans de larges trousses de cuir ; l’étalage des larcins lors d’une descente de police ; les cartes truquées, peintes, étalées à la file, les montres qui sortent sans fin du veston d’un pickpocket, qui les remonte une à une ; les cigarettes classées par un mendiant du mégot au cigare ; la Bourse aux Tartines chez les mêmes mendiants ; les instruments d’un magasin de musique ; la récurrence des étals à travers tout le film, étals de fruits, vitrines de cuillers disposées en éventail solaire, d’outillages de manucure rappelant en miniature l’attirail des cambrioleurs (ph. 56), cadres où apparaissent des couteaux (ph. 57), livres ; ballons ; friandises ; jouets (ph.71) ; bric-à-brac d’un grenier d’immeuble commercial, où s’entassent chaises, lampes, horloges, draps, paniers, bouteilles mis au rebut.
12Quelle utilité peut-on trouver à un tel tournoiement d’objets, que l’on étale avec complaisance devant l’œil du spectateur – cette fantasmagorie de la marchandise ? Celle-ci revient à tracer la piste qui mène au meurtrier, si l’on doit en croire Walter Benjamin :
Sans se lasser, [le bourgeois] prend l’empreinte d’une foule d’objets ; pour ses pantoufles et ses montres, ses couverts et ses parapluies, il imagine des housses et des étuis. Il a une préférence marquée pour le velours et la peluche qui conservent l’empreinte de tout contact. Dans le style du Second Empire l’appartement devient une sorte d’habitacle. Les vestiges de son habitant se moulent dans l’intérieur. De là naît le roman policier qui s’enquiert de ces vestiges et suit ces pistes. La Philosophie de l’ameublement et les « nouvelles-détectives » d’Edgar Poe font de lui le premier physiognomiste de l’intérieur. Les criminels dans les premiers romans policiers ne sont ni des gentlemen ni des apaches, mais de simples particuliers de la bourgeoisie14.
13On tâche donc, dans M le Maudit, de faire parler les objets du quotidien, qui, objets plats, creux, sans âme, sans symboles, prennent soudain une valeur inquiétante. C’est le sens de ce que Freud nomme Unheimliche, ou infamiliarité. Ce que l’on croit connaître recèle à seconde vue un inquiétant secret. Ainsi, l’horloge de Frau Beckmann projette soudain une ombre hirsute et menaçante (ph. 11) ; la juxtaposition d’escaliers dont la spirale mène vers le vide, un grenier à linge désert, une chaise mise devant le couvert où personne ne s’assied, une balle roulant dans l’herbe, un ballon pris dans des fils électriques, symbolisent le meurtre d’Elsie Beckmann. Trois Mickey hilares, collés sur la vitrine d’une confiserie, apportent une note ironique et cruelle à un inspecteur recherchant des témoins (ph. 23.3). Un inspecteur ausculte en vain une table de bois polie (ph. 53) ; les couteaux d’un étal forment un cadre où M aperçoit, dans un reflet de vitrine, la fillette qui sera sa prochaine victime ; une librairie montre d’une flèche sa prochaine victime à M (ph. 58, 59) ; dans le même temps, un disque de couleur tournant sur lui-même fait signe vers le vertige de la folie. Un peu plus loin, le pantin d’une vitrine de jouets écarte les jambes, surmontant d’un M la figure de l’assassin qui sourit au-dessous, et évoquant, qui sait, la nature obscène du crime qu’il s’apprête à commettre. L’identité de M est révélée à la suite de l’examen minutieux de ses rognures, de ses traces, de ses vestiges : des mégots de cigarette, l’encre rouge d’un stylo, les marques laissées sur le bis d’un rebord de fenêtre. D’innocents objets font signe, redoublés par les omniprésents mots d’ordre criards de la publicité, qui saturent et barrent l’espace des rues à longueur de film, ajoutant parfois l’absurde à l’inquiétant : « Bilder, Bücher, Plastik », lit-on sur une devanture de librairie – « des images, des livres, du plastique ».
Conclusion
14L’homme, dit Aristote, est un animal politique15 ; la polis est formée par la communauté des hommes et vise à la suffisance et au bonheur. Le Progrès, dont l’idée est le fruit de la pensée du xviiie et de l’action du xixe, trouve sa réalisation dans la métropole du xxe siècle, la polis moderne : hygiène et rationalisation haussmannienne ; amélioration de la nutrition, accès accru aux biens de consommation, aux vêtements, développement de la politesse dans les usages selon l’économiste Georges Friedmann16. Mais chez Haussmann, dit-on parfois17, on creuse des avenues pour mieux relier les quartiers ouvriers à la caserne militaire et permettre le passage des canons. Une telle image apparaît dans M le Maudit. Comme chez Tocqueville la démocratie porte en elle les germes du despotisme, chez Fritz Lang la Ville et la foule qu’elle abrite engendrent des monstres. M, flâneur dévoyé, est le produit d’une Ville qui permet les étals, la production d’outils visant à fracturer les portes et les plafonds, l’uniformisation des silhouettes (pardessus et chapeau), l’achat de friandises à portée de main pour attirer les jeunes filles, qui se trouvent dans les rues comme dans un terrain de jeu à ciel ouvert, et que leurs familles ne surveillent pas, car on est occupé à travailler et à produire. Dans L’Homme des foules déjà (1840), Edgar Poe nous donne à suivre un tel inquiétant flâneur ; ce flâneur porte un poignard et un diamant. Hans Beckert, lui, ne porte rien d’autre que le même chapeau, le même pardessus que les autres. Il fume comme tout le monde fume dans M le Maudit, du mendiant au ministre ; seule la marque de cigarettes le distingue ; et encore faut-il la perspicacité et la mémoire de Lohmann pour que ces détails deviennent des pistes crédibles – aujourd’hui un algorithme travaillerait plus rapidement. La ville est un monde de tentations constantes et diverses, elle engendre tous les crimes ; elle fournit sa pâture aux malfrats, mais aussi sa chair humaine aux M qui y flânent, car elle a transformé les corps en choses (cf. prostituées, asile de nuit, photos du dernier procès-verbal, celles des gardiens ligotés et entassés). Création éminemment humaine, puisque l’homme est fait pour vivre en ville, la Ville a fini par dépasser l’Homme. Si la « fin de l’Histoire » devait être celle prédite par un certain Francis Fukuyama, pour qui le bonheur suprême réside dans l’accès à volonté d’un homme sans courage (l’homme nietzschéen) aux biens de consommation18, l’ombre d’un Hans Beckert sur une colonne publicitaire vaut pour un avertissement. Si nous ne pouvons pas surveiller davantage nos enfants, au moins avons-nous le devoir de les éduquer.
1 Réalisateur de La Dernière séance (1971).
2 Peter Bogdanovich, Fritz Lang en Amérique, Paris, Les Cahiers du cinéma, 1990, p. 105.
3 Depuis la fin du xixe siècle, la presse développe considérablement la part de faits divers consacrés aux meurtres d’enfants, ou violences sexuelles portées sur eux (tout en gardant une retenue de langage à ce dernier sujet, usant de périphrases, « derniers outrages », « odieuses violences » pour évoquer les faits). Le 19 avril 1898 en France est votée une loi encadrant légalement les violences faites à l’enfant, parue au Journal Officiel le 21 avril et portée par René Béranger.
4 « Si tout crime nous renvoie à nous-même et génère immanquablement des mouvements internes, ce crime-là nous interpelle dans notre filiation et dans nos propres représentations de la parentalité. Que l’on se situe du côté de l’enfant que nous avons été, et que nous sommes toujours, ou du point de vue du parent que l’on est ou que l’on a, nous nous heurtons à l’irreprésentable : notre imaginaire bute sur l’impossible. » Odile Verschoot, « Le filicide : un crime pour la vie », Cliniques méditerranéennes, no 87, 2013/1, p. 7-18. DOI : 10.3917/cm.087.0007.)
5 « Une autre méta-analyse ayant permis d’analyser les données recueillies dans 79 études (pays nord-américains, européens et asiatiques) rapporte les taux de récidive suivants : 12,4 % de récidive sexuelle (72 études), 17,5 % de récidive violente, sexuelle et non sexuelle, (36 études) et 30,1 % de récidive générale (40 études). La période de suivi moyenne des dossiers était de 68 mois. Bien que les qualités méthodologiques de cette étude soient rigoureuses, ces proportions demeurent sous-estimées parce que les infractions commises ne sont pas toutes connues, donc recensées. » (https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/fiches-thematiques/la-recidive-chez-les-agresseurs-sexuels, consulté le 23 mai 2018).
6 Voir François Albera, Claire Angelini et Martin Barnier, « M / Le Maudit, ses doubles et son doublage », Décadrages, nos 23-24, Université de Lausanne, 2013, p. 80-113. La figure de Gennat inspire à Fritz Lang le personnage de Lohmann.
7 « La lettre appartient, comme initiale, à un double réseau textuel constitué en diachronie, dans l’œuvre de Lang, par les M(abuse) et en synchronie, dans le film, par le titre original et les deux sous-titres définitifs, comportant tous le mot M(örder), meurtrier. » (Thierry Kuntzel, « Le travail du film », Communications, 19, 1972, « Le texte : de la théorie à la recherche », p. 25-39. En ligne : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1972_num_19_1_1279, consulté le 23 mai 2018).
8 Isidore Ducasse, Les Chants de Maldoror, Paris, Wittman, 1874, p. 8.
9 Stefan Zweig, Le Monde d’hier, trad. de J.-P. Zimmermann, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 10.
10 Le Bâtiment 314 est relié à une centrale de police, qui réagit en cas d’alarme.
11 Esquirol définit la monomanie homicide comme « délire partiel, caractérisé par une impulsion plus ou moins violente au meurtre. » (Jean-Etienne Esquirol, Note sur la monomanie-homicide, Paris, J. B. Baillière, 1827, p. 5.)
12 Équivalent de la colonne Morris parisienne, apparue à Berlin en 1854.
13 Dans son Introduction à Paris, capitale du xixe siècle, Walter Benjamin écrit : « Notre enquête se propose de montrer comment par suite de cette représentation chosiste de la civilisation, les formes de vie nouvelle et les nouvelles créations à base économique et technique que nous devons au siècle dernier entrent dans l’univers d’une fantasmagorie. » (Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, Paris, Allia, 2016, p. 8).
14 Ibid., p. 26-27.
15 Aristote, La Politique, trad. de J.-F. Thurot, Paris, Didot, 1824, p. 10.
16 Robert Goetz-Girey, « Progrès technique et bien-être », Revue économique, volume 3, no 5, Paris, Armand Colin, 1952, p. 722-730.
17 Pierre Pinon, « Haussmann Georges Eugène, baron (1809-1891) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 25 mai 2018. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/georges-eugene-haussmann/ ; le même Pinon détaille : « Incidemment plusieurs autres mythes s’écroulent. Les recherches récentes montrent que les artisans et les ouvriers, malgré les démolitions, sont restés dans leurs quartiers d’origine, à proximité de leur clientèle, et que les faubourgs se sont grossis, certes, mais d’une population nouvelle, rurale ou provinciale (voir Fl. Bourillon, 1987). Les percées auraient avant tout eu des visées stratégiques : permettre aux canons de tirer et à la cavalerie de charger. Certains « théoriciens de 1840 » y avaient pensé, Haussmann aussi, mais seules quelques rares opérations répondent à cet objectif : le couvrement du canal Saint-Martin par le boulevard Richard Lenoir (le canal formait une barrière empêchant de poursuivre les émeutiers dans leurs faubourgs de l’Est), l’ouverture du boulevard Voltaire relie les casernes de Vincennes et du Château-d’Eau, les rues Monge, Claude Bernard et Gay-Lussac encerclent la Montagne Sainte-Geneviève. Mais cela représente cinq percées sur les 70 programmées sous le Second Empire » (http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/wa_files/Pinon.pdf, consulté le 25 mai 2018).
18 La référence à Fukuyama n’est pas fortuite ; on l’oppose ici à Benjamin. Les deux, antagonistes puisque l’un, Benjamin, ne voit pas de fin à l’histoire, et que l’autre, Fukuyama, écrit en 1989 son article The End of History ? (paru l’été 1989 dans le no 16 du National Interest), sont tous deux, à cinquante ans d’intervalle, considérés comme porteurs d’une pensée messianiste.
organisée par Aurélien d'Avout et Alex Pepino à l’Université de Rouen le 30 mai 2018
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 16, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/878.html.
Quelques mots à propos de : Thibault Vermot
Université de Rouen Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
