Sommaire
Journée des doctorants 2018
organisée par Aurélien d'Avout et Alex Pepino à l’Université de Rouen le 30 mai 2018
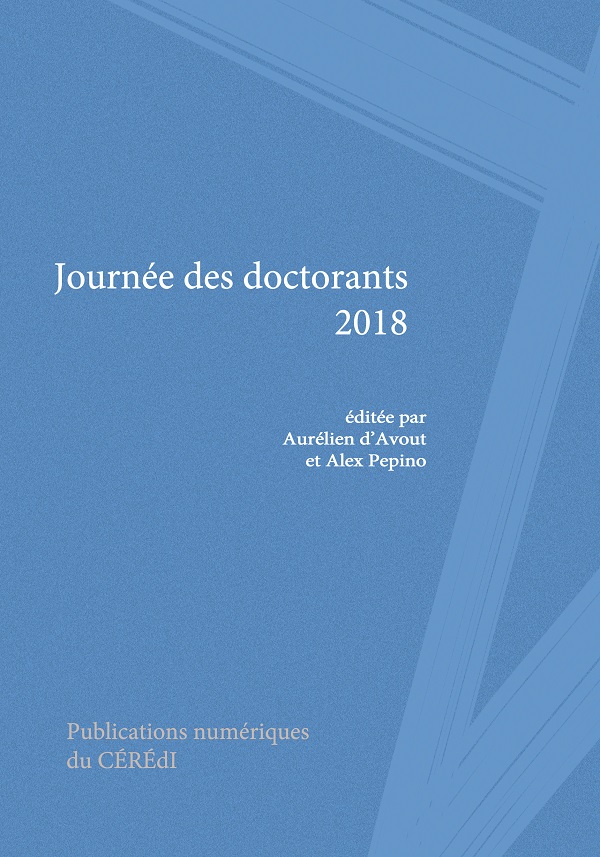
- Alexandra Vinogradova Renier son credo quia absurdum : Autocritique (1959) d’Edgar Morin
- Thibault Vermot M le Maudit de Fritz Lang (1931), ou la Ville inquiète
- Daniel Paterson Kitsch et modernisme : histoire d’un fratricide ?
- Angélique Salaun Portraits des femmes guerrières : des descriptions romanesques aux planches de bandes dessinées, entre clichés et variations
Journée des doctorants 2018
Renier son credo quia absurdum : Autocritique (1959) d’Edgar Morin
Alexandra Vinogradova
1Quand on parle de l’histoire politique de la France au xxe siècle, il est impossible d’omettre le Parti communiste français (PCF) qui a joué (avec le Parti communiste italien) un rôle important sur la scène politique européenne et a été le plus grand parti communiste du monde occidental. Il est notoire que les partis communistes ont exigé de leurs adhérents « la discipline la plus rigoureuse, une véritable discipline de fer1 », comme le disait Lénine. L’autocritique était l’un des outils de cette discipline communiste, qui, sous Staline, s’est développée dans tous les domaines de la vie quotidienne en URSS. Même les slogans inscrits sur les assiettes des cantines soviétiques et les affiches de propagande ont visé à susciter l’autocritique chez les peuples soviétiques. La figure 1 représente une affiche soviétique de propagande réalisée en 1953 par Véniamine Briskine, elle se nomme « Cultivez la critique et l’autocritique2 ! » À l’origine, le Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) faisait de l’autocritique sincère une méthode éprouvée pour corriger les imperfections.

Figure 1. Véniamine Briskine, « Cultivez la critique et l’autocritique ! » (1953)
2De l’idée à la réalisation, l’autocritique est devenue forcée, elle s’est transformée en un mode de contrôle politique. L’autocritique a été imposée par les partis communistes à leurs militants ou à leurs cadres dirigeants sous forme de questionnaires autobiographiques, d’auto-narration ou de discours. Cet exercice de confession publique servait d’outil de contrôle et était censé fournir aux membres du Parti un modèle biographique qui permettait en retour de repérer les déviations ou les apostasies à condamner. Dans son article consacré à l’autocritique dans les milieux kominterniens des années 1930, l’historien autrichien Berthold Unfried écrit :
Sur le plan symbolique, l’autocritique signifie la soumission du cadre à la discipline du Parti. Qu’il soit ou non coupable, le bon cadre s’incline lorsque le Parti exige son autocritique. En ce sens, l’autocritique était un rituel confirmant la relation privilégiée entre le Parti et ses membres3.
3Particulièrement significative pour l’URSS stalinienne, l’autocritique est devenue tout aussi importante au sein du PCF. Cet article n’aborde pas la question de l’autocritique institutionnelle des militants communistes, mais nous considérerons l’autocritique faite de manière critique par les ex-communistes ou par les anciens compagnons de route. L’engagement communiste a posé la question de l’adhésion à l’idéologie soviétique, aussi bien celle de la transmission de cette foi politique que celle de la prise de distance lors d’une rupture avec l’appareil communiste. Le doute qui s’installait progressivement dans les esprits des écrivains français de gauche ne s’est pas seulement traduit par leur désaffiliation du PCF, mais également par la publication de nombreux textes : Mémoires, autobiographies, essais et articles. L’exclusion ou la sortie volontaire du monde communiste s’accompagnait souvent de cette forme d’écriture de soi où il s’agissait de reconnaître ses erreurs passées et d’en révéler les causes. Là s’élaborait une pratique littéraire, l’autocritique, qui s’inspirait de la pratique institutionnelle que nous avons déjà décrite. En effet, des communistes en rupture de ban se sont peu à peu appropriés l’autocritique : ils ont détourné ce cadre institutionnel à leur profit et y ont puisé les ressources cognitives et littéraires pour expliquer leur parcours idéologique, analyser la nature de leur engagement politique passé et justifier leur geste de désaffiliation. Nous nous attacherons ici à un texte qui a joué, parmi tous ces textes d’ex-communistes, un rôle de modèle littéraire : il s’agit d’Autocritique d’Edgar Morin écrit en 1959.
4Dans l’un de ses articles, Jean-Louis Jeannelle écrit qu’« Edgar Morin et ses successeurs s’écartent […] d’une très longue pratique du récit mémorial4 » et fait l’hypothèse que « le communisme ou plus précisément le stalinisme est la seule passion politique à avoir donné naissance au xxe siècle à un sous-genre des récits de soi bien précis5 », qu’il nomme les « récits de désaveu ». Dans un autre article, il examine
l’ouvrage d’Edgar Morin comme le modèle narratif de récits de désaveu se situant au point de jonction de plusieurs traditions littéraires fort anciennes, notamment les Mémoires et l’essai, afin de cerner la singularité de ces « essais de Mémoires » où un individu tente de justifier une ancienne passion politique en en livrant la représentation la plus distanciée possible6.
5Toutefois, pour nous, il s’agira ici d’étudier quel modèle d’auto-analyse propose plus particulièrement Autocritique d’Edgar Morin et pourquoi ce texte est parvenu à servir de modèle d’autocritique pour plusieurs ex-communistes français qui ont à sa suite déconstruit leur credo quia absurdum communiste. Nous mentionnerons tout d’abord brièvement quelques textes dans lesquels des écrivains – qui se sont éloignés du communisme – ont fait leur autocritique avant la publication du texte de Morin : il s’agissait de cas très particuliers qui n’ont donc pas pu servir d’exemples. Puis nous examinerons en détail Autocritique de Morin. Enfin, nous présenterons quelques auteurs qui lui ont succédé dans l’entreprise d’autocritique.
6Il a fallu attendre les années 1970 et les récits de Soljenitsyne7 pour que de nombreux intellectuels du PCF comprennent et mesurent la tragédie qui avait eu lieu en URSS. Pourtant, quelques précurseurs, parmi lesquels les écrivains Boris Souvarine et Victor Serge, avaient essayé, même avant la Seconde Guerre mondiale, de faire entendre leur voix. Dans ses Souvenirs, Souvarine écrivait :
Quiconque voulait faire carrière, dans le Parti ou dans l’Internationale, devait faire écho à leurs dénonciations virulentes du « trotskisme », invention de circonstance et absolument arbitraire. Ayant refusé de hurler avec les loups, par simple souci de vérité, de morale et de justice, je me vis bientôt tombé en disgrâce, exclu du Parti [en 1924] et voué aux gémonies8.
7Bien avant Soljenitsyne, Victor Serge a également traité des purges de l’ère stalinienne dans ses Mémoires d’un révolutionnaire rédigés durant la guerre et publiés en 1951. Il y dénonce les mécanismes du régime stalinien, sans renier toutefois sa foi révolutionnaire : « Le mot “totalitarisme” n’existait pas encore. La chose s’imposait durement à nous sans que nous en eussions conscience. J’étais de l’impuissante minorité qui s’en rendait compte9. » D’autocritiques en souvenirs ou Mémoires, ces militants communistes exclus du Parti s’emploient à reconnaître leurs erreurs et deviennent les grands vecteurs de la critique du stalinisme.
8Beaucoup plus tard, en 1955, Auguste Lecœur – qui fut un temps le dauphin du secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, puis fut attaqué et dut démissionner du Parti – publie une brochure, L’Autocritique attendue, où il renie les « fautes opportunistes » dont il était accusé. Il y dénonce la manière de ridiculiser le traditionnel exercice d’autocritique, puisque le Parti force ses membres (« les têtes de turc ») à l’autocritique quand ce sont les autres (« les intouchables10 ») qui ont commis les fautes. Lecœur proteste aussi contre la fabrication des idoles, tels que Staline en URSS ou Thorez au PCF. Il encourage les militants communistes à revenir sur la conception originale du PCF : « Il faudra bien […] arriver à cette autocritique attendue, mais cela dépend essentiellement des membres du Parti à la base et de la qualité de leur critique11. » Ce qui veut dire que l’ex-dirigeant du PCF applique l’ancienne méthode du Parti : il appelle les autres à faire leur autocritique, mais il ne s’intéresse pas à son cas personnel.
9À partir des années 1920, les « retours de l’URSS12 » désabusés se sont multipliés : après Victor Serge, ce fut le tour d’André Gide, d’Arthur Koestler et de bien d’autres. Leurs textes sur l’URSS ont provoqué une vive polémique autour du stalinisme. D’abord proche du PCF, après son voyage en URSS en 1936, alors écrivain reconnu, Gide perd son enthousiasme et affiche sa déception face aux défauts du régime stalinien dans son récit de voyage Retour de l’URSS, publié la même année. En ce qui concerne Arthur Koestler, il a été parmi les premiers intellectuels à dénoncer les purges staliniennes. Après avoir quitté le Parti communiste allemand en 1938 en raison des procès de Moscou, il écrit son roman Le Zéro et l’Infini, publié en 1940. Koestler y retrace le destin d’un homme, fidèle à son Parti, accusé d’une trahison dont il n’est pas coupable, mais qui néanmoins capitule. Dans Humanisme et terreur (1947), Merleau-Ponty fait un commentaire de ce roman et résout les dilemmes de Koestler. Il y analyse l’autocritique de Roubachov, le héros de Koestler, et montre qu’il est objectivement coupable et que son autocritique est donc justifiée.
10Un peu plus tard, en 1949, le livre Le Dieu des ténèbres rassemble les témoignages de six célèbres anciens militants communistes et compagnons de route, y compris Arthur Koestler et André Gide, que nous avons déjà évoqués, mais aussi Ignazio Silone, Richard Wright, Stephen Spender et Louis Fischer. Fischer, ex-communiste américain, y parle de « Kronstadt », ce moment où des militants ou sympathisants ont décidé non seulement de quitter le Parti mais également de lutter directement contre son influence. Après avoir décrit la véritable révolte de Kronstadt en 1921, celui-ci applique ce concept au parcours d’anciens communistes, dont il fait partie :
Ce qui compte, c’est d’avoir son « Kronstadt ». Jusque-là, on peut bien se livrer aux oscillations affectives, au doute intellectuel, ou même se séparer totalement de la cause en esprit, tout en refusant de s’en déclarer l’ennemi.
Il me fallut attendre longtemps mon « Kronstadt13 ».
11Dans ce livre, six intellectuels décrivent leur itinéraire communiste, aller et retour, mais ce sont plutôt de courtes descriptions que de vraies auto-analyses profondes.
12Tous les textes mentionnés ci-dessus mettent en lumière le quotidien de ceux qui ont croisé le chemin du Parti communiste et ont finalement renié leur foi. Ces exemples nous montrent que la pratique de l’autocritique parmi les écrivains de gauche naît assez tôt. Cependant, à cause de leurs limites, ces textes n’ont pas pu servir ultérieurement de modèle littéraire de l’autocritique pour les ex-communistes.
13Passons à présent à l’analyse du modèle proposé par Edgar Morin dans son Autocritique. Il ne s’agit pas ici d’une autocritique institutionnelle, c’est-à-dire de l’analyse et de la reconnaissance publique, devant les instances responsables, de ses erreurs ou déviations. Comme on le lit sur la quatrième de couverture de la première édition de 1959, « [e]n plongeant dans sa vie mentale passée, [Morin] essaie de voir clair, à travers lui-même, pour répondre à ses interrogations ». Voici comment l’auteur lui-même définit le but de son livre dans l’avant-propos :
J’étais au parti communiste.
Aujourd’hui tout est devenu mirage et en même temps le sens même de la vie me semble vidé. Je veux repartir à la recherche de la vérité, comme à quinze ans. […] Je cherche à me vider, me nettoyer, me rendre transparent, afin de voir clair, à travers moi-même, par-delà moi-même. […] je veux m’interroger sur une foi, hier source de toute assurance, aujourd’hui étrangère et ennemie14.
14Reprenons les quatre éléments structuraux de son récit l’un après l’autre. D’abord, Morin essaie de comprendre son adhésion au PCF en 1941 sous l’Occupation, ensuite ses années de foi, puis les déchirements et les désillusions à partir de 1948 et enfin son exclusion en 1951 avec le rejet de sa croyance.
15Pourquoi le jeune Morin fut-il irrésistiblement attiré par le communisme ? En cherchant la réponse à cette question, l’écrivain évoque l’envie adolescente de tant d’entre eux, jeunes petits-bourgeois, de « [se] fuir et [de se] retrouver, c’est-à-dire [de] tenter de [se] libérer15 ». À plusieurs reprises, il revient sur leurs recherches de la fraternité, par exemple :
On était attirés, non par les justifications officielles du parti, mais pour des raisons souterraines, pour la vieille idée de la révolution mondiale […]. Ceci nous permettait […] d’endosser le stalinisme comme seul moyen réaliste d’accéder à la fraternité universelle16.
16L’écrivain évoque la soif d’aventure illégale incarnée par le communisme : « J’étais un de ces adolescents pour qui devenir communiste signifie en même temps devenir homme. L’entrée au parti se confondait pour moi avec l’initiation virile, le risque de mort, l’engagement dans la vie authentique17. » Morin prétend avoir pris conscience de tous les sujets controversés du communisme : la question de la discipline, l’absence de démocratie et d’autonomie de la conscience individuelle, la cruauté, les outrages, les exclusions, les procès, les liquidations, et en même temps il reconnaît que « les crimes du stalinisme se dissipaient dans les gigantesques massacres de la guerre18 ». À l’époque, Morin excusait tous ces crimes parce qu’il pensait que le stalinisme transformerait ce monde violent. C’est la bataille de Stalingrad qui a balayé tous les critiques, doutes, réticences idéologiques : « Staline s’identifiait à la ville de son nom, celle-ci à l’usine “Octobre rouge” avec ses ouvriers en armes, l’usine à la révolution d’Octobre 1917, et tout cela à la liberté du monde, à la victoire enfin en vue, à tous nos espoirs, à l’avenir radieux19. » Morin conclut que dans les conditions de la vraie guerre, totale et mondiale, il était venu dans les rangs du PCF parce que « [s]eul le communisme stalinien était l’antidote au fascisme. Le conflit véritable était celui qui opposait les deux titans du siècle20 ».
17Comment Morin s’est-il converti à « la grande religion terrestre du xxe siècle21 » ? Dès le début de sa période communiste, il commence à justifier le Parti, à l’admirer. Selon Morin, « Malraux était le saint Jean-Baptiste de [s]a foi naissante22 ». Avec le temps, sa foi se renforce et il trouve « dans le communisme stalinien le sentiment de communion […] qui atténu[e] ou dissip[e] l’obsession du malheur, de l’inutilité, du néant, de la solitude23 ». Parmi les dogmes d’infaillibilité stalinienne, l’un était tristement célèbre : le Parti a toujours raison. Ce dogme a conduit Morin et beaucoup d’autres communistes au « credo quia absurdum : on a raison d’avoir tort, avec le parti, et on a tort d’avoir raison, contre le parti24 ». Juste après avoir formulé ce credo, à partir de plusieurs exemples (les procès de Moscou, le culte de Staline, le conformisme, l’atrophie culturelle, et plus loin encore le massacre de Katyń), l’auteur explique de quelle manière il a cru à ces absurdités. Le champ lexical mystico-religieux domine dans les pages suivantes d’Autocritique : « [l]es psalmodies chauvines de l’Humanité » étaient les reflets d’une admiration exagérée ; « le caractère rituel et mensonger du langage stalinien » produisait un ensemble de faux-semblants et de masques ; « la magie identificatrice » transformait en fascistes ceux qui avaient servi par leurs actes la cause des fascistes ; « le Sur-Moi du parti » pénétrait au plus intime des consciences. Sur ces bases à la fois nationalistes, religieuses, psychanalytiques, mystiques et magiques, Morin se convainquait progressivement que le Parti avait toujours raison. Il termine cette longue liste assez brusquement : « Je ne plaide ici, ni innocent, ni coupable : je confesse l’atrophie mentale25. » À quelle conclusion est-il arrivé ? « [Q]ue son parti [était] une Église, Staline une idole, ses principes des dogmes. […] Certes, il y a toujours eu un acte de foi dans toute adhésion au communisme26. »
18À partir de 1948, Morin commence à tirer les leçons de son expérience vécue au sein du monde stalinien. C’était surtout la censure littéraire qui le frappait le plus. Il fit un exposé sur une « Lettre à Togliatti sur la culture » que l’écrivain italien Elio Vittorini avait publiée en 1947. Ni Action ni les Lettres françaises n’avaient osé la reproduire ni même la citer. On accusa Morin de mensonge politique et un silence pénible accompagna, selon Morin, « la violation d’un tabou27 ». Morin commence à se reconnaître aveugle, ignorant et cynique, il se nomme « déviant » et avoue que l’adhésion au Parti impliquait un certain mysticisme politique. Cependant, même au plus fort du désaccord et de la méfiance vis-à-vis du Parti, quand Morin s’est senti coupable de « la participation mentale aux grands assassinats politiques28 », il n’a pu quitter le Parti, « qui [l]’avait arraché du néant, et en dehors duquel [il] ne voyai[t] que néant29 ». Avec la rupture entre Tito et Staline, dite également schisme yougoslave, l’opposition de Morin, qui était culturelle, est devenue morale. Il a éprouvé un sentiment de rejet de plus en plus vif, ce dont il témoigne : « Nausée et angoisse sont les sentiments liés à ces années suffocantes30. » Considéré comme titiste, Morin n’a jamais osé aller en Yougoslavie, « c’est-à-dire aller au-devant de l’exclusion31 ». Les procès Rajk en Hongrie et Kostov en Bulgarie ont marqué la grande rupture au plus profond de sa croyance. En refusant d’accepter l’ultime mensonge comme vérité première, Morin a mûri sa décision tout au long de l’année 1949 : quitter le Parti. Il ne reprit pas sa carte en 1950, il déserta pratiquement les réunions de cellule, mais il continua à se reconnaître membre du Parti. Au regard de cette situation ambiguë, Morin fait une longue litanie de formules identiques : « Trop de bêtises, trop de religiosité, trop de mensonges, trop de procès, trop de meurtres, trop de victimes concentrationnaires, trop de culte à Staline32. » Prisonnier de ce cercle infernal, Morin répète quatre fois la même phrase d’une page à l’autre : « C’était trop et ce n’était pas encore assez33. » En expliquant dans les détails ce « combat spirituel », pendant lequel il subissait et refusait le système stalinien, Morin comprend que quitter le Parti signifiait choisir la solitude. Il écrit : « Et ainsi s’élargissait, sous mes déchirements internes, une zone d’ombre et de folie que je ne savais où transférer, une zone de doutes et de tourments insolubles34. » Car le communisme était pour Morin l’avenir de l’humanité, en dehors de cette utopie il ne croyait en rien.
19Morin est exclu du PCF en 1951, après avoir écrit un article dans L’Observateur politique, économique et littéraire (qui deviendra Le Nouvel Observateur), un journal réputé être de l’intelligence service dans le milieu communiste. Très ému, il décrit la séance de son exclusion : « Je parlais difficilement et j’avais les larmes aux yeux35. » Devenu un exclu, le pire ennemi du Parti, Morin se croit perdu, sans avenir, et se met à sangloter : « J’étais seul dans la rue, rejeté, exclu. / Exclu ! Exclu ! […] Et moi j’étais seul dans la nuit. […] J’étais seul comme un fantôme. […] Exclu de tout, de tous, de la vie, de la chaleur, du parti36. » Morin exprime la souffrance d’un renégat, dont la vie s’est confondue avec celle du Parti pendant dix ans. Huit jours après son exclusion, il découvre qu’il est toujours communiste, mais enfin libre. Morin écrit : « À vrai dire, mon exclusion n’avait pas été une grande rupture. Le traumatisme avait été trop léger pour ébranler le fond de ma croyance37. » Il a continué d’être convaincu que l’URSS évoluerait, mais la guérison avait déjà commencé. Le choc décisif vint du rapport Khrouchtchev au XXe Congrès du PCUS en 1956 : « J’en fus exalté, affolé, et mes pensées zigzaguèrent dans trois directions : la colère, l’espoir, et un début de réflexion autocritique38. » Pour la première fois depuis son adhésion au PCF en 1941, « [il] repartai[t] à zéro39 ». Sa foi se détruisait de l’intérieur :
En même temps que je prenais lentement conscience que mon stalinisme était une religion, que mes élans les moins contestables étaient mystiques, que mes outils mentaux étaient eux-mêmes des mythes, je découvrais quel rôle fantastique pouvait jouer la magie dans nos esprits qui se croient rationnels et dans nos sociétés qui se disent rationalisées, combien nos attitudes et nos croyances baignaient dans l’imaginaire40.
20Dans le dernier chapitre, au titre parlant, « Le tribunal », Morin se demande s’il a voulu se justifier, et répond : « Bien sûr je n’ai pas évité la double tentation de l’auto-accusation et de l’auto-apologie41. » Le tribunal devrait être un lieu où est rendue la justice, où les uns viennent chercher la justice et où les autres sont jugés, mais dans le cas de l’autocritique d’ex-communistes, le risque de la manipulation est très grand. Est-ce que Morin et les autres ex-communistes parviennent à éviter la tentation de la complaisance ?
21Ce double modèle d’auto-analyse proposé par Morin a été reproduit par beaucoup d’ex-communistes français qui avaient à peu près le même statut intellectuel, c’est-à-dire qui n’étaient ni militants communistes, ni compagnons de route temporaires, ni grands écrivains, mais intellectuels de gauche ayant trouvé leur propre niche dans les sciences humaines et sociales, comme Morin l’avait trouvée en sociologie. Dans les récits de soi de Claude Roy, Dominique Desanti, Emmanuel Le Roy Ladurie, Régis Debray, Annie Kriegel et bien d’autres, tous ont eu pour but de formuler les raisons et les circonstances d’un éloignement ou d’une déviation ayant mis fin à leur attachement idéologique au communisme ou au stalinisme. Donnons-en deux exemples qui constituent les deux pôles extrêmes : celui de l’auto-apologie et celui de l’auto-accusation.
22Selon l’historienne Annie Kriegel, Morin lui a fait jouer, dans un passage d’Autocritique, « le personnage odieux de l’exécuteur des hautes œuvres42 », parce que c’est elle qui a présidé la séance où Morin a été exclu. Quand il publia son Autocritique en 1959, elle avait, comme lui, quitté le Parti. Dans ses Mémoires, même si Kriegel dit qu’elle ne veut pas reprocher à Morin de l’avoir accablée, elle plaide :
à son exemple, des années durant par la suite, tant de courageux ex-staliniens, qui sans doute voulaient se venger sur moi d’avoir été communistes, m’ont désignée à la vindicte publique comme responsable majeure de leur dévergondage. […] De toute nécessité, je devais rester, aculée et déshonorée par mon stalinisme passé43.
23Un peu plus loin, elle critique les intellectuels de gauche, y compris Morin, qui ont eu l’ambition de réformer le Parti de l’intérieur : « Là où Morin, en tout cas, a eu franchement tort, […] j’eus au moins le mérite d’être bien convaincue que le communisme avait ses lois qui, telles quelles, avaient leurs raisons et n’étaient pas réformables44. » On voit ici que Kriegel réussit mieux dans l’auto-apologie que dans l’auto-accusation.
24Intéressons-nous maintenant à un écrivain qui a produit une trilogie autobiographique. Claude Roy considère Autocritique de Morin comme « le meilleur témoignage qu’on ait donné en France sur l’ “expérience communiste45” ». Il est assez remarquable que Morin lui-même fasse trois fois46 référence à Roy en donnant une version différente de ce qui s’est passé entre eux. En 1949, la décision de se retirer du Parti mûrissait en Morin et il s’en est ouvert à Roy, qui lui a répondu : « Mais le parti est notre garde-fou. » Dans le livre autobiographique Nous, Roy évoque la même anecdote et dit que Morin avait répondu : « Ce sont eux les fous, pas moi47. » En 1949, Roy n’en était pas convaincu, il pensait toujours que les folies pouvaient être guéries. En 1958, il est définitivement exclu du PCF. En 1972, quand Roy publie Nous, il dit finalement que « [l]e Parti n’était plus du tout un garde-fou. Il fabriquait plutôt les fous48. »
25Cette anecdote n’est pas le seul épisode évoqué par les deux écrivains. Roy explore le rapport entre croyance et politique et fait partie de ceux qui sont revenus assez souvent dans leur œuvre à la formule communiste du credo quia absurdum repris par Morin. Roy se demande en 1981,
[p]ourquoi, dans ces conditions, Edgar Morin [est] resté dix ans au Parti, moi-même treize ans, Pierre Daix trente-cinq ans, Charles Tillon quarante-sept ans ? L’énumération pourrait continuer pendant des pages et des pages […]. Les usines et le Collège de France, les ateliers et l’École des hautes études, les salles de rédaction et la littérature, les fermes, les usines et les laboratoires, les magasins et le palmarès des Prix Nobel sont peuplés de cette immense armée des ex-communistes, dix fois plus importante que celle des militants actuels49.
26À la question : « Pourquoi sont-ils restés si longtemps ? », il y a peut-être autant de réponses que d’individus. Roy donne aussi sa propre réponse : « On restait d’abord parce que la machine à broyer les esprits marchait si efficacement que le militant tenté de s’interroger reculait devant l’énormité de son “crime”, que le tonnerre venu d’en haut l’assourdissait et faisait taire ses doutes50. » Le mystère tient donc au mécanisme efficace et puissant par lequel le système communiste produisait de la certitude et suscitait un culte oblitérant l’accès au réel. L’étude de la pratique littéraire de l’autocritique est importante parce qu’elle aide à comprendre ce mystère.
27Pour conclure, tous ces écrivains désaffiliés racontent l’histoire d’un parcours idéologique à la fin duquel ils renient tout ce pour quoi ils ont longtemps combattu, parce que leur but n’a plus aucun sens, est devenu incompréhensible et ressemble même à une sorte de folie collective, c’est-à-dire au credo quia absurdum dont parle Edgar Morin. Lui et les ex-communistes suivants ont entrepris une véritable critique de soi, ils ont exposé le jugement qu’ils ont porté sur leur propre destin politique et les illusions dont ils avaient été victimes. D’une certaine manière, la différence entre ces livres d’autocritique et les autres récits de soi communistes, c’est qu’eux seuls reconnaissent s’être trompés tandis que les autres dénoncent ceux qui les ont trompés. Ces œuvres de genres et d’auteurs très divers – qui peuvent cependant être regroupées sous la notion d’autocritique – ont jusqu’alors été largement négligées parce que considérées comme trop historiques ou trop idéologiques. Ces témoignages d’ex-communistes peuvent aussi être une leçon pour notre époque, pleine de nouvelles croyances obscurantistes.
1 Vladimir Lénine, La Maladie infantile du communisme, le « gauchisme », Paris, Union générale d’éditions, 1962, p. 13.
2 Nous traduisons ici les mots et les expressions écrits sur l’affiche de propagande.
3 Berthold Unfried, « L’autocritique dans les milieux kominterniens des années 1930 », dans Autobiographies, autocritiques, aveux dans le monde communiste, dir. Claude Pennetier et Bernard Pudal, Paris, Belin, coll. « Socio-Histoires », 2002. p. 51.
4 Jean-Louis Jeannelle, « Les “récits de désaveu” ou comment faire son autocritique de manière critique ? » dans « Moi public » et « moi privé » dans les Mémoires et les écrits autobiographiques du xviie siècle à nos jours, édité par Rolf Wintermeyer, en collaboration avec Corinne Bouillot, Rouen, PURH, 2008, p. 283.
5 Ibid., p. 274.
6 Id., « Essais de Mémoires : Autocritique d’Edgar Morin », dans « Edgar Morin, plans rapprochés », Communications, no 82, 2008, p. 121.
7 Alexandre Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag 1918-1956 : essai d’investigation littéraire [en russe], Paris, YMCA-Press, 1973-1975 (vol. 1, 1973 ; vol. 2, 1974 ; vol. 3, 1975).
8 Boris Souvarine, Souvenirs sur Isaac Babel, Panaït Istrati, Pierre Pascal, suivi de Lettre à Alexandre Soljénitsyne, Paris, Gérard Lebovici, 1985, p. 143.
9 Victor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire (1901-1941) [1951], Paris, Seuil, 1978, p. 141.
10 Auguste Lecœur, L’Autocritique attendue, Paris, Girault, 1955, p. 11.
11 Ibid., p. 19.
12 Claude Roy, Les Chercheurs de dieux. Croyance et politique, Paris, Gallimard, 1981, p. 148.
13 Arthur Koestler, Ignazio Silone, Richard Wright, André Gide, Louis Fischer et Stephen Spender, Le Dieu des ténèbres [1949], introduction de Richard Crossman, postface de Raymond Aron, trad. par Armand Petitjean, René Guyonnet et Raymond Millet, Paris, Calmann-Lévy, 1950, p. 223.
14 Edgar Morin, Autocritique [1959], Paris, Seuil, 2012, p. 21-22.
15 Ibid., p. 30.
16 Ibid., p. 53.
17 Ibid., p. 66.
18 Ibid.
19 Ibid., p. 60.
20 Ibid., p. 48.
21 Ibid., quatrième de couverture.
22 Ibid., p. 52.
23 Ibid., p. 67.
24 Ibid., p. 72.
25 Ibid., p. 85.
26 Ibid., p. 118-119.
27 Ibid., p. 114.
28 Ibid., p. 128.
29 Ibid., p. 66.
30 Ibid., p. 141.
31 Ibid., p. 146.
32 Ibid., p. 180-181.
33 Ibid., p. 186-187.
34 Ibid., p. 187.
35 Ibid., p. 204.
36 Ibid., p. 206.
37 Ibid., p. 220.
38 Ibid., p. 226.
39 Ibid., p. 250.
40 Ibid., p. 294.
41 Ibid., p. 309.
42 Annie Kriegel, Ce que j’ai cru comprendre, Paris, Robert Laffont, coll. « Notre époque », 1991, p. 13.
43 Ibid., p. 494.
44 Ibid., p. 495.
45 Claude Roy, Nous [1972], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1980, p. 417.
46 Edgar Morin, Autocritique, op. cit., p. 137, 159, 208.
47 Claude Roy, Nous, op. cit., p. 556-557.
48 Ibid.
49 Claude Roy, Les Chercheurs de dieux. Croyance et politique, op. cit., p. 173.
50 Ibid.
organisée par Aurélien d'Avout et Alex Pepino à l’Université de Rouen le 30 mai 2018
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 16, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/876.html.
Quelques mots à propos de : Alexandra Vinogradova
Université de Rouen-Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
