Sommaire
Appropriations de Corneille
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
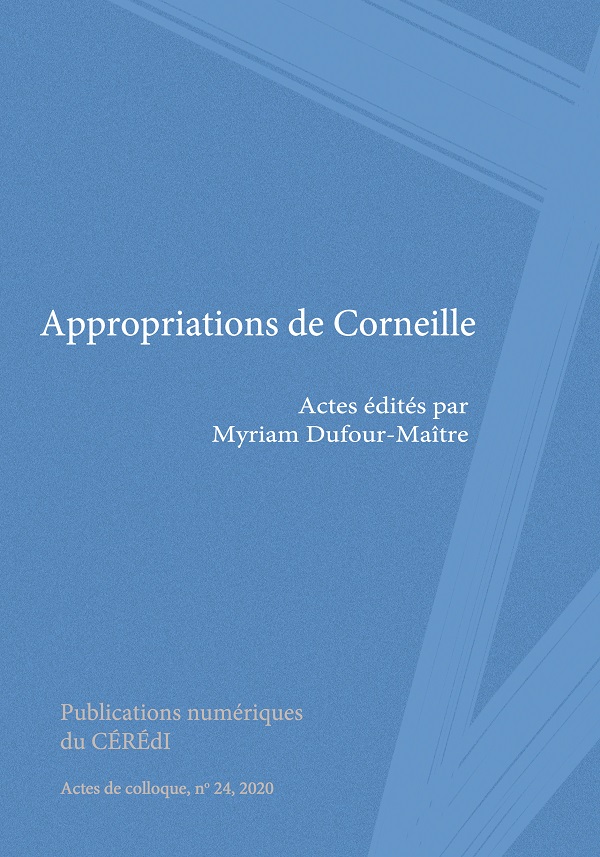
- Myriam Dufour-Maître Remerciements
- Collectif Le Festival Corneille de Barentin (1956-1975) et le Mouvement Corneille
- Myriam Dufour-Maître Introduction
- Sylvain Ledda Polyeucte, ou comment mettre en scène la violence ?
- Hélène Merlin-Kajman Comment déterminer ce qui est « religion » en littérature ? Réflexions à partir du cas de Polyeucte de Corneille
- Liliane Picciola De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
- Jacques Téphany Corneille, l’autre fondateur du TNP
- Roxane Martin Horace à l’épreuve des révolutions : les remaniements du texte et l’édification d’un Corneille patriote (1789-1799 vs 1848)
- Claire Carlin L’Illusion comique sur la scène du monde anglophone, entre traduction et « adaptation libre »
- Cécilia Laurin L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
- Julia Gros de Gasquet Filmer L’Illusion comique, réécrire Corneille ? À propos du film de Mathieu Amalric à la Comédie-Française (2010)
- Noëmie Charrié Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
- Jean-François Lattarico De l’Horace (1641) à l’Orazio (1688). Prémisses de la réforme dans le premier dramma cornélien per musica
- Sarah Nancy Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse
- Mariane Bury Le Corneille des historiens de la littérature au xixe siècle
- Michal Bajer Les contextes de la traduction. L’établissement de la tradition cornélienne en Pologne au tournant romantique : discours critique, pratiques éditoriales, péritextes
- Lise Forment Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
- Bénédicte Louvat « L’invention » du dilemme cornélien
- Jean-Yves Vialleton Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
- Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval Un Corneille à l’usage de la jeunesse au tournant des xviiie et xixe siècles : quelques jalons
- Beate Langenbruch Corneille, auteur de concours
- Hélène Bilis Corneille aux États-Unis, ou quel « auteur classique » pour les campus américains ?
La critique et l’histoire littéraire
Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
Jean-Yves Vialleton
À partir de la fin du xviie siècle, les professeurs de rhétoriques introduisent dans leurs cours des exemples français et non plus seulement latins, dont de nombreux sont pris dans l’œuvre de Corneille. Dans les cahiers manuscrits et les traités imprimés, on ne trouve cependant ni le « Va, je ne te hais point » ni l’« obscure clarté », exemples devenus pourtant aujourd’hui traditionnels pour illustrer la litote et l’oxymore. L’article retrace la généalogie de cette tradition, en essayant de montrer plus largement que les processus de sélection aboutissant à dégager des exemples-types s’appuient sur une pensée non formulée de la langue et de la littérature.
1On s’attend à ce que, dans un manuel ou livre de vulgarisation qui donne une liste même courte des « figures de style », soit retenu l’oxymore et que la figure soit illustrée par l’« obscure clarté » prise du Cid. Il s’agit là d’un bon exemple de « tradition », au sens où l’on parle de tradition pour le conte populaire, la légende, le proverbe, etc. Comme ces derniers, l’exemple canonique non seulement se transmet, mais apparaît comme quelque chose qui mérite d’être transmis et est reçu comme quelque chose d’intéressant, même s’il n’a pas de caractère immédiatement pratique. Il relève en somme de ce qu’on appelle depuis Paul Sébillot la « littérature orale », dont on sait qu’elle se caractérise non pas tant par sa transmission exclusivement orale que par l’« oubli de son origine » (Arnold Van Gennep1) qui lui donne l’apparence d’une œuvre collective et le prestige de quelque chose de très ancien. Ancienneté, on le sait, souvent illusoire. De fait les anciens traités de rhétorique qui donnaient dès le xviiie siècle des passages pris à Corneille ne retenaient pas l’« obscure clarté » parmi leurs exemples. Ils n’utilisaient même quasiment jamais le mot oxymore. Ce mot n’est pas encore enregistré par le Littré. Il ne s’impose en français qu’au xxe siècle. En ce début de xxie siècle il connaît un grand succès dans les essais et les médias avec divers emplois élargis (contradiction irréductible entre deux choses, énoncé non valide parce que fondé sur une absurdité, etc.). Quand une tradition s’impose, pour arbitraire qu’elle soit, sa connaissance finit par devenir nécessaire.
2C’est comme un cas de tradition que nous envisagerons ici les exemples rhétoriques empruntés à Corneille : on soutiendra l’hypothèse selon laquelle les processus de sélection aboutissant à dégager des exemples traditionnels s’appuient sur une pensée non formulée de la langue et de la littérature, une sorte de mythologie, dont on peut retracer la genèse.
Un trésor d’exemples oubliés : traités, manuels et cours du xviiie siècle
3Corneille fait partie des auteurs qui fournissent des exemples aux traités de rhétorique dès que ces derniers utilisent des exemples français et non plus seulement antiques. Cette introduction se fait avant même la fin du règne de Louis XIV dans les cours dictés, un peu plus tard dans les traités publiés. Elle est à mettre en relation non avec la pénétration de la langue vulgaire dans le vieil enseignement latin2, mais avec ce que Brunetière appelait la « nationalisation » de la littérature3. En effet, elle n’est pas liée à la rédaction en français des traités, mais elle se fait dans des textes à destination d’élèves ou de lecteurs français et non plus européens. Les traités en français du xviie siècle ne comportent quasiment pas d’exemples pris à la littérature française4. En 1675 encore (rééditions 1688, 1715), La Rhétorique ou l’art de parler de Lamy (qui est par ailleurs plus une anthropologie de la parole qu’un simple traité de rhétorique) fait peu de place aux auteurs français5. En revanche, on trouve des exemples français dans des cours dictés et des manuels imprimés qui sont en latin.
4Corneille apparaît comme auteur d’exemples en 1730. Dans le Traité des Tropes de Dumarsais (rééditions jusqu’en 1829), on trouve dix exemples de Corneille (contre quatre de Racine), mais les auteurs latins restent mieux représentés (Virgile : 41 ; Cicéron : 28 ; Horace : 27). Il ne s’agit pas d’un traité de rhétorique, mais d’un traité linguistique issu de la réflexion sur la traduction français-latin, comme l’a montré F. Douay-Soublin, qui a aussi réfuté l’idée fondée sur cet ouvrage d’une rhétorique précocement « restreinte » à l’élocution6. Il a cependant une influence sur les traités de rhétorique postérieurs. La même année, Balthasar Gibert publie à la fois un cours en latin (Rhetorica juxta doctrinam Aristotelis dialogis explanata, F. G. Quillau, 87 p.) et La Rhétorique, ou les Règles de l’éloquence (C.‑L. Thiboust, 654 p. ; réédition jusqu’en 1749). Ce dernier ouvrage est destiné, dit le privilège, non seulement aux écoliers, mais à « toutes sortes de personnes ». Les exemples sont massivement pris à l’Antiquité (Tite-Live, Virgile, Horace, Térence, Plaute, Ovide, mais aussi Démosthène, les Évangiles et Épîtres, les Pères de l’Église…) et en premier lieu aux discours de Cicéron, corpus essentiel de toutes les rhétoriques anciennes. On y trouve des exemples modernes, mais souvent pour des passages qui fournissent une « imitation » d’un texte antique7. La première rhétorique appuyée presque entièrement sur des exemples français, comme l’a indiqué Françoise Douay-Soublin, paraît en 1746, c’est L’Essai de rhétorique françoise a l’usage des jeunes demoiselles, avec des exemples tirés, pour la plupart, de nos meilleurs orateurs & poëtes modernes, écrite par G.-H. Gaillard (Le Clerc, 348 p.). Une édition complétée paraît en 1748 (Rhétorique françoise, a l’usage des jeunes demoiselles…, Ganeau, 468 p.), suivie de nombreuses autres jusqu’en 1835. La première rhétorique latine avec des exemples français (même si les discours de Cicéron et ceux de l’Énéide y restent la référence majeure) est celle de Hurtaut en 1757, Manuale rhetorices, ad usum artis dicendi candidatorum, exemplis tum latinis, tum gallicis (L. Prault, 154 p.). En 1765 paraît la Rhétorique françoise de J.-B.-L. Crevier (Saillant, Desaint, deux vol., 809 p. ; seconde édition dès 1767, rééditions jusqu’en 1812). On y trouve une quinzaine d’exemples pris à Corneille (face à une trentaine pris à Racine) : quatre exemples pris au Cid, quatre à Horace, deux à La Mort de Pompée, d’autres pris à Othon, Polyeucte, Héraclius, Nicomède, Médée et au poème au cardinal8. Le manuel latin de Hurtaut est réédité en 1782 avec des compléments qui intègrent des exemples utilisés par Dumarsais et Crevier (troisième édition, « apud autorem », 348 p. sans compter le Tractatus de fabula qui clôt le livre9). À la fin du siècle une Nouvelle rhétorique à l’usage des jeunes demoiselles (anonyme, écrite par A. J. Dugour, Angers, Pavie et Paris, Devaux, 1792, 300 p.) utilise des exemples pris à des auteurs classiques mais aussi à des auteurs inspirateurs de la Révolution (Raynal, Voltaire, Rousseau, Montesquieu) et aux « discours de l’Assemblée nationale ».
5Un coup d’œil sur les cahiers scolaires conservés montre que les publications ne font qu’enregistrer après coup une évolution précoce dans l’enseignement. Dans un cahier de l’année scolaire 1706-1707 conservé à la bibliothèque municipale de Lyon, le cours de rhétorique en latin est illustré par une véritable anthologie de poèmes français, empruntés en particulier à Malherbe, Corneille et Racine10. Dans un autre, conservé à la bibliothèque de l’Arsenal, de l’année 1738-1739, on trouve Cicéron et Virgile, mais aussi de nombreux auteurs du xviie siècle (les prédicateurs Fléchier et Bourdaloue, les poètes Boileau, Racine, Corneille, La Fontaine, mais aussi Racan, Pellisson, Segrais…) et même de textes quasi contemporains (une cantate de J.-B. Rousseau de 1703, l’Idoménée de Crébillon de 170511). On trouve des exemples français dans les cahiers de rhétorique proprement dits, mais aussi dans les cahiers de l’année précédente, celle de seconde12, consacrés aux exercices préparatoires (la fabula, la narratio, l’amplificatio, parfois la chrie13).
6Parmi les exemples s’en trouvent quelques-uns qui restent aujourd’hui vivants. Très vite par exemple la tirade de Camille (V, 5) est devenue le modèle de l’imprécation. Ce sont des imprécations « célèbres en ce genre », selon Gaillard, un exemple praeclarum d’imprecatio seu execratio selon Hurtaut, qui y joint celles de Cléopâtre dans Rodogune (v. 1819-182414). On les cite même quand d’autres exemples plus récents sont aussi donnés (les imprécations de Palmire dans Mahomet15). On y relève qu’elles s’associent à la figure de la répétition, c’est-à-dire de l’anaphore, illustrée par la Camille « execrantem », mais aussi par Médée, v. 315-320 et Rodogune, v. 1525-152916.
7Mais ce qui frappe, c’est le nombre d’exemples oubliés, qui offrent une mine à celui qui voudrait lire Corneille avec l’œil du professeur de rhétorique : Camille avant de passer aux imprécations utilise l’exprobatio (VI, 5, « Donne-moi donc barbare un cœur comme le tien17 »), Cornélie use de licentia face à César (III, 4, v. 985-99418), etc.
8Les exemples sont surtout utilisés pour la partie concernant l’élocution. Mais on en trouve concernant les genres de discours (Horace, V, 2, tirade de Valère illustrant du genre judiciaire19), les lieux intrinsèques (comment invalider la loi, discours du roi dans Horace, v. 1733-175920), l’état de cause (conjectural ou de qualité, à propos de la stratégie oratoire du vieil Horace à l’acte V21), les exemples (utilisation des exemples contraires dans le délibératif, Cinna, v. 377-38322), les passions23 et la manière de les combattre l’une par l’autre selon la leçon d’Aristote. Gilbert rappelle que « Les passions s’excitent les unes les autres […] la colère contre un coupable, par la compassion des malheureux, qu’il a cruellement traités » et donne les vers de Léonor à l’Infante (Le Cid, v. 81-84, « Une grande princesse à ce point s’oublier… »), comme exemple d’un « discours » qui « réprime une passion par une autre24 ».
9On y trouve aussi des analyses concernant la construction de la période. Les vers 911-916 de Sertorius sont un exemple de période bimembris dont le second membre est en quatre sections25. La deuxième strophe des stances de Polyeucte est un exemple de période quadrimembris sive quadrata (v. 115 ;1116-1118 ;1119-1120 ;1121-112426). La réplique du comte du Cid « Pour grands que soient les rois… » (v. 151-154) est un autre exemple de ces « Périodes à quatre membres, que l’on nomme Périodes carrées, lorsque ces membres sont à peu près égaux », ou « Périodes rondes à cause de leur perfection27 ». Cette remarque donne une clé rhétorique pour les observations de Mario Roques reprises par Jacques Scherer sur la « pompe » et le « quatrain à rime suivie » dans la tragédie28.
10Les rhétoriques notamment sont sensibles à l’emploi de l’ironie chez Corneille, dans Nicomède bien sûr (v. 1153 et suiv.29), mais pas seulement. Dumarsais donne comme exemple d’ironie le vers « À de plus hauts partis Rodrigue doit prétendre » (Le Cid, I, 4, v. 164 dans l’édition de 1637) et signale que le vers était très célèbre (« Tout le monde sait ce vers de Chimène dans le Cid30 »), exemple repris par Hurtaut pour illustrer la concessio ou ironia (distingué de l’épitrope ou permission)31. La Rhétorique des demoiselles relève l’ironie amère de Créon à l’égard de Médée32.
11Les rhétoriques nous offrent parfois un point de vue qui nous est devenu étranger. Nous ne voyons probablement plus avec évidence le début des stances de Polyeucte (IV, 2) comme un bel exemple d’expolition33. Nous ne distinguons plus clairement les types d’amplification indiqués pour le début de la plainte de Chimène au roi (II, 8, v. 665 et suiv.34), le tableau que Tite fait à Flavian de sa puissance (II, 1, v. 397-40435), la réponse de Pompée à Sertorius (III, 1, v. 911-91636). Dans les vers 459-462 du Cid (II, 3 ; « Maudite ambition ! détestable manie… »), nous ne voyons probablement plus un de ces « lieux communs » « qui servent à fortifier ou à embellir le Discours, pourvu qu’ils ne soient pas trop longs37 ».
Un exemple de sublime aujourd’hui obsolète : le « Qu’il mourût »
12Certains exemples semblent s’être s’imposés parce qu’ils ont fait l’objet de remarques prestigieuses : passages du Cid commentés dans les Sentiments de l’Académie (ces passages suscitent notamment l’intérêt chez Dumarsais38), passages de Corneille loués ou critiqués par Voltaire. Ils peuvent aussi s’imposer simplement parce qu’ils sont copiés d’un ouvrage précédent. Ici s’applique la loi énoncée par Montesquieu anticipant sur les théories de Gabriel Tarde, loi selon laquelle « Il y a des choses que tout le monde dit, parce qu’elles ont été dites une fois39 ».
13L’exemple du « Qu’il mourût » a bénéficié du patronage de Boileau qui le cite dans ses réflexions sur le sublime : « Qu’il mourust. Voilà des termes fort simples. Cependant il n’y a personne qui ne sente la grandeur qu’il y a dans ces trois syllabes40 ». Voltaire dans ses commentaires du théâtre de Corneille annote le vers de façon ambivalente. Il juge « le fameux Qu’il mourût » comme un « trait du plus grand sublime », un « mot auquel il n’en est aucun de comparable dans toute l’antiquité », mais note qu’il est suivi d’un « vers faible » et que le fait que le vieil Horace n’ait pas cru bon d’être présent lors du combat « gâte » tout. Il lance ainsi un sujet de débat, auquel participeront notamment Fénelon, Palissot, La Harpe et que les notes des classiques de jadis rappelaient41.
14Dans les traités de rhétorique, cette réplique sert à illustrer la beauté de la simplicité, mais pas toujours le sublime. Dumarsais utilise l’exemple pour illustrer le « genre d’écrire, où toute la beauté consiste dans la pensée exprimée sans figure », au côté du « Roi » de Nicomède (IV, 3), notant sur ce dernier mot qu’« Il n’y a point là de figure, et [qu’]il y a cependant beaucoup de sublime dans ce seul mot42 ». Crevier range les « traits tant et si justement admirés » du « Qu’il mourût » et du « Moi » de Médée dans le « sublime de sentiment » (qu’il distingue du « sublime de pensée43 »). Mais certains textes louent la beauté du simple sans parler de sublime. C’est le cas de Gibert qui insiste sur le fait que la « grande beauté » des « mots dans le propre » (c’est-à-dire sans figure) tient à leur juste place et ajoute au « Qu’il mourût » le « Meurs ou tue » du Cid et le « Elle est… Quoi ! Mariée ! » de Polyeucte44. Le « Moi » de Médée apparaît dans une rubrique consacrée aux « termes qui tiennent comme le milieu entre le propre et le figuré » et illustrée par le « Moi me reste encore » de la Médée de Sénèque : on y remarque simplement que le « Moi » de celle de Corneille n’est en revanche « point obscure45 ». La Rhétorique des demoiselles préfère illustrer le sublime sans figure par des mots de Joad, renvoyant le « Roi » de Nicomède, le « Qu’il mourût » et le « Moi » de Médée au « style laconique46 ». La Nouvelle rhétorique à l’usage des jeunes demoiselles publiée pendant la Révolution retrouve cependant le goût du sublime, l’illustrant par Corneille (« Avant que d’être à vous j’étais à mon pays » d’Horace, « Soyons ami, Cinna » de Cinna), mais aussi par la prosopopée de Fabricius et les « images sublimes de Mirabeau ». Mais une tradition subsiste qui préfère illustrer le sublime par la poésie religieuse de Racine. Dans le recueil Chefs-d’œuvre de l’éloquence poétique, le « Qu’il mourût » et le « Elle est… Quoi ! Mariée ! » sont donnés comme exemples de simplicité (sans périphrase), mais sont exclus du sublime incarné par « Que la lumière se fasse » de la Bible et qu’on trouve dans la poésie religieuse de Racine et dans Athalie (« Le Dieu qui met un frein47… ») D’autres exemples de Corneille qui pourraient illustrer le sublime sont sous une autre rubrique, celle de l’emphase, c’est-à-dire de l’expression brève qui prend un poids énorme. C’est ce que fait par exemple le recueil Chefs-d’œuvre de l’éloquence poétique qui donne de l’emphase une définition qui rappelle ce que dit Gibert : « Cette figure consiste dans un seul mot qui, par la place qu’il occupe, signifie beaucoup plus qu’il n’exprime, et fait naître à l’esprit, une multitude d’idées, dont seul il tenait la place ». Sont donnés en exemple le « Et parle à mon tyran en fille d’empereur » dit par Pulchérie à Phocas, le « Rome n’est plus dans Rome… » de Sertorius, le « Et vous pensez avoir l’âme toute romaine » dans les vers 789-790 de Sertorius à Pompée48. Pour l’emphase, Hurtaut donne lui aussi l’exemple de l’« âme toute romaine49 » et il ne cite « Qu’il mourût » qu’au chapitre sur la périphrase et pour reprendre la critique de Voltaire sur le vers qui suit50.
Deux exemples canoniques d’aujourd’hui : « Va, je ne te hais point », « Cette obscure clarté »
15Les listes de figures de style d’aujourd’hui ne parlent plus du « Qu’il mourût », mais, même courtes, comprennent souvent deux exemples pris à Corneille, tous deux tirés du Cid : le « Va je ne hais point » et « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles ». Ce sont deux des trois exemples de Corneille retenus dans le Dictionnaire de rhétorique de Georges Molinié51.
16Le premier a donné lieu à un débat : cet exemple canonique de litote (c’est l’exemple donné dans le dictionnaire de Littré) est-il bien une litote ? Ce débat est évoqué par Gérard Genette comme un vieux souvenir dans Codicille52, mais le débat n’est pas clos53. Wikipedia y consacre une longue section (« Exemple de divergence interprétative ») de sa longue notice sur la litote. L’article cite le jugement de Molinié54 qui voit là une « fausse litote » et note : « Si l’on en croit Fontanier, on doit le succès de cette “litote” à Laharpe. » Fontanier cite en effet La Harpe55. Mais il faut remonter plus loin pour ce qui est de l’origine de l’exemple et de sa contestation. C’est Dumarsais qui lance l’exemple, avec ce commentaire : « elle lui fait entendre bien plus que ces mots-là ne signifient dans leur sens propre56. » Voltaire a dû participer à son succès. Dans l’article « Froid » de son Dictionnaire philosophique, même s’il ne parle pas de litote, il utilise l’exemple pour montrer comment des propos « vifs » valent plus que des grands mouvements de passions qui sentent le froid : « Les sentiments qui échappent à une âme qui veut les cacher, demande au contraire les expressions les plus simples. » D’autre part, ce ne sont pas les linguistes récents qui ont dénoncé en premier cette fausse litote en prenant compte le contexte, mais Albert Thibaudet dès 193657 qui en fait « une invention de grammairien qui projette en Corneille ou en Racine sa propre pauvreté », alors que « ni Corneille ni Racine n’ont usé communément de la litote dans leurs scènes de déclaration d’amour ». Disant cela, il veut s’opposer à un prétendu goût classique « qui voit la perfection de l’art dans une litote perpétuelle, dans une sobriété hyperbolique où on ne parlerait que par sous-entendu ».
17L’exemple de l’« obscure clarté » montre encore mieux que la sélection des exemples s’appuie sur un imaginaire. Cet exemple n’est pas ancien : nous ne l’avons trouvé dans aucun livre ou cahier de rhétorique d’Ancien Régime. Le mot même d’oxymore est d’introduction récente en français. Il apparaît dans l’Encyclopédie de d’Alembert et Diderot (1765, vol. XI, p. 728), sous la forme oxumoron, mais reste longtemps d’un emploi rare. L’Encyclopédie donne des exemples très conformes à ce que nous appelons aujourd’hui oxymore, mais exclusivement latins :
On la trouve souvent employée dans les Orateurs & les Poëtes. Horace dit arcani fides prodigua, une fidélité indiscrete ; parjura fides, une fidélité parjure ; insaniens sapientia, soevus jocus, amabilis insania, lene tormentum, dulce periculum, &c.
18Elle donne le mot comme « le nom grec donné par les Rhéteurs à la figure que nous appelons opposition » et renvoie à l’article de cette entrée. Mais ce dernier article (signé par Jaucourt) est confus. Il commence en définissant ce que nous appelons oxymore :
OPPOSITION, s. f. terme de Rhétorique, c’est une figure de rhétorique, par laquelle l’on joint deux choses qui en apparence sont incompatibles, comme quand Horace parle d’une folle sagesse, & qu’Anacréon dit que l’amour est une aimable folie. Cette figure qui semble nier ce qu’elle établit, & se contredire dans ses termes, est cependant très-élégante ; elle réveille plus que toute autre l’attention & l’admiration des lecteurs, & donne de la grace au discours, quand elle n’est point recherchée & qu’elle est placée à propos.
19Mais il continue par un exemple renvoyant à un procédé que nous jugeons tout différent :
Voulez-vous un exemple d’une opposition brillante moins marquée dans les mots que dans la pensée, je n’en puis guere citer de plus heureuse que celle de ces beaux vers de la Henriade, chant IX.
Les amours enfantins désarmoient ce héros,
L’un tenoit sa cuirasse encor de sang trempée,
L’autre avoit détaché sa redoutable épée,
Et rioit, en tenant dans ses débiles mains
Ce fer l’appui du trône, & l’effroi des humains.
Il falloit dire, peut-être l’effroi des ennemis.
20qui ne se distingue pas de l’antithèse, selon la définition qu’on trouve dans L’Encyclopédie : « (Bell. Lett.) figure de Rhétorique, qui consiste à opposer des pensées les unes aux autres, pour leur donner plus de jour. ») et qui est celle de la contentio des rhétoriques latines (« contentio est, quum ex contrariis verbis aut rebus conficitur », Rhétorique à Herennius, IV, 15). Comme l’a montré Françoise Douay-Soublin, la pensée des figures d’opposition est confuse à l’âge des Lumières58. Au début du siècle suivant, Fontanier ne parle toujours pas d’oxymore. Il décrit la figure qu’il nomme après Beauzée59 paradoxisme en lui donnant une définition qui semble convenir à l’oxymore :
Le paradoxisme, qui revient à ce qu’on appelle communément alliance de mots, est un artifice de langage par lequel des idées et des mots, ordinairement opposés et contradictoires entre eux, se trouvent rapprochés et combinés de manière que, tout en semblant se combattre et s’exclure réciproquement, ils frappent l’intelligence par le plus étonnant accord, et produisent le sens le plus vrai, comme le plus profond et le plus énergique60.
21Mais, si l’un des exemples relève de ce que nous appelons oxymore (« vieille jeunesse »), tous les autres sont plutôt ce que nous appellerions des antithèses (« Et monté sur le faite, il aspire à descendre »).
22C’est que la notion d’oxymore, bien distinguée de l’antithèse, et typiquement incarnée par l’association d’un substantif et d’une épithète d’apparence contradictoire, si elle est une notion ancienne dans le savoir en latin, est tardivement importée dans le savoir en français. Le mot est un mot de latin tardif fabriqué sur des éléments grecs. La notion vient non des grandes rhétoriques (qui ne distinguent pas vraiment l’antithèse et l’oxymore), mais des commentaires de Servius à Virgile : commentaire du capti potuere capi de l’Énéide (VIlI, v. 295). Il en est d’ailleurs exactement de même pour la litote, notion qui hérite du commentaire par Servius du non tarda des Géorgiques (II, v. 12561). On trouve une longue notice sur l’oxymorum dans les Parallela du jésuite Caussin (161962). C’est selon lui une figure périlleuse : elle joue sur une formulation étudiée et « pointue » (« acute enuntitata ») au point de paraître proche de la déraison63. Dans le Manuale rhetorices de Hurtaut (édition de 1682), une section est consacrée à l’oxymore64, défini comme une « figure qui mêle et accorde de belle façon des pensées ou des mots qui en apparence s’opposent, c’est-à-dire en bref comme un trait d’esprit » (« acute dictum65 »). Le titre de la section insère dans le latin un mot français comme explication : « De oxymoro, seu acute dicto (la Pointe) ». De fait la « folle sagesse » qu’on trouve dans Horace comme le rappelle l’Encyclopédie est typiquement une pointe, même si cette dernière notion recouvre divers procédés, en fait ceux que déjà Aristote, au chapitre 10 du livre III de sa Rhétorique, répertoriait pour les mots d’esprit (asteia) : métaphore, antithèse et suggestion vive (energeia). Cette équivalence entre oxymorum et « pointe » est explicite dans un discours sur le style burlesque joint aux œuvres de Scarron en 1752 qui dit que la « figure que nos Écoles nomment oxymoron » est « propre au style burlesque » et la rapproche du grotesque de Calot et de Rembrandt.
23L’« obscure clarté » de Corneille est donc à l’origine une pointe, ce que les Italiens appellent une « acutezza », et elle ne devient un oxymore que lorsque la pointe devient une notion obsolète, ou plutôt que le mot a pris un sens uniquement péjoratif : le français lui trouve alors un remplaçant dans la terminologie des « écoles », celle qui remonte à Servius. Mais reste à comprendre pourquoi retenir cet exemple alors que la littérature du xviie siècle fournissait des pointes en abondance.
24Que cet exemple soit retenu est d’autant plus étrange que « obscure clarté » est à peine une pointe à l’époque de Corneille, cette alliance de mot est sinon lexicalisée du moins peu surprenante : l’expression « obscure clarté » (de la foi) se trouve littéralement déjà chez François de Sales dès 161666. Elle est d’autant moins frappante qu’elle rappelle un terme de peinture italien, chiar oscuro, emprunté par le français dès le xvie siècle sous sa forme italienne et à l’époque classique sous sa forme francisée, enregistrée dans le premier dictionnaire de l’Académie. L’expression est d’ailleurs moins une pointe qu’une « imitation ». Elle rend le célèbre lux maligna de Virgile, terme utilisé dans l’Énéide (VI, 270) pour parler de la lumière des enfers pareille à celle que fait la lune dans les bois la nuit, terme que les dictionnaires rendent par « lumière sombre ». C’est la traduction du Dictionnaire françois-latin… de Robert Estienne, publié en 153967, ou bien encore du Grand dictionnaire franco-latin paru à Rouen chez Pierre Loiseley en 160968. L’Abrégé du parallèle des langues française et latine du jésuite Philibert Monet, édité à Pont-à-Mousson en 1627 pour lux maligna donne « barlue, lumière obscure et ombragée ». En lisant la définition de « Barlue » dans le Trésor de Nicot édité en 1606, on trouve une autre expression latine connue et proche de lux maligna : « lueur fusque, qui entre-luit en temps umbrageux et nocturne, que Virgile au neufiéme livre de l’Eneide, et Horace appellent nox sublustris, ce que Servius explique, nuit qui a un peu de lueur. » Nicot cite le terme « nuit entreclaire » utilisé par « le chevalier d’Agneaux audit passage de Virgile ».
25Corneille, dans le récit de Rodrigue, écrit un « tableau à faire » : le tableau de bataille et le tableau de nuit, plus encore le tableau de la bataille nocturne, sont les exemples d’ekphraseis donnés par Hermogène dans ses Exercices préparatoires. Voltaire ne s’y trompe pas. Non seulement il caractérise le passage comme une « description d’armée », mais il le juge selon une vieille méthode, celle chérie par Scaliger dans ses Poetices, la comparaison avec d’autres tableaux du même type (ici celui de Fénelon). Dans ce tableau à faire, Corneille met une notation de lumière qui est non une pointe surprenante mais une « imitation ». Dans le tableau de bataille nocturne, Plutarque parle de « la lune, qui, déjà sur son coucher, ne donnait qu’une faible lumière », selon la traduction d’aujourd’hui (Nicias XXXI) ; Dacier en 1721 rendra justement le passage en employant l’expression « obscure clarté ».
26La fortune de l’« obscure clarté » doit tout en fait à la vogue préromantique et romantique du Paradis perdu de Milton. C’est dans l’édition du Théâtre de Corneille « avec des observations des anciens commentateurs et de nouvelles remarques », donnée par Charles Nodier et Pierre Lepeintre pour la « Bibliothèque dramatique ou répertoire universel du théâtre français », qu’une note attire l’attention sur « obscure clarté » : « On croirait presque que cette obscure clarté est une imitation des ténèbres visibles de Milton, darkness visible69. » La note va être recopiée. Dans l’édition du Cid chez Hachette en 1848 « annoté par E. Géruzez », elle apparaît sous cette forme : « Voilà un vers admirable, dont la peinture envie l’effet à la poésie. Cette obscure clarté rappelle, par voie de contraste, les ténèbres visibles admirées dans Milton70. » Dans Les Poètes français…, recueil de morceaux publié en 1858, on trouve le récit de Rodrigue avec la note : « Obscure clarté : belle antithèse qui rappelle les ténèbres visibles de Milton71. » L’édition de la pièce par Hémon en 1886 cite Géruzez, mais dévoile la source virgilienne :
« Cette obscure clarté rappelle, par voie de contraste, les ténèbres visibles admirées dans Milton (M. Géruzez) Elle rappelle aussi le lux maligna des poètes anciens, et le vers de Virgile :
Quale per incertain lunam, sub luce maligna.
Préoccupé avant tout de peindre l’intérieur de l’âme, Corneille n’a pas souvent de ces traits qui peignent la nature extérieure; encore ne se les permet-il, comme ici, que lorsqu’ils font corps avec le récit et le drame72. »
27L’engouement pour le Paradis perdu de Milton commence en France vers 172873. Une première traduction intégrale est publiée en 1729 ; de nombreuses suivront, notamment par Louis Racine, Delille, Chateaubriand. Relayant Addison qui fit redécouvrir l’œuvre en Angleterre, Voltaire la loue dans son Essai sur la poésie épique (1727 pour la première version en anglais, 1733 pour la version revue et en français). Il juge la description de Satan aux Enfers (début du livre I, v. 56-67) comme « un des plus sublimes endroits du poème singulier de Milton ». Voltaire commence par affirmer la différence entre le goût des peuples et juge que les langues espagnole et anglaise permettent un sublime et une extravagance impossible à la littérature française, dont le « génie sage et exact » ne permet que d’« écrire aussi bien que Racine et Despréaux ». Milton entre dans une liste de grands poètes épiques, au côté d’Homère, Virgile, Lucain, Camoens, le Tasse, Don Alonzo de Ereilla. Le traité de Voltaire est un livre avant-coureur des romantismes européens. Dans le tableau de Satan aux Enfers, les vers 59-64 du livre I de Paradis perdu sont désignés comme typiques de la hardiesse de la langue anglaise. Ce sont eux qui contiennent justement l’expression darkness visible qui va devenir célèbre. Dans la Rhétorique des demoiselles, on n’utilise que des exemples français, à l’exception d’un exemple étranger, justement le discours de Satan à Belzébuth dans Paradis perdu74.
28Le succès de Milton correspond à la pensée nouvelle du sublime telle qu’Addison l’a lancée. Voltaire disait que chez Milton ne se trouvait pas seulement le sublime, mais aussi « je ne sais quelle horreur ténébreuse, un sublime sombre et triste qui ne convient pas mal à l’imagination anglaise ». Milton est cité par Burke dans Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau (1757 et 1759, 1767 pour la traduction, II, ch. III, et IV) et Kant évoque son tableau du royaume infernal dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime (1764). Dans le Salon de 1767, Diderot, on le sait, très influencé par Burke, expose la notion moderne de sublime : « Tout ce qui étonne l’âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur conduit au sublime ». Or il le fait à propos d’un tableau d’un nocturne de Vernet où se voit une obscure clarté grâce à la lune et aux feux dans la nuit : « C’est la nuit partout et c’est le jour partout […] Il a rendu en couleurs les ténèbres visibles et palpables de Milton75. »
29Dans sa traduction, Louis Racine (1755) rend les vers :
No light; but rather darkness visible
Served only to discover sights of woe,
30par « au lieu de lumière, qu’une sombre clarté, pâle lueur qui lui rend visibles ces abîmes ténébreux, ces régions de douleurs ». Une longue note est ajoutée, avec comme entrée, non « sombre clarté », mais « obscure lueur » :
Une obscure lueur. Milton dit, une obscurité visible ; ce que Rolli a traduit littéralement :
Lume non gia, ma oscurià visibile.
31Louis Racine parle alors de la critique faite par Voltaire de cette traduction italienne et de la réponse du traducteur qui justifie le caractère non absurde de l’expression. Il ajoute : « Dans notre Langue, nous ne pouvons dire une obscurité visible » et il cite une « imitation » en vers qu’il a faite du passage et où les vers sont rendus par :
Centre de la douleur, où d’épaisses ténèbres
Ne laissent échapper que des clartés funèbres.
32Toute la fin de la note justifie le terme, non pas en invoquant le génie des langues et le sublime, mais par des exemples qui l’inscrivent justement dans la tradition antique de l’acutum dictum qui est à l’origine de la pointe « baroque » :
L’expression de Milton est hardie, mais je ne la voudrois pas condamner. Sénèque, Epit. 57 a dit d’une manière encore plus hardie : Nihil illis faucibus obscurius, non ut tenebras videamus, sed ut ipsas. L’Enfer est appelé l’abyme ténébreux, & en même temps un lieu plein de flammes. Ces flammes ne rendent donc point de lumière ; ce qui a fait dire à Racan dans un de ses Psaumes, que Dieu
Aux siens départira ses plus pures clartés,
Et des feux sans lumières aux ames criminelles.
On dit aussi dans le Temple de la Mort par Habert :
Et des flambeaux de poix, les lumières funèbres,
Par leurs noires vapeurs, augmentent les ténèbres76.
33Chateaubriand lui-même, dans le Génie du christianisme77, tout en faisant valoir les beautés du Paradis perdu et particulièrement la hardiesse de son expression (« On connaît les ténèbres visibles, le silence ravi, etc. »), met en garde contre l’abus de ces termes qui « ont un faux air de génie ». Il s’inscrit par là dans la tradition classique de la condamnation de la pointe, celle même qui fait critiquer par exemple les métaphores « prétendues ingénieuses », l’excès des hyperboles ou les « rodomontades » chez Corneille78. Mais, en 1840, c’est une allusion à Milton qui ouvre la préface du recueil Les Rayons et les Ombres, où Hugo à côté d’un vers de Macbeth donne le vers « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles » pour montrer que « Tout se tient, tout est complet, tout s’accouple et se féconde par l’accouplement ». L’oxymore est définitivement devenu, selon la belle définition de Léon Cellier, la figure qui assure « la présence d’un élément mystérieux […], le sacré79 ».
34La litote « Va je ne te hais point » illustre une certaine idée du classicisme, post-classique et restrictive : « Le théâtre classique n’est bien que dans la litote » dit un personnage de Montherlant, en 195180. L’oxymore « obscure clarté » s’impose grâce au passage du sublime de Boileau à celui de Burke, ou encore, pour employer des notions prises à l’anthropologie de l’imagination de Gilbert Durand81, le passage d’un sublime de « régime diurne » à un sublime de « régime nocturne ». Ce n’est donc ni la beauté ni la pertinence pédagogique qui suffisent à expliquer le succès des exemples. Ils ne deviennent intéressants qu’en tant qu’« éléments du système d’idées de la société82 ». Pour les exemples pédagogiques aussi, l’entrée dans l’oubli ou la survivance ont à voir avec la « pensée sociale » dont on sait depuis Maurice Halbwachs qu’elle est elle-même « essentiellement une mémoire ».
1 A. Van Gennep, Manuel de folklore français, Bibliographie, rééd. Paris, Laffont, coll. « Bouquins », 1999, p. 520.
2 C’est surtout à ce point que s’intéressent les histoires de l’éducation : voir par exemple R. Chartier, M.-M. Compère, D. Julia, L’Éducation en France du xvie au xviiie siècle, Paris, Sedes, 1976.
3 F. Brunetière, Manuel de l’histoire de la littérature française, Paris, Ch. Delagrave, 1898, titre du chapitre II, sur la période 1610-1622. Sur l’histoire des « classiques scolaires », voir le chapitre de D. Molo dans Les Lieux de mémoires, II, La nation, dir. P. Nora, t. 3, 1986, p. 517-562.
4 Dans La Rhétorique française de R. Bary publiée en 1653 et rééditée jusqu’en 1673, les exemples sont résumés de Cicéron ou inventés.
5 B. Lamy cite des théoriciens et des poètes de l’antiquité, surtout latine. Des auteurs français sont cités en tant que traducteurs (Gilles Boileau pour Virgile, Godeau pour les Psaumes, Brébeuf pour Lucain, Boileau pour Hésiode). Les exemples proprement français ne sont pas nombreux (Fléchier, textes français pris à la Manière de penser de Bouhours, une maxime de La Rochefoucauld comme exemple de sentence, une citation de Des Barreaux comme exemple d’épitrophe ou consentement, des expressions prises au Bourgeois gentilhomme mais sans mention de leur origine).
6 C. Ch. Dumarsais, Des tropes ou des différents sens, éd. F. Douay-Soublin, Paris, Flammarion, 1988, p. 15-18. On y trouve un index des auteurs cités p. 437-438.
7 Exemples de Malherbe, Corneille, Racine, Boileau (comme dans beaucoup de manuels du xviiie siècle, Boileau tient la première place), mais aussi de Scudéry (cité par Boileau), de Brébeuf (comme traducteur de Lucain), de Nicole. La maxime « Il faut manger pour vivre… » est donnée, mais sans référence explicite à Molière.
8 Il ne faut donc pas exagérer la réduction du corpus cornélien. À la fin du siècle, un recueil de textes, Chef-d’œuvres [sic] d’éloquence poétique à l’usage des jeunes orateurs, ou Discours françois tirés des auteurs tragiques les plus célèbres suivis d’une table raisonnée dans laquelle on définit et on indique les différentes figures qui s’y rencontrent… (anonyme, écrit par Charles Batteux ; Paris, Nyon l’aîné, 1780, réédition jusqu’en 1832), donne des extraits de onze pièces de Corneille (Cid, Héraclius, Cinna, Nicomède, Horace, Polyeucte, Médée, Sertorius, Mort de Pompée, Rodogune, Pulchérie). Table des figures, p. 371 et suiv. (p. 264 et suiv. dans la rééd. 1832, disponible sur Gallica).
9 Même dans cette réédition, le nom des auteurs français est encore latinisé, ce dont se moque le compte rendu paru dans Le Journal de Litterature, des Sciences et des Arts (1782, t. 2, p. 282), qui par ailleurs loue le livre, notamment pour le choix et le nombre des exemples.
10 Institutiones oratoriae veterum et recentium exemplis illustratae, « Premier cayer de rhétorique commancé le 20e octobre l’année 1706 », BM de Lyon, M142. Y est joint un Rhetoricae compendium par questions-réponses (p. 286-300). Dans les cours n’utilisant pas encore d’exemples d’auteurs français pouvaient cependant apparaître en français des devises en vers : voir Rhetorica seu novae et veteris Eloquentiae Praeceptiones, cahier daté de 1681, BM de Lyon, Ms 138, fos 152-153.
11 Rhetorica data a reverendissimo patre Du Hautbocs et scripta a me Claudio Francisco Giquel du Nedo, anno Domini 1738, BnF, Arsenal, MANUS 883 (19 BL). Le cours se donne comme une Rhetorica ad Tullianam rationem exactu.
12 Le manuscrit M146 de la BM de Lyon réunit par exemple deux cahiers de l’élève François Pavy, correspondant aux années scolaires 1772-1773 et 1773-1774, dictés dans le même collège de Roanne (coll. Rhodumnensi) par le même professeur (D. Barrié) Le premier s’intitule Elementa rhetorices continentia narrationem, stilum, fabulam et epistalam (exemples de Racine, de Voltaire, de Boileau surtout), le second Rhetoricae quaedem Praecepta (exemples de Racine, Corneille, Fénelon).
13 Elementa rhetorica, BM de Lyon, MS143, copié en 1739 (fabula, narratio, chria, amplificatio) ; Rhetorica Elementa, BM de Lyon, M137 (cinq chapitres : fabula, narratio, amplificatio, stylus, figurae). Dans ce cahier, les exemples de fables sont tous issus de La Fontaine : on voit que le La Fontaine « pour enfants » ne naît pas au xixe siècle comme on l’a dit.
14 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 300. Pour la numérotation des vers, nous suivons ici et ailleurs l’éd. G. Couton (Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980-1987).
15 A. J. Dugour, op. cit., p. 260.
16 Rhetorica, cahier cité, MANUS 883, p. 45 ; J.-B.-L. Crevier, op. cit., t. II, p. 80.
17 Institutiones oratoriae…, cahier cité M142, p. 212.
18 Rhetorica, cahier cit, MANUS 883, p. 108.
19 Institutiones oratoriae, cahier cité, M142.
20 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 66.
21 J.-B.-L. Crevier, op. cit., t. I, p. 144.
22 Ibid., t. I, p. 92.
23 Le cahier cité M 142 donne la liste des passions d’Aristote (listes équivalentes dans Ms 138 et Ms 139) et les illustre par des citations de l’Énéide et de Racine. Hurtaut donne lui une liste moderne plus longue de dix-neuf passions, inspirée par Thomas d’Aquin (division en trois chapitres : passions concupiscentes, irescentes, mixtes) en les illustrant par des exemples de Racine. Fr. de Dainville (L’Éducation des jésuites, xvie-xviiie siècles, Paris, Éditions de Minuit, 1978, p. 196) signale un cahier de rhétorique contenant des extraits de pièces du xviie siècle pour illustrer les passions (Bibl. La Barde, Orfaure, Limoges) que nous n’avons pas retrouvé.
24 B. Gibert, op. cit., p. 262.
25 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 145 ; G.-H. Gaillard, op. cit., éd. 1776, p. 143-144.
26 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 150.
27 B. Gibert, op. cit., p. 568.
28 J. Scherer, La Dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, [1950], p. 297-302.
29 Ch. Batteux, op. cit., éd. 1832, p. 275.
30 C. Ch. Dumarsais, ouvr. et éd. cités, p. 157. On se rappelle que ce vers est prononcé par le Comte furieux répondant à Don Diègue qui lui proposait le mariage de leurs enfants.
31 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 241.
32 G.-H. Gaillard, op. cit., éd. 1776, p. 455.
33 Rhetoricae quaedem Praecepta, cahier cité Ms 146 ; J.-B.-L. Crevier, op. cit., t. II, p. 134-135 ; Hurtaut, éd. 1682, p. 303 (expolitio seu commoratio). G. Molinié, op. cit., p. 149, donne un exemple pris à Rebatet.
34 Rhetorices elementa, cahier cité Ms 137 : amplificatio per repetitione.
35 Elementa rhetorica, cahier cité Ms 143.
36 G.-H. Gaillard, éd. 1776, p. 245-246 (amplification par « répétition variée de la même idée »).
37 B. Gibert, op. cit., p. 414. L’autre exemple est le « Maudit soit le premier… » de la satire 2 de Boileau (v. 53 et suiv.). Il s’agit du « lieu commun » au sens d’Aphtonius.
38 La critique par l’Académie par exemple de « Malgré des feux si beaux qui rompent ma colère » (Cid, III, 4) se retrouve dans Dumarsais (p. 144) et est reprise par Crevier (t. II, p. 98) comme « application prétendument ingénieuses » dans une métaphore.
39 Considérations sur les causes de la grandeur des Romains…, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. 1, 1951, p. 90.
40 Boileau, Réflexions critiques, X, dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1966, p. 548.
41 Voir Horace, éd. F. Hémon, Paris, Ch. Delagrave, 1899 (7e éd.), p. 125-126.
42 C. Ch. Dumarsais, ouvr. et éd. cités, p. 66.
43 J.-B.-L. Crevier, op. cit., t. II, p. 313.
44 B. Gibert, op. cit., p. 449.
45 Ibid, p. 464.
46 G.-H. Gaillard, op. cit., éd. 1776, p. 239, p. 240, p. 245.
47 Ch. Batteux, op. cit., p. 449 et p. 384.
48 Ibid., p. 394.
49 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 314. Il y joint le « En roi » d’Alexandre le Grand de Racine, cité en revanche par Crevier pour illustrer le sublime (p. 313).
50 P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 196.
51 Le troisième est un extrait de Nicomède (v. 1307-1314) illustrant la communication, p. 82.
52 Paris, Édition du Seuil, 2009, entrée « Litote ».
53 M. Meyer (Qu’est-ce que l’argumentation ?, Paris, Vrin, 2005, p. 64) et H. Lausberg (Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, Stuttgart, Franz Steiner, 2008, p. 304-305) y voient encore une litote.
54 G. Molinié, op. cit., p. 134.
55 P. Fontanier, Les Figures du discours [textes de 1821 et 1827], Paris, Flammarion, 1968, p. 131, article VII « La litote ».
56 Dumarsais reprend Lamy, mais ajoute l’exemple de Corneille. Le mot litote vient des commentaires de Servius à Virgile : voir note de l’éd. Fr. Douay-Soublin, p. 273.
57 Article paru dans la NRF, repris dans Réflexions sur la littérature, 13. « Les chapelles littéraires », Gallimard, 1938, p. 133 (rééd. « Quarto », 2007, p. 550).
58 Françoise Douay-Soublin, « Le paradoxe et son cortège : de l’Encyclopédie à l’Encyclopédie méthodique, dans Le Paradoxe en linguistique et en littérature, dir. R. Landheer et P. J. Smith, Genève, Droz, 1996, p. 221-236.
59 Ibid., p. 222.
60 P. Fontanier, ouvr. et éd. cités, p. 137.
61 Note de l’éd. Fr. Douay-Soublin du Traité des tropes, p. 273.
62 Eloquentiae sacrae et humanae parallela, Auctore P. Nicolao Caussino, Paris, Sébastien Chappelet, 1619, liber septimus, p. 285. Caussin donne l’oxymore comme une figure proche mais différente de l’antithèse : la première est toujours tirée des « contraires » alors que la seconde peut l’être des « divers ». Dans les exemples donnés, la contradiction est soulignée par un polyptote : innupta nuptiae (« mariage nul », Cicéron), impia pietas (« piété cruelle »), qui rappelle l’expression de Virgile commenté par Servius.
63 « ita affectatè et acutè enuntiata, ut ad insaniam accedere videatur », définition donnée dans un glossaire, p. 272.
64 L’oxymore est classé parmi les six figures de conflit, avec l’antithèse, l’énantiose, la paradiastole, la commutation (ou antimétabole ou métathèse) et la sinéciosis.
65 « Est Figura, quae pugnantes in speciem, sententias vocesque pulchrè miscet & conciliat ; vel brevius est acute dictum », P.-T.-N. Hurtaut, op. cit., éd. 1682, p. 223. Sont donnés des exemples comme mortui vivunt, pris au De l’amitié de Cicéron.
66 F. de Sales, Traité de l’amour de Dieu, Lyon, 1616, Livre II, ch. XIV, p. 123.
67 P. 188, s.v. « Lumière, Luminaire ».
68 S.v. « Obscur ».
69 Paris, Veuve Dabo, 1824, t. 1, p. 189.
70 P. 101, note 1.
71 Les Poètes français. Recueil de morceaux choisis dans les meilleurs auteurs… Nouv. Édition… augmentée de notes grammaticales, littéraires…, Paris, Ch. Delagrave, [s.d.] 1858, p. 29, note 1.
72 Le Cid, éd. F. Hémon, nouvelle édition, Paris, Ch. Delagrave, 1886, p. 261-262. Le débat est continué par A. Gazier, « Le “Qu’il mourût” », RHLF, 1894-2, p. 186-188, pour qui secourût signifie secondât et non sauvât.
73 J. M. Telleen, Milton dans la littérature française, Paris, Hachette, 1904 (Genève, Slatkine reprints, 1971) ; J. Gillet, Le Paradis Perdu dans la littérature française de Voltaire à Chateaubriand, Paris, Klincksieck, 1975.
74 Éd. 1756, p. 44 et 84.
75 Cité par J. Gillet, op. cit., p. 383.
76 Œuvres, Paris, Lenormant, 1808, t. III, p. 79.
77 II, I, III (Lyon, Ballanche, t. II, p. 20).
78 J.-B.-L. Crevier, op. cit., t. II, p. 90, p. 197 ; « rodomontades » de Don Sanche : B. Gibert, op. cit., p. 327.
79 L. Cellier, « D’une rhétorique profonde : Baudelaire et l’oxymoron », article de 1965 repris dans Parcours initiatiques, Neuchâtel, La Baconnière et Grenoble, PUG, 1977, pages 191-203.
80 La ville dont le prince est un enfant, II, 2.
81 G. Durand, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris, PUF, 1960.
82 M. Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Félix Alcan, 1925, p. 401 (phrase finale).
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 24, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/842.html.
Quelques mots à propos de : Jean-Yves Vialleton
Université Grenoble Alpes
Jean-Yves Vialleton est maître de conférences en littérature française du xviie siècle à l’Université Grenoble-Alpes et membre de Litt&Arts (UMR 5316), composante « Rhétorique de l’Antiquité à la Révolution ». Parmi ses publications, Poésie dramatique et prose du monde. Le comportement des personnages dans la tragédie en France au xviie siècle (Champion, 2004) ; Vices de style et défauts esthétiques xvie-xviiie siècles (avec C. Barbafieri, Classiques Garnier, 2017). Il a publié plusieurs éditions critiques de pièces de Jean de Rotrou, Sedaine, Alexandre Hardy, Pierre Du Ryer. En 2018, il a notamment dirigé avec Christiane Louette un numéro de revue en ligne sur les commentaires suivis des pièces de Térence rédigés par les humanistes et leur importance sur la pensée et la pratique dramaturgiques, jusque même dans la tragédie classique (Exercices de rhétorique, no 10, 2018).
