Sommaire
Appropriations de Corneille
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
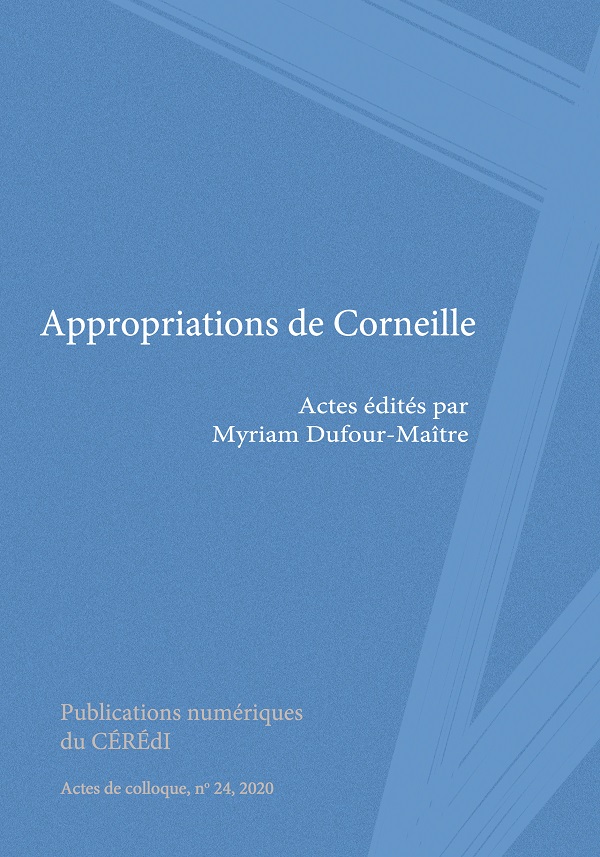
- Myriam Dufour-Maître Remerciements
- Collectif Le Festival Corneille de Barentin (1956-1975) et le Mouvement Corneille
- Myriam Dufour-Maître Introduction
- Sylvain Ledda Polyeucte, ou comment mettre en scène la violence ?
- Hélène Merlin-Kajman Comment déterminer ce qui est « religion » en littérature ? Réflexions à partir du cas de Polyeucte de Corneille
- Liliane Picciola De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
- Jacques Téphany Corneille, l’autre fondateur du TNP
- Roxane Martin Horace à l’épreuve des révolutions : les remaniements du texte et l’édification d’un Corneille patriote (1789-1799 vs 1848)
- Claire Carlin L’Illusion comique sur la scène du monde anglophone, entre traduction et « adaptation libre »
- Cécilia Laurin L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
- Julia Gros de Gasquet Filmer L’Illusion comique, réécrire Corneille ? À propos du film de Mathieu Amalric à la Comédie-Française (2010)
- Noëmie Charrié Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
- Jean-François Lattarico De l’Horace (1641) à l’Orazio (1688). Prémisses de la réforme dans le premier dramma cornélien per musica
- Sarah Nancy Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse
- Mariane Bury Le Corneille des historiens de la littérature au xixe siècle
- Michal Bajer Les contextes de la traduction. L’établissement de la tradition cornélienne en Pologne au tournant romantique : discours critique, pratiques éditoriales, péritextes
- Lise Forment Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
- Bénédicte Louvat « L’invention » du dilemme cornélien
- Jean-Yves Vialleton Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
- Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval Un Corneille à l’usage de la jeunesse au tournant des xviiie et xixe siècles : quelques jalons
- Beate Langenbruch Corneille, auteur de concours
- Hélène Bilis Corneille aux États-Unis, ou quel « auteur classique » pour les campus américains ?
La critique et l’histoire littéraire
Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
Lise Forment
Pourquoi Roland Barthes a-t-il si peu écrit sur Corneille ? Pourquoi semble-t-il avoir hésité à s’approprier ses textes ? Loué l’espace d’une parenthèse pour la place réservée à la Cité dans son théâtre, Corneille apparaît pourtant aux yeux de Barthes comme moins « disponible », moins « transparent » que Racine – peut-être plus dangereux aussi. C’est cette dernière piste que le présent article explore, en confrontant au modèle de la « lecture concernée », variante barthésienne de l’appropriation, le commentaire que l’auteur du Sur Racine aurait pu écrire sur Corneille. Paradoxalement, c’est le caractère inévitablement politique du théâtre cornélien, de sa réception critique et de ses mises en scène dans la « modernité », qui semble avoir entravé chez Barthes toute possibilité d’appropriation filée. Toutefois, sans le faire lui-même, Barthes nous a montré comment parler de Corneille aujourd’hui, comment continuer de le partager tout en conjurant ce péril de l’instrumentalisation politique qui hante toute défense de la critique littéraire comme appropriation ou actualisation.
1Roland Barthes n’a pas écrit d’essai intitulé Sur Corneille, et très peu écrit, plus généralement, sur Le Cid, Cinna ou les autres pièces pourtant souvent jouées et commentées dans les années 1950 et 1960. Le fer de lance de la Nouvelle Critique, qui commente Racine, mais avoue qu’il ne l’« aime pas1 », n’est pas, bien évidemment, dix-septiémiste ; il ne fait pas même profession de critique littéraire, puisque sa démarche est bien plus éclectique et ses objets de réflexion, bien plus hétéroclites. Malgré tout, la quasi-absence de Corneille dans ses écrits étonne : Barthes semble l’oublier, il semble même refuser de se l’approprier, alors qu’il consacre plusieurs textes aux auteurs canoniques du xviie siècle – on peut lire de lui le fameux essai Sur Racine, mais aussi deux préfaces consacrées à La Rochefoucauld et à La Bruyère, des comptes rendus de représentations dédiés à Molière, un court texte sur La Fontaine et quelques considérations sur Bossuet dans « Le discours de l’histoire2 ».
2Pourquoi un tel silence critique sur Corneille ? Bernard Dort et Serge Doubrovsky lui auraient-ils coupé l’herbe sous le pied ? Dans les années cinquante, Barthes s’est passionné pour l’entreprise du TNP et a commenté pour la revue Théâtre populaire les mises en scène de plusieurs grands classiques à Chaillot ou à Avignon. Toutefois, alors qu’il consacre de nombreux articles à des représentations de Sophocle, Eschyle, Molière, Racine, Marivaux, et d’autres encore, il ne mentionne qu’en passant les mises en scène par Jean Vilar du Cid et de Cinna. Et c’est Bernard Dort qui fait paraître en 1957 un essai très stimulant en partie issu, de son propre aveu, de ces « mémorables représentations3 » : Corneille dramaturge. Plus tard, en 1963 et 1966, le tonitruant diptyque de Serge Doubrovsky, composé de sa thèse sur Corneille et la dialectique du héros et d’une réplique à Raymond Picard (Pourquoi la Nouvelle Critique. Critique et objectivité), vient redoubler, dans la « querelle de la Nouvelle Critique », l’ensemble formé par Sur Racine et Critique et vérité. On pourrait encore citer L’Œil vivant de Jean Starobinski, qui paraît en 1961 et dont le premier chapitre s’intitule « Sur Corneille ». Tout était-il alors dit, et Barthes venait-il trop tard ?
3Peut-être est-il vain de chercher d’autres raisons au silence de Barthes que cette bibliographie déjà foisonnante – et ce, d’autant plus que les propositions sur Corneille formulées par Dort, Starobinski et Doubrovsky s’accordent assez bien, à première vue, avec la démarche critique prônée par Barthes dans l’avant-propos du Sur Racine, démarche résolument tournée vers le présent et l’avenir, distincte des méthodes historiennes d’alors. Mais j’aimerais déployer ici une autre hypothèse que celle du « Tout est dit ». Quoique relue et commentée à nouveaux frais par les nouvelles critiques, l’œuvre de Corneille ne serait-elle pas apparue, aux yeux de Barthes, comme moins disponible, comme moins transparente, que les tragédies raciniennes ? Barthes n’aurait-il pas jugé impossible d’« essay[er] » sur Corneille « tous les langages que notre siècle nous suggère4 » ? N’aurait-il pas jugé trop périlleux de pratiquer sur lui cette « lecture concernée » qui suscite habituellement son « plaisir aux classiques » ?
4Pour répondre à cette question, je proposerai d’abord une définition de la « lecture concernée » dont use Barthes, en la situant par rapport à la problématique qui nous réunit ici : celle de l’appropriation. Je dresserai ensuite un rapide tableau résumant les rares occurrences du « nom Corneille » chez Barthes pour les confronter à ce modèle critique : sous quelles formes la référence à Corneille se décline-t-elle ? Quels qualificatifs – « classique », « baroque », « précieux » – et quelles valeurs lui sont-ils attachés ? Dans quels contextes et pour quels usages le nom de Corneille est-il sollicité ? Je tenterai de suivre, au fil des occurrences, les traces de ce qu’aurait pu être une « lecture concernée » de Corneille par Barthes, je remonterai la piste de ce commentaire fantôme. Je m’attacherai enfin, plus précisément, à l’analyse d’une tension particulière dans la lecture – ou non-lecture – de Corneille par Barthes, liée au sens politique de son théâtre.
Appropriation et altération : le choix d’une « lecture concernée » des classiques
5L’expression même de « lecture concernée » apparaît tardivement dans l’œuvre critique de Barthes, dans une conférence consacrée au cycle romanesque proustien, À la Recherche du temps perdu. Barthes écrit : « Il faudrait […] reconnaître que l’œuvre émeut, vit, germe, à travers une espèce de “délabrement” qui ne laisse debout que certains moments, lesquels en sont à proprement parler les sommets, la lecture vivante, concernée, ne suivant en quelque sorte qu’une ligne de crête5 ». Mais la défense d’une pratique critique qui, sans scrupules, choisirait de suivre dans l’œuvre commentée « une ligne de crête » particulière, la défense d’une pratique critique qui irait jusqu’à « reconnaître le pathos comme force de lecture6 », pour reprendre une autre expression de ce même texte – cette défense du « concernement » se dessine bien plus tôt, dès les premiers livres et articles de Barthes. Et elle est étroitement liée à la lecture des auteurs du xviie siècle.
6On connaît bien l’avant-propos du Sur Racine où Barthes définit dans un même mouvement la littérature et la critique littéraire : « à la fois sens posé et sens déçu », « l’être même de la littérature » résiderait dans sa « disponibilité qui lui permet de se maintenir éternellement dans le champ de n’importe quel langage critique ». Face au « principe allusif de la littérature », face à l’« interrogation indirecte » que l’écrivain a « dispos[ée] » dans l’œuvre, le commentateur a pour fonction et pour « responsabilité » de répondre « assertivement », quoiqu’éphémèrement, au « suspens » du texte, en « apportant son histoire, son langage, sa liberté7 ». Si transhistoricité de la littérature il y a, si les textes peuvent traverser les siècles et rester disponibles, ce n’est donc pas, selon Barthes, par la qualité d’éternité ou d’universalité du chef-d’œuvre ; c’est plutôt le fait de ce tremblement du sens et de la variabilité historique propre aux phénomènes de réception.
7La tâche de la critique littéraire ainsi circonscrite semble bien relever d’une appropriation, puisqu’une telle définition balaye l’idée d’une « vérité » de l’œuvre et le « mythe de la retrouvaille critique8 » qui lui est souvent associé. Barthes moque souvent cette tendance essentialiste et revendique le droit d’appliquer des concepts de la modernité aux textes anciens. Il défend avec force la productivité herméneutique d’un regard critique non historien, qui permettrait de « parler à neuf9 » des classiques en se fondant sur la reconnaissance de quelques « points de concernement », actualisables pour lui-même et pour ses lecteurs.
8Plus largement, le « plaisir » que prend Barthes à la lecture des classiques a tout à voir avec un geste d’appropriation. Il l’évoque bien avant Sur Racine, dès 1944, dans un texte de jeunesse dont le titre, « Plaisir aux Classiques », fait justement écho au livre de Jean Schlumberger dédié à Corneille et paru en 1936 : Plaisir à Corneille10. Si Barthes, dans cet article, fait l’éloge des classiques, c’est d’abord parce qu’ils nous concernent encore et qu’on peut « les lire dans un dessein tout personnel11 ». Il explique :
Je vais chercher, sous la généralité de leur art, la flèche qu’à travers les siècles ils m’ont décochée. […] Rien ne m’interdit de penser que cette sentence de La Bruyère, que ce vers de Racine ont été écrits pour doubler très exactement mon amertume ou ma passion actuelles. À travers l’équivoque d’une forme très générale qui recouvre du très précis, il s’établit entre l’écrivain et moi une sorte de complicité flatteuse ; je me sens choisi ; l’artiste me découvre ; il me chante, il chante ma peine, ma joie, ma curiosité ; il la chante bien ; il en a tout vu, et d’autres choses encore que je ne voyais ni ne sentais. Écho d’un Narcisse qui ne sait pas parler, c’est mon double inspiré ; sa confidence m’illumine […]. Plus le lecteur aura de passion, plus il se retrouvera dans les Classiques. Il ne pourra en lire une page sans y reconnaître quelque chose de lui-même, et bien que la parenté proposée par les Classiques soit entre leurs créatures et nous plutôt qu’entre nous et eux, je ne vois que des lecteurs sans cœur et sans imagination pour rester froids devant ce pur miroir enflammé par nous-mêmes12.
9Cet extrait mériterait d’être plus longuement commenté mais je me contenterai, ici, de souligner à la fois sa proximité avec l’avant-propos du Sur Racine, et l’écart qui apparaît immédiatement entre deux modalités possibles de l’appropriation. L’« art de la disponibilité » souligné chez Racine est déjà présent dans ce texte : l’image de la flèche décochée fait écho à la définition de la littérature comme « être trans-historique ». Cependant, le lecteur, dépeint en 1944 comme « un Narcisse qui ne sait pas parler », devient tout autre lorsqu’il se fait commentateur en 1963 : dans Sur Racine, le critique ressemble plutôt à la figure du « héros dogmatique », dont il est par ailleurs question dans l’essai13.
10Dépassant le cadre initial de la lecture naïve pour devenir le principe même du commentaire critique, l’appropriation serait alors, nécessairement, synonyme d’altération. Il s’agit, pour Barthes, de lire et de commenter les classiques « de notre point de vue moderne14 », comme il l’écrit dans son texte sur La Rochefoucauld. Si Racine l’intéresse, c’est parce qu’on peut « essay[er] sur [lui], en vertu de son silence même, tous les langages que notre siècle nous suggère15 », notamment l’anthropologie de Lévi-Strauss et la psychanalyse de Freud. La préface qu’il donne aux Caractères vise à montrer, contre toute attente, que La Bruyère serait en réalité le premier écrivain de la modernité – le premier écrivain à mettre en œuvre l’indirect de la littérature16 ; et la préface aux Maximes de La Rochefoucauld se conclut sur l’affirmation que leur projet est toujours d’actualité17. La légitimité de telles appropriations peut dès lors être remise en cause, le terme même d’appropriation laissant toujours entendre une réduction de l’autre à soi, une négation de l’altérité du texte commenté au profit de l’autorité du commentaire et du commentateur. Comme le précisait l’argumentaire du colloque, ces gestes critiques « qui font entrer les œuvres dans un cadre d’analyse » sont toujours susceptibles – et soupçonnés – d’« aller jusqu’à l’annexion ou l’instrumentalisation ».
11Toutefois le rapport que Barthes établit avec les textes classiques complexifie fortement la notion d’appropriation en la dialectisant, et peut échapper, me semble-t-il, aux procès intentés à ce type de « lectures intéressées » ou « concernées », souvent accusées de multiplier les contresens. La démarche critique de Barthes face aux classiques repose en fait sur une tension toujours maintenue entre plaisir de la reconnaissance et goût de l’altérité, mouvement d’identification et mouvement de distanciation, actualisation et historicisation. Ce choix d’une appropriation dialectisée est explicite dans ses essais critiques. Dans Sur Racine, Barthes écrit par exemple que le dramaturge « nous concerne bien plus et bien mieux par son étrangeté que par sa familiarité : son rapport à nous, c’est sa distance. Si nous voulons garder Racine, éloignons-le18 ». Dans la préface aux Caractères de La Bruyère, Barthes distingue également entre deux lectures possibles :
On peut certes lire La Bruyère dans un esprit de confirmation, y cherchant et chassant, comme dans tout moraliste, la maxime qui rendra compte sous une forme parfaite, de cette blessure que nous venons de recevoir des hommes ; on peut aussi le lire en marquant tout ce qui sépare son monde du nôtre et tout ce que cette distance nous apprend sur nous-mêmes ; c’est ce qu’on fera ici : discutons de lui tout ce qui nous concerne mal : nous recueillerons peut-être alors enfin le sens moderne de son œuvre19.
12Et ce choix d’une appropriation dialectisée apparaît encore plus nettement dans les comptes rendus que Barthes dédie aux mises en scène des classiques, aux représentations de ce « répertoire de haute culture » placé au cœur du théâtre populaire dont il rêve.
13On sait que le TNP de Jean Vilar a incarné pour lui ce programme civique – au moins pour un temps –, et que Corneille, comme le rappelle Jacques Téphany dans ce volume, en était justement l’un des pivots. Cependant le spectacle que Barthes constitue en modèle de la bonne distance à trouver avec le classique, n’est pas la célèbre mise en scène du Cid ou celle de Cinna ; c’est plutôt la « régie » de Dom Juan20. En montant la pièce de Molière, Vilar est parvenu, selon Barthes, à mettre en scène un athée qui « nous concerne », qui « nous aspire dans sa modernité21 », plutôt qu’un athée de « musée22 » ou de « reconstitution archéologique23 ». Mais il ne faut pas s’y tromper : il n’y a pas là un simple éloge de l’anachronisme ou de l’actualisation. Barthes loue au contraire le vieillissement, l’« épaisseur d’histoire24 », la « profondeur sadienne25 » qu’a su donner le metteur en scène à la pièce, en convoquant « un athéisme gros d’hérédités postérieures à Molière26 », en composant un Don Juan « gros de toute l’histoire de son public27 ». Barthes distingue ainsi deux types d’historicisation, en opposant le geste théâtral de Vilar aux mises en scène de la Comédie-Française et au « postulat scolaire28 » qui prétend que « l’athéisme de Dom Juan est purement historique, inspiré de l’athéisme des grands libertins du xviie siècle29. » Sous prétexte d’historiciser le protagoniste de Dom Juan, le théâtre bourgeois et la critique universitaire contextualisante tendraient à le renvoyer « dans les limbes de l’anecdote locale30 », « à édulcorer [son] athéisme31 » et « à émasculer la pièce32 ». Au contraire, la mise en scène de Vilar, en superposant les strates temporelles, rendrait tout son tranchant à Dom Juan, et inviterait les spectateurs à réfléchir aux conséquences de leur propre liberté33.
14S’il y a bien appropriation de la pièce de Molière dans le spectacle de Vilar, l’effort réclamé par Barthes au metteur en scène (et au critique littéraire) est donc double : c’est à la fois un geste d’actualisation et d’historicisation. L’appropriation ainsi dialectisée est alors fondée à la fois sur des coups de force anachroniques et sur une attention concomitante et plus inattendue à l’historicité des œuvres et de leur réception. Sur scène, comme en matière de commentaire, Barthes s’oppose autant aux contextualisations ou « reconstitutions archéologiques », qu’aux actualisations naïves de « chefs-d’œuvre » réputés intemporels : car, ces dernières, inattentives à l’Histoire, font paradoxalement manquer l’actualité politique des œuvres classiques34.
15Mais venons-en (enfin !) à Corneille. Même si Barthes n’a pas écrit d’essai Sur Corneille, peut-on retrouver dans l’ensemble de son œuvre critique les indices d’un traitement comparable aux propos de Barthes sur Racine, sur les moralistes ou sur Dom Juan ? Quelles modalités d’appropriation sont réservées au « nom Corneille » et aux textes du dramaturge ? La possibilité d’une appropriation dialectisée s’ouvre-t-elle dans le jeu des occurrences éparses ?
Sur Corneille : à la recherche du commentaire perdu
16Les références à Corneille, si elles sont assez peu nombreuses, ne sont pas absentes de l’œuvre de Barthes. Si l’on en croit les différents index fournis par Éric Marty et par les éditeurs des cours et séminaires, Corneille, soit par son nom soit via l’une de ses œuvres, est mentionné dans quinze articles ou livres rassemblés dans les Œuvres complètes, ainsi que dans deux cours donnés au Collège de France : Comment vivre ensemble et Le Neutre. Si l’amenuisement des références est frappant (présent dans neuf textes du premier tome édité par Éric Marty, seule une occurrence apparaît dans le dernier), il n’est pas propre à Corneille : d’autres classiques, comme Racine et Molière, connaissent le même sort.
17Quatre modalités de présence se dégagent principalement de ce petit corpus. Premièrement, le « nom Corneille » joue un rôle certain dans la dramaturgie historique de Barthes exposée dès Le Degré zéro de l’écriture (1953) et reprise notamment dans « Réflexions sur un manuel » (1971). Dans les deux cas, Barthes, en bon moderne, s’en prend au triomphe de l’écriture « classico-bourgeoise », en attaquant à la fois la littérature française passée (le moment 1650-1850) et son enseignement actuel. Mais la place de Corneille est mouvante. Alors que dans Le Degré zéro de l’écriture, Corneille semble échapper à la condamnation barthésienne, inversement, il est présenté comme l’une des figures majeures du « classico-centrisme » dénoncé dans « Réflexions sur un manuel ». D’abord rattachée au moment de « la Littérature préclassique », qualifiée tour à tour de « précieuse » ou de « baroque », et louée par Barthes pour son « foisonnement », son « euphorie » et sa « liberté35 », l’écriture cornélienne ne suffit pas à éviter l’annexion de la figure Corneille à « l’inventaire des portraits36 » qui ornent la salle Louis-Liard et qui révèlent, selon Barthes, la soumission des classiques à la monarchie absolue, autant que l’attrait exercé par les régimes autoritaires chez quelques contemporains nostalgiques. Il explique en effet qu’on trouve sur les murs de la Sorbonne « les divinités qui président au savoir français dans son ensemble : Corneille, Molière, Pascal, Bossuet, Descartes, Racine sous la protection – cela, c’est un aveu – de Richelieu37 ». Cette « guirlande » qui « a bordé la trame de nos études », Barthes la trouve « un peu rêche38 », mais elle ne l’a pas empêché, pour autant, de s’emparer de Racine ou des moralistes pour les actualiser. Que fait-il donc de Corneille ? Se donne-t-il également pour tâche, même éphémèrement, de contester la mythologie scolaire qui lui est attachée ?
18Une première piste d’appropriation apparaît dans « Plaisir aux Classiques ». Il s’agirait d’explorer sa « délicieuse impossibilité » : « Voici Corneille, s’épuisant à vaincre les désordres du cœur et faisant naître de cet effort une encore plus monstrueuse passion (qui est de n’en avoir jamais39). » Corneille aura sa place dans les Fragments d’un discours amoureux – j’y reviendrai –, mais on reconnaît là, avant tout, la trace des débats qui ont animé la critique cornélienne, de Gustave Lanson à Paul Bénichou en passant par Octave Nadal, sur les rapports entre nature et volonté, passion et raison40. Or, plutôt que ces débats universitaires, « Plaisir aux Classiques » met en avant « les duos qui s’engagent de siècle en siècle, entre écrivains de même classe » et conseille de prendre pour intercesseurs des Classiques « quelques grands écrivains modernes » qui les ont lus : « Sévigné, La Bruyère et Saint-Simon ont été lus, aimés et cités par Proust ; Montesquieu, Montaigne et Rousseau, par Gide ; Descartes, La Fontaine et Bossuet, par Valéry ; les auteurs jansénistes par Montherlant41 ». L’absence de Corneille est notable et suggère l’hypothèse suivante : sans intercesseur moderne, aucun désir d’appropriation ne pourrait naître chez Barthes, aucun « point de concernement » ne se ferait jour42.
19La seconde piste, très vite abandonnée, concerne ce Corneille précieux ou baroque mentionné dans Le Degré zéro de l’écriture. En réalité, Barthes ne s’est guère intéressé à la mode du baroque et n’a que rarement utilisé cette catégorie pour contrer la mythologie du classicisme. Corneille a donc peut-être fait les frais de ce désintérêt, quand Racine, pensé comme « le classique des classiques » se prêtait davantage aux jeux de la sémioclastie.
20Les deux modalités de présence suivantes sont liées à ces deux possibilités d’appropriation manquées : il s’agit, d’une part, du recours à la citation et, d’autre part, de la reprise du fameux parallèle entre Racine et Corneille. L’usage de la citation renvoie à la possibilité d’appropriation esquissée dans « Plaisir aux Classiques », celle du dialogue entre classicisme et modernité. Barthes se fait alors lui-même intercesseur, livrant au lecteur le texte cornélien, avec ou sans commentaire. C’est d’abord sans aucune exégèse que les vers cornéliens apparaissent chez Barthes, dans l’anthologie clôturant l’article de 1944 et comptant trois extraits de Corneille. La première citation est extraite du Cid43, la deuxième, de L’Imitation de Jésus Christ44, et la troisième, de Médée : « Dans un si grand revers, que vous reste-t-il ? / – Moi45 ».
21Barthes explique sa démarche dans un court paragraphe précédent l’anthologie :
Rien n’est plus contraire à l’honnêteté que l’habitude des citations et des anthologies, mais rien ne dit qu’il faille toujours être honnête, et l’on peut présenter quelques fragments de textes classiques comme ces friandises multiples qui précèdent les repas des Mille et Une Nuits, et où l’on puise au hasard pour se donner faim46.
22Les citations sont données « sans ordre, sans explication », précise-t-il ; rien d’autre ne préside à leur sélection que le « plaisir » et « l’intérêt » de « celui qui les propose47 ». Mais dans une parenthèse concluant l’anthologie, il rajoutera à ces deux termes un troisième critère pour motiver son recueil : le « courage » qui, par le biais de ces morceaux choisis, peut être donné au lecteur. En effet, de citation en citation, un réseau de termes se tisse en réalité autour du champ de la liberté, de la lâcheté, de la servitude, de la mort et de la guerre. En avril 1944, alors que la France est encore occupée et que Barthes est en cure au sanatorium, Corneille et les autres Classiques se voient dotés d’un « pouvoir explosif48 » de résistance : l’auteur du Cid49 a une fonction à la fois thérapeutique et politique face aux traumatismes de la maladie et de la guerre50. Il n’est donc pas anodin que l’article se termine par cette citation de Médée, par ce Moi solitaire, qui se dresse face à « un si grand revers », et qui constitue peut-être la formule la plus nette de l’appropriation de Corneille par Barthes. Car on retrouve encore cette citation dans Comment vivre ensemble où le Moi de Médée, l’affirmation de son « ultime différence », est associé par Barthes à la claustration de la Séquestrée de Poitiers chez Gide51.
23Deux autres citations commentées apparaissent, l’une dans Sade, Fourier, Loyola, l’autre dans Fragments d’un discours amoureux, et reposent à chaque fois sur une association d’idées quelque peu irrévérencieuse. Dans le triptyque de 1971, Barthes associe la rhétorique des personnages sadiens au langage des héros cornéliens. La section intitulée « La frappe » lie en effet rhétorique et désir, frappe et jouissance :
Le langage de la débauche est souvent frappé. C’est un langage césarien, cornélien : « Mon ami, dis-je au jeune homme, vous voyez tout ce que j’ai fait pour vous ; il est bien temps de m’en récompenser. – Qu’exigez-vous ? – Votre cul. – Mon cul ? – Vous ne posséderez pas Euphrémie que je n’aie obtenu ma demande. » On croit entendre le vieil Horace : « Que vouliez-vous qu’il fît contre trois ? – Qu’il mourût52. »
24Dans les Fragments d’un discours amoureux, une citation de Corneille apparaît en pied de page selon un appareillage complexe, puisqu’elle est en fait extraite du Littré, citant d’abord Montaigne :
Littré : Montaigne parle de la fruition de la vie. Et Corneille : « Et sans s’immoler chaque jour / On ne conserve point l’union fruitive / Que donne le parfait amour53. »
25La citation se trouve détachée de son contexte initial, puissamment érotisée par sa nouvelle insertion. Elle apparaît en effet dans le fragment « Union » (« Union. Rêve d’union totale avec l’être aimé »), en regard du passage suivant : « […] je rêve que nous jouissons l’un de l’autre selon une appropriation absolue54 ; c’est l’union fruitive, la fruition de l’amour (ce mot est pédant ? Avec son frottis initial et son ruissellement de voyelles aiguës, la jouissance dont il parle s’augmente d’une volupté orale ; le disant, je jouis de cette union dans la bouche55.) » L’appropriation du texte de Corneille par Barthes paraît alors aussi « absolue » que cette « union fruitive » dont il parle56.
26La troisième modalité de présence réside sans surprise dans l’usage fréquent du parallèle avec Racine. Quatre des six références à Corneille dans Sur Racine relèvent de cette comparaison topique entre les deux dramaturges. Les parallèles dressés par Barthes sont souvent très allusifs, mais tous soulignent la présence du monde comme valeur chez Corneille. Je ne citerai qu’un exemple :
Pour mesurer la solitude du couple racinien, il suffit de penser à Corneille (pour reprendre un parallèle inépuisable) ; chez Corneille, le monde (au sens d’une réalité plus large et plus diffuse que la société), le monde entoure le couple d’une façon vivante : il est obstacle ou récompense, bref il est valeur. Chez Racine, la relation est sans écho, elle s’établit dans l’artifice d’une pure indépendance : elle est mate ; chacun n’est concerné que par l’autre – c’est-à-dire par lui57.
27L’analyse rappelle le projet critique de Corneille dramaturge qui insistait sur la signification historique et politique du théâtre cornélien. Bernard Dort y soulignait pareillement l’importance du monde, qu’avait minorée, selon lui, le mythe du héros dans la critique ; et il accordait au « trop classique parallèle Corneille-Racine » cette « utilité » : « disons que, si Racine peint les êtres tels qu’ils s’arrachent au monde alors que, comme l’écrit Goldmann, “toute solution intra-mondaine leur est interdite”, Corneille peint, lui, les êtres tels qu’ils sont dans et par le monde (même si c’est contre lui58). » Aussi est-il probable qu’aux yeux de Barthes, le théâtre cornélien se prêtait mal à une « analyse volontairement close sur elle-même59 » à la manière du Sur Racine. La présence du « monde » chez Corneille ne réclamait pas la reconstitution d’une « anthropologie […] à la fois structurale et analytique60 », elle motivait plutôt une lecture historique renouvelée – une lecture semblable à celle de Bernard Dort et proche de ce qu’avait déjà fait Goldmann avec Racine.
28Dans l’œuvre de Barthes, la quatrième (et dernière) modalité de présence de Corneille est étroitement liée à cette importance du monde dans son théâtre. Ne sont plus simplement concernés le « nom Corneille » ou les vers cornéliens, mais l’un des usages possibles du texte – son premier usage : le spectacle. À deux reprises, dans les articles intitulés « Pour une définition du théâtre populaire » et « Le théâtre populaire aujourd’hui », Barthes place Corneille en tête d’une liste de dramaturges composant, selon lui, le « répertoire de haute culture » : « le théâtre où personne ne s’ennuie, de quelque condition qu’il vienne, c’est le théâtre de Corneille, de Molière, de Shakespeare ou de Kleist61 », écrit-il dans le premier texte. Corneille a donc une place de choix dans le programme que Barthes assigne au théâtre populaire et qui repose sur « trois obligations concurrentes […] : un public de masse, un répertoire de haute culture, une dramaturgie d’avant-garde62. » Comme je l’ai dit en introduction, Barthes ne consacre spécifiquement aucun texte aux mises en scène de Corneille mais plusieurs allusions au Cid et au Cinna montés par Vilar apparaissent dans les comptes rendus d’autres représentations du TNP. Cinna est critiqué dans un éditorial non signé de Théâtre populaire, mais attribué à Barthes63. En revanche, la mise en scène du Cid est louée dans les textes sur Le Prince de Hombourg64 et Richard II65.
29Mais la référence à Corneille la plus signifiante se trouve dans « Pouvoirs de la tragédie antique », où Barthes accorde au dramaturge un statut d’exception dans la production théâtrale française. Dans ce texte, Barthes cherche à caractériser la tragédie antique et la distingue de ses formes plus modernes, en insistant sur la « grande idée civique » qui la porte. Il commente notamment « la fonction essentielle du chœur antique » tuée par notre conception psychologique du théâtre. Or le nom de Corneille apparaît alors dans une parenthèse qui laisse entrevoir de possibles fondements pour notre commentaire fantôme :
Le public antique, dont le chœur n’était qu’une sorte de prolongement spatial, plongeait lui-même dans l’acte tragique, il l’imprégnait de son commentaire, et recevait chacun de ses à-coups au creux même de son intellection ; la tragédie irradiait vers tous les gradins, et par un mouvement inverse, la collectivité mêlait sa parole explicatrice, comme un don solennellement humain, au procès de l’argument tragique, on sait qu’à l’opposé, notre théâtre de boulevard n’est plus collectivité, mais collection de voyeurs. Il est à peine nécessaire de faire remarquer qu’à ce prix le théâtre perd toute dimension civique. La Cité est presque toujours absente de notre scène (sauf peut-être chez Corneille66) […], le théâtre a dévié de sa fonction tragique, par la fausse tragédie du xviie siècle ; l’essentialisme classique a substitué un théâtre de types à une dramaturgie des grandes idées morales, qui seules peuvent s’imposer avec passion à l’intelligence d’une collectivité, et jusqu’à ce jour, aucune révolution, surtout pas la romantique, n’est venue troubler la fausse universalité du théâtre psychologique, et n’a fait surgir le chœur du théâtre populaire de sa tombe trop bien fermée67.
30Dès cet article de 1953, Barthes reconnaît donc la présence d’une « grande idée civique » chez Corneille, « pouvoir de la tragédie antique » qui fait cruellement défaut, selon lui, au théâtre français et à la tragédie racinienne en particulier, jugée trop psychologique. Cette « grande idée civique », que Barthes repère et loue chez Eschyle et Sophocle, hante tous ses écrits sur le théâtre. C’est elle assurément qui motive la plupart des louanges qu’il adresse à Vilar et qui suscite son enthousiasme pour le théâtre politique de Brecht. L’importance de la Cité dans les tragédies cornéliennes, les rapports entre le héros et le monde si l’on reprend plutôt les termes de Dort, la présence continue et évolutive de la question politique au fil des pièces, semblaient donc aptes à déclencher chez Barthes le désir d’une « lecture concernée » de Corneille. On sait quel succès a rencontré Jean Vilar auprès du public des années cinquante en mobilisant un « Corneille héroïque figurant la résistance68 », un « Corneille, politique, complexe, pré-brechtien69 » : telle était la voie critique que Barthes aurait pu exploiter à son tour.
31Mais l’ébauche de « lecture concernée » n’a pas dépassé le cadre de cette parenthèse. Car c’est peut-être ce caractère inévitablement politique des drames cornéliens, de leur réception critique et de leurs adaptations scéniques dans la « modernité », qui a entravé chez Barthes toute possibilité d’appropriation filée. C’est l’hypothèse que j’émettrai pour terminer.
Corneille politique : défaut d’appropriation, appropriation en défaut ?
32Il était sans doute plus aisé d’arracher Racine à ses thuriféraires que d’adopter la bonne distance pour commenter Corneille. Dans les premières décennies du xxe siècle, Racine, comme Corneille, avait été annexé par l’extrême-droite maurrassienne, mais Gide, Valéry et les tenants du classicisme moderne avaient déjà œuvré, à leur manière, contre son instrumentalisation politique. Peut-être que Corneille, au contraire, paraissait à Barthes irréversiblement pris dans les affrontements idéologiques. Entre autres commentateurs, Christian Biet a rappelé les différentes étapes de formation du « national-classicisme » cornélien, en s’attachant tout particulièrement au Corneille de 1938-1944. Il a analysé comment la critique nationaliste a phagocyté Corneille, de Paul Déroulède et Auguste Dorchain à Robert Brasillach et André Delacour70. Les deux premiers ont fait de Corneille une icône nationale, un guide des valeurs françaises, un lieu de mémoire patriotique ; les deux derniers ont reconnu dans les héros cornéliens tour à tour un modèle fasciste (en particulier chez Horace) et une figure vichyste.
33Or, nul doute que cet écho d’un Corneille crypto-fasciste résonne encore aux oreilles de Barthes – d’où cette manière d’orthographier « résons » dans mon titre. Comme l’a rappelé Philippe Roger dans « Barthes post-classique », l’auteur du Sur Racine est « né assez tôt (1915) pour avoir vu les classiques enrôlés, dans les années 1930, sous la bannière du nationalisme intégral ou du fascisme à la française. »
Le lycéen de Louis-le-Grand peu politisé, mais révulsé par les progrès des ligues et de l’antisémitisme, n’oubliera pas qu’à l’heure où les Camelots du Roi et les Jeunesses Patriotes tiennent le haut du pavé au Quartier Latin71, les prestigieuses pages littéraires de l’Action Française multiplient les péans aux classiques72.
34Bien plus tard, au moment de la parution des Mémoires de Guerre du général de Gaulle, Barthes s’en prendra à la presse de l’époque et à l’éloge quasi unanime que le livre reçoit. Il associera la naïveté des critiques au vieux rêve qui anime l’élite française d’avoir « un écrivain au pouvoir », et au castillanisme « qui ne cesse de hanter notre littérature, de Corneille à Montherlant73 » : l’un et l’autre tendraient à masquer le « danger fasciste » attaché au pouvoir gaulliste.
35Le silence de Barthes sur Corneille résulte donc sans doute d’un embarras face à cette saturation des interprétations et des instrumentalisations nationalistes. Racine avait été tout aussi soigneusement enrôlé par l’extrême-droite, mais la nature directement politique du théâtre cornélien le rendait plus vulnérable face aux soupçons : peut-être même que l’auteur du Cid et d’Horace n’était pas jugé tout à fait innocent des lectures que les fascistes en faisaient. Je crois toutefois qu’on peut aller encore au-delà de cette méfiance idéologique.
36En effet, au vu de sa propre conception de la critique littéraire, fondée sur cette appropriation dialectisée que j’ai rappelée au début de cet article, Barthes avait-il les moyens de montrer que les tragédies politiques de Corneille étaient toujours d’actualité, sans toutefois apporter son crédit – même indirect – aux appropriations nationalistes ? Pouvait-il défendre l’idée que cette « grande idée civique » concernait ses contemporains, sans laisser le champ libre aux interprétations d’un Brasillach, par exemple74 ?
37Il peut sembler saugrenu de mettre en regard l’introduction du Corneille de Brasillach avec les principes de la « lecture concernée » barthésienne tels qu’on a pu les repérer à la fois dans l’avant-propos du Sur Racine, dans « Plaisir aux Classiques » ou dans les comptes rendus rédigés pour Théâtre populaire. Mais la confrontation est assez fascinante et dérangeante, tant elle donne l’impression que Barthes ne pourrait renier la paternité d’un tel texte. Le ton de Brasillach est sans doute plus potache que ne l’est la prose barthésienne, mais l’impulsion critique à l’œuvre n’est pas complètement étrangère aux modalités d’appropriation favorisées par Barthes :
[quand on joue une pièce de théâtre] toujours de la même manière, quand seuls les professeurs et les comédiens d’État en prennent soin, quand on la respecte, quand on y mène dans la province les longues théories de pensionnaires en pèlerines bleues et de jeunes filles externes en robes roses […], alors, plaignez-la, c’est une pièce morte.
Pendant des années, pendant plus d’un siècle à vrai dire, on a pu croire que Pierre Corneille avait empli à lui seul le plus abondant cimetière de pièces mortes qu’on puisse imaginer. […] une fois l’enfance et l’adolescence oubliées, une fois passé ce dernier sacrement du baccalauréat qui est pour tant de Français comme l’extrême-onction de la culture bourgeoise, plus personne ne se souciait de Pierre Corneille. […] Alors que de décade en décade notre compréhension de Racine s’affine et se renouvelle, […] Pierre Corneille en reste toujours à la même image figée. L’honneur et le devoir, certaine phrase de La Bruyère que tout Français vacciné et diplômé a expliquée au moins une fois, et la clémence qui l’emporte sur la passion, et l’amour de la patrie sur celui de la famille, et l’amour de Dieu sur tous les autres, donnent à son œuvre une apparence de cours de stratégie, mécanique et morale, aussi passionnante en vérité que les règles du jeu de dominos ou le manuel de sous-officier d’infanterie. […] chacun de nous ne devrait-il pas, pour son usage personnel, essayer de procéder, comme on le fait pour les tableaux anciens, à un nettoyage vigoureux de ce portrait inconscient que nous nous sommes donné (ou que l’on nous a donné) du fondateur de notre théâtre […] ? C’est ce que, pour notre part, nous voudrions essayer de faire75.
38Attaque contre les mises en scène trop stéréotypées, règlement de compte avec l’institution scolaire, raillerie à l’égard de la mythologique critique sur Corneille, volonté de dépoussiérer tout cela « pour son usage personnel » : les similitudes avec le programme barthésien sont frappantes.
39On m’opposera la divergence des intentions : pas question pour Barthes, bien évidemment, de célébrer le fascisme de Corneille. Mais que pourrait-il opposer au programme de Brasillach, si ce n’est la tentative d’édifier une appropriation contre une autre, en privilégiant par exemple un fil conducteur démocratique dans la lecture de Corneille ? La « lecture concernée » de Barthes repose sur un usage intéressé et anachronique des textes comparable aux moyens que Brasillach emploie pour annexer Corneille. Autant il était opportun pour Barthes de contester l’essentialisme de la critique racinienne en demandant « pourquoi parler de Racine aujourd’hui ? », autant la critique cornélienne avait déjà fait le choix du pragmatisme, s’appuyant sur l’actualité, la quasi-contemporanéité des questions politiques posées par Cinna, Horace, Sophonisbe et les autres76.
40Que reste-t-il alors de la pertinence de la « lecture concernée », puisqu’elle ne peut invalider les appropriations nationalistes, puisqu’elle ne peut invoquer une vérité ou un sens droit du texte ? Il demeure, je crois, l’attention à un troisième terme, qui me paraît la plus à même de conjurer ce risque du silence critique : plutôt que de limiter la question de l’appropriation au couple formé par le commentateur et son texte, on peut envisager une relation à trois termes, comme le suggère quelquefois Roland Barthes, dans Critique et Vérité notamment. De la même façon que le spectateur était placé au centre des préoccupations dans les comptes rendus dédiés par Barthes à Vilar, à Barrault et aux autres, on peut distinguer, dans la critique littéraire, entre différents rapports visés par le commentateur avec son public de lecteurs : si le Sur Racine de Barthes « drague » son lecteur et cherche sans doute à le ravir, la brutalité du rapt imposé par le Corneille de Brasillach à celui qui le lit est tout autre. Certes, la séduction qu’exerce la rhétorique de Barthes sur ses lecteurs implique le recours à des stratagèmes, une série de manipulations (pointées par ses adversaires dans la fameuse querelle), voire un désir de possession : le lecteur séduit serait comme charmé et possédé, dépossédé de lui-même… On retient souvent la condamnation par « l’Ancienne critique » de la violence faite aux textes raciniens sauvagement mis en système, mais Raymond Picard, dans Nouvelle critique ou Nouvelle imposture, s’en prenait aussi au jargon du Sur Racine, qu’il soupçonnait de résonner aux oreilles d’un public non averti comme le chant pernicieux des Sirènes :
Le savoir-faire évident de son auteur, son imagination intellectuelle, sa prestidigitation idéologique, son équilibrisme dialectique, ses illuminations verbales – en un mot, un talent incontestable mais dévoyé – tout cela n’est pas sans prestige sur divers types de lecteurs : ceux qui ne connaissent de Racine que les deux tragédies étudiées au lycée et les représentations de Meyer et de Vilar77 ; ceux qui ne s’intéressent pas vraiment à la littérature et qui n’admettent Racine que comme un prétexte à idées ; ceux qui, fatigués à juste titre des lieux communs et des platitudes d’un certain enseignement scolaire, désirent à tout prix du nouveau, etc.78
41Cependant, et quels que soient les talents de prestidigitateur de Barthes, il n’en devient pas pour autant un sorcier ! Sur Racine laisse du jeu à celui qui le reçoit, et les lecteurs sont invités à leur tour à s’approprier Racine, à le lire « en essayant tous les langages que [leur] siècle [leur] suggère », à répondre à ce « sens déçu », à cette « interrogation indirecte79 » qu’est le texte littéraire, et à se faire, par conséquent, aussi assertifs que le critique lui-même. Quelle liberté, en revanche, est laissée aux lecteurs de Brasillach, quand il s’agit proprement de les subjuguer et de les enrôler80 ? L’assertion réclamée ne peut être ici que la réitération ou l’amplification d’une lecture politique dangereusement brillante, brutalement militante – une véritable désappropriation de l’individu-lecteur (lisant Brasillach lisant Corneille) au profit d’un collectif sans reste.
42Le silence de Barthes sur Corneille nous apprend à quel point sa lecture et sa transmission sont inévitablement politiques ; sa parole sur Racine dessine malgré tout, et pour nous – et encore aujourd’hui –, les conditions d’un bon dispositif pour partager Corneille, les contours de notre « responsabilité81 ». Plutôt que de choisir une appropriation contre une autre, c’est en fait une manière d’adresser cette appropriation qu’on peut favoriser. Comment qualifier la distance entre les ouvrages de Barthes et Brasillach, comment mesurer l’écart entre les modes d’appropriation sur lesquels ils reposent ? La différence en question n’est pas, à mon sens, une différence de nature (appropriation il y a, annexion ou instrumentalisation aussi) ; elle n’est pas non plus, fondamentalement, une différence de degré ou de justesse (quoiqu’on puisse juger qu’une appropriation soit plus ou moins productive, pertinente ou éclairante) ; elle n’est pas même une différence d’intention : les lectures nationalistes et fascistes de Corneille ne se soustraient pas à leur « responsabilité » vis-à-vis de leur lectorat, ou du public pris plus largement encore – bien au contraire. En revanche, l’adresse à la Cité ne se fait guère selon un souci comparable de l’autre et de son propre. Et la Cité que cette adresse crée – même quand la Cité se restreint, le temps d’un spectacle ou d’une lecture, à l’espace d’une salle de théâtre ou de classe –, la « grande idée civique » que le partage de Corneille charrie bon gré mal gré, peut se faire aussi détestable que désirable.
1 « Autant j’aime Michelet, autant je n’aime pas Racine ; je n’ai pu m’y intéresser qu’en me forçant à y injecter des problèmes personnels d’aliénation amoureuse. » (Roland Barthes, « Réponses » [1971], Œuvres complètes, éd. Éric Marty, Paris, Seuil, 2002, tome I, p. 1033. Les références ultérieures à l’œuvre de Barthes renvoient toutes à cette édition, seuls le tome et les pages concernés sont précisés.)
2 Voir respectivement : Sur Racine [1963], II, p. 53-196 ; « La Rochefoucauld : Réflexions ou Sentences et maximes » [1961], IV, p. 25-40 ; « La Bruyère » [1963], II, p. 473-487 ; « Le silence de Don Juan » et « Dom Juan » [1954], I, p. 453-455 et p. 461-463 ; « L’Étourdi ou le nouveau contretemps » [1955], I, p. 629-631 ; « Roland Barthes : ses différentes lectures » [1976], IV, p. 1002 ; « Le discours de l’histoire » [1967], II, p. 1250-1262.
3 J’emprunte cette expression à Bernard Dort lui-même, qui l’emploie dans l’avant-propos rédigé pour la deuxième édition de Corneille dramaturge en 1972.
4 Sur Racine, II, p. 55.
5 « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » [1978], V, p. 468.
6 Ibid.
7 Sur Racine, II, p. 54-55.
8 « Racine est Racine », Mythologies, I, p. 746.
9 Sur Racine, II, p. 55.
10 Dans son cours au Collège de France sur Le Neutre, Barthes rapporte une anecdote liée à cet ouvrage, qu’il connaissait donc. Commentant la « récession de la timidité » dans le « monde “courant” » (« on dirait que les gens ont de moins en moins le trac »), Barthes raconte : « (Étudiant Sorbonne : première fois où je parlais en public. À cette époque, pas de séminaires, pas d’exposés : un étudiant pouvait ne rien dire pendant quatre ans, sauf aux oraux, ce n’était pas si mal ! Jean Schlumberger sur Corneille : j’avais appris le speech de présentation panne Schlumberger rougit pour moi » (Le Neutre. Cours et séminaires au Collège de France (1977-1978), éd. Thomas Clerc, Seuil-IMEC, 2002 p. 198). Le 27 janvier 1937, Schlumberger avait été invité à présenter son livre Plaisir à Corneille, par le groupe théâtral de la Sorbonne, dont Barthes faisait partie.
11 « Plaisir aux Classiques » [1944], I, p. 57.
12 Ibid., p. 57-58.
13 Pour une analyse plus détaillée de ce rapprochement, voir Claude Coste, Roland Barthes moraliste, Presses Universitaires du Septentrion, 1998, p. 28-29 ; et « Le Sur Racine de Barthes : un éclectisme critique », actes du colloque Barthes et la philosophie, organisé par Michel Murat, le 28 mars 2008, à l’ENS (communication consultable sur les sites « Diffusions des savoirs de l’ENS » et « roland-barthes.org ». URL : http://www.roland-barthes.org/audio_sur_barthes2.html, page consultée le 22 août 2016). Je me permets de renvoyer également au troisième chapitre de ma thèse intitulé « “D’eux à nous” : le choix d’une “lecture concernée” des classiques » (voir Lise Forment, L’Invention du post-classicisme de Barthes à Racine. L’idée de littérature dans les Querelles entre Anciens et Modernes, thèse soutenue le 5 décembre 2015 à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
14 « La Rochefoucauld : Réflexions ou Sentences et maximes », IV, p. 39.
15 Sur Racine, II, p. 55.
16 « La Bruyère », II, p. 487.
17 « [L]eur projet reste, qui dit que le jeu touche à la mort du sujet » (« La Rochefoucauld : Réflexions ou Sentences et maximes », IV, p. 40).
18 Sur Racine, p. 174.
19 « La Bruyère », II, p. 474-475.
20 Outre les deux comptes rendus qu’il écrit de cette mise en scène (« Le silence de Dom Juan » [1954], I, p. 453-455, et « Dom Juan » [1954], I, p. 461-463), on peut se reporter à diverses allusions, toutes positives, dans des textes parus en 1954 : « Pour une définition du théâtre populaire » (I, p. 516), « Éditorial » (I, p. 525), « Le théâtre populaire d’aujourd’hui » (I, p. 531).
21 « Le silence de Don Juan », I, p. 454.
22 « Dom Juan », I, p. 463.
23 « Le silence de Don Juan », I, p. 455.
24 Ibid., p. 454.
25 « Dom Juan », I, p. 463.
26 « Le silence de Don Juan », I, p. 455.
27 Ibid.
28 « Dom Juan », I, p. 461.
29 Ibid.
30 Ibid., p. 463.
31 Ibid., p. 461.
32 Ibid.
33 « Cela était-il dans Molière ? non, bien sûr. Mais le théâtre n’est pas un musée, et ce n’est pas notre faute si nous sommes plus vieux que Molière, si depuis 1665 il y a eu mille formes nouvelles d’athéisme, de Sade à Sartre. Vilar a mis dans son Don Juan une dimension trop souvent oubliée au théâtre, et qui est la mémoire de son public, ce que Péguy appelait son vieillissement. » (Ibid., p. 463).
34 C’est ce qu’il reproche par exemple à L’Orestie de Barrault, qui, à l’opposé de Vilar, n’a pas su allier distance et concernement. Cet article repris dans les Essais critiques sous le titre « Comment représenter l’antique » explique que le spectacle doit restituer les enjeux civiques de la tragédie non pas en les transportant naïvement dans le présent, car il y a, dit Barthes, « une marche de l’histoire », mais en marquant leur « particularité », leur « altérité », leur « éloignement », en les soumettant à la réflexion des spectateurs, à la « mémoire du public », pour leur propre présent : « Représenter en 1955 une tragédie d’Eschyle n’a de sens que si nous sommes décidés à répondre clairement à ces deux questions : qu’était exactement L’Orestie pour les contemporains d’Eschyle ? Qu’avons-nous à faire, nous, hommes du xxe siècle, avec le sens antique de l’œuvre ? » (« Comment représenter l’antique » [1955], II, p. 337). Pour une analyse plus détaillée de ces questions, voir Lise Forment, « Roland Barthes et l’actualité du théâtre “classique”. La transhistoricité de la littérature mise en spectacle », Revue Roland Barthes, nº 1, juin 2014, en ligne : http://www.roland-barthes.org/article_forment.html, page consultée le 22 août 2016.
35 Le Degré zéro de l’écriture [1953], I, p. 205. Barthes parle un peu plus loin d’« élargissement du Langage » à propos du style cornélien (ibid., p. 210).
36 « Réflexions sur un manuel » [1971], III, p. 949.
37 Ibid.
38 « Plaisir aux Classiques », I, p. 60.
39 Ibid.
40 Voir Gustave Lanson, Corneille, Paris, Hachette, 1898 ; Paul Bénichou, Morales du grand siècle, Paris, Gallimard, 1948 ; et Octave Nadal, Le Sentiment de l’amour chez Corneille, Paris, Gallimard, 1948. John D. Lyons a synthétisé ce débat dans son article sur « Le mythe du héros cornélien » (RHLF, 2007/2, vol. 107, « Le Classicisme des modernes. Représentations de l’âge classique au xxe siècle », p. 433-448, voir en particulier : p. 435-438).
41 « Plaisir aux Classiques », I, p. 57.
42 Parmi les « modernes », les principaux lecteurs de Corneille sont Claudel, qui l’abhorre, et Péguy, qui le vénère ; mais ni l’un ni l’autre ne pouvaient servir d’intercesseurs pour Barthes. Je remercie Myriam Dufour-Maître d’avoir suggéré ces deux noms pendant la discussion qui a suivi mon intervention, et d’avoir aussi pointé l’impossible dialogue de Barthes avec ces deux auteurs.
43 « Cette haute vertu qui règne dans votre âme / Se rend-elle si tôt à cette lâche flamme ? / Ne la nomme point lâche à présent que chez moi, / Pompeuse et triomphante elle me fait la loi. / Porte-lui du respect puisqu’elle m’est si chère… » (Le Cid, acte II, scène 5, cité dans « Plaisir aux Classiques », I, p. 63).
44 « … Les délices du soir font un triste matin. / Ainsi la douceur sensuelle / Nous cache sa pointe mortelle / Qui nous flatte à l’entrée et nous tue à la fin. » (L’Imitation de Jésus Christ, cité dans « Plaisir aux Classiques », I, p. 66.).
45 Médée, acte I, scène 5, cité dans « Plaisir aux Classiques », I, p. 67.
46 « Plaisir aux Classiques », I, p. 63.
47 Ibid.
48 Ibid., p. 60.
49 Toutes les citations de l’anthologie sont accompagnées du nom de leur auteur, à l’exception des mots de Léonor et de l’Infante, suivis de la mention « (Le Cid) ».
50 Philippe Roger, Hélène Merlin-Kajman et Marielle Macé ont commenté en ce sens « Plaisir aux Classiques ». Voir P. Roger, « Barthes post-classique », RHLF, 2007, no 2, p. 283-284 ; H. Merlin-Kajman, « Le corps classique des modernes », RHLF, 2007, no 2, p. 294 ; et M. Macé, Façons de lire, manière d’être, Paris, Gallimard, coll. « Nrf Essais », 2011, p. 216.
51 Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977), éd. Claude Coste, Paris, Seuil-IMEC, 2002, p. 142.
52 Sade, Fourier, Loyola [1973], III, p. 822.
53 Fragments d’un discours amoureux [1977], V, p. 277.
54 Je souligne cette expression.
55 Ibid.
56 Notons que les vers du Cid apparaissent également en creux chez Barthes, via une autre appropriation du texte cornélien : l’opéra de Massenet, commenté ici même par Sarah Nancy. Dans l’avant-propos des Fragments d’un discours amoureux, alors que Barthes explique « comment est fait ce livre », il définit ce qu’il nomme « figure » par l’analogie suivante : « La figure est en quelque sorte un air d’opéra ; de même que cet air est identifié, remémoré et manié à travers son incipit (“Je veux vivre ce rêve”, “Pleurez, mes yeux”, “Lucevan le stelle”, “Piangerò la mia sorte”), de même la figure part d’un pli de langage (sorte de verset, de refrain, de cantilation) qui l’articule dans l’ombre. » (Ibid., p. 31.)
57 Sur Racine, II, p. 85.
58 Bernard Dort, Corneille dramaturge, op.cit., p. 33.
59 Sur Racine, II, p. 53.
60 Ibid.
61 « Pour une définition du théâtre populaire », I, p. 516. Cette liste, enrichie du nom de Büchner, est réitérée dans « Le théâtre populaire aujourd’hui » (I, p. 531).
62 « Pour une définition du théâtre populaire », p. 515.
63 « L’erreur des costumes de Cinna gangrène fortement Cinna, en dépit de Vilar » (« Le théâtre populaire aujourd’hui », I, p. 526.)
64 « Le Prince de Hombourg » [1953], I, p. 248.
65 « Fin de Richard II » [1954], I, p. 471.
66 Je souligne.
67 « Pouvoirs de la tragédie antique » [1953], I, p. 267.
68 Christian Biet, « L’éblouissant soleil ou le mythe du national-classicisme français. Lectures et représentations du “Grand Siècle” : Corneille et le national-classicisme », dans L’Annuaire théâtral, no 39, printemps 2006, p. 29.
69 Ibid., p. 30.
70 Paul Déroulède, Conférence sur Corneille et son œuvre, Librairie Bloud et cie, 1911 ; Auguste Dorchain, Pierre Corneille, Garnier frères, 1918 ; Robert Brasillach, Pierre Corneille, Fayard, 1938 ; André Delacour, Corneille et notre France, Librairie Floury, 1944.
71 Barthes évoque lui-même le moment de sa formation dans « Premier texte » : « notre grande affaire, c’était le fascisme. L’année suivante, en 1934, au lieu d’une revue littéraire, ce fut un groupe de “Défense Républicaine Anti-Fasciste”, appelé DRAF, que nous fondions pour nous défendre contre les arrogances des “Jeunesses Patriotes”, majoritaires en classe de Philo. » (IV, p. 498).
72 Philippe Roger, « Barthes post-classique », op. cit., p. 278.
73 « De Gaulle, les Français et la littérature » [1959], I, p. 996.
74 On peut notamment lire, à propos du Corneille de Brasillach, l’article d’Hélène Merlin-Kajman : « Relire le Racine de Thierry Maulnier et le Corneille de Robert Brasillach ? », dans Maurrassisme et littérature, éd. Michel Leymarie, Olivier Dard et Jeanyves Guérin, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 159-175.
75 Robert Brasillach, Corneille, Fayard, 1938, rééd. 2006, p. 9-11. Bernard Dort a dit le rôle joué par cette lecture de Brasillach dans son propre intérêt critique pour Corneille : « Peut-être aimais-je Corneille auparavant, mais c’est Brasillach (j’ai toujours son livre, dans une édition datée de 1943) qui, pour moi, mit le feu aux poudres. C’est par lui que je découvris sinon Corneille, du moins l’ampleur, la variété, la splendeur d’un Corneille tentaculaire qui s’étendait de Calderón au Mystère de la chambre jaune, d’Euripide et de Sénèque à Pirandello… bref, qui était notre Shakespeare. Et il ne me déplaisait pas (toujours l’esprit de contradiction) de flirter, par Corneille interposé, avec un Brasillach dont tout, par ailleurs, m’éloignait. » (Bernard Dort, L’Écrivain périodique, Paris, POL, 2001, p. 303).
76 Voir B. Dort, « Actualité de Corneille » (1960), repris dans Théâtre public, Paris, Seuil, 1967, p. 27-29.
77 Raymond Picard fait ici allusion aux Phèdre montées par Vilar et Meyer, respectivement en 1957 (Théâtre de Strasbourg, reprise à Chaillot en 1958) et 1959 (Comédie-Française).
78 R. Picard, Nouvelle critique ou nouvelle imposture, Paris, Éditions Jean-Jacques Pauvert, coll. « Libertés », 1965, p. 85-86.
79 Sur Racine, loc. cit.
80 Je rejoins ici une question déjà soulevée par Hélène Merlin-Kajman dans son article « Relire le Racine de Thierry Maulnier et le Corneille de Robert Brasillach ? » (art. cité).
81 Voir Critique et vérité, par exemple t. II, p. 793 : « La sanction du critique, ce n’est pas le sens de l’œuvre, c’est le sens de ce qu’il en dit » ; et p. 798 : « En critique, la parole juste n’est possible que si la responsabilité de l’“interprète” envers l’œuvre s’identifie à la responsabilité du critique envers sa propre parole. »
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 24, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/838.html.
Quelques mots à propos de : Lise Forment
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Lise Forment est maîtresse de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, directrice du mouvement Transitions (http://www.mouvement-transitions.fr). Elle a soutenu en 2015 une thèse de doctorat résolument transhistorique intitulée L’Invention du post-classicisme de Barthes à Racine. L’idée de littérature dans les querelles entre Anciens et Modernes. Elle a déjà publié plusieurs articles sur les différentes appropriations dont les auteurs du xviie siècle ont fait l’objet dans la modernité.
