Sommaire
Appropriations de Corneille
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
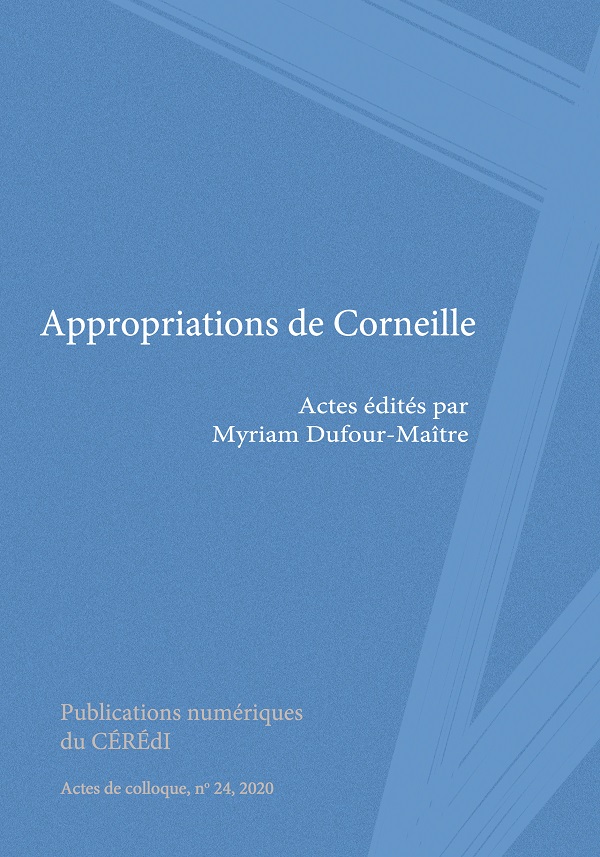
- Myriam Dufour-Maître Remerciements
- Collectif Le Festival Corneille de Barentin (1956-1975) et le Mouvement Corneille
- Myriam Dufour-Maître Introduction
- Sylvain Ledda Polyeucte, ou comment mettre en scène la violence ?
- Hélène Merlin-Kajman Comment déterminer ce qui est « religion » en littérature ? Réflexions à partir du cas de Polyeucte de Corneille
- Liliane Picciola De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
- Jacques Téphany Corneille, l’autre fondateur du TNP
- Roxane Martin Horace à l’épreuve des révolutions : les remaniements du texte et l’édification d’un Corneille patriote (1789-1799 vs 1848)
- Claire Carlin L’Illusion comique sur la scène du monde anglophone, entre traduction et « adaptation libre »
- Cécilia Laurin L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
- Julia Gros de Gasquet Filmer L’Illusion comique, réécrire Corneille ? À propos du film de Mathieu Amalric à la Comédie-Française (2010)
- Noëmie Charrié Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
- Jean-François Lattarico De l’Horace (1641) à l’Orazio (1688). Prémisses de la réforme dans le premier dramma cornélien per musica
- Sarah Nancy Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse
- Mariane Bury Le Corneille des historiens de la littérature au xixe siècle
- Michal Bajer Les contextes de la traduction. L’établissement de la tradition cornélienne en Pologne au tournant romantique : discours critique, pratiques éditoriales, péritextes
- Lise Forment Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
- Bénédicte Louvat « L’invention » du dilemme cornélien
- Jean-Yves Vialleton Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
- Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval Un Corneille à l’usage de la jeunesse au tournant des xviiie et xixe siècles : quelques jalons
- Beate Langenbruch Corneille, auteur de concours
- Hélène Bilis Corneille aux États-Unis, ou quel « auteur classique » pour les campus américains ?
Réécritures, adaptations ou « inadaptations »
Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
Noëmie Charrié
Réalisé d’après Othon de Pierre Corneille, le film de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour, se présente comme « le rêve d’une réappropriation » culturelle et politique. À partir des débats suscités par ce désir de restitution, cet article cherche à élucider pourquoi et comment ces deux artistes ont voulu faire du « vieux Corneille » leur bien.
1Corneille au cinéma : le défi que les cinéastes Jean-Marie Straub et Danièle Huillet se proposent de relever d’après Othon déclenche, en 1969, une nouvelle « Querelle du Cid ». Ce défi intéresse particulièrement notre propos, puisqu’il pose à nouveaux frais la question de l’appropriation de la culture passée. En effet – et c’est une des premières raisons de la polémique qui accompagna la sortie du film – le travail cinématographique des Straub met à mal le modèle de « démocratisation culturelle », sans pour autant rejeter ou démystifier la valeur du théâtre cornélien. Othon, pièce dite « de la vieillesse » de Corneille créée en 1664, est une réflexion du dramaturge sur la propre réflexion de Tacite sur l’histoire1. Son intrigue, réputée obscure, s’attarde sur les rouages de l’accession au pouvoir et la manière dont celui-ci mutile les hommes qui ne songent qu’à en tirer avantage. Candidat à la succession de l’empereur Galba, Othon tente d’obtenir la couronne et de déjouer – grâce aux stratégies matrimoniales que lui souffle le consul Vinius – les manœuvres des conseillers de Galba, qui souhaitent, quant à eux, placer Pison sur le trône. Mais l’amour de Camille pour Othon, laquelle est à la fois la nièce de l’empereur et l’épouse promise à son successeur, viendra, l’espace d’un instant, faire effraction sur la scène des jeux de pouvoir en formulant le désir d’une nouvelle politique. Si bien que cette pièce joue le rôle, pour les Straub, du chef-d’œuvre injustement méconnu.
2Outre les nombreuses déclarations témoignant de leur admiration pour l’œuvre, et en particulier pour l’œuvre tardive de Pierre Corneille, on peut avancer le contenu explicite de la dédicace, sur laquelle s’amorce le générique de fin :
Ce film est dédié au très grand nombre de ceux nés dans la langue française, qui n’ont jamais eu le privilège de faire connaissance avec l’œuvre de Corneille.
3La dédicace, « hommage qu’un auteur fait de son œuvre à une personne » selon les dictionnaires du xviie siècle, se place ici sous le signe de la multitude, du manque et – nous verrons combien la chose est déterminante – de la langue française. Mais le terme qui frappe le plus l’attention est celui de « privilège ». Il renvoie simultanément à l’inégalité et à l’importance d’un objet culturel qui devrait être la propriété de tous ceux qui partagent le même domaine linguistique. Pour les Straub, l’unité « peuple, langue, nation » est une fiction qui vient masquer la division en classes de la société. Ainsi la dédicace accuse un écart : celui, comme le précisent les Straub dans un entretien ultérieur, qui sépare les classes laborieuses des « intellectuels bourgeois ». Néanmoins, peut-on dire que la réalisation filmique d’Othon se donne pour mission de combler, sinon de réparer cet écart ?
4Dans le Nouvel Observateur du 25 janvier 1971, le critique Jean-Louis Bory évoque dans un article intitulé « Caviar pour tous », le dernier film des Straub :
L’opération « Othon » c’est le pendant culturel de l’opération Fauchon. Straub se dit, et il a raison, pourquoi tout le monde n’aurait-il pas droit à « Othon » ? Tout le monde a droit à la tragédie – à la tragédie classique de Corneille2.
5Du point de vue de Jean-Louis Bory, le geste des Straub consiste à exproprier une richesse culturelle devenue l’apanage des « spécialistes », pour l’offrir à la consommation de ceux qui en sont démunis. La comparaison avec « l’opération Fauchon » est à ce titre des plus éloquentes. Lancée par les maos en mai 1970, l’opération « Fauchon nourrit les bidonvilles » s’attaque à un symbole du luxe à la française, dans l’idée de redistribuer les produits de l’épicerie de luxe aux habitants des banlieues de Nanterre et de Bagnolet. Mais Jean-Marie Straub, qui disait avoir « rêvé Othon pour les paysans et les ouvriers français3 », ne tient pas à cibler un public en vertu de sa catégorie socioprofessionnelle. À la question de l’origine sociale de ses spectateurs potentiels, voici ce qu’il réplique :
Quand j’ai tourné le Corneille (Othon) en 16 millimètres, j’avais le rêve sauvage de le prendre sous le bras et de le montrer dans les usines. Mais cela reste une abstraction, car vous ne pouvez pas intéresser les gens avec des films quand ils ont travaillé neuf heures dans la journée4.
6Dans un entretien donné aux Cahiers du Cinéma, le réalisateur précise encore un peu plus sa position :
Afin que les films atteignent les gens pour lesquels on les a rêvés ou pour lesquels on les rêve, il faudrait changer la société tout entière. Jouer au missionnaire, sans changer la société, et parcourir le pays avec un appareil de projection et avec ses propres films et des films des autres, ça ne serait pas encore une solution, ça ne serait qu’une solution provisoire. Car ça voudrait dire aller aux gens, comme on va « au peuple5 ».
7Pour les Straub, l’appropriation d’Othon ne se soutient d’aucun mandat social. Il ne s’agit pas de porter ou de servir le théâtre de Corneille aux classes populaires, mais d’accuser l’écart qui les en éloigne, tout en maintenant que le théâtre est fait pour elles. Formulation paradoxale, presque intenable, qui se réfère en réalité à un horizon encore inexistant : il s’agit d’un appel, d’une espérance, du rêve d’une réappropriation culturelle et politique. Un rêve qui réclame une invention, sinon un saut dans l’inconnu, puisque le désir dont il provient n’est pas inscrit dans la réalité immédiate. À cet égard, la « mise en film » de la pièce de Corneille opère un renversement des attendus, puisqu’elle cherche moins à transmettre ou à restituer un contenu précis, qu’à effectuer un travail d’étrangéisation dans la lignée de Brecht. Autrement dit : à susciter la stupeur, l’étonnement, en refusant de neutraliser par la forme les contradictions et les dissonances de la vie sociale6. Dédié aux classes laborieuses, mais réalisé sans intentions pédagogiques7, le film déroute et scandalise la critique. Dans son compte rendu pour la revue de cinéma Positif, voici comment Michel Ciment décrit l’entreprise des Straub :
Othon, tragédie politique de la vieillesse de Corneille, et fort belle de surcroît, a été choisie par le réalisateur pour un exercice parfaitement réactionnaire […], en ce qu’elle transforme cette réflexion sur l’art de gouverner et l’art de marier en un récital obscur de 90 minutes. Au lieu d’éclairer la pièce classique, de lui donner des résonances modernes, Straub en voile le sens, la vide de toute substance politique et pour mieux accroître la confusion dédie son film à ceux qui n’ont pas eu la chance d’étudier Corneille8.
8« Voiler », « vider », « obscurcir » : ces verbes, à l’évidence peu flatteurs, s’arriment à de solides préjugés ; à lire Michel Ciment, l’appropriation de Corneille est un problème qui se règle en ayant recours à deux procédés : l’explication du contenu ou du message politique et l’actualisation de la pièce. À l’inverse, pour les Straub, l’appropriation de Corneille est un problème qui reste ouvert et que l’on doit montrer, à l’aide de l’étrangéisation (que l’on connaît mieux sous le terme, mal traduit, de « distanciation ») et de la réactivation9.
9Mais comment montrent-ils concrètement ce problème et pourquoi avoir choisi en particulier Othon ? Rebaptisé Othon par commodité, le film de Straub et Huillet s’intitule en réalité Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour. Le rapprochement des deux vers, extraits de la pièce de Corneille, interpelle d’emblée le spectateur, en couplant le motif de la lucidité à celui du courage. Deux facultés qui innervent le théâtre cornélien, mais également celui de Brecht, dont la critique à l’égard de la scène théâtrale de son temps entre en résonance avec le projet des Straub sur Othon. Voici ce qu’avance Brecht dans Le Petit Organon pour le théâtre :
Nous ne pouvons guère, en effet, laisser le théâtre dans l’état où nous le trouvons. Pénétrons dans une de ces salles et observons l’effet qu’il exerce sur les spectateurs. Regardant autour de soi, on y aperçoit des silhouettes plutôt inertes, dans un état étrange […] elles ne communiquent guère entre elles, on dirait une assemblée de dormeurs mais de ce genre de dormeurs dont le sommeil est agité […]. Certes, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne regardent pas : ils fixent, de même qu’ils n’écoutent pas, mais épient. […] Regarder et écouter sont des activités qui procurent parfois du plaisir, mais ces gens semblent dégagés de toute activité et pareils à ces gens dont on fait quelque chose10.
10Si nous remplaçons le mot « théâtre » par celui de « politique », nous comprenons mieux ce qui retient les Straub dans la pièce de Corneille. En effet, selon Serge Doubrovski, auquel se réfèrent volontiers les réalisateurs, Othon est par excellence la tragédie où la « morale des “yeux” » indépendants du « cœur », condamne les personnages à l’impuissance. Morale qu’incarne au plus haut point Othon, le héros éponyme, qui affirme alors même qu’il brigue le pouvoir :
Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ;
Mais l’Empire en tout temps a de quoi les charmer,
L’amour passe ou languit, et pour fort qu’il puisse être,
De la soif de régner, il n’est pas toujours maître11.
11De la sorte, la tragédie n’est plus qu’illusion, puisque l’héroïsme – conçu comme face-à-face avec l’impossible – se défait12. La disjonction du « cœur », autrement dit du courage, et des « yeux », soit la clairvoyance, empêche tout affrontement ou toute alliance de se produire. Ce qu’exprime bien l’avis au lecteur dans lequel Corneille souligne, non sans ironie, la stérilité de ces intrigues de cour : « on n’a jamais vu de pièce où il se propose tant de mariages pour n’en conclure aucun ». Néanmoins, si le héros ne parvient pas à s’élever à l’impossible, son impuissance n’est jamais montrée comme une donnée naturelle et inhérente à son caractère : « Othon [explique Jean-Marie Straub] a de grandes vertus, mais il est fondamentalement un homme de cour et sous Néron, il a dû se plier à en adopter les vices ». Les personnages, dans le film, sont donc traités en conséquence : semblables aux « silhouettes inertes », ils semblent, tels les spectateurs sous hypnose que décrit bien Brecht, dégagés de toute activité. À cet égard, l’exemple le plus frappant est encore une fois celui d’Othon ; comme le montre l’extrait ci-joint de la deuxième scène du premier acte13.
12
13Othon s’y entretient avec le consul Vinius, dont il convoite les faveurs en courtisant sa fille, Plautine. Mais Vinius lui suggère « d’aimer ailleurs ». Afin de s’assurer une protection contre les conseillers Lacus et Martian, qui intriguent pour nommer Pison à la succession de l’empereur Galba, Vinius exige d’Othon qu’il tourne ses yeux vers Camille, la nièce de Galba et future détentrice du trône. Othon, dans ce contexte, doit paraître l’amant désintéressé et le gouverneur idéal. Sa voix monocorde, couplée à un débit très rapide, fait éprouver au moyen du rythme sa nature politique14, laquelle se manifeste dans un phrasé presque incompréhensible, comme s’il voulait liquider ou exécuter sa partition au plus vite. Car les personnages, prisonniers d’une, ou plutôt des intrigues, sont sommés de s’identifier à un rôle dont ils ne parviennent pourtant pas à exercer la fonction : exactement, à nouveau, comme les spectateurs sous l’emprise du théâtre illusionniste critiqué dans Le Petit Organon. Mais ici, c’est la politique en tant que « science machiavélique » qui envoûte les esprits. Le calcul inlassable des intérêts, la hantise et l’anticipation du complot obsèdent les personnages, qui semblent poursuivre la célèbre maxime d’État de Machiavel : « Gouverner, c’est mettre vos sujets hors d’état de vous nuire, et même d’y penser15. » Un précepte que les Straub récusent avec Corneille, en montrant combien le problème de la neutralisation des ennemis potentiels englue l’action politique dans les méandres de la spéculation, et sert les intérêts particuliers au détriment du bien public. De nombreuses scènes du film montrent ainsi de dos les personnages qui intriguent ; tantôt indifférents à la ville moderne – c’est-à-dire à l’avenir – et tantôt aveugles devant les restes de l’Empire – soit devant le présent – qui n’est plus qu’un amas de ruines. Par exemple, nous pouvons voir, à la scène iv du deuxième acte, Lacus et Martian, tous deux conseillers de l’empereur Galba, délibérant sur qui de Pison ou d’Othon servira le mieux leurs intérêts une fois devenu Empereur :
14
15Avec ce long plan-séquence nous retrouvons ici, pour reprendre la terminologie d’André Bazin, le passage d’une idée de théâtre à une idée de cinéma. Les scènes de conseillers sont en effet légion dans l’œuvre de Corneille : nous les voyons manœuvrer, s’insinuer auprès d’un personnage central, le roi16. Or, dans Othon, les conseillers ordonnent et règlent tout : l’empereur n’est plus la cible de la persuasion, mais une figure absente, un « atout » que l’on évoque au cours d’une négociation. La conversation privée des deux ministres d’État est ainsi filmée à hauteur d’homme, de façon à rapprocher leurs conceptions politiques au plus près du sol, au ras de la terre, qu’ils scrutent opiniâtrement des yeux. L’horizon politique de Lacus et Martian s’élève brièvement à l’instant où ils évoquent les qualités du bon souverain17. La caméra vise légèrement au-dessus de leurs têtes, laisse entrevoir le ciel, puis redescend aussitôt dans les vestiges de Rome, dès l’instant où ils reviennent au portrait de Pison, le candidat qu’ils veulent en définitive porter au trône, puisqu’il a « l’âme simple et l’esprit abattu », « grande naissance », mais peu de vertu. Ainsi l’opposition qu’établit Corneille entre la politique comme pratique de la vertu et la politique comme science ou technique machiavélienne, est réactivée par les Straub dans la période immédiate de l’après-1968 : une période qui voit triompher la technocratie avec la montée au pouvoir de Georges Pompidou, à qui les réalisateurs disaient adresser une lettre ouverte en choisissant Othon.
16Mais alors, pourquoi parler d’étrangéisation plutôt que d’actualisation ? Parce qu’il ne s’agit pas de rabattre le présent sur le passé et de reconnaître dans la pensée de Corneille ce qui est propre à notre temps. La position formulée par le metteur en scène Antoine Vitez sur ce point éclaire la démarche critique des Straub :
L’actualisation commence au texte. On découvre des équivalences qui suggèrent au public des images et des conflits de notre époque, et la mise en scène rapproche, par allusion, le passé du présent, ou plutôt identifie le passé au présent : les costumes et les décors sont chargés de signes contemporains, la musique évoque l’histoire, etc. Démagogie ingénue. On veut être compris du peuple et faire un théâtre « de notre temps », mais on ne voit pas qu’on nie ainsi l’Histoire, qu’on voulait affirmer, puisqu’on postule qu’une œuvre de Shakespeare ou d’Eschyle peut illustrer l’histoire moderne, au prix de quelques remaniements18.
17À rebours du processus d’actualisation qui procède par analogies et donne au passé les couleurs, les formes, en un mot le « décor » de notre actualité pour en faciliter la réception, l’étrangéisation des Straub manifeste différentes strates temporelles, afin de contrarier l’identification du spectateur. La représentation des personnages en costumes romains contraste durant la quasi-totalité du film avec les sons et les images de la ville moderne. Or, ce contraste ou effet de dissonance relève d’une double stratégie : il s’agit, tout d’abord, de montrer l’épaisseur, les couches de l’Histoire de manière à faire ressentir que ce que l’on voit n’est ni naturel, ni immuable et donc susceptible d’un changement, d’une transformation. C’est, selon les réalisateurs, le propre de l’art des réalistes tel que le valorise Brecht : « ce que tu filmes [affirme Jean-Marie Straub] doit provoquer cet effet d’étrangeté, doit provoquer l’idée que tout ça, ni au niveau de ce qu’on voit, ni au niveau des rapports entre les gens, ni de l’histoire, ni de la narration – que rien de tout ça n’est normal, ne va de soi19. » Mais ce procédé ne fonctionne pas de manière autonome. Il est solidaire du processus de réactivation qui va chercher dans le passé une idée oubliée, refoulée, délaissée par les hommes afin de tirer la vérité en dessous du dépôt ou du sédiment de l’histoire. Dans Othon, cette idée se manifeste de façon privilégiée par l’entremise de l’un des personnages, Camille. Les réalisateurs la distinguent de l’ensemble du personnel dramatique, en mettant l’accent sur sa valeur épique : « On doit à l’invention de Corneille le personnage de Camille, nièce de Galba, personnage véritablement épique (au sens brechtien) : “Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour”20. » La citation de ce dernier vers donne une indication quant à l’idée qui est mise en mouvement : Camille, en effet, représente pour les Straub le pays, le peuple qui n’est jamais consulté, mais qui laisse pourtant pressentir la possibilité d’un nouvel ordre du monde21. Nous pouvons observer le traitement qui lui est réservé, lors de sa confrontation, acte II, scène v, avec les intrigants Lacus et Martian :
18
19À la différence des deux ministres d’État, Camille est filmée en contre-plongée ce qui lui confère une hauteur, une dignité que n’ont pas les autres personnages. Toutefois, sa grandeur n’est pas de celle qu’assurent les cothurnes. Loin de lutter contre le fatum¸ elle se débat contre un rapport de forces, lui-même contradictoire, divisé et incertain, comme en témoignent les jeux de regards ainsi que le chassé-croisé des voix qui se prolongent dans le champ de la caméra en l’absence, parfois, des corps qui les prononcent. Irrémédiablement lié au devenir de l’État, le « destin » de Camille suit bien la trajectoire du personnage épique, tel que Robert Abiracheb la définit d’après Brecht :
Le personnage […], est soumis à un incessant travail d’effraction qui l’empêche de s’unifier en un tout harmonieux et, avec plus de vigilance encore, de se constituer en monade. Son isolement une fois brisé, il ne peut plus appeler l’identification : pour chercher à maîtriser son sort, on ne lui offre pas d’autre issue – consciemment ou non repérée par lui-même, mais toujours désignée par la fable – que de se saisir à travers la collectivité22.
20L’amour que porte Camille à Othon engage aussi bien le cercle de sa vie privée que le domaine public de la société, puisque du choix de son époux dépend celui de l’empereur. Lorsqu’à la dernière scène de l’acte III, elle décide au mépris des intrigues, de s’offrir à Othon, elle ouvre une brèche dans la logique du « paraître » et sort de l’impasse dans laquelle chaque personnage, pris individuellement, s’enlise. Pour la première fois, la question du « bien public » est évoquée non comme simple antagonisme à l’intérêt personnel, mais comme l’accomplissement véritable d’un amour, d’une passion d’où irradie une volonté de transformation et de réappropriation du politique. Au niveau de l’œuvre dramatique, cette possibilité n’est pas saisie : le seul moment où le présent s’ouvre vers le futur est rejeté par Othon, dont l’opportunisme sera vainement couronné.
21En revanche, au niveau de la fabrique du film, la réactivation de l’idée d’une réappropriation du politique est portée à un tel point d’incandescence, qu’il devient impossible de s’en détourner. L’exhumation de cette pièce, réputée pour son « obscurité », est en elle-même un geste qui touche à la question des inégalités devant la culture, dont Jean-Marie Straub désigne les garants officiels :
Othon, tragédie de Pierre Corneille, fut donnée pour la première fois à la cour de Fontainebleau, le 3 août 1664. Au cours des siècles suivants, Othon a eu bien peu de fortune. Entre 1682 et 1708 elle fut représentée trente fois à la Comédie-Française, et puis jamais plus23.
22Considérée par les réalisateurs comme l’œuvre « la plus politique » de Corneille, dans la mesure où la dialectique qu’elle met au travail ne donne lieu à aucune réconciliation, cette pièce est abandonnée par l’institution qui est chargée de la représenter. Aussi, il ne s’agit pas d’aller contre la « tradition interprétative24 », mais d’arracher le texte au livre, à l’imprimé, à la « reproductibilité technique » :
Mon film, Les yeux ne veulent pas… repose précisément sur ces choses qui ne sont pas « reproductibles » – sur l’incarnation du verbe de Corneille dans chaque personnage dans l’instant, le bruit, l’air et le vent et sur l’effort que font les acteurs et le risque qu’ils courent, comme des funambules, d’un bout à l’autre de longs textes difficiles enregistrés en prise directe – c’est-à-dire en même temps que l’image25.
23Selon Walter Benjamin, la signification sociale du cinéma est reliée à un processus de « liquidation de la valeur traditionnelle de l’héritage culturel », qui conduit à détacher l’objet culturel reproduit – en l’occurrence le film – du domaine vivant et changeant de la tradition. La reproduction technique, tout en niant « le travail de l’histoire », permet de rapprocher l’œuvre du récepteur26. Or, dans le cas d’Othon, le travail de prise directe et la valorisation de la performance des acteurs rétablissent « l’ici et maintenant » de l’œuvre, sans pour autant la rapprocher de ses spectateurs. On sait que pour Walter Benjamin, le rapprochement spatial – et non plus spirituel – des œuvres, doublé du besoin irréfléchi de les posséder dans leur image, ou plutôt dans leur reflet, signifie que l’on ne tient plus compte de leur fonction sociale27. Ainsi, afin d’empêcher tout sentiment de possession, lequel ferait du théâtre de Corneille un produit de « l’art pour l’art », les Straub effectuent un travail que l’on pourrait dire « d’étrangement » de la langue française. La distribution du film privilégie en effet les acteurs d’origine italienne, dans la mesure où le travail d’appropriation de la langue cornélienne se donne à voir de manière bien plus radicale et exige de la part du spectateur une attention sans relâche. La difficulté à comprendre parfois l’entièreté du texte provoque un effet de déprise, qui loin de susciter une rêverie où s’enchaînent les associations d’idées, renvoie aux limites de chacun. L’état d’engourdissement des aptitudes critiqué par Brecht est ainsi combattu par ce que les Straub nomment « le devoir du cinéaste », lequel consiste à « transformer l’œil de la caméra en regard », et à « ouvrir les yeux et les oreilles » du public, dont il faut éveiller la « disposition morale ». Du côté des acteurs, tous non professionnels, chaque parole, chaque syllabe prononcée est arrachée au prix d’un effort, d’une lutte où ils sont pleinement engagés. Une lutte, qu’ils effectuent aussi contre eux-mêmes, puisqu’il va sans dire que l’appropriation d’une langue étrangère va à l’encontre des réflexes spontanés, « naturels » du locuteur. Et cette redécouverte du « parler », ce combat pour s’approprier la langue du xviie siècle devient ici la métaphore exacte de la place et de la lutte des exploités devant la culture. Question brûlante de réappropriation politique, qui met en scène, pour conclure sur une citation de Jean-Marie Straub : « une humanité qui, au-delà de tous les progrès, semble constamment obligée de se reprendre à zéro, et de se poser constamment à elle-même la question de son sens28. »
1 Jean-Marie Straub, « Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Entretien (suite) », Cahiers du Cinéma, no 224, septembre 1970, p. 40-47, p. 40.
2 Jean-Louis Bory, « Caviar pour tous », Le Nouvel Observateur du 25 janvier 1971, p. 49.
3 Jean-Marie Straub, « Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Entretien (suite) », art. cité, p. 41.
4 Jean-Marie Straub, « Le cinéma commencera quand l’industrie disparaîtra » (Rome, 1970), Cinéma / politique série 1, dir. Nicole Brenez, Édouard Arnoldy, Bruxelles, Éditions Labor, 2005, p. 37-60, p. 52.
5 Jean-Marie Straub, « Entretien avec Jean-Marie Straub et Danièle Huillet », Cahiers du Cinéma, no 223, août 1970, p. 48-57, p. 51.
6 Bertolt Brecht, Les Arts et la Révolution (1948-1956), précédé de Notes sur le travail littéraire (1935-1941), Articles sur la littérature (1934-1946), Paris, L’Arche, 1970, p. 23.
7 Sur la critique du « mythe pédagogique », voir Jacques Rancière, Le Maître ignorant, Paris, Fayard, 1987, p. 15-26.
8 Michel Ciment, « Othon ou Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour, de Jean-Marie Straub (Allemagne-Italie) », Positif, no 119, 1970, p. 29-30.
9 Straub aime à citer cette phrase, qu’il attribue à Péguy : « La révolution, c’est remettre en place des choses très anciennes mais oubliées. »
10 Bertolt Brecht, Le Petit Organon pour le théâtre, Paris, l’Arche, 1963, p. 38.
11 Pierre Corneille, Othon (1664), Paris, Seuil, 1963, acte IV, scène i, vers 1127-1130, p. 677.
12 Serge Doubrovski, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, 1963, p. 372-375.
13 Pierre Corneille, op. cit., acte I, scène ii, vers 177-248, p. 667-668.
14 Jean-Marie Straub, « Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet. Entretien (suite) », art. cité, p. 42.
15 Nicolas Machiavel, Discours sur la Première Décade de Tite-Live, II, 23, traduit de l’italien par Toussaint Guiraudet, Paris, Bibliothèque Berger-Levrault, 1980, p. 215.
16 Sur la fonction de la « politique des conseillers », voir Hélène Merlin-Kajman, L’Absolutisme dans les lettres et la théorie des deux corps, passions et politique, Paris, Champion, 2000, p. 32-33.
17 Pierre Corneille, op. cit., acte II, scène iv, vers 641-642 : « Il faut de la prudence, il faut de la lumière, / Il faut de la vigueur adroite, autant que fière ».
18 Antoine Vitez, « À propos d’Électre », dans Le Théâtre des idées, Paris, Gallimard, 1991, p. 59-60.
19 Jacques Aumont et Anne-Marie Faux, « Entretien avec Jean-Marie Staub et Danièle Huillet », dans La Mort d’Empédocle, Dunkerque, Studio 43 MJC de Dunkerque, Dopa film et école régionale des Beaux-Arts, 1987, p. 27-64, p. 59.
20 Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Écrits, édition établie par Philippe Lafosse et Cyril Neyrat, Paris, Independencia, 2012, p. 76.
21 Jean-Marie Straub, « Entretien avec Jean-Marie Straub et Danièle Huillet », Cahiers du Cinéma, no 223 août 1970, p. 55.
22 Robert Abirached, La Crise du personnage dans le théâtre moderne (1978), Paris, Gallimard, 1994, p. 284.
23 Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Écrits, op. cit., p. 75.
24 Voir l’entretien de Jean-Marie Straub par François Maurin pour le journal L’Humanité du 9 janvier 1970.
25 Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Écrits, op. cit., p. 67.
26 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (1939), dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 273-279.
27 Ibid., p. 278.
28 Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, op. cit., p. 24.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 24, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/825.html.
Quelques mots à propos de : Noëmie Charrié
Université Toulouse Jean Jaurès
Patrimoine, Littérature, Histoire (PLH)
Noémie Charrié prépare une thèse sous la direction de Bénédicte Louvat, intitulée Molière, Corneille, Racine à l’épreuve de la perspective révolutionnaire au xxe siècle : rêves et enjeux d’une réappropriation. Membre du comité de lecture de la revue Cahiers du GRM (Groupe de Recherches Matérialistes), elle est également corédactrice de la programmation artistique du Centre dramatique national La Commune à Aubervilliers.
