Sommaire
Appropriations de Corneille
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
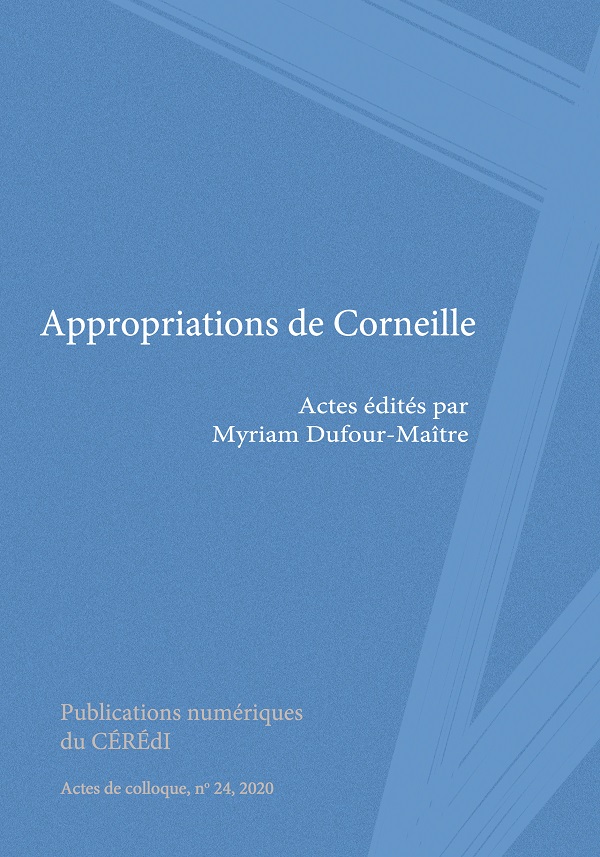
- Myriam Dufour-Maître Remerciements
- Collectif Le Festival Corneille de Barentin (1956-1975) et le Mouvement Corneille
- Myriam Dufour-Maître Introduction
- Sylvain Ledda Polyeucte, ou comment mettre en scène la violence ?
- Hélène Merlin-Kajman Comment déterminer ce qui est « religion » en littérature ? Réflexions à partir du cas de Polyeucte de Corneille
- Liliane Picciola De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
- Jacques Téphany Corneille, l’autre fondateur du TNP
- Roxane Martin Horace à l’épreuve des révolutions : les remaniements du texte et l’édification d’un Corneille patriote (1789-1799 vs 1848)
- Claire Carlin L’Illusion comique sur la scène du monde anglophone, entre traduction et « adaptation libre »
- Cécilia Laurin L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
- Julia Gros de Gasquet Filmer L’Illusion comique, réécrire Corneille ? À propos du film de Mathieu Amalric à la Comédie-Française (2010)
- Noëmie Charrié Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
- Jean-François Lattarico De l’Horace (1641) à l’Orazio (1688). Prémisses de la réforme dans le premier dramma cornélien per musica
- Sarah Nancy Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse
- Mariane Bury Le Corneille des historiens de la littérature au xixe siècle
- Michal Bajer Les contextes de la traduction. L’établissement de la tradition cornélienne en Pologne au tournant romantique : discours critique, pratiques éditoriales, péritextes
- Lise Forment Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
- Bénédicte Louvat « L’invention » du dilemme cornélien
- Jean-Yves Vialleton Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
- Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval Un Corneille à l’usage de la jeunesse au tournant des xviiie et xixe siècles : quelques jalons
- Beate Langenbruch Corneille, auteur de concours
- Hélène Bilis Corneille aux États-Unis, ou quel « auteur classique » pour les campus américains ?
Réécritures, adaptations ou « inadaptations »
L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
Cécilia Laurin
S’intéresser à l’adaptation transmédiale de M. A. Goorjian, quasiment inconnue en France, permet d’étudier un cas d’appropriation qui propose une variation résolument contemporaine autour de la structure cornélienne originale, dans un triple questionnement : sur les pouvoirs de l’image, sur la mutation de la thématique du théâtre du monde en celle d’un cinéma du monde, et sur le travail opéré sur cet « étrange monstre » de façon à l’intégrer dans la perspective de la culture anglophone, à travers une sorte de fusion des dramaturgies cornélienne et shakespearienne.
1[Note de l’auteur]1
2Illusion2 constitue une appropriation cinématographique d’une des pièces les plus connues de Pierre Corneille : L’Illusion comique. Ce film américain, réalisé en 2004 par Michael A. Goorjian, se présente comme une adaptation très libre de l’œuvre cornélienne, qui suit cependant – en la déplaçant et la modifiant – la structure imaginée par le dramaturge. Donald (interprété par Kirk Douglas), ancien réalisateur de cinéma désormais vieux et condamné par la maladie, se voit offrir l’opportunité, alors qu’il est sur le point de mourir, de visionner la vie du fils qu’il a abandonné, de nombreuses années auparavant, sous la forme de trois courts métrages, qui retracent principalement sa romance avec Isabelle et donnent à voir sa fin tragique. Donald est guidé dans cette expérience spectaculaire par la figure énigmatique de son ancien chef monteur décédé depuis longtemps, Stan (interprété par Ron Marasco), transposition du magicien Alcandre.
3À travers le mouvement d’appropriation de Michael A. Goorjian, la métathéâtralité se fait donc métafilmicité, insérant des séquences du film intérieur de la vie de Christopher, le fils (interprété par le réalisateur lui-même), au sein du film-cadre qui suit l’aventure du père aux côtés de Stan. Ce procédé peut manifestement se justifier par deux raisons principales : d’une part, la volonté de conserver la dynamique réflexive caractéristique de l’œuvre originale et, d’autre part, conformément à l’évolution des pratiques culturelles, le changement de paradigme de l’image, qui est aujourd’hui celui de l’image filmée. Or, la pièce de Corneille invite bien à questionner les pouvoirs de l’image, et de l’art. Toutefois, contrairement à son modèle théâtral, le film n’enchâsse pas d’illusion à l’intérieur de l’illusion magique, ce second degré d’illusion qui cherche à tromper le spectateur sur la nature du spectacle auquel il assiste, qui travaille à « l’éblouir », comme le dit la langue classique. L’appropriation cinématographique s’affranchit ainsi de la confusion surprenante entre plusieurs niveaux de représentation qui pourraient se retrouver dans le film intérieur, et ne cherche pas à démultiplier le procédé de mise en abyme. Elle reprend par contre la « structure chorale » à « enchâssement décomposé » que Georges Forestier identifie dans L’Illusion comique, qui en fait une des pièces où l’héritage du chœur est le plus sensible :
Le spectacle intérieur est constitué non par une véritable pièce de théâtre, mais par une « évocation magique ». Les acteurs étant des « fantômes » censés représenter des personnages réels, il n’est pas question de juger leur jeu : ils ne jouent pas, ils revivent. Aussi les commentaires des spectateurs, tout comme ceux d’un chœur, portent-ils sur les périls ou les joies qui affectent les personnages dont ils accompagnent l’action du regard3.
4À la manière de Pridamant et d’Alcandre, Donald et Stan occupent une place à côté du cadre où se déroule la vision et le père commente à intervalles réguliers, en spectateur impliqué, les images de la vie de son fils, comme autant de réels échantillons filmiques de son existence. C’est d’ailleurs la question de l’essence du cinéma et de la vie, du lien qui les unit, dans une sorte de coessentialité, qui se trouve au cœur de l’adaptation de Michael A. Goorjian.
5Le film s’ouvre sur un écran noir – qui permet de symboliser le seuil entre le monde des vivants et le passage dans le cinéma de l’au-delà où officie Stan –, sur l’empêchement de tout ce qui pourrait venir s’offrir au regard du spectateur, au profit d’une posture d’auditeur. Les mots de ce nouvel Alcandre résonnent en voix off : « The story doesn’t end when you get here… like you think it might. All the mortal pieces have scattered, but the impressions remain. Every last one of them4. » La question du lien entre l’immatérialité et la matérialité qui anime l’œuvre cornélienne est donc exprimée liminairement, et se retrouve condensée autour d’un seul mot, dans le double sens qu’il revêt : impression. La confusion des frontières traditionnelles entre l’immatériel et le matériel est en effet notamment sensible dans ces vers d’Alcandre, qui semblent propres à résumer tout le processus dynamique de L’Illusion comique, processus que suit également l’adaptation cinématographique :
Toutefois si votre âme était assez hardie,
Sous une illusion vous pourriez voir sa vie,
Et tous ses accidents devant vous exprimés
Par des spectres pareils à des corps animés,
Il ne leur manquera ni geste, ni parole5.
6Ainsi, l’œuvre de Michael A. Goorjian présuppose que la mort, la fin de la matérialité humaine, ne marque pas pour autant la fin du drame. La vie humaine imprime ses émotions jusqu’à devenir film. L’immatériel se matérialise, ce que manifestent les images du générique qui suit immédiatement les paroles de Stan : la caméra évolue dans les rayons d’une immense vidéothèque où se trouvent stockées des bobines qui sont autant d’existences humaines, avant de nous présenter les deux techniciens qui assurent le fonctionnement de ce cinéma proprement extra-terrestre. Le premier se caractérise d’emblée par la réalisation de tours de magie, dans un rappel évident du masque d’Alcandre. Le second, Stan, projectionniste des films-vies, prépare la séance de Donald, qui s’apprête à vivre les derniers instants de sa dernière bobine, c’est-à-dire vivre la fin de son expérience terrestre. Transgressant les frontières entre les espaces du vivant et de l’au-delà, Stan se rend dans la chambre de Donald pour le faire basculer merveilleusement de l’autre côté de l’écran, et le ramener à ses côtés dans le lieu auquel il appartient, le cinéma.

Capture d’image représentant l’écran qui apparaît à Donald dans sa chambre,
Illusion (Michael A. Goorjian, 2004), 15 min. 20 sec.

Capture d’image représentant l’écran qui apparaît à Donald dans le cinéma,
Illusion (Michael A. Goorjian, 2004), 38 min. 55 sec.
7Travaillant sur une symétrie topographique, l’écran devient alors l’élément qui assure le passage de l’art à la vie, et inversement. Il amorce un mouvement de confusion des seuils, et rend poreuse la distinction entre illusion et réalité. Une fois transporté dans la salle de cinéma, Donald demande à Stan s’il est mort, mais ce dernier lui répond simplement qu’il est « au cinéma ». Nous retrouvons ici, dans le lien qui se crée entre lieu d’accès à la fiction des images et lieu de mort, l’évocation magique d’un art qui permet « d’assembler […] les vivants et les morts6 », selon l’expression de Pridamant à la fin de L’Illusion comique qui consacre l’essence merveilleuse des arts du spectacle et la toute-puissance de leur enchantement. Le spectacle, par le ravissement de son illusion, assemble les spectres et les êtres charnels, l’immatériel et le matériel, l’essence et l’apparence.
8Stan décrit ensuite à Donald le fonctionnement de ces impressions, gravées par les vies humaines : « When people live their lives, it’s recorded. […] The deeper things, the significant things, burn an impression and it becomes an actual record. […] Just like a movie. And, just like a movie, some are flops, some are funny, some are sad, some are romantic… it all depends upon who’s starring in it7. » Ce faisant, Stan explicite la thématique du cinéma du monde comme transposition, ou peut-être appropriation, moderne, de celle du théâtre du monde. Ainsi, le monde est un cinéma, et la vie humaine un film. La transgénéricité potentielle des expériences humaines n’est d’ailleurs pas sans rappeler le mélange des genres dans L’Illusion comique, et plus généralement dans la dramaturgie shakespearienne, qui semble conditionner l’approche américaine du traitement d’enjeux qui peuvent être qualifiés de « baroques ». Georges Forestier envisage précisément la pièce de Corneille comme une « profession de foi du théâtre “baroque”8 », qui correspond à une esthétique et une dramaturgie pré-classiques, à une « vision du monde » fondée sur les notions de théâtralité et de dédoublement :
Le théâtre dans le théâtre, c’est d’abord l’expression du théâtre du monde, et, partant, c’est le théâtre gagné par la théâtralité. C’est aussi l’expression d’une mentalité qui se complait dans le même, dans le double : ressemblances et fausses ressemblances. Le théâtre dans le théâtre, c’est le théâtre qui se dédouble. […] Étant la transposition scénique de la thématique du theatrum mundi, la technique du théâtre dans le théâtre met tout particulièrement en valeur les thèmes de la confusion entre être et paraître, entre vivre et tenir un rôle, entre la réalité et le jeu9 […].
9C’est une telle vision du monde, appropriée à l’actuelle ascendance de l’image cinématographique sur l’image théâtrale, qui se donne à voir à travers le développement de la thématique d’un cinéma du monde.
10Durant la projection des séquences du film intérieur, de nombreux plans sur le visage de son premier spectateur, Donald, permettent de suivre ses émotions, dans la logique d’une traduction filmique de la présence scénique de Pridamant assistant au spectacle de la vie de son fils. Mais lors de la dernière projection, l’émotion est telle qu’une intervention orale de Donald vient rompre le rapport de séparation et d’autonomie qu’entretenaient jusqu’alors réciproquement le film-cadre et le film intérieur. À ce point de l’intrigue, cette tentative d’intrusion du film-cadre dans le film intérieur n’est effective qu’en paroles et non en actes, puisque la posture spectatorielle reste encore marquée par l’impuissance à agir sur le spectacle qui se déroule devant ses yeux. Donald assiste à l’assassinat de son fils et, contrairement au choix que fait Corneille, cette mort est à considérer comme réelle dans l’œuvre de Michael A. Goorjian, qui supprime l’ultime degré de l’illusion.

Capture d’image représentant la réaction du père face à la mort du fils,
Illusion (Michael A. Goorjian, 2004), 1 h 30min. 55 sec.
11Le désespoir du père est alors sensible dans l’élan pathétique qui le saisit (il se lève pour la première fois, malgré sa condition qui le contraint à l’alitement) et le pousse à vouloir établir un impossible dialogue entre le spectacle et son spectateur : il s’adresse aux images qu’il perçoit, tentant de communiquer avec son fils à travers l’écran. Il s’agit d’un moment doublement pathétique, puisque la douleur de la mort de Christopher est dédoublée par la souffrance du spectateur intra-filmique, modèle compassionnel pour tout spectateur d’Illusion.
12Même si la fin ne révèle pas le fils comédien (car c’est davantage la vie elle-même qui est à considérer comme une illusion ici), le souffle thérapeutique qui animait la pièce de Corneille opère toujours, bien que de manière différente, dans l’adaptation cinématographique, permettant un dénouement qui réunit également l’art et la vie, en ouvrant la voie à une sagesse supérieure. Lorsque Donald affirme qu’il ne peut supporter une telle fin parce qu’il aime son fils, suivant le principe de la révélation salvatrice, Stan lui offre la possibilité de réintégrer son existence terrestre (et donc, sa dernière bobine) pour quelques instants afin d’empêcher la mort de Christopher. Des fragments de séquences du film intérieur se trouvent projetés à nouveau, mais cette fois-ci à l’intérieur du film-cadre, puisque les deux niveaux de représentation se trouvent dès lors réunis. Le père parvient à transmettre un message qui sauve la vie de son fils : l’art et la vie sont ultimement à la fois agis et agents l’un par l’autre, l’un sur l’autre. La vie a agi sur l’art, puisque Donald change le film-vie de son fils, autant que l’art a agi sur la vie, puisque c’est par la projection filmique qu’il a appris l’amour paternel. Cette représentation de la puissance émotionnelle rédemptrice ou salvatrice de l’art reste assez proche de l’esprit de la leçon finale de L’Illusion comique, même si elle évacue le rôle déterminant du logos au profit de l’exploitation d’un pur pathos. Donald peut donc mourir l’esprit tranquille, et nous le retrouvons à nouveau dans la salle de cinéma céleste, d’où il exprime finalement à Christopher tout son amour et sa fierté à travers l’écran. Le dernier regard du fils, face caméra, semble bien attester que le message a traversé l’écran, que l’art, la vie et la mort se voient ultimement réunis. La projection s’achève, la bobine – étiquetée comme la dernière de Donald – peut trouver sa place parmi les rayons de l’immense vidéothèque que le générique d’ouverture nous dévoilait et qui constitue spéculairement la dernière image du film.
13Lors de la projection de la mort de Christopher, Stan revient sur la thématique du cinéma du monde comme appropriation moderne du théâtre du monde, en reprenant pour les amplifier les idées qu’il exprimait déjà au début de l’œuvre : « All that’s ever left of a person is what’s recorded. […] A few lines, a few scenes, and you’re in the can. [..] Deep down, everyone knows all we are is a brief flicker on a screen in the dark… an illusion10. » Il paraît difficile, après un tel énoncé, de ne pas renvoyer à l’une des formulations les plus célèbres de cette thématique, telle qu’elle se présente dans Macbeth de Shakespeare :
Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more11.
14C’est effectivement bien plus Shakespeare que Corneille qui semble servir d’hypotexte aux dialogues d’Illusion de Michael A. Goorjian. Le réalisateur s’approprie le dispositif cornélien, pratiquement sans reprendre le contenu de L’Illusion comique : aucun vers de la pièce de Corneille n’est donné à entendre, et l’œuvre est vidée de toute charge polémique, puisqu’elle supprime la démonstration épidictique et judiciaire d’Alcandre en faveur des arts du spectacle. Certes l’intérêt dramatique se noue autour de la relation père-fils, mais suivant une approche moderne et psychologisante qui explique l’inflation de l’importance des enjeux de la pièce-cadre au détriment des éléments propres à la pièce intérieure, qui ne sont plus traités de façon autonome. Toutefois, même si ces derniers font l’objet d’une réduction, ils ne disparaissent pas tout à fait pour autant, comme en témoigne la subsistance du personnage de Matamore.

Capture d’image représentant la transposition du personnage de Matamore,
Illusion (Michael A. Goorjian, 2004), 59 min. 44 sec.
15Dans sa version cinématographique, ce soldat fanfaron typique de la tradition théâtrale se métamorphose en artiste performeur, toujours auréolé d’une gloriole ridicule et caractérisé par une grandiloquence vaine. Figure de l’« artiste » contemporain creux et vaniteux (il ne réalise lui-même rien et se contente de la perception de son ethos rayonnant), il reste marqué par une puissance grotesque, d’emblée sensible d’un point de vue onomastique : Michael A. Goorjian le renomme en effet « Mortimer Malalatête ». Son rôle dans le film est cependant appréhendé de façon plutôt anecdotique.
16Le mouvement d’appropriation de L’Illusion comique par Michael A. Goorjian peut donc se comprendre comme l’insertion et le développement d’un texte shakespearien – qui inscrit l’œuvre dans un renvoi à la mémoire culturelle et populaire du monde anglophone – au sein d’un dispositif cornélien. Tout se passe ici comme si Corneille, pour être approprié et acculturé au cinéma anglophone, devait en quelque sorte fusionner avec la langue de Shakespeare. Cette appropriation retravaille donc « l’étrange monstre12 » de Corneille d’une façon encore plus « monstrueuse », au sens littéral, puisque la thématique du cinéma du monde qui est au cœur du film semble procéder d’un processus d’hybridation entre les écritures cornélienne et shakespearienne, aboutissant à l’accumulation au sein d’une même œuvre des grands thèmes de la vision « baroque » du monde. La métaphore du théâtre du monde ayant notamment été utilisée par les dramaturges de l’âge dit « baroque » pour célébrer le rapport analogique du théâtre et du monde, l’harmonie du microcosme humain et du macrocosme suprahumain, et mettre en garde dans le même temps contre une certaine vanité que pourrait développer l’être humain à se penser comme réalité absolue du monde. Un élan du même type constitue la force principielle de son appropriation moderne en métaphore du cinéma du monde, et cette idée se retrouve notamment chez Jean Baudrillard, lorsqu’il évoque la possibilité que nos yeux ne soient qu’un négatif, dont nous serions dépossédés à notre mort et qui serait ensuite développé pour être visionné dans une sorte de cinéma infernal ou bien dispersé dans le vide sidéral13. La dramaturgie et la poésie shakespeariennes – qui imprègnent de façon privilégiée la mémoire et l’imaginaire culturels anglophones – reprennent régulièrement cette tension métaphorique14, dont voici un autre exemple, tiré du sonnet 15 :
That this huge stage presenth naught but shows
Whereon the stars in secret influence comment15.
17Ainsi, le commentaire que font les étoiles de chaque scène de la vie humaine représentée (pratique courante du théâtre de l’époque) nous renvoie à la structure chorale à enchâssement décomposé emblématique de L’Illusion comique, reprise et amplifiée par Michael A. Goorjian dans Illusion. À l’évocation de cette pratique se joint l’idée que le commentaire stellaire s’effectue de manière occulte et suprahumaine, ce qui se retrouve dans l’adaptation cinématographique à travers la mention, à plusieurs reprises, du concept ésotérique des « enregistrements akashiques », qui fonctionnement comme une pellicule cosmique sur laquelle s’enregistrent les événements du monde.
18Chez Michael A. Goorjian, l’appropriation de L’Illusion comique passe principalement par la reprise de la structure cornélienne qui permet d’exposer la magie de l’art à partir d’un lieu marginal, à l’écart de la réalité du monde (une grotte ou un cinéma céleste), dans une sorte d’épochè, où une figure démiurgique et psychagogique organise un spectacle initiatique dans le but d’élever celui qui y assiste. Dans les deux cas, ce dernier apprend de manière coessentielle la valeur de l’art et la valeur de la vie, inscrivant l’œuvre dans la catégorie des « comédies initiatiques », pour reprendre Georges Forestier :
Guérir un homme de ses préjugés ou de ses défauts, l’initier à la sagesse ou à une sagesse supérieure, ou, plus simplement, lui enseigner la vertu, au moyen d’un spectacle surnaturel ou théâtral, que suscite ou présente un personnage doté d’une sagesse supérieure et, le plus souvent, de pouvoir démiurgiques, telles sont les constantes qui définissent cette catégorie. […] [Alcandre] dispose ses sortilèges pour sortir le Spectateur de son errance : il est la conscience initiée qui présente à la conscience aveugle le spectacle du monde – « l’illusion comique » – et qui tâche à le faire naître à une réalité supérieure, celle du théâtre16.
19Stan incarne bien une appropriation moderne d’Alcandre, qui fait naître Donald à la réalité supérieure du cinéma, à partir d’un lieu pourtant caractérisé par son obscurité. Il s’agit alors manifestement d’une inversion du dispositif de la caverne décrit par Platon au livre VII de sa République, où les hommes qui n’ont pas encore accédé à la sagesse de la connaissance vraie sont prisonniers des pouvoirs de l’illusion, séduits par des simulacres. Si la topographie et le fonctionnement des dispositifs cornélien et platonicien sont dans une certaine mesure similaires, c’est par contre leur valeur aléthique qui se voit renversée, conformément à la façon dont la dramaturgie dite « baroque » peut célébrer l’effet et les bienfaits du spectaculaire. C’est en ce sens que nous pouvons parler d’une « anti-caverne » mise en place par Corneille, lieu d’expérience qui aboutit à l’ultime conseil paradoxal d’Alcandre : « N’en croyez que vos yeux17 », alors que ce sont précisément nos yeux qui nous soumettaient à l’illusion. Mais il s’agit chez Corneille d’une illusion temporaire, soumise à un telos, qui n’apparaît qu’à la condition de sa propre disparition, qui se construit sur la nécessité in fine de révéler, pour la dépasser, sa propre nature illusoire. L’anti-caverne d’Alcandre peut donc être le lieu d’accès à la Vérité, par un aveuglement, un éblouissement, fécond, qui ne tend qu’à dessiller les paupières de son spectateur. Certes, Stan lui aussi aveugle un personnage encore lui-même aveugle (quant à certaines vérités) pour mieux lui rendre la vue par la suite, mais la Vérité d’Alcandre n’est pas celle de Stan. Après s’être adressé à la sensibilité de Pridamant, Alcandre dévoile l’illusion et s’adresse également à son intelligence. L’utilité du spectacle illusoire est comprise dans sa capacité à engager une activité rationnelle.
20Si L’Illusion comique crée, en quelque sorte, une caverne du logos, son appropriation filmique se déploie plutôt dans une caverne du pathos. Illusion, en effet, ne fait jamais sortir son spectateur de la sphère émotionnelle pour le faire entrer dans la sphère rationnelle. De manière pratiquement inverse à ce qui se passe chez Corneille, les éléments rationnels, quand ils sont présents, sont au service de la puissance émotionnelle, là où L’Illusion comique emploie l’émotion au service de la raison. L’œuvre, ainsi appropriée, délaisse toute valeur démonstrative pour offrir une expérience esthétique et pathétique avant tout. En cela, à l’autre pôle de la situation initiale, face à Platon, elle s’inscrit dans le plein potentiel hollywoodien de L’Illusion comique, conformément à la régulière utilisation du procédé dramatique de l’illusion par l’industrie cinématographique. D’une grande puissance spectaculaire, il lui offre, par la confusion des plans de représentation et de réalité qu’il permet, un moyen sûr d’éblouir son spectateur. Pour n’en citer que quelques-uns, Matrix, Fight Club ou encore Inception sont autant de films qui, sans cesse, nous invitent à « n’en croire que nos yeux », tout en nous dévoilant dans le même temps que nos yeux s’étaient trompés, s’étaient laissés éblouir par l’illusion. Ainsi, au-delà de son éventuelle appropriation par des productions d’allures hollywoodiennes, c’est le dispositif cornélien lui-même qui semble particulièrement approprié à Hollywood.
1 L’expression « entre Platon et Hollywood » est empruntée à Jean Serroy. C’est suivant cette perspective qu’il invite à situer L’Illusion comique dans Les Nouveaux Chemins de la connaissance de France Culture (émission diffusée le 14 juillet 2011).
2 Illusion, Michael A. Goorjian, États-Unis, 2004, 106 min.
3 Georges Forestier, Le Théâtre dans le théâtre sur la scène française du xviie siècle, Genève, Droz, 1981, p. 63.
4 Le film n’étant pas distribué en Europe, et ne proposant aucun sous-titrage francophone, nous traduisons : « L’histoire ne s’achève pas lorsque vous arrivez ici… comme vous pourriez le croire. Tous les fragments mortels se sont dispersés, mais les impressions subsistent. Jusqu’à la dernière d’entre elles. »
5 L’Illusion comique, dans Œuvres complètes, t. I, éd. Georges Couton, Paris, Gallimard, 1980, v. 149-153.
6 Ibid., v. 1752.
7 « Quand les gens vivent leur vie, c’est enregistré. […] Les choses les plus profondes, les plus importantes, gravent une impression, et elle devient un véritable enregistrement. […] Comme un film. Et, comme pour les films, certains sont des fiascos, d’autres drôles, tristes ou romantiques… cela dépend de qui joue dedans. »
8 Op. cit., p. 245.
9 Ibid., p. 341-345.
10 « Tout ce qui reste d’une personne est ce qui a été enregistré. […] Quelques répliques, quelques scènes, et vous finissez dans la boîte. […] Au fond, chacun sait que nous ne sommes qu’un bref scintillement sur un écran dans le noir… une illusion. »
11 Macbeth, dans Œuvres complètes, Tragédies II, éd. Michel Grivelet et Gilles Monsarrat, Paris, Robert Laffont, 1995, V, 5, v. 23-25. Traduction par Jean-Claude Sallé : « La vie n’est qu’une ombre qui passe, un pauvre acteur qui parade et s’agite pendant son temps sur scène et puis qu’on n’entend plus. »
12 Selon l’expression bien connue qui ouvre l’Épître dédicatoire de L’Illusion comique, op. cit., p. 613.
13 Jean Baudrillard, Cool Memories 1980-1985, Paris, Galilée, 1988, p. 83.
14 Voir par exemple Shakespeare, le monde est une scène, anthologie proposée et commentée par Georges Banu, traduction et introduction par Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, 2009.
15 Sonnets, dans Œuvres complètes, Tragicomédies II, Poésies, éd. Michel Grivelet et Gilles Monsarrat, Paris, Robert Laffont, 2002, p. 774. Traduction par Robert Ellrodt : « Et que dans ce théâtre immense, les étoiles en secrète influence commentent chaque scène. »
16 Op. cit., p. 79 et p. 306.
17 Op. cit., v. 1815.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 24, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/821.html.
Quelques mots à propos de : Cécilia Laurin
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
À la suite d’un parcours en études théâtrales et en philosophie, Cécilia Laurin soutient en décembre 2019 une thèse sur la tension entre éthique et poétique chez les « admirables criminels » cornéliens (Sorbonne Nouvelle, dir. Gilles Declercq). Ses travaux questionnent plus généralement les enjeux philosophiques et esthétiques de la rhétorique du crime et de la représentation du mal, mais aussi les rapports de l’être au paraître. Elle a notamment publié « La querelle d’Horace ou le problème du criminel vertueux : aspects éthiques, politiques et esthétiques d’une dispute fratricide », dans Arrêt sur scène / Scene Focus, 3, 2014, et « Du héros sériel à la sérialité du héros : le spectateur face à l’acteur multiplié (Battlestar Galactica, Fringe, Orphan Black) », dans Télévision, 9, 2018.
