Sommaire
Appropriations de Corneille
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
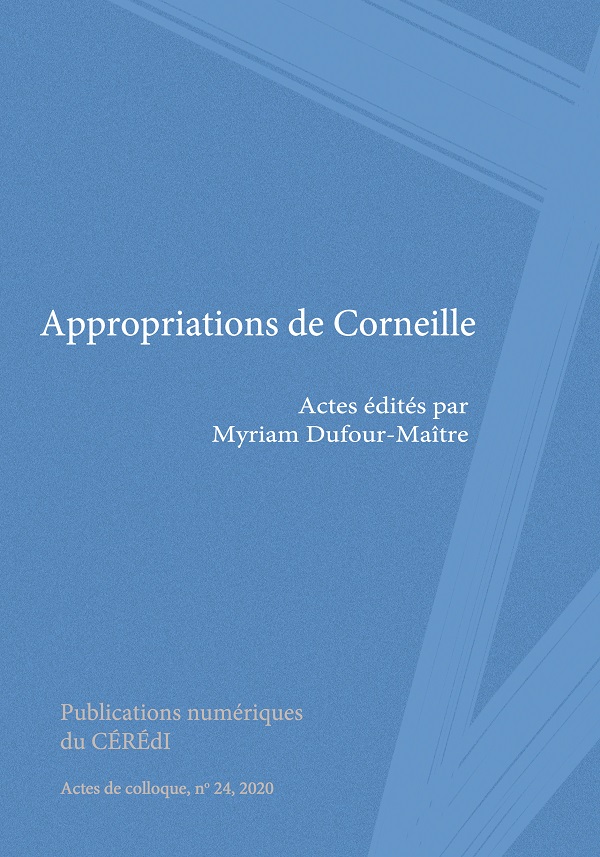
- Myriam Dufour-Maître Remerciements
- Collectif Le Festival Corneille de Barentin (1956-1975) et le Mouvement Corneille
- Myriam Dufour-Maître Introduction
- Sylvain Ledda Polyeucte, ou comment mettre en scène la violence ?
- Hélène Merlin-Kajman Comment déterminer ce qui est « religion » en littérature ? Réflexions à partir du cas de Polyeucte de Corneille
- Liliane Picciola De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
- Jacques Téphany Corneille, l’autre fondateur du TNP
- Roxane Martin Horace à l’épreuve des révolutions : les remaniements du texte et l’édification d’un Corneille patriote (1789-1799 vs 1848)
- Claire Carlin L’Illusion comique sur la scène du monde anglophone, entre traduction et « adaptation libre »
- Cécilia Laurin L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
- Julia Gros de Gasquet Filmer L’Illusion comique, réécrire Corneille ? À propos du film de Mathieu Amalric à la Comédie-Française (2010)
- Noëmie Charrié Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
- Jean-François Lattarico De l’Horace (1641) à l’Orazio (1688). Prémisses de la réforme dans le premier dramma cornélien per musica
- Sarah Nancy Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse
- Mariane Bury Le Corneille des historiens de la littérature au xixe siècle
- Michal Bajer Les contextes de la traduction. L’établissement de la tradition cornélienne en Pologne au tournant romantique : discours critique, pratiques éditoriales, péritextes
- Lise Forment Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
- Bénédicte Louvat « L’invention » du dilemme cornélien
- Jean-Yves Vialleton Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
- Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval Un Corneille à l’usage de la jeunesse au tournant des xviiie et xixe siècles : quelques jalons
- Beate Langenbruch Corneille, auteur de concours
- Hélène Bilis Corneille aux États-Unis, ou quel « auteur classique » pour les campus américains ?
Mises en scènes et actualisation
De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
Liliane Picciola
L’article étudie la mise en scène par Arlette Téphany (1992, reprise en 1997), qui renouvelle l’interprétation de Cléopâtre en plaçant au centre la relation ambiguë de la mère à ses fils. Le caractère historique et non pas naturel de « l’amour maternel », le combat acharné que la reine a livré pour sauver le trône, sa joie vite déçue de reconnaître en ses enfants la même ambition, viennent nuancer le portrait du monstre consommé dans l’art de la manipulation.
1On sait que, parmi toutes les pièces que Corneille avait composées avant 1660, Rodogune, représentée pour la première fois pendant l’hiver 1645-1646 et imprimée en 1647, était sa préférée. À l’occasion de la nouvelle édition collective de son théâtre qu’il réalisa cette année-là, il écrivait en effet dans l’« Examen » qu’il donna de sa tragédie :
On m’a souvent fait une question à la Cour : quel était celui de mes poèmes que j’estimais le plus, et j’ai trouvé tous ceux qui me l’ont faite si prévenus en faveur de Cinna ou du Cid que je n’ai jamais osé déclarer toute la tendresse que j’ai toujours eue pour celui-ci, à qui j’aurais volontiers donné mon suffrage1 […].
2Ce sont surtout les arguments stylistiques et dramaturgiques justifiant cette préférence qu’on a retenus : Corneille souligne en effet « la nouveauté des fictions, la force des vers, la facilité de l’expression, la solidité du raisonnement, la chaleur des passions, les tendresses de l’amour et de l’amitié » ; il apprécie la montée continue de l’intérêt et la quasi perfection du respect des règles. On a prêté moins d’attention à une première explication, moins rationnelle, qu’il fournissait de cette préférence et qui repose pourtant sur une comparaison tout à fait adaptée au sujet de cette tragédie, le rapport entre parents et enfants : « Cette préférence est peut-être en moi un effet de ces inclinations aveugles qu’ont beaucoup de pères pour quelques-uns de leurs enfants plus que pour les autres2. » Cette mention de la force de la relation unissant des membres d’une famille nous paraît avoir été inspirée au poète – consciemment ? inconsciemment ? – par les idées-mêmes qu’il a agitées dans Rodogune, car les plus fortes des émotions qu’il suscite dans cette pièce interrogent bien les liens qui unissent, non pas un père, mais une mère et ses enfants. On sait que le sens du mot « inclination » a changé, qu’il ne désignait pas alors un léger penchant mais, si nous nous référons au Dictionnaire universel de Furetière (1690), « une pente, une disposition naturelle de l’âme à faire quelque chose ». Aussi pourrait-on être tenté de voir dans cette « inclination » un synonyme du mot « nature », d’autant plus que le qualificatif « aveugle » semble connoter ici le caractère irrépressible d’un instinct. Cependant l’observateur lucide des comportements qu’était Corneille contredit lui-même cette interprétation : « l’inclination aveugle » opérerait avec plus ou moins de force. Étrange affection instinctive, qui ne serait pas la même pour chacun des enfants ! Comparant Rodogune à l’ensemble de son œuvre, les enfants conçus par sa plume, le poète avance aussitôt une explication : « peut-être y entre-t-il un peu d’amour-propre à cause des incidents surprenants qui sont purement de mon invention et n’avaient jamais été au théâtre. » Au fond, Perrault exprimera plus crûment la même idée dans « Le petit Poucet », en commentant un geste d’affection de la bûcheronne quand elle retrouve son fils aîné, qu’elle avait cru perdre avec les autres dans la forêt : « Ce Pierrot était son fils aîné qu’elle aimait plus que tous les autres parce qu’il était un peu rousseau et qu’elle était un peu rousse3 .» Voici que la voix de nature se trouve singulièrement couverte par celle de l’amour de soi ! De surcroît, il nous apparaît que l’image dont use Corneille pour évoquer la fabrique de son œuvre éclaire elle-même à son tour la conception de la famille : le rêve des parents consiste souvent à considérer dans leur enfant la réplique d’eux-mêmes qu’il pourrait produire ; ils s’efforcent de le façonner en vue de cette similitude, sans rien accorder à son aspiration personnelle : nous voilà bien au cœur de l’action de Rodogune.
3Peut-on considérer cette pièce comme une tragédie d’horreur, d’horreur morale s’entend, cette émotion se trouvant provoquée par la haine meurtrière vouée par une mère à ses enfants ? Faut-il y voir surtout une tragédie hautement politique mettant en valeur les procédés tyranniques d’une usurpatrice implacable ? Les deux points de vue s’affrontent sur la pièce. N’y aurait-il pas, en rapport avec la manière dont Corneille parle de sa pièce dans l’« Examen », d’autres facettes à envisager sans pourtant négliger ces deux-là ? Il nous a semblé que la mise en scène réalisée par Arlette Téphany au CDN de Limoges en 1992 et reprise en 1997 à Paris au Petit Montparnasse a su faire porter sur cette tragédie4 un regard nouveau, qui lui valut cette appréciation laudative de Frédéric Ferney dans Le Figaro : « Quoi de plus palpitant que le spectacle de cette mamma souveraine, mère aberrante, sublime, dénaturée, suscitant l’horreur et le rire5 ? »
4Le terme étonnant de mamma m’a incitée d’abord à m’interroger sur la perception que le public de l’époque pouvait véritablement avoir de Cléopâtre, héroïne noire de la pièce, en qualité de mère ; il convenait ensuite d’étudier ensuite la « mise en scène énergiquement inspirée6 » d’Arlette Téphany en insistant sur la forte complémentarité décelable entre le décor et le jeu pour expliquer l’effet simultané d’horreur et de rire, souligné par le critique théâtral du Figaro et produit par une rare et étonnante interprétation du personnage principal.
5Dès l’avertissement précédant la première édition de la tragédie, Corneille a rappelé qu’en dépit du titre, le personnage principal en était bien Cléopâtre, régnant par intérim sur la Syrie ; elle n’est jamais nommée par son prénom mais évoquée comme « la Reine », pour éviter une confusion avec Cléopâtre d’Égypte. Or cette désignation contribue à la faire percevoir essentiellement comme femme de pouvoir et fort peu comme simple femme, ce qui éloigne en même temps l’aspect maternel qui pourrait être le sien. Pour se référer à elle, dans le même avertissement, le poète emploie l’expression « cette seconde Médée ». Ce rapprochement est-il si éclairant sur la sombre reine de Syrie ?
6On peut évidemment rapprocher Cléopâtre et la terrible magicienne de Colchide du fait qu’il s’agit bien de deux criminelles, capables de s’en prendre à leurs enfants pour mieux exercer une vengeance indirecte contre un époux qui les a offensées et qui choisissent d’avancer masquées dans l’accomplissement de leur vengeance. Médée est toutefois une femme jalouse. En revanche, bien que son premier mari, le roi Nicanor de Syrie, ait tenté d’épouser la princesse parthe Rodogune à ses yeux, Cléopâtre avoue à sa confidente Laonice qu’elle n’est jalouse que du trône dont la jeune Parthe est censée l’écarter pour l’occuper elle-même : en effet, selon les traités, et après l’assassinat du roi, elle doit épouser un des héritiers du défunt, Antiochus ou Séleucus, ses fils jumeaux. Par ailleurs, l’appellation « seconde » Médée ne semble pas faire envisager une sœur de la première mais une Médée modernisée, dont les pouvoirs magiques seraient remplacés par le pouvoir politique, voire tyrannique. Enfin, les enfants de la magicienne étaient tout jeunes tandis que Séleucus et Antiochus sont en âge de régner : le fait qu’il s’agisse de grands adolescents ne devrait-il pas rendre Cléopâtre moins scandaleuse que Médée dans le crime qu’elle accomplit, parce que ses jumeaux, d’âge moins tendre, attireraient moins la pitié ? Il est vrai qu’Agavé, dans Les Bacchantes d’Euripide, ne souffre pas moins, quand, après un délire bachique provoqué par Dionysos, elle découvre avoir déchiré son propre fils, Penthée, pourtant déjà roi de Thèbes ; et que dire de la douleur d’Hécube devant le sacrifice de Polyxène, déjà jeune fille ? En fait, Corneille ne pousse pas très loin sa comparaison entre Cléopâtre et Médée, ne la reprenant pas dans l’« Examen de 1660 ». Lorsqu’il réfère ailleurs à une tragédie pour la rapprocher de sa pièce préférée, c’est toujours Électre et non pas Médée qu’il évoque7 : c’est pourquoi Marc Fumaroli voit d’Électre à Rodogune la transformation d’un mythe païen en mythe chrétien8, à condition toutefois de ne considérer que les personnages, Oreste et les jumeaux de Cléopâtre, qui, eux, ne tuent pas leur mère, pas même par agnition9 ; en la reine de Syrie, il voit plutôt une réincarnation de la Junon de L’Énéide, donc une créature peu humaine.
7Que disait Corneille de Médée en qualité de figure centrale de sa première tragédie, imitée de Sénèque10 ? D’après l’épître dédicatoire de la première édition de la pièce, elle est « méchante », fait voir « le crime en son char de triomphe », et le rôle du personnage y est présenté comme « un beau portrait d’une femme laide ». Cependant l’« Examen » de la même tragédie évoque en 1660 l’injuste violence faite à la magicienne par Créon et estime que le roi de Corinthe et sa fille émeuvent aussi peu par leurs gémissements que par leurs malheurs quand la robe de Médée les brûle tous deux ; il suggère même la sympathie qu’on éprouve pour cette dernière : « La raison est qu’ils semblent l’avoir mérité [leur malheur] par l’injustice qu’ils ont faite à Médée qui attire si bien de son côté toute la faveur de l’auditoire qu’on excuse sa vengeance ». Corneille va même jusqu’à évoquer la « compassion » qu’on peut ressentir pour l’héroïne éponyme : l’idée peut étonner, même si alors le poète n’évoque pas le meurtre de ses deux enfants. Au contraire, dans le Discours de la tragédie, il note que l’auditeur n’a point de « commisération » pour Cléopâtre. C’est que Médée tuait des enfants que le poète tragique lui faisait aimer profondément. Elle en parle dans la tragédie en disant « ce que j’aime11 », elle les voit comme les « petits portraits12 » de Jason, proteste contre la volonté de Créon de les séparer d’elle en s’écriant : « Barbare volonté qui m’arrache à moi-même » ; seule, elle parle d’eux comme des « chers fruits de mon [son] amour13 » et reconnaît en elle des « tendresses de mère » ; la pitié qui l’étreint la fait longtemps hésiter avant de commettre le meurtre de ces deux fils que, de toutes les manières, elle est condamnée à ne plus voir, et elle n’y parvient qu’en s’élevant en quelque sorte au-dessus de la condition des humains, de leurs lois et de leurs souffrances, dans son char tiré par deux dragons.
8Cléopâtre, elle, n’aime pas ses fils et a fort bien supporté de s’en séparer en les envoyant à Memphis et en y prolongeant leur séjour au-delà du nécessaire. Faut-il pour autant ne voir dans son personnage que monstrueuse majesté ?
9Arlette Téphany, qui n’a pas seulement mis en scène la tragédie mais incarné la reine de Syrie, m’a confié14 qu’ayant vu autrefois représenter la pièce avec Edwige Feuillère dans le rôle principal15, elle a tenu à éviter de le jouer elle-même en « grande dame16 » car la lecture de la pièce lui faisait percevoir Cléopâtre comme une « terrienne », qui aime toucher tout ce qu’elle possède. Le sentiment d’« admiration », dont Corneille parle dans le Discours de l’unité et des parties du poème dramatique, le terme désignant une surprise fascinée sans valeur laudative17, est-il en effet le seul que la reine suscite ? Rappelons ce qu’écrit notre poète :
Cléopâtre dans Rodogune est très méchante, il n’y a point de parricide qui lui fasse horreur pourvu qu’il la puisse conserver sur un trône qu’elle préfère à toutes choses tant son attachement à la domination est violent ; mais tous ses crimes sont accompagnés d’une grandeur d’âme qui quelque chose de si haut, qu’en même temps qu’on déteste ses actions, on admire la source dont elles partent18.
10Semble militer en faveur de cette perception de Cléopâtre par son créateur le fait que voir une femme davantage attachée à la domination qu’à ses enfants ne constituait nullement un phénomène rare dans les sphères du pouvoir, et même ailleurs, au xviie siècle : Élisabeth Badinter a bien mis en garde contre le réflexe qui consisterait à considérer l’amour maternel comme allant de soi à cette époque ; dans L’Amour en plus, elle rappelle les refus très nombreux de donner le sein à un enfant alors qu’à l’époque c’était un des gages de sa survie19 et elle souligne avec quelle méfiance ecclésiastiques et hommes de foi envisageaient la relation voluptueuse qui pouvait exister entre le nouveau-né allaité et sa mère, se méfiant même de tout élan de tendresse : c’était le cas de saint Augustin20 et, plus près du xviie siècle, de Vivès21. Elle rappelle que faire élever les enfants loin de soi n’avait rien de scandaleux pour les femmes de l’aristocratie, qui entendaient tenir leur place sociale et mondaine. Dans le Discours de la tragédie, Corneille lui-même nous invite à considérer que bien des mères de son temps, si elles n’étaient pas les meurtrières de leurs enfants, ne leur voulaient pas forcément beaucoup de bien, la possession des terres et des richesses familiales leur semblant visiblement plus douce que la satisfaction de voir les héritiers en jouir :
Il est peu de mères qui voulussent assassiner, ou empoisonner leurs enfants, de peur de leur rendre leur bien, comme Cléopâtre dans Rodogune ; mais il en est assez qui prennent goût à en jouir, et ne s’en dessaisissent qu’à regret et le plus tard qu’il leur est possible. Bien qu’elles ne soient pas capables d’une action si noire et si dénaturée, que celle de cette Reine de Syrie, elles ont en elles quelque teinture du principe qui l’y porta22.
11Yves Castan indique de surcroît qu’une des raisons que les mères avaient de s’attacher à l’héritier était leur dépendance à son égard en cas de décès de l’époux23… Ce qui nous semble insupportable dureté du cœur et excessive force de caractère pouvait être admis bien plus aisément par le public contemporain de la pièce et il n’est pas impossible que le verbe admirer, dans la première évocation de Cléopâtre que nous avons citée, ait recelé une discrète nuance positive.
12Néanmoins Corneille parle bien d’action « dénaturée ». C’est l’épithète qu’emploie aussi François de Rosset pour qualifier la terrible Gabrine, mère meurtrière de son fils adulte, Phalante, dans la vingtième de ses Histoires tragiques24 (1619). Dans le Discours de la tragédie, Corneille souligne également la pitié extraordinaire suscitée par une violence perpétrée dans une situation de « proximité de sang ». Enfin, si bien des mères de haut rang ne se distinguaient nullement par des comportements traduisant un amour maternel, l’image idéale de la mère attachée à l’enfant restait évidemment véhiculée par la dévotion à Marie, portant pensive l’enfant Jésus ou douloureuse près du tombeau du Christ… Ainsi l’horizon d’attente en matière de relation mère / enfant n’était pas bien net : de quoi permettre, voire nécessiter, une « appropriation ».
13De nos jours, quoi qu’il en soit, l’évidence, fausse, de l’existence naturelle d’un amour maternel ne noircit-il pas excessivement le personnage, en faisant une incarnation du mal absolu, ce qui risquerait de réduire la pièce à une opposition de la noire Cléopâtre à la blanche innocence des jumeaux, dans une sorte de mélodrame romantique ?
14La Cléopâtre historique a dû affronter seule, et comme elle le pouvait, avec les armes qui étaient les siennes, des armes féminines, la désertion involontaire du roi Nicanor : dans un pays qui semblait voué au chaos, elle a assuré par son remariage avec son beau-frère une sorte de permanence de l’État syrien. Dominant son second époux, elle a pris plaisir à exercer le pouvoir, fût-ce par personne interposée ; elle continue d’utiliser les mêmes armes pour le garder après la mort du nouveau roi : dissimulation, habileté, manipulation, crime si besoin. Ce qui choque la candide Laonice, et avec elle, sans doute, le public d’aujourd’hui, c’est qu’elle utilise ces armes-là contre ses propres enfants. Il paraît en effet difficile qu’une femme qui aime ses enfants joue de l’amour maternel… Même surjouer semblerait déjà la preuve qu’on aime moins qu’on ne le dit ! Or Cléopâtre, qui n’était sans doute pas tenue, pour plaire aux spectateurs de l’époque de Corneille, de paraître tendre, joue bel et bien, dès la scène 3 de l’acte II, la mère douce et sacrificielle quand elle affirme à ses fils : « […] mon amour pour vous fit tout ce que je fis25 », alors que le spectateur l’a entendue révéler exactement le contraire à Laonice dans la scène précédente. Cléopâtre feint, manipule, tire les ficelles comme si les princes n’étaient pas ses enfants mais en se servant habilement du fait qu’ils le sont.
15C’est bien la raison pour laquelle Arlette Téphany, outre l’attirance qu’elle avait toujours ressentie vers ce grand rôle, voulut que la comédienne incarnant le personnage se confondît avec le metteur en scène. Cette comédie de l’amour maternel saisissait le public dans sa mise en scène dont Annie Copperman soulignait cependant le « classicisme scrupuleux26 » et la presse en général le raffinement du décor et de l’éclairage. Néanmoins cette incontestable beauté n’empêchait pas, au Petit Montparnasse, qu’un public tendu et attentif, composé pour bonne partie de jeunes gens, laissât éclater certains soirs des rires, brefs, mais comme impossibles à étouffer. Ces rires, soulignés par Frédéric Ferney, survenaient dans une scène de l’acte IV, et la première de l’acte V. Ils jaillissaient visiblement parce que la volte-face de la reine, passant dans la scène 3 du quatrième acte, d’une implacable dureté, face à son fils Antiochus, à la tendresse maternelle la plus émouvante, puis la révélation dans la scène suivante qu’elle avait feint l’attendrissement, paraissaient soudain d’une audace inouïe, énorme ; ils naissaient du sentiment de s’être laissé prendre, ce qui, en l’occurrence, supposait qu’on n’avait pas lu la tragédie au préalable : on riait donc autant de soi que de l’audace de la reine de Syrie. Les rires se renouvelaient devant la froide et jubilante satisfaction de la reine, quand elle se félicite, dès le premier vers du dernier acte, de s’être promptement délivrée de l’encombrant et méfiant Séleucus. Tournant au jaune, devenant nerveux, ils cédaient vite la place au silence : angoisse de la perspective d’un nouveau crime imminent ? confirmation, par cette surenchère elle-même, de la réalité de l’assassinat dont le personnage venait de se vanter et dont les esprits s’étaient d’abord protégés émotionnellement en exprimant par le rire qu’il était invraisemblable ?
16Une mamma, c’est une femme qui, en tant que mère, agit à l’italienne, c’est-à-dire avec un art consommé de l’ostentation de son amour maternel, tout en effusions, tout en pathos, et qui exige en retour, non sans autorité, la soumission à cette affection, notamment de la part d’enfants adultes. Le costume conçu pour Arlette Téphany, qui pourtant ne put à aucun moment de sa vie passer pour une comédienne replète, lui créait en quelque sorte des rondeurs : sans doute à tort, on n’imagine guère une femme hyperactive et dévorée par la passion du pouvoir avec cette silhouette que créait l’abondance de jupons ; contribuait aussi à l’impression une coiffure arrondissant le visage. La présence d’ambition et de sinistres projets n’est que plus saisissante dans un physique qui ferait attendre des mots et des comportements rassurants. Par ailleurs, ce que nous avons dit plus haut du peu de pratique charnelle, si on nous permet l’expression, dans l’exercice de la maternité au xviie siècle n’invalidait pas cette représentation de la reine de Syrie car, si Cléopâtre n’éprouve, en réalité, aucune affection de mère, en revanche, elle sait à merveille la feindre parce que certains la célèbrent, se rapprochant ainsi de ces exceptions dont parle Philippe Ariès27 et, surtout, du dévouement de Marie à son fils divin… Enfin, créer en quelque sorte les conditions physiques d’accueil de la fonction maternelle n’était pas si faux par rapport au xviie siècle même ; car, Séleucus et Antiochus n’étant plus des enfants, ils sont justement tels qu’une aristocrate, voire un père, pouvait les aimer. Citant François Lebrun, Élisabeth Badinter rappelle le violent chagrin manifesté par Henri de Campion et qui avait étonné tout le monde quand, en 1653, il perdit sa fille, âgée de quatre ans. Il s’en excusa en écrivant :
Si l’on dit que ces si vifs attachements peuvent être excusables pour des personnes faites et non pour des enfants ayant incontestablement beaucoup plus de perfections qu’on l’on n’en avait jamais eu à son âge, personne ne peut avec raison me blâmer croire qu’elle eût été toujours de bien en mieux28.
17Sauf pareilles exceptions, l’enfant jeune paraissait peu aimable car sans réaction au péché mais l’adolescent semblait davantage digne d’affection29… Montrer de l’amour maternel à un jeune enfant, c’était surtout consacrer des soins à le faire devenir adulte. Cléopâtre se vante d’avoir ainsi procédé. Elle valorise et fait pardonner son comportement passé – éloignement de ses fils, meurtre de son époux – en faisant « bien sonner ce grand amour de mère30 », qui ne s’imposait pas au xviie siècle et qui paraît naturel aujourd’hui, dans la mesure où elle prétend avoir favorisé en ses enfants les futurs adultes. Au reste, les spectateurs ne pouvaient-ils imaginer que l’ambitieuse ait été capable de choyer ses jumeaux adultes du moment que leurs actions se fussent accordées à ses sentiments et projets ? Ces actions n’étaient, certes, pas de même nature que celles qu’Henri de Campion espérait de ses enfants… Néanmoins, même s’il semblait légitime alors d’aimer des fils devenus presque adultes et de pleurer leur perte éventuelle, on n’attendait pas de rappels verbaux de cet amour, et encore moins des gestes affectueux. De surcroît, l’essentiel du jeu des acteurs reposant au xviie siècle sur la diction, il est probable que, lors des représentation au Théâtre du Marais, cette démonstration d’affection à la fois tardive et précoce – Cléopâtre ne sait pas encore si ses enfants pensent comme elle – se limitait aux mots et à la manière de les prononcer ; les termes affectueux abondent en effet dans la première tirade de Cléopâtre : « mes enfants », « mes fils », « pour vous », « pour vous » ; la réplique s’achève sur une onctueuse bénédiction : « Daigne du juste Ciel la bonté souveraine […] / […] n’épandre sur vous que des prospérités31 ». Était-il légitime de faire plus en représentant la pièce à la fin du xxe siècle ? Or, quand les jumeaux convoqués entraient en scène, la comédienne leur tendait les bras comme pour les attirer vers elle, chaleureuse, dans le geste et dans la voix32.
18On pourrait parler de « sincérité intéressée » de Cléopâtre : et c’est cette sincérité intéressée qui peut dicter à son interprète des gestes grandiloquents de tendresse, à l’italienne.
19Avant d’aller plus loin dans l’évocation du jeu, il convient de décrire le décor, qu’on dut à l’immense talent et à la belle culture de Claude Lemaire, fréquente collaboratrice d’Arlette Téphany mais aussi de la Comédie française ; il était renforcé par les éclairages de ce grand artiste qu’est Jean Grison. D’évidence, ce décor se voulait caravagesque : les costumes de Cléopâtre et de Rodogune étaient dominés par des tons bruns et bordeaux (pourpre symboliquement assombrie ?) ; les deux femmes portaient des chemises blanches avec manches à crevés ; amples effets de drapé. Quant aux jumeaux, ils étaient vêtus de costumes strictement identiques, de tons mordorés. Les jeux d’éclairage valorisaient le clair-obscur : ombre qui cache, lumière qui découvre, rappelant la succession des scènes avec ces contrastes violents entre les dialogues et les monologues de Cléopâtre et le jeu dissimulation / révélation. Le décor avait été conçu au départ pour le vaste plateau du théâtre de Limoges, lieu de la création, mais la taille exiguë de la scène du Petit Montparnasse renforçait l’impression de mystère créée par ces jeux d’ombre et de lumière sur les couleurs.
20Une rampe en arrondi, qui semblait venir d’un palais labyrinthique, peut-être souterrain, emblème de ses complications historiques et psychologiques, débouchait à jardin sur la scène. La partie la plus haute de la rampe était plongée dans la pénombre. De là arrivaient, par-là repartaient tous les personnages.
21Un sol brillant, imitant le marbre, et sur lequel on distinguait une sorte de rose des vents à seize directions, dans les tons verts, bleus et rose foncé, comme en voit non seulement sur les sols mais sur les objets de marqueterie provenant du Moyen Orient33. Malgré le dénuement du décor, impression de somptuosité due à ce sol et à la splendeur des costumes : Cléopâtre aime le faste. Au Ve acte, un peu plus de solennité encore. Le centre de la rose des vents était alors occupé par un siège de bois un peu travaillé, mais léger, dans lequel on devait reconnaître un trône34. C’était celui de Cléopâtre, c’était celui que devrait occuper Antiochus. Centre de la rosace, centre des pensées de la reine35…
22Face au public, un miroir en triptyque, dans lequel se reflétaient les personnages36. On sait que les metteurs en scène d’aujourd’hui adorent les miroirs mais, s’il est une pièce pour laquelle le miroir convient, c’est bien celle-ci, qui est placée sous le signe de la ressemblance et de la répétition. Corneille fait d’Antiochus et de Séleucus des jumeaux. Ils n’étaient pas incarnés par les frères Mallet mais par Pierre-Arnaud Juin et Philippe Risler, deux acteurs fort différents : pourtant, outre la similitude de leur costume, celle de leur coiffure, de même que le maquillage de leurs yeux les rendaient fort ressemblants. À ces jumeaux viennent les mêmes idées : renoncer au trône en faveur de l’autre contre la cession de Rodogune et préserver leur amitié ; affection immense et réciproque de l’un pour l’autre ; même évolution : tous deux réalisent qu’aimer Rodogune, c’est vouloir en faire une reine et non pas une sujette. Tous deux aiment la même femme mais il se trouve que c’est aussi celle qu’aimait leur père. Répétition du passé dans le présent, et en deux exemplaires… Qui plus est, l’un d’eux est, selon Rodogune, le « vivant portrait » de Nicanor, ce qui invitait sans doute le public à considérer deux « vivants portraits » du père, peut-être à l’expression du regard près, puisque l’on a affaire à des jumeaux, qu’il est tentant d’imaginer comme « vrais37 ». On a vu que les costumes de Cléopâtre et de Rodogune rapprochaient les deux femmes et l’on connaît la symétrie de leur demande aux fils de Cléopâtre, chacune réclamant la tête de sa rivale dans l’acte II et l’acte III ; leur similitude est dénoncée notamment par Séleucus qui dit de Rodogune, dans la scène 5 de l’acte III : « Une âme si cruelle / Méritait notre mère, et devait naître d’elle38 ». Mais, au-delà de la ressemblance et de la répétition évidente, le miroir convient également aux desseins de Cléopâtre, dont les jeux successifs et contrastés étaient magnifiquement figurés par le sol en rosace dont Claude Lemaire souligne qu’il évoquait un kaléidoscope39 aussi riche que le comportement de Cléopâtre.
23Séleucus, dans la scène 3 de l’acte II, ne croit pas si bien dire lorsqu’il rassure sa mère en lui disant : « Et c’est bien la raison […] que celui de nous dont le Ciel a fait choix / Sous votre illustre exemple apprenne l’art des Rois40 ». Cléopâtre ne voit pas dans ses fils des êtres autonomes mais des instruments de son pouvoir ; elle ne les rappelle de Memphis que pour satisfaire le peuple car « aux champs de Mars / Lâchement d’une femme il suit les étendards41 ». Ils sont en fait le prolongement de sa main ; au départ, elle envisage chacun d’eux comme la possibilité d’un autre soi-même. Ainsi, lorsque les jumeaux manifestent peu d’empressement à se saisir du trône, elle interprète immédiatement leur réaction comme la preuve qu’ils détestent Rodogune, à l’instar d’elle-même. Elle se met à parler en leur lieu : « Dites tout, mes enfants. Vous fuyez la Couronne […]. Elle passe à vos yeux pour la même infamie / S’il faut la partager avec notre42 ennemie43 ». L’amour maternel qui pourrait naître n’est en fait que narcissisme chez elle. Elle en rajoute sans doute dans la joie qu’elle exprime alors, devant la preuve qu’elle croit tenir de la ressemblance de ses fils avec elle, mais c’est peut-être aussi le seul moment où Corneille lui prête quelque sincérité. Là, les miroirs et le jeu de l’actrice s’accordent profondément : « Ô fils vraiment mes fils ! ô mère trop heureuse44 !». La Cléopâtre qu’on voyait ne percevait ses fils comme ses enfants que dans l’exacte mesure où leurs sentiments reflétaient les siens45…
24Or le silence des princes marque leur différence. À défaut de la trouver, Cléopâtre impose cette ressemblance par son autorité : « Ce n’est qu’en m’imitant que l’on me justifie46 ». Loin de reconnaître la nature, elle bouleverse au contraire l’ordre « naturel » de succession, celui de la naissance47, et le remplace par un ordre institué par elle, en fonction d’une imitation de ses actes. Ayant les mains sanglantes, elle ne reconnaît ses fils que s’ils souillent également les leurs. Comme l’imitation est refusée, l’improbable affection ne peut naître. Ce besoin d’une similitude acquise par le crime s’exprimera encore dans les imprécations finales lancées à Rodogune et Antiochus : « Et pour vous souhaiter tous les malheurs ensemble, / Puisse naître de vous un fils qui me ressemble48. »
25Le miroir permet enfin à Cléopâtre de se contempler49. Comme la captation le fait voir, Arlette Téphany, a choisi, quand Cléopâtre commence à s’adresser à ses fils, de tourner le dos au public, se trouvant ainsi face au miroir, donc face à elle-même, se regardant agir et manipuler les volontés des jumeaux alors qu’elle est déjà regardée par Laonice, à laquelle elle a annoncé le spectacle avec quelque fierté : « Écoute, et tu verras quel est cet Hyménée50 », lui a-t-elle recommandé. Dans la scène suivante, Séleucus dénoncera les véritables motivations de sa mère : « Mais elle seule enfin s’aime, et se considère51 ». Figure de la ressemblance, de la répétition, le miroir est aussi figure de l’amour de soi. Cléopâtre peut se donner à elle-même la comédie de l’amour maternel aussi bien quand elle pense pouvoir s’aimer elle-même dans des enfants à son image que lorsqu’elle les sait différents d’elle.
26Dans Le Naturalisme au théâtre, Zola écrivait que l’escalier, suggéré par Marie Dorval, qui faisait partie du décor de Chatterton « jouait le rôle le plus réel et le plus vivant dans le drame52 » ; le miroir joue un rôle tout aussi capital dans cette mise en scène de Rodogune.
27Le contraste entre la femme qui déborde de tendresse en accueillant ses fils et celle qui les terrorise à la fin de la même scène 3 de l’acte II est saisissant. Il l’est plus encore quand il se produit dans l’ordre inverse lors de l’entrevue de Cléopâtre et Antiochus à l’acte IV. Cette fois, la reine passe du dédain, de la menace, et de la froide perspective de voir mourir son fils à la comédie de la mère attendrie53. Là encore, Arlette Téphany renonçait à la « grande dame54 » pour jouer, après s’être montrée en Furie, à la mère enveloppante, émue, sensible, redevenue femme en quelque sorte : après un battement de paupières qui marquait la réflexion, elle prenait Antiochus dans ses bras, lui caressait les cheveux, mais se plaçait assez vite et symboliquement derrière lui, le tenant aux épaules55 ; elle feignait si bien l’attendrissement qu’elle parvenait à faire voir quelques-unes de ces larmes notées par Laonice dans le texte de Corneille56, mais pour, une fois seule, se redresser droite et terrible et révéler que ses pleurs étaient « des pleurs de rage ». Séleucus, qui apparaît alors, ne laisse pas sa mère jouer car il a pris conscience de son imposture. Ainsi, dans la mesure où ils sont feints, les pleurs et les gestes d’attendrissement, ne ramènent pas Cléopâtre à la banalité des mères aimantes.
28Quand, après avoir assassiné l’un de ses fils, Cléopâtre revient sur scène dans l’acte V, la mise en scène parvenait à concilier la haute ambition que Corneille aimait dans son personnage et le côté « terrien » qu’y voyait Arlette Téphany, si fortement marqué dans l’expression « je possède » employée par la reine quand elle découvre ses desseins à Laonice dans la scène 2 de l’acte II. Devant prononcer le vers « Trône, à t’abandonner, je ne puis consentir57 », l’actrice ne s’adressait pas amoureusement à son trône, ne l’étreignait pas comme les metteurs en scène le firent souvent voir58 mais elle s’y asseyait lentement, s’y installait véritablement, en tenait les accoudoirs, solide ainsi, donnant l’impression que, nouvel Antée59, elle tirait de ce symbole de la possession toute sa force : ce geste permettait de saisir que lui prendre son trône revenait à la priver physiquement de son énergie, de sa vie-même. Après s’être levée pour lancer la terrible invocation « Tombe sur moi le Ciel, pourvu que je me venge60 ! », l’actrice passait les mains sur son visage comme pour se composer de nouveau le masque mielleux avec lequel elle accueillait Laonice, puis Antiochus et Rodogune – bras tendus vers eux, ses « enfants » : elle s’apprêtait pourtant à les empoisonner, annonçant à plusieurs reprises le spectacle qu’elle allait offrir par des phrases à double entente, dont elle seule, toujours spectatrice d’elle-même, goûtait la signification réelle61, dominatrice, réglant tout, en metteur en scène et souveraine.
29Cette mamma, que l’on retrouvait en elle quand elle manifestait une fausse affliction à l’annonce de la mort de Séleucus, qu’elle venait juste d’assassiner, incriminant un désespoir d’amour, faisait encore preuve d’une superbe majesté dans les ultimes moments de la pièce : d’abord dans le contraste qui existait entre l’affreuse description que faisait Rodogune des effets du poison sur Cléopâtre et la maîtrise que la reine assumait de son corps, alors même qu’aujourd’hui la bonne visibilité des mimiques et des gestes permettrait aux actrices de se départir du hiératisme des tragédiennes du xviie siècle62 et de se tordre de douleur ; ensuite, bien qu’une didascalie de Corneille indique que « Laonice lui aide à marcher », quand la reine quittait la salle pour éviter de tomber aux pieds de ses ennemis, la confidente de Cléopâtre la laissait sortir seule, très droite, lentement, mais rendue plus digne encore par cette solitude63…
30Entre l’admiration pour la « source » élevée dont partent les actions de Cléopâtre, dans une approche aristocratique teintée de féminisme, et l’horreur inspirée par la mère dénaturée, dans une approche sans doute plus bourgeoise de la maternité et plus familière au public d’aujourd’hui, surgit la surprise, faite d’affolement en même temps que de fascination, devant la hardiesse du mensonge de type affectif et devant la perfection d’un jeu qui emprunte à des valeurs maternelles pourtant récusées ; on peut rire devant une sorte de comique absolu64, celui de la créature « poétique » dont l’aspect semble relever de l’imagination la plus folle. « Le personnage n’est pas immoral », selon Arlette Téphany, « il est a-moral65 ». Comme c’est dans une tragédie que se déclenche le rire, car le mensonge et le jeu de Cléopâtre incluent de plus en plus la perspective de sa propre mort, on a affaire à un rire bref et angoissé, réaction émotive très moderne.
31Cette mise en scène révèle enfin une autre face et une autre force de Rodogune : l’excellent disciple des jésuites qu’était Corneille semble y vanter encore les réussites du théâtre jusque dans les représentations que Cléopâtre se donne à elle-même ; c’est aussi dans son talent d’actrice que la reine de Syrie fait preuve de la « grandeur d’âme » dont la crédite l’auteur de Rodogune. Après ce spectacle, on avait envie de lancer à Corneille, à Cléopâtre, à la comédienne-metteur en scène, un triple « Salut, l’artiste ! », plein de respect.
1 Examen de Rodogune, donné dans les éditions du Théâtre de Pierre Corneille de 1660 à 1682, texte réédité par G. Couton, dans Pierre Corneille, Œuvres complètes, tome II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, p. 199. Toutes les références à Rodogune sont tirées de cette édition.
2 Ibid.
3 Charles Perrault, Contes, éd. Jean-Pierre Collinet, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1981 p. 193. Rappelons que ce conte fut publié pour la première fois dans les Histoires et contes du temps passé, en 1697.
4 Donnée d’abord au Centre dramatique National de Limoges en 1992, puis reprise avec des modifications de décor et de distribution en janvier-mars 1997 au Petit Montparnasse, à Paris. Ses représentations furent nominées cette année-là pour le Molière du meilleur spectacle du répertoire. Une captation réalisée alors est disponible à la COPAT sous la forme d’une vidéocassette VHS (2 h 3’), qui vit le jour en 1998. Cette captation fut réalisée par Jean-Pierre Oualid. Distribution : Arlette Téphany, Cléopâtre ; Cécilia Hornus, Rodogune ; Pierre-Arnaud Juin, Antiochus ; Philippe Risler, Séleucus ; Agnès Proust, Laonice ; Michel Lebret, Oronte ; Robert Sireygeol, Timagène. Décor et costumes de Claude Lemaire ; éclairages de Jean Grison. C’est Marie Rousseau qui, à Limoges, incarnait le rôle de Rodogune et Jean-Pierre Lorit celui d’Antiochus.
5 Le Figaro, 7 février 1997.
6 Roger Maria, « Le pouvoir et la terreur », L’Humanité, 17 février 1997, en ligne : https://www.humanite.fr/node/151580#sthash.SnmTV2lI.dpuf, consulté le 19 novembre 2019.
7 Cléopâtre a tué son époux Nicanor ; Clytemnestre a fait assassiner Agamemnon par Égisthe. Les princes de Syrie se voient réclamer la tête de leur mère par Rodogune comme Oreste est poussé au matricide par Électre.
8 Marc Fumaroli, « Une dramaturgie de la liberté : tragique païen et tragique chrétien dans Rodogune », dans, Héros et orateurs, Genève, Droz, 1996, p. 170-208 (reprise d’un article publié en 1973 dans la Revue des Sciences Humaines, XXXVIII, p. 600-631).
9 C’est le terme qu’emploie Corneille dans le Discours de la tragédie (1660) pour parler de l’action criminelle d’un personnage qui la commet sans connaissance des liens existant entre sa victime et lui.
10 Représentée en 1635 et publiée en 1639.
11 II, 2, v. 494, dans l’édition de Médée procurée par Florence Dobby-Poirson (Corneille, Théâtre, tome II, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 284).
12 III, 3, v. 932, ibid., p. 302.
13 V, 1, v. 1369, ibid., p. 324.
14 Entretien du 15 septembre 2014.
15 Mise en scène d’Antoine Bourseiller, Théâtre de l’Odéon, 1960.
16 Toutes les remarques d’Alette Téphany sont tirées d’un entretien qu’elle m’a accordé le 15 septembre 2014.
17 Admirer signifie « considérer quelque chose avec surprise, avec étonnement une chose qui est extraordinaire en quelque manière que ce soit », selon l’Académie.
18 Nous citons l’édition de ce Discours procurée par Bénédicte Louvat et Marc Escola dans Corneille. Trois Discours sur le poème dramatique, Paris, Garnier-Flammarion, 1999, p. 78-79.
19 Élisabeth Badinter, L’Amour en plus. Histoire de l’amour maternel. xviie-xviiie siècle, Paris, Flammarion, 1980, p. 83-89.
20 « N’est-ce pas un péché de convoiter le sein en pleurant car si je convoitais à présent avec pareille ardeur un aliment convenable à mon âge, on me raillerait… C’était donc une avidité mauvaise puisqu’en grandissant nous l’arrachons et la rejetons » (Les Confessions, ch. 7, cité par É. Badinter, p. 43-44).
21 Vivès est un célèbre prédicateur espagnol, disciple d’Érasme et favorable à l’éducation des femmes. Son De Institutione feminae christianae, publié à Anvers en 1524, fut traduit en France par Pierre de Changy (Livre de L’Institution de la femme chrestienne, Paris, Kerver, 1542 ; Slatkine Reprints, 1970). On peut y lire, au chapitre X du Second Livre un jugement sévère sur les mères trop dévouées à leur enfant : « Ne cibis obruat, ne somnio nimio et deliciis dedere se pueros patiatur. Et sunt quaedam matres quibus numquam satis edunt, bibunt, dormiunt, vestiuntur, curantur filii » (nous traduisons : « Qu’elle n’accable pas ses enfants de nourritures, qu’elle n’admette pas qu’ils s’adonnent aux rêves et aux délices […]. Il est des mères pour lesquelles ce n’est jamais à suffisance que leurs fils mangent, boivent, dorment, sont habillés et soignés »). Élisabeth Badinter donne la traduction, très synthétique, de Vivès par Pierre de Changy (op. cit., p. 242) : « Les mères perdent leurs enfants quand voluptueusement elles les nourrissent » (op. cit., p. 45). S’il convient de considérer que « nourrir », comme le latin edere signifie « élever », « faire grandir », cibus, toutefois, peut référer à la sève nourricière donc au lait maternel. Quoi qu’il en soit, la tendre sollicitude maternelle est rejetée.
22 « Discours de la tragédie », dans Corneille. Trois Discours sur le poème dramatique, éd. Louvat / Escola citée, p. 101.
23 « Père et fils en Languedoc à l’époque classique », revue Dix-septième siècle. Numéro spécial Le xviie siècle et la famille, 1974, p. 31-45. Voir É. Badinter, op. cit., p. 81.
24 « Des barbaries étranges et inouïes d’une mère dénaturée », François de Rosset, Histoires tragiques, éd. Anne de Vaucher Gravili, Paris, Librairie générale française, coll. « Livre de poche », p. 462-480.
25 II, 3, v. 562, p. 223.
26 Les Échos, 6 février 1997.
27 L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien régime, nouvelle édition, Paris, Le Seuil, 1973.
28 L’Amour en plus, p. 78. La citation fournie par François Lebrun est tirée de sa Vie conjugale sous l’Ancien régime, Paris, Armand Colin, 1975, p. 144-145.
29 C’est même à partir de sept ans, selon Philippe Ariès, que l’enfant entrait dans la communauté des hommes.
30 Selon le propos de Séleucus, dans la scène 4 de l’acte II, v. 735, p. 228.
31 Rodogune, v. 579 et 582, p. 223.
32 Voir vidéocassette citée, à 34’12.
33 On peut voir ce décor dans l’image fournie sur le site de la décoratrice Claude Lemaire. Cette photographie fut prise lors d’une des représentations données en 1992 à Limoges (les tons s’y trouvent un peu rougis par rapport à la réalité du spectacle) : claudelemaire.com / pages_sceno / 1992_rodogune.html.
34 Ce trône était apporté dans l’obscurité entre l’acte IV et l’acte V.
35 Voir vidéocassette citée, à 37’44.
36 Voir vidéocassette citée, à 45’30.
37 La ressemblance des frères semble avoir fasciné au xviie siècle comme le révèle le tableau de Philippe de Champaigne, Les Enfants Habert de Montmor, achevé en 1649, donc peut-être commencé à une date proche de la publication de Rodogune, qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Reims. Henri-Louis Habert avait bien des jumeaux : Louis (quasiment le même prénom que le père comme dans la tragédie de Corneille !) et Jean-Paul. Issu d’une grande et richissime famille, il écrivait des poèmes (dont « Le Perce-Neige » pour la Guirlande de Julie) et était passionné par la physique et l’histoire naturelle ; il résidait dans l’actuel Hôtel de Sully. Il est donc à peu près assuré qu’il vit représenter Rodogune dans son quartier du Marais. L’affiche annonçant les représentations de la mise en scène d’Arlette Téphany à Limoges montrait un gros plan d’un détail de ce tableau centré sur les deux enfants qui se trouvent côté jardin du tableau. Sur le visage de l’un d’eux, un masque de mort avait été ajouté…
38 V. 1051-1052 de Rodogune, p. 237.
39 Site internet de Claude Lemaire, cité supra, onglet « scénographie », année 1992, Rodogune.
40 V. 611-614 de Rodogune, p. 224.
41 Acte II, scène 2, v. 489-490, p.221.
42 Nos italiques.
43 Rodogune, II, 3, v. 615-620, p. 224.
44 Ibid., v. 624.
45 Voir vidéocassette citée, de 40’27 à 42’45.
46 Rodogune, II, 3, v. 668, p. 226.
47 C’est le premier à voir le jour qui était alors considéré comme l’aîné de deux frères jumeaux.
48 Rodogune, V, 4, v. 1823-1824, p. 265.
49 Voir vidéocassette citée, de 44’à 44’56.
50 Rodogune, II, 2, v. 519, p. 222.
51 Rodogune, II, 4, v. 736, p. 228.
52 Zola, Le Naturalisme au théâtre, Paris, Charpentier, 1881, « Les reprises », p. 378.
53 Voir vidéocassette citée, à 1 h 22’07’’ et à 1 h 25’.
54 La femme de pouvoir ne pouvait de toutes les manières jamais se faire oublier : diadème couleur vieil or, boucles d’oreilles, lourdes agrafes, bracelet, s’opposant au dépouillement de la tenue de Rodogune, dont pourtant les vêtements ressemblaient aux siens.
55 Voir vidéocassette citée, de 1 h 26’ à 1 h 30’.
56 « Vos pleurs coulent encore, et ce cœur adouci… », acte IV, v. 1381, p. 249.
57 V, 1, v. 1529, p. 254.
58 Comme dans la mise en la scène de Bourseiller, déjà citée.
59 Dans la mythologie grecque, Antée, fils de Neptune et de la Terre, était un Géant invincible car sa mère, la Terre, renouvelait sans cesse ses forces. Héraklès parvint à le vaincre en l’arrachant du sol et en rompant ainsi son contact avec la Terre-Mère.
60 V, 1, v. 1532, p. 254.
61 Voir vidéocassette citée, à 1 h 38’40’’.
62 Notons toutefois que le frontispice de l’édition de 1647 (Quinet / Courbé), réalisé par Charles Le Brun, fait voir une Cléopâtre au regard à la fois courroucé et affolé, mais l’on sait que les illustrateurs représentaient souvent non pas ce qu’ils avaient vu sur scène mais ce que les propos prononcés leur avaient fait imaginer (le combat des Horaces et des Curiaces, l’assassinat de Pompée, le bris des idoles par Polyeucte, invisibles mais longuement racontés, inspirèrent ainsi les dessinateurs / graveurs).
63 Voir vidéocassette citée, à 1 h 57’.
64 Baudelaire, De l’Essence du rire (1e éd. 1855) dans Baudelaire. Œuvres complètes, éd. Marcel A. Ruff, Paris, Le Seuil, coll. « L’intégrale », p. 370-378.
65 Entretien avec la comédienne-metteur en scène du 15 septembre 2014.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 24, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/813.html.
Quelques mots à propos de : Liliane Picciola
Université Paris Nanterre
EA 1586
Liliane Picciola, professeur émérite à l’université Paris Ouest, est l’auteur de Corneille et la dramaturgie espagnole, (Narr, « Biblio 17 », 2002) ainsi que de nombreux articles sur Corneille et le théâtre du xviie siècle. Elle a publié plusieurs éditions de pièces classiques (entre autres, Balthasar Baro, Parthénie ; Jean de Rotrou, La Diane et Les Occasions perdues ; Thomas Corneille, Les Engagements du hasard, Le Feint Astrologue, Le Berger extravagant) et dirige la nouvelle édition du Théâtre complet de Corneille aux Classiques Garnier (deux volumes parus).
