Sommaire
Appropriations de Corneille
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
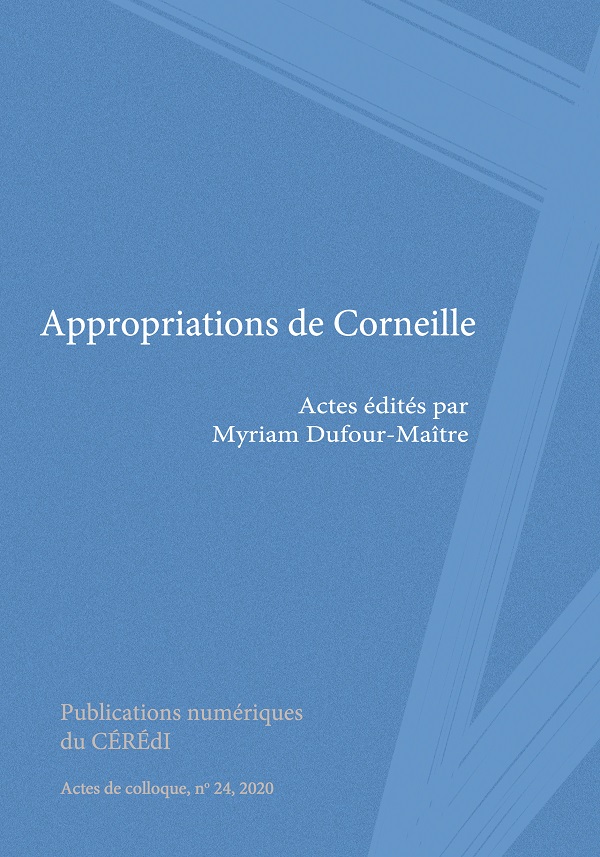
- Myriam Dufour-Maître Remerciements
- Collectif Le Festival Corneille de Barentin (1956-1975) et le Mouvement Corneille
- Myriam Dufour-Maître Introduction
- RÉCEPTIONS CRÉATRICES
- Sylvain Ledda Polyeucte, ou comment mettre en scène la violence ?
- Hélène Merlin-Kajman Comment déterminer ce qui est « religion » en littérature ? Réflexions à partir du cas de Polyeucte de Corneille
- Liliane Picciola De la « seconde Médée » à la « mamma souveraine […] suscitant l’horreur et le rire » : Rodogune au Petit Montparnasse en 1997
- Jacques Téphany Corneille, l’autre fondateur du TNP
- Roxane Martin Horace à l’épreuve des révolutions : les remaniements du texte et l’édification d’un Corneille patriote (1789-1799 vs 1848)
- Claire Carlin L’Illusion comique sur la scène du monde anglophone, entre traduction et « adaptation libre »
- Cécilia Laurin L’Illusion comique, « entre Platon et Hollywood » ? Du théâtre du monde au cinéma du monde : autour du film Illusion de M. A. Goorjian
- Julia Gros de Gasquet Filmer L’Illusion comique, réécrire Corneille ? À propos du film de Mathieu Amalric à la Comédie-Française (2010)
- Noëmie Charrié Le rêve d’une réappropriation : Othon sur les écrans
- Jean-François Lattarico De l’Horace (1641) à l’Orazio (1688). Prémisses de la réforme dans le premier dramma cornélien per musica
- Sarah Nancy Le Cid de Massenet, Gallet, d’Ennery et Blau : une appropriation amoureuse
- Mises en scènes et actualisation
- Réécritures, adaptations ou « inadaptations »
- LES DISCOURS D’APPROPRIATION
- Mariane Bury Le Corneille des historiens de la littérature au xixe siècle
- Michal Bajer Les contextes de la traduction. L’établissement de la tradition cornélienne en Pologne au tournant romantique : discours critique, pratiques éditoriales, péritextes
- Lise Forment Roland Barthes, Sans Corneille : les « résons » politiques d’un silence critique
- Bénédicte Louvat « L’invention » du dilemme cornélien
- Jean-Yves Vialleton Les exemples rhétoriques empruntés à Corneille et la construction de la mémoire collective
- Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval Un Corneille à l’usage de la jeunesse au tournant des xviiie et xixe siècles : quelques jalons
- Beate Langenbruch Corneille, auteur de concours
- Hélène Bilis Corneille aux États-Unis, ou quel « auteur classique » pour les campus américains ?
- La critique et l’histoire littéraire
- L’enseignement
Appropriations de Corneille
Introduction
Myriam Dufour-Maître
De la réception à l’appropriation
1Depuis la célébration du tricentenaire en 1984, un certain nombre d’ouvrages et d’articles ont exploré la réception de l’œuvre de Corneille de la fin du xviie siècle à aujourd’hui, en France comme en Europe1. Quatre colloques plus particulièrement, co-organisés à Rouen par le CÉRÉdI et le Mouvement Corneille, ont tâché de construire une histoire, encore très lacunaire, de la réception de Corneille : Corneille après Corneille2 examinait la lecture que le xviiie siècle avait faite du « père de la tragédie française » (Fontenelle), tandis que Corneille des Romantiques3 traitait de l’accueil mitigé que la génération de 1830 avait pu faire à ce « classique » supposé avoir souffert de la tyrannie des règles. À l’occasion du quadri-centenaire de 2006, un colloque était consacré aux Pratiques de Corneille4, tant celles du dramaturge que celles que son œuvre pouvait susciter, hier ou aujourd’hui. Tâchant de poser à nouveaux frais la question du personnel dramatique chez Corneille, le volume Héros ou personnages5 ? se trouvait encore amené à interroger, à la suite de l’article de John D. Lyons6, l’édification au fil du temps du « héros cornélien », la vivacité de son mythe, les avantages et les risques éventuels de sa déconstruction.
2Ces ouvrages collectifs s’inscrivaient, sur le plan théorique, dans une conception désormais classique de la notion de « réception », s’interrogeant avant tout sur la façon dont on a pu lire, éditer, interpréter, jouer, enseigner, traduire ou critiquer le théâtre de Corneille. Mais nombre d’articles cherchaient aussi, plus ou moins explicitement, à interroger la notion même de « réception » et à se dégager des connotations plutôt passives véhiculées par ce terme7. Au fil de ces colloques, s’est précisée et élargie la rencontre avec des textes, des gestes, des objets qui marquaient non seulement l’interprétation critique ou la mise en scène du répertoire, mais qui signifiaient la transformation de l’auteur, de son œuvre et de sa poétique en un matériau éminemment plastique, célébré, adapté, réécrit, incorporé à des pratiques littéraires, culturelles ou plus largement sociales parfois très éloignées de la source. Ainsi le colloque Pratiques de Corneille tâchait d’explorer non seulement la façon dont on a reçu et interprété le théâtre de Corneille, mais aussi et surtout les « usages » de ce théâtre, les actes par lesquels se manifeste la vitalité des œuvres, pratiques qu’un index, expérimental et modeste, tâchait de recenser (p. 803-804). Certaines pratiques relevées dans cet index suggéraient une activité créatrice plus intense face au corpus cornélien, une véritable (re)création entée sur lui.
3Beaucoup reste à faire cependant pour dessiner plus précisément encore la place de Corneille dans la culture, les multiples façons dont les époques successives se sont emparées de son œuvre, ont construit sa figure d’auteur, son nom, et les ont incorporés non seulement à la vie même des lettres, mais aussi de la langue, de la cité, de la nation, de l’imaginaire collectif. Les réécritures, les suites, les parodies, les adaptations, les commémorations et les « fêtes à Corneille », les maisons-musées, la publicité, etc. témoignent d’une relance active de l’émotion et de l’imaginaire, d’un désir d’incorporation individuel et collectif, d’un amour tout simplement, qui ne peut se satisfaire d’une simple lecture8, d’une écoute ritualisée, d’une révérence distante9.
4Le terme d’« appropriation » a paru rendre compte de cette activité protéiforme et transformatrice par laquelle un auteur et son œuvre deviennent « nôtres ». Sans rigidifier les distinctions, le geste d’« appropriation » nous semble se distinguer de la simple « réception », et se rapprocher de l’« innutrition » classique. Il comprend sans s’y limiter les entreprises d’« actualisation » ou de « modernisation », et entre en dialogue avec l’apport majeur des notions de « transition » ou « transitionnalité10 ».
5Selon le Littré, « approprier » signifie d’abord « rendre propre, convenable à, adapté à ; mettre en état de propreté, disposer convenablement (un logis par ex) ». On peut ainsi parler d’appropriation, dans ce sens premier, pour désigner tout geste de configuration de l’auteur et de l’œuvre qui a pour but (mais n’est-ce pas toujours le cas ?) de les adapter au public. Guidés par la notion d’aptum, ces gestes peuvent viser un public universel, ou au contraire des auditeurs ou des lecteurs très précisément ciblés. Ainsi des anthologies, éditions sélectives, bibliothèques idéales (telles que les étudie ici Marie-Emmanuelle Plagnol), apparats critiques voire réécritures qui fabriquent un Corneille pour les enfants11, pour les femmes, pour le peuple, pour les étrangers, etc. « S’approprier » en ce sens signifie « se conformer, se mettre à portée », et l’on peut interpréter en ce sens le geste éditorial de Corneille en 1660 qui, en accompagnant ses pièces du dispositif critique des Discours et des Examens, « approprie » sa poétique novatrice à un public plus large que les seuls doctes12.
6Le verbe à la forme pronominale porte néanmoins un second sens, qui est le plus usité, « faire qu’une chose devienne comme la propriété d’un autre », et le Trésor de la langue française note la nuance péjorative de cette forme réfléchie : « S’approprier : S’attribuer quelque chose. Attribuer quelque chose à soi-même, la faire sienne (souvent d’une manière indue13) ». S’approprier, c’est « poser une marque d’appartenance nouvelle », en un geste de nouveau propriétaire, voire « tirer à soi », en un accaparement plus ou moins licite ou légitime.
7L’exigence antique et classique de l’innutrition implique bien qu’on fasse de l’œuvre sa « propriété », en vue de la production de ses propres discours, ne laissant plus distinguer dans la culture d’accueil l’origine de ce dont on s’est nourri : « je l’ai dit comme mien », revendique La Bruyère14 ; au contraire, note Fénelon, « on quitte sans peine une pensée qu’on avait sans appropriation15 ». Mais lorsque, dans le régime auctorial moderne, subsistent l’origine de la pensée et le nom de son auteur, l’innutrition ne peut s’affranchir de la reconnaissance de cette propriété originelle. L’appropriation se situerait ainsi entre l’innutrition légitime et le plagiat condamnable, entre les deux horizons, purement théoriques d’ailleurs, d’une réception passive et d’une recréation totale.
8Le geste d’appropriation peut être conscient et même délibéré, accompagné d’ironie déférente comme dans la parodie. Mais plus souvent, ce sont les variations historiques de la critique et de la mise en scène, le changement parfois complet de la figure dans le kaléidoscope qui nous font percevoir les cadres d’analyse passés comme des « appropriations », des formes d’annexion ou d’instrumentalisation, animées chacune par la certitude de leur justesse ainsi que par l’espoir de fixer la critique et l’image du prestigieux ancêtre. Aucun cependant de ces « Corneille » successivement « classique », « louis-treize », « républicain », « revanchard », « nietzschéen », « normand », « cartésien », « shakespearien », « fasciste », « résistant », « hégélien », « baroque », « brechtien » ou « colonial » n’a sans doute plus de légitimité qu’un autre : si voyants et si partiaux que nous apparaissent les procédés qui « tirent » le dramaturge vers telle doctrine esthétique, vers tel camp politique ou vers telle école philosophique, ils ne diffèrent sans doute pas de nos propres démarches critiques, telles qu’elles apparaîtront à ceux qui nous suivront. Les appropriations ne font en ce sens que marquer la remarquable et constante disponibilité de l’œuvre, son classicisme16. Plutôt que de chercher à poser de très problématiques « limites de l’interprétation » (Umberto Eco), ou de soupçonner certaines lectures de trahir, d’« exproprier » l’auteur en quelque sorte, il s’agit donc de nous intéresser à toutes les manifestations de la réception, jusqu’aux éventuelles « monstruosités de la critique », d’examiner et de situer historiquement la « somme de transformations » que toute interprétation impose aux textes, et dont Foucault voulait faire apparaître les « principes » et les « lois17 ». Ainsi, dans sa fonction d’institution de la littérature, l’histoire littéraire repose largement sur des phénomènes d’appropriation, qui configurent l’œuvre et ses interprétations, et l’on trouve précisément au moment de la naissance de cette discipline deux études très novatrices, qu’on posera en jalons avant-coureurs de notre démarche ici.
Émile Picot et Roger Le Brun : deux pionniers dans l’approche des « appropriations » de Corneille
9Deux ouvrages bibliographiques ont en effet précocement attiré l’attention sur ce corpus immense, essentiellement « côté texte », qui comprend les interventions sur le texte cornélien (coupes, censures, extraits, réécritures), les imitations, pastiches, parodies et travestissements, les adaptations (pour l’opéra essentiellement alors) et les narrativisations, les traductions, les apparats et démarches didactiques, mais aussi la masse immense des pièces de circonstance, dramatiques ou lyriques, qui ont célébré Corneille et son œuvre.
10La Bibliographie cornélienne d’Émile Picot18 est à notre connaissance le premier ouvrage qui recense, de façon encore très partielle, ces diverses appropriations, classées selon un ordre semble-il, d’éloignement progressif du texte-source. Les éditions occupent les treize premières sections. La section XIV recense les « pièces de Corneille remaniées ou retouchées », la suivante les traductions en diverses langues (XV). Viennent ensuite les opéras et les ballets (XVI), les biographies (XVII), puis les discours, éloges, critiques, et parallèles relatifs à Corneille (section XVIII). La section XIX regroupe les dissertations, critiques, pièces de théâtre et parodies, et la suivante se concentre sur les « pièces de théâtre, scènes dramatiques et cantates ». Un tiers de cette bibliographie est donc consacré à ces diverses formes d’appropriations non seulement de l’œuvre, mais aussi du nom et de la figure du dramaturge.
11En 1906, Roger Le Brun propose un « résumé de la critique cornélienne aux xviie, xviiie et xixe siècles ». Son anthologie présente « les phases successives de l’opinion critique », dont une copieuse introduction expose le « diagramme19 ». Mais il ne s’agit pas seulement de connaissances positives de l’histoire littéraire, qui grâce à ses méthodes scientifiques corrigerait les erreurs du passé et détruirait les légendes. L’enquête a pour but de mettre en lumière la façon dont progressivement, à travers les fluctuations du goût et des idées, « l’âme cornélienne » a pénétré dans les « âmes françaises », jusqu’à la parfaite coalescence que Le Brun croit lire dans les commémorations de 1906 : « Le tricentenaire de Corneille, assure-t-il, donne à cette immortelle figure un caractère d’actualité littéraire, que les tendances intellectuelles du moment vers une rénovation de l’énergie française – cette dominante de l’œuvre cornélienne – soulignent davantage et solennisent20. » Point d’aboutissement d’une longue élucidation critique, la commémoration de 1906 révèle au grand public l’action qu’ont exercée lettrés et universitaires novateurs pour à la fois faire vivre Corneille dans les âmes au-delà des années d’école, et pour manifester l’adéquation profonde de l’œuvre au temps qui la célèbre. L’appréciation de cette appropriation dialectique s’éclaire, là encore de manière très novatrice, par la situation institutionnelle dont Le Brun rend compte de chacun des critiques (universitaire, érudit indépendant, journaliste, critique dramatique, poète, etc.) et par le degré d’adhésion que chacun témoigne aux méthodes et aux opinions modernes sur le grand auteur.
12Le corpus examiné par Le Brun appartient pour l’essentiel à la critique de facture traditionnelle, mais il comprend aussi quelques mentions des hommages poétiques et de l’« interminable série de comédies vaudevilles » (p. LVIII) dont Corneille est le héros. Mieux, Le Brun perçoit avec assez de lucidité que « ces à-propos d’anniversaire » sont plus à même aujourd’hui de séduire le grand public mais aussi celui « qui lit et qui pense », que les pièces de Corneille elles-mêmes. Ces œuvrettes, reconnaît-il, sont comme l’illustration attrayante de la documentation dont les temps modernes ont fait […] l’objet principal de leurs émotions intellectuelles21 ». L’histoire littéraire en odes, saynètes et vaudevilles représente ainsi l’appropriation la mieux accordée à l’esprit du temps, en attendant que celui-ci, en changeant, ne change les conditions de lecture et ne redonne par exemple aux femmes, influencées par le féminisme naissant, les clefs d’une identification perdue aux Camille, Émilie ou Cornélie, et ne favorise ainsi le retour aux textes (p. LXXXIII).
13À l’autre bout de la chaîne temporelle et quelque temps après le colloque dont ce volume est tiré, une entreprise d’envergure a recensé l’ensemble des hommages rendus à Corneille par les théâtres de Rouen entre 1784 et 1884, sur la base des comptes rendus dans la presse locale22. Dans un très riche article, Joann Élart analyse en détail les formes multiples que prend la célébration par les Rouennais de leur grand homme : à-propos dont Corneille est le sujet et souvent le héros, couronnements du buste et apothéoses, odes et cantates se succèdent rituellement sur la scène du Théâtre des Arts et celle du Théâtre-Français de Rouen23. La « dette sacrée24 » de la ville à l’égard de son célèbre enfant n’est certes pas honorée aussi activement chaque année entre les deux centenaires : remarquablement régulières jusqu’en 1842, les « fêtes Corneille » subissent ainsi une longue interruption entre 1843 et 1884. Le culte de Corneille est néanmoins relancé dès 1860, avant que la commémoration de 1884 ne réinstalle la figure du dramaturge au cœur de l’identité nationale et normande, alors même que le répertoire cornélien subit de fortes éclipses tout au long de cette période.
14Le présent volume, de façon à la fois plus large et moins exhaustive, propose quelques explorations partielles de cet immense corpus rayonnant en tous sens autour de Corneille, et tâche ce faisant d’interroger autant de façons de lire, d’interpréter, mais aussi d’entretenir avec sa figure et son œuvre une relation constituante de valeurs et d’identité(s), un lien affectif et un dialogue créateur. Pour des raisons de commodité plus que de théorie, on a séparé ici les réceptions créatrices (mises en scène, adaptations de tous types, pastiches et parodies) des discours d’appropriation (critiques, didactiques, encomiastiques) : on voit aisément cependant que création et commentaire s’accompagnent mutuellement dans la plupart des cas.
Réceptions créatrices
Mises en scène et actualisation
15S’interrogeant sur la mise en scène de la violence dans Polyeucte, Sylvain Ledda souligne l’extraordinaire « plasticité d’une pièce dont les résonances avec notre monde sont sensibles », dès lors que l’on explore les non-dits d’un texte, particulièrement ambivalent ici. Selon les mises en scène – et la dernière par Brigitte Jaques-Wajeman en 2016 aux Abbesses le montre amplement – la pièce paraît quasi réversible : tragédie du martyre ou drame du fanatisme ? Trajectoire d’un renoncement au monde, ou conversion susceptible de « redynamiser la révolte contre l’oppresseur romain ? ». Grâce ou hybris ? Une lecture actualisante peut aujourd’hui mettre au jour la grande violence, non seulement passionnelle ou religieuse mais aussi géo-politique qui traverse, ouvertement ou plus souterrainement, la totalité de la tragédie, et choisir, ou non, d’interpréter cette violence dans un sens ou un autre.
16Mais, comme le montre fortement Hélène Merlin-Kajman, l’horizon d’interprétation, du moins en milieu scolaire, risque fort d’être unilatéral : en privilégiant pour l’analyse littéraire l’angle d’un très problématique « fait religieux », le danger est grand pour les élèves, voire pour leurs professeurs, d’une application directe – et désastreuse – aux formes actuelles du fanatisme religieux, notamment islamiste. Sous peine de devenir une instrumentalisation plus ou moins consciente, la démarche d’actualisation exige que soient interrogés du moins les cadres de l’analyse, et que soient déjoués par le « détour » les mécanismes d’une analogie aussi trompeuse qu’apparemment évidente. C’est donc en mobilisant la connaissance qu’elle a de ce « dispositif collectif indissociable d’un mode de subjectivation, qui s’appelle “zèle” au xviie siècle » qu’Hélène Merlin-Kajman opère ce détour et cette médiation. Polyeucte, avance-t-elle, sera mieux lu à la lumière d’Horace et du zèle, de « l’excès sacrificiel » de son héros qu’à celle, problématique et délicate à manier, d’un supposé « fait religieux ». On voit ainsi comment une appropriation à la fois créatrice, actualisante et attentive à l’ancrage historique du texte peut (doit ?) passer par la relecture critique des horizons d’attente les plus immédiats.
17Liliane Picciola analyse ainsi le renversement d’un double horizon d’attente, celui du « monstre » cornélien qu’est la Cléopâtre de Rodogune, traditionnellement jouée comme une « seconde Médée », « usurpatrice implacable » et froidement calculatrice, et celui de la relation mère / enfant, dont Liliane Picciola montre l’ambivalence au xviie siècle : « […] si bien des mères de haut rang ne se distinguaient nullement par des comportements traduisant un amour maternel, l’image idéale de la mère attachée à l’enfant restait évidemment véhiculée par la dévotion à Marie ». La mise en scène de Rodogune par Arlette Téphany en 1992 à Limoges puis en 1997 au Petit-Montparnasse balaie cette double attente en produisant, jouée par la metteuse en scène elle-même, une « mamma » à l’italienne, qui surjoue d’un amour maternel théâtral, envahissant, par instants comique et in fine frustré, cette déception entraînant le déchaînement meurtrier que l’on sait.
18Si le travail du metteur en scène peut ainsi déplacer, décaler ou renverser les lectures reçues, encore faut-il que le public adhère à cette proposition et s’en empare, ce qui fut le but, largement atteint, du théâtre populaire. De manière aussi juste qu’un brin provocatrice, Jacques Téphany propose de faire de Corneille « l’autre fondateur du TNP » : rarement en effet un classique avait fait l’objet jusque-là d’une interprétation scénique aussi délibérément offerte au public de son temps. Avec les deux réalisations majeures du Cid et de Cinna, Vilar ajoute, écrit Jacques Téphany, « la dimension essentielle à la notion d’interprétation : celle d’écoute et de réception du public qui confine, en l’occurrence, à l’identification de toute une génération à deux icônes », Vilar dans le rôle d’Auguste et Gérard Philipe dans celui de Rodrigue. « J’ai fait, aimait à répéter Vilar, pour mon époque le théâtre de mon temps ».
Réécritures, adaptations ou « inadaptations »
19L’appropriation ou la réappropriation d’un classique peut justifier, aux yeux de ceux qui l’entreprennent et du public qui la reçoit, des interventions sur le texte, dont on sait qu’elles sont quasi la norme pour la scène25. Roxane Martin montre ainsi comment l’édification d’un Corneille « patriote », entre la Révolution française et la Révolution de 1848, conduit à des coupes importantes dans le texte d’Horace, accompagnées de remaniements des entrées et sorties des personnages. L’appropriation en ce sens a « partie liée avec les réflexions sur le rôle du théâtre dans la fabrique d’une nation régie par une identité culturelle commune ». La classicisation de Corneille oscille ainsi entre la sacralisation du texte et la nécessité, largement ressentie, des coupes et des réécritures, tant pour la scène que pour l’école26.
20Au xxe siècle se fait jour le sentiment d’une large disponibilité du scénario27 et de la nécessité de dépasser la simple traduction littérale. Claire Carlin analyse ainsi les réécritures en anglais de L’Illusion comique, qui offrent une large palette depuis la fidélité scrupuleuse jusqu’à l’adaptation libre. Le long succès de celle de Kushner, The Illusion, semble plaider en faveur de cette « transculturation », sur laquelle souffle l’esprit de Brecht autant que celui de Corneille. Particulièrement séduisante pour notre modernité en raison de la réflexion qu’elle propose sur l’image et ses miroitements28, L’Illusion comique donne lieu à des hybridations multiples, notamment avec les thématiques shakespeariennes, comme dans le film Illusion de Michael A. Goorjian, étudié ici par Cécilia Laurin. S’approprier la comédie de Corneille pour Goorjian, c’est ainsi à la fois la lire à la lumière du classique par excellence qu’est Shakespeare pour le monde anglo-saxon, et la réécrire pour l’écran, en donnant au cinéma le rôle d’une véritable magie moderne, capable « d’assembler les vivants et les morts ».
21L’exploration des potentialités de l’image filmique guide aussi partiellement la transposition par Amalric en 2010. Julia Gros de Gasquet parle d’« inadaptation » pour caractériser cette démarche originale et expérimentale, dans laquelle l’image construit une actualisation de la fable, tandis que l’alexandrin cornélien, totalement respecté, achève par son anachronisme délibéré de produire un objet impossible, cet « étrange monstre » qu’évoque Corneille. L’appropriation consiste ici en un « pas de côté » à la fois cohérent et déroutant.
22Pas moins déroutante et tout aussi expérimentale est l’adaptation, nettement plus ancienne, par Jean-Marie Straub et Danièle Huillet d’Othon, sous le double titre « Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour » (1969). La démarche exigeante des Straub, dont compte ici Noémie Charrié, est autant plus intéressante pour notre propos qu’elle veut contredire, très explicitement, l’héritage vilarien et la doctrine du théâtre populaire. Leur brechtisme, plus orthodoxe sans doute, et plus dogmatique aussi que celui du TNP, conduit ainsi les deux cinéastes à marquer voire à accentuer la distance de l’œuvre à ce public populaire qui n’a jamais eu le privilège d’accéder au théâtre de Corneille, tout en maintenant que ce théâtre est fait pour lui. Lorsque Julia Gros de Gasquet parle d’« inadaptation » à propos du film d’Amalric, on pourrait à la limite ici parler d’« inappropriation », tant est radical le travail d’étrangéisation de l’image et du son, allié à un strict respect, là aussi, du vers cornélien. Il s’agit de déjouer en effet l’illusion de l’actualisation, qui voudrait « reconnaître dans la pensée de Corneille ce qui est propre à notre temps », et de montrer au contraire l’épaisseur historique et culturelle, en strates multiples et contradictoires, entre Corneille et nous. Il s’agit, avant tout, de faire entendre des dissonances et des discords, de lutter par tous les moyens contre l’hypnose de l’identification, de forcer le spectateur et l’auditeur à une attention nouvelle, difficile mais féconde : « ce combat pour s’approprier la langue du xviie siècle devient ici la métaphore exacte de la place et de la lutte des exploités devant la culture », conclut Noémie Charrié, et l’on peut estimer qu’au bout du compte et cet effort une fois consenti, cette tragédie largement oubliée et méprisée du « vieux Corneille » peut faire l’objet d’une authentique (re)appropriation.
23« Pas de côté » (Julia Gros de Gasquet), le geste d’appropriation aborde souvent l’œuvre non pas frontalement, mais par le « détour » créateur qu’impose la réécriture transmodale. Les moyens et les codes du cinéma ou de l’opéra permettent, au terme d’un éloignement apparent du texte ou de son actualisation scénique, des effets de sens inédits, propres à ces arts mais qui font alors retour vers les non-dits du texte cornélien lui-même. Examinant le renouvellement de la production opératique, en particulier vénitienne, au cours des dernières décennies du xviie siècle, Jean-François Lattarico montre qu’il passe par « une réappropriation des thèmes héroïques, moraux, c’est-à-dire au fond par un rapprochement avec le genre canonique de la tragédie ». Dans son Orazio représenté en 1688, Vincenzo Grimani se réfère explicitement à Corneille auquel il emprunte, écrit-il, son sujet, de « nombreuses significations » et jusqu’à des passages entiers transposés ou traduits quasi mot à mot. Le respect va jusqu’à celui de la prosodie française, dont l’opéra italien tente de s’approcher au plus près. La convention incontournable du lieto fine oblige néanmoins Grimani à supposer que Curiace et Giunia (le personnage équivalent de Camille) ont survécu à leurs blessures : sous l’apparent respect littéral et sous la réaffirmation des valeurs patriotiques (supposées cornéliennes), c’est donc à une profonde transformation de la tragédie qu’équivaut sa transposition pour l’opéra.
24Selon Sarah Nancy, c’est par les larmes de Chimène que l’adaptation du Cid par Massenet échappe à une conception purement utilitaire de l’appropriation : la lecture nationaliste et revancharde se trouve nuancée non seulement par la présence massive de la source espagnole et la musicalité propre des vers de Corneille, mais aussi par cet « appel du signifiant » qui vibre dans le nom et la voix de Chimène et qui, dans l’œuvre, « a tracé son sillon de manière non linguistique ».
Entre la lettre et l’esprit
25Le respect littéral du texte ne marque pas nécessairement en effet son écoute la plus attentive : la parodie qui, à la foire, démarque les vers mot à mot pour des effets polémiques et comiques évidemment étrangers aux buts de la tragédie (Judith le Blanc) s’éloigne paradoxalement peut-être davantage de sa source que ne le fait le pastiche de Gautier : Le Capitaine Fracasse n’emprunte au Cid ni son sujet ni ses personnages ni ses dialogues, mais plus intimement « la forme vigoureuse, solide, indestructible du style et des vers » (Françoise Court-Perez). Bousculant la chronologie, le roman se veut « œuvre posthume » du xviie siècle, et c’est d’ « imprégnation », et peut-être d’innutrition stylistique qu’il convient alors de parler.
26Cette innutrition et cette modélisation poétique, appropriations non littérales de l’œuvre de Corneille, peuvent encore caractériser son influence sur la dramaturgie non seulement française mais aussi européenne, et sur la construction des littératures nationales. De nombreuses études ont montré le rôle joué par la poétique et l’œuvre de Corneille dans les divers pays où il a été admiré29. Après la simple réception, via notamment les traductions, voire les représentations en français dans l’Europe largement francophone des Lumières, c’est par la médiation de la critique, des poétiques novatrices et de l’histoire littéraire naissante que se manifeste le geste d’appropriation, ou de refus30. Geste (re)créateur, l’appropriation passe en effet aussi par un vaste ensemble de discours et de pratiques critiques, pédagogiques, encomiastiques, dont l’examen, forcément très partiel, forme la seconde partie de ce volume.
Les discours d’appropriation
La critique et l’histoire littéraire
27Nous avons brièvement analysé ci-dessus l’anthologie critique réunie en 1906 par Roger Le Brun. D’autres états présents de la critique cornélienne ont ponctué le xxe siècle31, mais plus souvent occupés à rendre compte des contenus notionnels avancés qu’à les examiner d’un point de vue discursif32. Mariane Bury pour le xixe siècle, et Lise Forment pour la grande figure critique du xxe siècle qu’est Roland Barthes, s’attachent ici au contraire à situer le discours sur Corneille dans l’ensemble du paysage critique, à montrer les multiples enjeux d’une appropriation ou, dans le cas de Barthes, de son absence, à suggérer aussi les effets de sens du style de la critique : dans le cas de Corneille, frappe notamment l’abondance des métaphores lumineuses pour illustrer le génie, son éclat, ses intermittences et son déclin supposés.
28La naissance de la littérature nationale au xixe siècle consacre en Corneille un « père fondateur » de notre théâtre, capable d’être aussi, à la différence de Racine, « le père du drame romantique et de la modernité théâtrale », assurant ainsi « la continuité vitale des mouvements et des époques » (Mariane Bury). Comme Descartes dont on le rapproche, Corneille incarne pleinement le génie national, et ses personnages, fondus en ce « héros cornélien » dont John D. Lyons a analysé le mythe, reçoivent pour mission de guider et d’élever les âmes françaises, elles-mêmes images de l’universel. Le monument, pour être capable de « compenser les blessures de l’histoire », notamment après 1870, se doit d’être sans failles ni fissures, et cette nécessité d’unifier le génie cornélien impose à la critique un travail massif d’abstraction, autre facette donc de l’appropriation.
29Michal Bajer montre, dans le cas de la Pologne du xixe siècle et pour d’autres buts, des effets similaires d’édification de Corneille en monolithe : l’évolution du goût et la progressive désaffection à l’égard de Corneille transforment par réaction les appropriations multiples précédentes en « une image rétrospective unifiée », notamment dans le discours professoral : « la tradition cornélienne dans la littérature polonaise apparaît désormais comme phénomène cohérent, incontestable », mais à distance historique et relativement abstrait.
30Cette construction « classico-nationale » (Christian Biet) éclaire pour partie le cas paradoxal, sur lequel se penche Lise Forment, de la « non-appropriation » de Corneille par Roland Barthes33 : ce silence peut sembler d’abord étonnant en effet, dans le contexte notamment du théâtre populaire, des mises en scène de Vilar et des affinités supposées alors du brechtisme avec la dramaturgie cornélienne. La réserve de Barthes renvoie à la question de la « disponibilité », ou non, de l’œuvre, telle qu’elle arrive au lecteur moderne, précédée et entourée de la masse des lectures et des images qu’elle a suscitées : comment en effet, dans les années 1950-1960, proposer une « lecture concernée » et surtout politique de Corneille qui ne ramènerait pas aux interprétations fascistes de Brasillach et de Delacour, ou ne répèterait pas la figure vilarienne d’un Corneille « résistant » ? À la recherche par Barthes d’une dialectique entre concernement et distance, s’opposent semble-t-il à la fois une tradition critique (voire instrumentalisante) si solidement vitrifiée qu’elle paraît infrangible et l’absence d’un lecteur contemporain qui jouerait le rôle de « grand intercesseur », comme Proust l’a été pour Saint-Simon, ou Valéry pour Descartes.
31Dans cette immobilisation de la critique, l’école joue un rôle majeur. Les exigences pédagogiques en effet contribuent très largement à la diffusion d’une image à la fois fixée, épurée et simplifiée de l’auteur et de l’œuvre. Dès le xviiie siècle, comme le montre Marie-Emmanuelle Plagnol, on « approprie » Corneille, au sens premier du terme, aux jeunes lecteurs et lectrices. Réécrite34, réduite à la tragédie et au seul Polyeucte parfois, abordée tardivement dans le programme des études féminines et dans les bibliothèques idéales (ainsi dans Adèle et Théodore de Mme de Genlis, 1782), l’œuvre de Corneille est l’occasion surtout d’exposer les règles classiques, y compris à la lumière des supposés manquements du dramaturge à leur égard. Se fixe ainsi une doxa, durcie au fil du temps, en même temps qu’un usage anthologique qu’explore Jean-Yves Vialleton à travers les exemples canoniques empruntés à Corneille dans les manuels de rhétorique : « la sélection des exemples, note Jean-Yves Vialleton, s’appuie sur un imaginaire » de l’œuvre et de la langue, sur une mémoire collective qui à terme retient moins l’origine de l’exemple que les autorités successives qui l’ont fixé dans la culture.
32Le vocabulaire critique, le répertoire des figures et la familiarité variable qu’a le public avec elles transforment la perception et modèlent en profondeur les interprétations. L’adjectif « cornélien » fait ainsi surgir un univers de valeurs, incarne une compréhension du monde et une attitude face à la vie qui peuvent être rapportées à Corneille, ou être inspirées par lui (ainsi dans le titre de la biographie grand public de Louis XIII, roi cornélien par Pierre Chevallier35), mais qui peuvent aussi ne faire à l’œuvre de Corneille qu’une référence schématique et lointaine. Quand le « rire moliéresque » désigne nettement la façon particulière qu’a Molière d’envisager les travers humains, quand la « douceur racinienne » ne se comprend que comme référence au talent poétique de Racine, le « dilemme cornélien » paraît une situation certes typique de la dramaturgie cornélienne, mais à laquelle chacun peut se trouver confronté au cœur de sa vie personnelle, même la moins héroïque en apparence : comme « kafkaïen », « cornélien » signale une appropriation qui prend l’allure d’une évidence, d’une vérité humaine universellement reconnue. L’histoire d’un syntagme qui paraît définir depuis toujours l’univers cornélien, le fameux « dilemme cornélien », réserve cependant des surprises. Bénédicte Louvat met en évidence en effet le caractère au contraire récent de cette formule, dans le contexte du « retour du tragique » à la seconde moitié du xxe siècle. Tout comme la « pointe » quasi topique qu’est « l’obscure clarté » ne devient que tardivement un « oxymore », supposé emblématique de l’esthétique cornélienne (Jean-Yves Vialleton), le « dilemme cornélien » vient remplacer ce que Corneille nommait les « oppositions » ou « combats » de la Nature (c’est-à-dire du sang) et des passions, ou du devoir et de l’amour et qui animaient largement la « scène à faire », productrice de pathétique, dans le théâtre de l’époque. On voit déjà comment l’appropriation réduit à la seule scène cornélienne des procédés alors courants, les transforment en une spécificité, voire en une singularité cornélienne d’ordre philosophique, esthétique ou morale. Dans le cas du « dilemme » en effet, nommer ce combat « cas de conscience », y reconnaître un « syllogisme disjonctif » d’origine scolastique, ou l’envisager comme la formule même du destin tragique et l’épreuve typique de l’héroïsme cornélien36 engagent une interprétation globale de l’œuvre, tout en réduisant le plus souvent ce « combat » pourtant sans cesse renouvelé au seul monologue délibératif, emblématiquement celui des stances de Rodrigue. Le lexique critique favorise par ce biais l’élection de morceaux choisis, qui contribuent encore davantage à la fixation d’une image partielle et d’une interprétation toute prête. L’appropriation est ainsi toujours sélective, et la pratique citationnelle témoigne de ce découpage, des « saillies » du texte qui entrent dans la mémoire individuelle et collective, pour s’y fixer et faire retour dans le discours, y compris ordinaire37 : chacun connaît les usages malicieux que peut faire une Sévigné des vers de Corneille tôt passés en proverbes38.
L’enseignement
33Plusieurs ouvrages et articles ont commencé d’explorer le destin scolaire de Corneille, à commencer par l’étude majeure de Ralph Albanese, Corneille à l’École républicaine39. En étudiant ici la place de Corneille dans les programmes et les sujets de l’épreuve reine des études littéraires, l’agrégation, Beate Langenbruch cherche à vérifier la dimension d’« auteur-type » qu’on peut prêter, pour ce grand concours, au « Grand Corneille ». Non que Corneille « tombe » plus souvent à la dissertation que d’autres auteurs, au contraire même peut-être, comme si son statut d’« hyperclassique », sa dimension de monument le protégeaient, avance Beate Langenbruch, d’un examen trop rapproché. Sans surprise en revanche est le choix des pièces mises au programme, assez largement conforme à la sélection traditionnellement opérée dans l’œuvre : la solennité et l’autorité du concours, ses répercussions majeures sur l’enseignement secondaire et supérieur, contribuent ainsi à figer encore davantage les contours d’un « Corneille » prototypique.
34On pouvait raisonnablement espérer qu’en dehors de nos frontières, la distance géographique et culturelle comme l’absence d’enjeux nationaux permettraient de sortir Corneille du « cadre d’analyse qui lui est imparti en France » (Hélène Bilis) et que, par exemple, les universités américaines proposent vers le dramaturge français des voies moins frayées. L’enquête auprès d’un large panel d’enseignants du supérieur aux États-Unis aboutit néanmoins à des conclusions plutôt mitigées. En dépit de l’excellence, de la vigueur et de l’originalité des études cornéliennes outre-Atlantique40, en dépit aussi du fait que les auteurs français n’y sont pas stricto sensu des classics, Corneille n’échappe dans les programmes undergraduate ni à la sélection habituelle dans son œuvre (« lorsque l’on parle d’enseigner Corneille, note Hélène Bilis, on parle en fait d’enseigner Le Cid »), ni à une forme du parallèle puisque sont très souvent étudiées dans le même programme une tragédie de Corneille et une de Racine. Seule, estime l’auteur, l’inscription dans des problématiques plus larges et des approches différentes (interdisciplinarité, humanités numériques, etc.) permet(trait) d’élargir et de renouveler l’étude du dramaturge rouennais dans les universités américaines. La classicisation et la patrimonialisation s’avèrent ainsi des formes paradoxales d’appropriation à la fois obligée et partielle : le devoir de transmission va de pair avec la ritualisation, et durant plus d’un siècle, la célébration du « Grand Corneille » s’est largement substituée au contact direct avec son œuvre.
Appropriations de l’auteur
35L’enquête de Joann Élart mentionnée ci-dessus vient confirmer en effet une des intuitions à l’origine de ce volume, éclairant sous un autre jour la note potentiellement péjorative présente dans le terme « appropriation » : il est frappant de constater en effet à quel point la programmation du répertoire cornélien, après l’Empire, semble inversement proportionnelle à la fréquence et à l’importance des hommages rendus à la figure tutélaire de Corneille, comme si les seconds suppléaient avantageusement au premier. La tragédie a disparu des théâtres, ni les acteurs ni les spectateurs n’en maîtrisent plus les codes, quels que soient les efforts de quelques Comédiens Français, comme Lafon et surtout Rachel : le répertoire est mince41, et surtout largement amputé, remanié voire réécrit, mais la figure du « créateur de la scène française42 » rayonne plus que jamais, à distance croissante de la fréquentation et de la connaissance de son œuvre43.
36L’influence majeure de Sainte-Beuve et le règne de la « vieuvre » (Antoine Compagnon) ont placé au premier plan l’auteur, son caractère, sa vie, ses portraits, ses maisons, sa légende et ce sont eux, au moins autant que l’œuvre et ses personnages, qui font l’objet des hommages et commémorations dont on a commencé d’explorer l’immense corpus. Georges Couton, ouvrant ce « légendaire cornélien » à la suite des historiens de la littérature de la fin du xixe siècle, a pu mettre en évidence la doxa a minima que nourrit un mince corpus de clichés inlassablement répétés : mêmes anecdotes, mêmes jugements, mêmes appels rituels – mais vains semble-t-il – à dépasser ces images convenues et souvent fausses. Il s’agit avant tout de s’assurer de la présence familière d’une figure tutélaire dont on cherche moins à approfondir la connaissance qu’on s’assure, par la répétition rituelle, de la part prestigieuse qu’elle constitue de notre identité nationale, régionale et individuelle.
37Stéphane Zékian, dans L’Invention des classiques, observe en effet le mouvement de « privatisation » dans la constitution de la figure du grand écrivain national : le génie qui plane au-dessus de l’humanité ordinaire est aussi un individu, un citoyen, un père de famille qui nous ressemble. De manière significative, la célébration rituelle de Corneille à Rouen fait figure de « fête de famille44 », et les à-propos dramatiques dont Corneille est le héros s’ancrent toujours davantage dans l’espace régional et domestique : des Champs-Élysées, du Capitole ou du Parnasse relativement abstraits des premiers au pittoresque cadre normand des derniers, des avanies reçues à la cour ou dans le cabinet de Richelieu aux consolations tardives de la vie patriarcale dans le pays natal, ces piécettes esquissent une biographie imaginaire à rebours, réinstallant le grand homme au soir de sa vie dans une province qu’il se repentirait d’avoir quittée45.
38Les maisons de la rue de la Pie et de Petit-Couronne font au xixe siècle l’objet d’un véritable culte : elles donnent lieu elles aussi à une intense production d’images et de textes, comme ce livre d’or du musée de Petit-Couronne, première maison d’écrivain, analysé ici par Marie-Clémence Régnier. Montrant comment l’érudit local Edmond Spalikowski compile, analyse et commente les contributions de diverses origines à ce livre d’or, Marie-Clémence Régnier met en évidence « l’enchâssement » des appropriations, depuis l’appropriation littérale de la maison par le Département de la Seine-Inférieure qui l’achète en 1874, jusqu’aux hommages topiques, qui en font un véritable « lieu commun » au sens rhétorique du terme, en passant par les gestes appropriateurs de la visite au « sanctuaire ».
Les appropriations de Corneille à Petit-Couronne résideraient dans l’adaptation polymorphe de son personnage, sur la scène théâtrale de sa propre maison, tous deux rendus opportunément conformes à l’image du génie et du gentilhomme campagnard que les contemporains fantasment. […] La visite de la maison, convertie en musée, constitue le pendant du « sacre de l’écrivain » aux yeux du commun des mortels, et plus précisément la déclinaison, au sein d’une culture de masse en gestation, des rituels correspondants : la « visite au grand écrivain46 » et le pèlerinage laïc47.
L’appropriation, entre destruction et création
39Sans doute discutable, la notion d’appropriation permet peut-être ainsi de mettre en évidence à quel point la réception des classiques oscille entre deux écueils. Faut-il opposer en effet le souci patrimonial à l’iconoclastie, la sacralité du texte au traitement cannibale, la révérence à la déshérence ? Ou, retournant l’argumentation, la recréation vivifiante à la monumentalisation, les variations de la mémoire au répertoire, le réemploi décalé à une orthodoxie fourrière de l’oubli ?
40La tradition classicisante, qui jadis pouvait ou voulait affirmer une présence éternelle de Corneille, se heurte aujourd’hui à un constat difficilement contournable : Corneille n’occupe plus la place éminente qui était la sienne naguère encore dans la culture et dans le cursus, sic transit le canon littéraire… Les amoureux de Corneille ont alors vanté contre cette érosion de sa gloire une improbable « modernité » du dramaturge, dont très significativement et comme par métonymie, on a redécouvert et exalté surtout les œuvres de jeunesse. Mais cette affirmation de la « jeunesse éternelle » de Corneille, autre formulation in fine du classicisme, si elle était encore vivace (mais déjà quelque peu volontariste sans doute) au moment du TNP, n’est plus à même aujourd’hui de parer au sentiment de la distance historique, perçue comme rédhibitoire par de plus en plus d’enseignants voire de metteurs en scène. À l’éloignement du texte s’ajoutent encore en effet la pesanteur de la tradition critique et la solennité de la figure, tant la patrimonialisation – au service de l’édification d’une littérature et d’une identité nationales jadis, et d’une forme de mémoire culturelle aujourd’hui –, peut s’avérer, comme le suggère Walter Benjamin, une « catastrophe48 » à laquelle ne saurait parer aucune iconoclastie, aucune « mise en pièces » comme celle, célèbre, à laquelle se livra Roger Planchon en 1969 avec La Contestation et la mise en pièces de la plus illustre des tragédies françaises « Le Cid » de Pierre Corneille, suivie d’une « cruelle » mise à mort de l’auteur dramatique et d’une distribution gracieuse de diverses conserves culturelles49.
41Au constat de l’écart des siècles et de la pétrification patrimoniale, on peut réagir en manifestant la distance, ou en travaillant à la réduire. L’approche historiciste, en documentant l’éloignement, ne l’annule pas néanmoins ; si elle fait de cette distance le point d’arrivée de l’effort critique, elle risque alors de transformer les œuvres en « objets inertes d’un musée des mentalités50 ». L’opération inverse consiste à aller chercher dans l’œuvre de Corneille uniquement ce qui nous ressemble (du moins le croit-on), ce qui nous parle, directement, et de nous-mêmes. Cette lecture « concernée » est par définition d’abord sélective, l’appropriation s’exerçant sur un aspect jugé actuel de l’œuvre : dans quelle mesure cependant cette part supposée « vivante » est-elle à nouveaux frais recherchée, reconnue et découpée au sein de l’ensemble de l’œuvre, ou est-elle plus souvent prélevée au sein de la part déjà jugée « lisible » du théâtre de Corneille, reconduisant ainsi le partage traditionnel entre majeur et mineur dans l’œuvre ? Noémie Charrié rappelle ensuite la critique par Vitez de la « démagogie ingénue » de l’actualisation, qui nie l’Histoire au moment même où on prétend l’affirmer. Dans quelle mesure enfin ce geste, qui s’empare du texte pour l’approcher de soi, détruit-il la distance nécessaire à « l’apparaître » de sa beauté ? Cette distance, rappelle Hannah Arendt à la suite de Kant, « ne peut s’instaurer que si nous sommes en position de nous oublier nous-mêmes, et les soucis, les intérêts, les urgences de notre vie, en sorte de ne pas nous saisir de ce que nous admirons, mais de le laisser être comme il est, dans son apparaître51 ». Si la distance est la condition de l’épiphanie de la beauté, toute appropriation risque d’être consommation, et donc destruction du caractère culturel de l’objet.
42Ce danger s’avère particulièrement aigu quand le destin de l’œuvre est engagé dans des processus qui « l’approprient », au sens premier, à la culture de masse. Quel est, dans le contexte du divertissement de masse, le résultat de ces formes d’appropriations sur leur objet ? Contribuent-t-elles au « pillage » et à la « destruction de la culture » qu’analyse Hannah Arendt ? La nature des objets culturels, avance-t-elle,
est atteinte quand ces objets eux-mêmes sont modifiés – réécrits, condensés, digérés, réduits à l’état de pacotille pour la reproduction ou la mise en images. Cela ne veut pas dire que la culture se répande dans les masses, mais que la culture se trouve détruite pour engendrer le loisir. […] Bien des auteurs du passé ont survécu à des siècles d’oubli et d’abandon, mais c’est encore une question pendante de savoir s’ils seront capables de survivre à une version divertissante de ce qu’ils ont à dire52.
43À lire le programme des festivités organisées par la municipalité de Rouen pour le tricentenaire en 1906, on peut se demander en effet quelle connaissance, et quelle connaissance commune de l’œuvre de Corneille elles pouvaient construire, entre cortège fleuri, concours de véhicules décorés, feu d’artifice, concert, grande soirée populaire, concours hippique et soirée chorégraphique avec concours de costumes du xviiie siècle (sic) d’un côté, visites de la rue de La Pie et du Petit-Couronne, inauguration de divers médaillons, bustes et plaques du grand homme, cortège du lycée Corneille au pont Corneille d’un autre côté, représentations enfin du Cid, d’Horace et du Menteur au Théâtre des Arts53. Sous l’apparence de la célébration collective, se devinent des modes d’appropriation à distance très variable de l’œuvre, pour des publics socialement différenciés, cloisonnés peut-être54. La commémoration de 2006 à Rouen présentait ce même caractère (en moins fastueux) de mélange d’actions divertissantes et « grand public » à distance de l’œuvre, et de mises en scène à destination des publics qui fréquentent les théâtres.
44Sans aller si loin peut-être que de promener Corneille en ballon dirigeable ou de transformer sa maison-musée en lieu d’expériences sensorielles sans grand rapport avec son théâtre, il paraît difficile néanmoins de proposer ce théâtre, y compris en classe, sans une forme d’adaptation. Les comédiens et les metteurs en scène ne se sont jamais privés, on le sait, de larges coupes dans les textes classiques, voire de réécritures importantes55. Sacrilège, ou modernisation indispensable, sans laquelle les textes de théâtre deviennent des monuments injouables, et bientôt illisibles pour l’immense majorité des lecteurs ? Le texte original, assurément, n’est pas physiquement mis en danger par ses réécritures, dont l’ampleur cependant, au passage, interroge. D’Aubignac invitait Corneille à corriger lui-même Le Cid ; Voltaire, lui, après avoir « réparée à neuf » et « habillé à la moderne » la Sophonisbe de Mairet, préconise que de jeunes plumes talentueuses réécrivent les œuvres de vieillesse de Corneille :
Nous avons des jeunes gens qui font très-bien des vers sur des sujets assez inutiles ; ne pourrait-on pas employer leur talent à soutenir l’honneur du théâtre français en corrigeant Agésilas, Attila, Suréna, Othon, Pulchérie, Pertharite, Œdipe, Médée, Don Sanche d’Aragon, la Toison d’Or, Andromède, enfin tant de pièces de Corneille tombées dans un plus grand oubli que Sophonisbe, et qui ne furent jamais lues de personne après leur chute ? Il n’y a pas jusqu’à Théodore qui ne pût être retouchée avec succès… On pourrait même refaire quelques scènes de Pompée, de Sertorius, d’Horace et en retrancher d’autres, comme on a retranché entièrement les rôles de Livie et de l’Infante dans ses meilleures pièces. Ce serait à la fois rendre service à la mémoire de Corneille et à la scène française56.
45Doit-on se réjouir qu’un tel projet soit resté lettre morte, du moins dans l’ampleur prévue par Voltaire ? Ou bien le texte cornélien est-il fatalement, à court ou moyen terme, appelé aux mêmes transformations que l’immense majorité des textes antiques et médiévaux, qui pour l’essentiel ne vivent dans la culture aujourd’hui qu’à travers leurs multiples réécritures, adaptations et parodies ? Selon les termes de Claire Carlin, les processus de « transposition », de « transculturation », de « transcodage » et d’« engagement intertextuel » sont autant de « transactions » sans doute nécessaires désormais entre le texte-source et ses recréations. C’est en tout cas pour une nouvelle relation aux textes classiques que plaide Christine Noille, sensible aux dangers de leur « muséalisation » :
[…] patrimonialiser des textes que notre culture a un temps promus comme identitaires, c’est risquer de les mettre hors-sol, c’est vouloir les retirer de leur intrication sociale et les archiver, c’est en avouer la valeur passée et l’inactualité (l’inefficience) présente. […] on peut résister à la tentation muséale en continuant à faire quelque chose avec les textes qui ne soit pas uniquement une fabrique de leur histoire […]. Et loin de nous replier sur la mémoire et l’archéologie des pratiques lectoriales et relectoriales, on peut en tenir pour une défense de nos disciplines comme arts vivants, […] plaider pour en accentuer la part vive et créatrice, pour en assumer plus consciemment et plus audacieusement peut-être la portée interventionniste et formalisatrice […]. Par-delà les clivages et les oppositions – entre interprétation et description, discours commentateur et discours rhétorique, critique littéraire et théorie –, le geste décisif est donc d’en arriver à promouvoir haut et fort l’idée d’une lecture experte, interventionniste et créatrice, l’idée d’un travail sur la textualité qui soit tourné vers la productivité et la prise en charge active du matériau textuel57.
46Une lecture « interventionniste et créatrice » donc, qui tablerait avant tout sur la faculté de « relance » du geste d’appropriation, conçu comme une relation esthétique, au sens premier, qui engage fondamentalement le corps, le désir et l’inconscient.
Rôle central du corps, de l’imaginaire et de l’émotion
47Dans l’avant-propos qu’elles consacrent à un collectif intitulé Corps et interprétation, Clotilde Thouret et Lise Wajeman plaident en faveur d’« une interprétation vraiment esthétique » : « l’objet à interpréter n’est pas tant l’œuvre que la réaction, l’affection du corps face à l’œuvre […] et les manières différentes d’engager l’expérience sensible dans l’interprétation58. » Ainsi l’exaltation, le transport59 propres au théâtre de Corneille appellent-ils une réponse sensible, frémissante, à l’unisson des héros, à la fois geste herméneutique infra-verbal et incorporation de l’œuvre60. Qu’on ait pu instrumentaliser, au service du bellicisme par exemple61, cette capacité du théâtre de Corneille à saisir et à galvaniser ne rend pas indésirables pour autant, au contraire, les vibrations en écho du public, mode premier et fondamental de l’appropriation de l’œuvre. La « réponse » au théâtre cornélien est corporelle, elle est aussi passionnelle. L’appropriation est fondamentalement un geste amoureux, bien des articles de ce volume le disent fortement : « pastiche aimant » de Gautier (Françoise Court-Perez), « appropriation amoureuse » du Cid par Massenet (Sarah Nancy), « affection » de Nisard pour cette même pièce (Mariane Bury), approche « sentimentale » de Corneille par le théâtre populaire (Jacques Téphany), et qui dit amour dit ouverture à l’altérité. Aimer les classiques c’est recevoir, comme le dit Barthes, « la flèche qu’à travers les siècles ils [nous] ont décochée ».
48On pourra donc plaider en faveur d’une « appropriation dialectisée », jouant « à la fois sur des coups de force anachroniques et sur une attention concomitante et plus inattendue à l’historicité des œuvres et de leur réception » (Lise Forment), jouant aussi sur l’alternance entre une réception sinon passive du moins accueillante à « l’apparaître » distant de l’œuvre et une actualisation transformatrice, entre l’abandon au transport et la réflexion, dialectique fidèle en cela au projet cornélien lui-même. La faculté d’emprise du théâtre de Corneille sur les réponses corporelles, les émotions immédiates (au sens propre) et les passions de l’auditoire, et dont il avait hautement conscience, engage en effet chez son auteur une éthique originale de la poétique et de l’écriture. L’admiration (la surprise donc, le choc quasi physique) dont Corneille fait le ressort original de son théâtre se trouve contrebalancée par le retour réflexif attendu du spectateur. À proportion de son doute à propos de la catharsis et de son ironie à l’égard de l’illusion théâtrale, grandit chez Corneille le souhait d’un spectateur à la fois totalement bouleversé et lucide, capable de réactions spontanées variées et complexes en même temps que d’une analyse informée et d’une critique à corps et cœur reposés, si l’on peut dire62. S’approprier Corneille, c’est sans doute entrer, par la lecture, l’interprétation, la mise en scène et le jeu, dans cette difficile dialectique entre saisissement et réflexivité, entre réponse corporelle, passionnelle et analyse. Complexe, l’appropriation est aussi marquée d’une profonde ambivalence, sensible par exemple dans la pratique anthologique, qui exalte le morceau de bravoure tout en désamorçant le pathétique continu lié au fil de l’intrigue63, dans l’admiration irrévérente de la parodie, dans la familiarité respectueuse avec « notre vieux Corneille ».
49Dialectisées et réfléchies, nos appropriations actuelles peuvent ainsi entrer en dialogue avec l’ensemble de l’héritage interprétatif, qui ne peut être ni une accumulation de strates dont la plus récente prétendrait à la vérité, ni un relativisme dans lequel les significations seraient aussi éphémères que les conditions historiques de leur production, mais qui exige des transactions fines, au cas par cas et toujours attentives à la variabilité historique des interprétations. S’approprier une œuvre exige enfin – et c’est l’essentiel peut-être – que, nous heurtant avec courage à l’énigme qu’elle nous oppose, nous lui permettions aussi de s’emparer de nous et de nous modifier.
1 Ralph Albanese, Corneille à l’École républicaine ; du mythe héroïque à l’imaginaire politique en France, Paris, L’Harmattan, 2008 ; Jean Mesnard, Alain Niderst et Jean-Marie Valentin (dir.), Pierre Corneille et l’Europe, Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. 28, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2008.
2 Corneille après Corneille, 1684-1791, dir. Myriam Dufour-Maître, xviie siècle, no 225, octobre 2004.
3 Corneille des romantiques, dir. Florence Naugrette et Myriam Dufour-Maître, Rouen, PURH, 2006.
4 Pratiques de Corneille, dir. Myriam Dufour-Maître, Rouen, PURH, 2012.
5 Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Pierre Corneille, dir. Myriam Dufour-Maître, Rouen, PURH, 2013.
6 John D. Lyons, « Le mythe du héros cornélien », Revue d’Histoire littéraire de la France, no 2, vol. 107, 2007, p. 433-448.
7 Voir sur ce point l’appel à communications du colloque Accuser réception organisé par Thierry Roger et Stéphane Zékian, https://www.fabula.org/actualites/accuser-receptiondossier-pour-la-section-colloques-en-lignes-du-site-fabula_88256.php, mis en ligne le 1er décembre 2018, page consultée la dernière fois le 1er juillet 2019.
8 Sur la spécificité du texte dramatique et les difficultés de sa lecture silencieuse et solitaire, en l’absence notamment de tout souvenir de représentation, voir André Petitjean, « Lire un texte théâtral », dans L’Expérience de lecture, dir. Vincent Jouve, Paris, L’Improviste, 2005, p. 189-202.
9 À propos de la « visite au grand écrivain », Olivier Nora évoque une sorte de « corps à corps que la lecture ne peut permettre, ou qu’elle n’autorise que de manière insuffisante » (Olivier Nora, « La visite au grand écrivain », dans Lieux de mémoire, t. II, La Nation, dir. Pierre Nora, Paris, Gallimard, 1986, p. 563-587, cité par Joann Élart, « D’un centenaire à l’autre : les hommages à Pierre Corneille à Rouen entre 1784 et 1884 », dans Nouvelles perspectives sur les spectacles en province (xviiie-xxe siècle), dir. Joann Élart et Yannick Simon, Rouen, PURH, 2018, p. 115-175, citation p. 118 note 26).
10 Hélène Merlin-Kajman, Lire dans la gueule du loup. Essai sur une zone à défendre, la littérature, Paris, Gallimard, 2016 ; L’Animal ensorcelé. Traumatismes, littérature, transitionnalité, Paris, Ithaque, 2016, et le site http://www.mouvement-transitions.fr.
11 Émile Faguet, Corneille expliqué aux enfants, Paris, Lecène et Oudin, 1885.
12 Je me permets de renvoyer à mon article « Corneille poéticien (anti)galant : l’édition de 1660 et la formation du public mondain », dans Littéraire. Pour Alain Viala, dir. Marine Roussillon, Sylvaine Guyot, Dominic Glynn et Marie-Madeleine Fragonard, Arras, Artois Presses Université, 2018, 2 vol., t. 1, p. 379-387.
13 Trésor de la langue française, 16 vol., Paris, CNRS, 1971-1994, cité ici par Sarah Nancy.
14 La Bruyère, Les Caractères, « Des ouvrages de l’esprit », 69.
15 Fénelon, Lettres sur l’Église, dans Œuvres, Paris, Lefèvre, 1835, vol. 1, p. 207.
16 Mariane Bury et Georges Forestier (dir.), Jeux et enjeux des théâtres classiques (xixe-xxe siècles), Littératures classiques, no 48, printemps 2003.
17 Michel Foucault, « Les monstruosités de la critique [1971], Dits et écrits I, dir. D. Defert et F. Ewald, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2001, p. 1082-1091. Je remercie Thierry Roger et Stéphane Zékian d’avoir attiré mon attention sur cet article.
18 Émile Picot, Bibliographie cornélienne ou description raisonnée de toutes les éditions des œuvres de Pierre Corneille, des imitations ou traductions qui en ont été faites, et des ouvrages relatifs à Corneille et à ses écrits, Paris, Auguste Fontaine, 1876.
19 Roger Le Brun, Corneille devant trois siècles. Opinions des principaux écrivains des xviie, xviiie et xixe siècles, Paris, Sansot, 1906, « Avertissement », p. V-VII.
20 Ibid., p. VI.
21 Ibid., p. LXXXIII.
22 Site Dezède : https://dezede.org/dossiers.
23 Joann Élart, « D’un centenaire à l’autre : les hommages à Pierre Corneille à Rouen entre 1784 et 1884 », art. cité.
24 Journal de Rouen, 281, 11 messidor an XIII [30 juin1805], p. 4, cité par J. Élart, p. 118.
25 É. Picot recense 15 « pièces de Corneille remaniées ou retouchées », entre la fin du xviiie et le milieu du xixe siècle (nos 810 à 825) : ce chiffre des réécritures publiées reste très en-deçà de la réalité de la scène. On va jusqu’à mixer entre elles des pièces réputées injouables, pour pouvoir les représenter, comme le fait Édouard Thierry en 1861 avec L’Illusion, d’abord réduite en 4 actes avec intercalation d’un fragment de Don Sanche d’Aragon au 4e acte, puis en 3 actes (notice de la Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française).
26 André Chervel commente en ces termes l’action de l’abbé Batteux sur les textes destinés aux élèves : « L’abbé Batteux consacrera la fonction éminemment oratoire que la pédagogie du xviiie siècle assigne à la tragédie classique. Il ponctionne donc sur les pièces classiques les harangues, les tirades ou les monologues qui pourront faire l’objet de récitations en classe, non sans opérer quelques interventions sur les textes qu’il livre à ses lecteurs, caviardages ou collages : “Si par hasard nous trouvions çà et là deux ou trois beaux vers qui ne pouvaient faire un discours à part, nous les insérions dans d’autres auxquels ils pouvaient se rapporter, liberté dont nous demandons pardon aux grands hommes dont nous avons emprunté ces discours.” » (Charles Batteux, Chefs-d’œuvre d’éloquence poétique à l’usage des jeunes orateurs, ou discours français tirés des auteurs tragiques les plus célèbres, Paris, 1780, préface ; cité par André Chervel, Histoire de l’enseignement du français, Paris, Retz, 2008, chapitre 8, « La scolarisation et l’exploitation des œuvres littéraires », p. 484).
27 Disponibilité d’autant plus grande que la fable théâtrale a elle-même une origine mythique, comme Horace. Le film Horace 62, réalisé par André Versini en 1962, avec Charles Aznavour dans le rôle principal, ne se réfère que dans le générique à la tragédie classique de Pierre Corneille, mais propose avec elle un jeu d’échos, de transpositions, de ressemblances et d’écarts : la futilité du motif de la vendetta, l’orgueil ridicule des pères, l’impuissance de l’État, la fabrique de « faux durs » mais de vrais cadavres, la course-poursuite meurtrière et le duel final, qui évoquent à la fois le film noir, le western et le jeu d’échecs, sont autant d’appropriations parodiques, non pas tant d’ailleurs du texte de Corneille que de la tradition critique qui lui est attachée. Lecture « albaine », si on reprend la distinction proposée par Marc Escola (« Récrire Horace », xviie siècle, no 216, 2002/3, p. 445-467), avec laquelle entre en résonance la mise en scène résolument antimilitariste et « anti-romaine » de cette tragédie par Hubert Gignoux au TNS, un an plus tard, mais qui ici transforme le mythe pour faire d’Horace – qui ne tue pas Camille – la victime in fine d’un enchaînement aussi tragique qu’absurde.
28 Sur la place privilégiée de L’Illusion comique dans les appropriations ces dernières décennies, et sur celle d’Olivier Py en particulier, voir Christian Biet « Corneille, ou la résistance », dans Pratiques de Corneille, op. cit., p. 95-112, et Ariane Ferry, « Mettre en scène un discours critique sur le théâtre. Portrait d’Olivier Py en “criticauteur” de Théâtres à Illusions comiques », dans L’Ombre dans l’œuvre. La critique dans l’œuvre littéraire, dir. Marianne Bouchardon et Myriam Dufour-Maître, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 225-239.
29 Voir tout particulièrement le grand livre dirigé par Jean-Marie Valentin avec la coll. de Laure Gauthier, Pierre Corneille et l’Allemagne. L’œuvre dramatique de Pierre Corneille dans le monde germanique (xviie-xixe siècles), Paris, Desjonquères, 2007.
30 Le refus sans doute le plus radical de la poétique cornélienne est celui exprimé par Lessing, qui traite le dramaturge français de « bousilleur », selon la traduction que propose Catherine Kintzler (« Lessing et les monstres cornéliens », dans Corneille après Corneille, 1684-1791, op. cit., p. 685-696, et Théâtre et opéra à l’âge classique. Une familière étrangeté, Paris, Fayard, 2004, p. 51-71).
31 Pour mémoire, citons entre autres André Rousseaux, « Situation de Corneille de 1636 à 1947 », Cahiers de Neuilly, 1947, XVI, p. 1-9 ; Georges Couton, « État présent des études cornéliennes », L’Information littéraire, mars-avril 1956, p. 43-48 ; Simone Dosmond, « Bibliographie du tricentenaire », La Licorne, IX, 1985, p. 97-102 ; Georges Forestier, « Corneille. Approche bibliographique », Littératures classiques, no 32, janv. 1998, p. 189-196 ; Charles Mazouer (dir.), Présences de Corneille. 1975-2005 : 30 ans de réception critique, Œuvres et critiques, t. XXX, vol. 2, Tübingen, Narr, 2005.
32 Delphine Denis, « Pour une approche discursive de l’histoire littéraire. Événements linguistiques et catégories esthétiques », dans L’Analyse du discours dans les études littéraires, dir. Ruth Amossy, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2003, p. 51-62.
33 Au-delà du silence sur l’œuvre comme dans le cas de Roland Barthes, la réflexion sur l’appropriation s’ouvre ainsi également sur les gestes qui travaillent plus activement à sa disqualification, militent pour son rejet et organisent son oubli : ainsi de l’œuvre du « vieux Corneille ».
34 André Chervel présente rapidement l’exercice de la déversification, ersatz de la version latine destiné aux classes primaires et populaires, qui consiste à réécrire les vers classiques français en une prose simple : cette pratique, ni avalisée ni vraiment condamnée par l’Inspection, rencontre un relatif succès jusqu’au début du xxe siècle (André Chervel, Histoire de l’enseignement du français, op. cit., p. 578-588). A. Bonnaire, dans son Manuel de compositions françaises contenant des sujets de narration et d’amplification, propose de son côté des « vers à retourner » ou « morceaux de poésie disposés de manière que l’élève ait à retrouver les vers », ainsi de l’acte II scène 3 d’Horace (Paris, Dupont et Cie, 1836, p. 181-182).
35 Pierre Chevallier, Louis XIII, roi cornélien, Paris, France Loisirs, 1980.
36 Beate Langenbruch cite dans ce volume le sujet de l’agrégation de Lettres classiques de 2015, qui portait sur le dilemme, nommé ici « paradoxe héroïque » : « La détermination héroïque suppose […] une prise de connaissance parfaite de la situation et un effort de volonté pour réaliser un ordre supérieur, qui contraint l’individu à renoncer à son droit essentiel ou à son propre bonheur. Il en sortira broyé et magnifié. Se réaliser, c’est se renoncer. Tel est le paradoxe héroïque. » (André Stegmann, L’Héroïsme cornélien, genèse et signification, Paris, Colin, 1968, t. 2, p. 409).
37 Voir par exemple Le Citateur dramatique, ou Choix de maximes, sentences, axiomes, apophtegmes et proverbes en vers contenus dans tout le répertoire du théâtre français recueillis et mis en ordre, par Léonard Gallois, Paris, Barba, 1822.
38 « Beaucoup de vers du Menteur avoient passé en proverbe ; & même, près de cent ans après, un homme de la Cour contant à table des anecdotes très-fausses, l’un des convives se tournant vers le Laquais de cet homme, lui dit : “Cliton, donnez à boire à votre Maître.” Cliton est le nom du Valet du Menteur. » (Joseph Laporte et Jean-Marie-Bernard Clément, Anecdotes dramatiques, Paris, Vve Duchesne, 1775, 3 vol. ; Genève, Slatkine Reprints, 1971, t. I, p. 541).
39 Martine Jey, La Littérature au lycée : invention d’une discipline (1880-1925), Metz, Université de Metz, 1998 ; Ralph Albanese, Corneille à l’école républicaine, op. cit. ; Françoise Gomez, « Didactiques de Corneille. Archéologie de la réception scolaire du héros cornélien », dans Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Pierre Corneille, op. cit., p. 259-296.
40 Qu’on songe, parmi d’autres, aux travaux de premier plan de Mitchell Greenberg (Corneille, Classicism, and the Ruses of Symmetry, Cambridge University Press, 1986), de John D. Lyons (The Tragedy of Origins. Pierre Corneille and Historical Perspective, Stanford University Press, 1996 ; Kingdom od Disorder. The Theory of Tragedy in Classical France, West Lafayette, Purdue University Press, 1999), de Claire Carlin (Women Reading Corneille: Feminist Psychocriticisms of Le Cid, New York, Peter Lang, 2000), de Katherine Ibbett (The Style of the State in french Theater, 1630-1660. Neoclassicism and Governement, Londres, Ashgate, 2009).
41 « À l’époque des débuts de Rachel en 1838, seules cinq tragédies sont maintenues au répertoire […] : Le Cid, Cinna, Don Sanche d’Aragon, Horace et Nicomède », auquel s’ajoutera Polyeucte » (J. Élart, art. cité, p. 116).
42 Selon la formule de Désiré Nisard, qui reprend celle de Fontenelle mais en insistant moins sur le poéticien (re)fondateur que sur le créateur de héros nationaux (Martine Jey, « Corneille dans l’institution universitaire au xixe siècle : classique ou romantique ? », dans Corneille des Romantiques, op. cit., p. 215-227, citation p. 217. Sur Fontenelle, voir Claudine Poulouin, « Corneille, père de la scène française. La théorisation de la supériorité de Corneille par Fontenelle », dans Corneille après Corneille (1684-1791), op. cit., p. 735-746).
43 Ainsi à Rouen sous la Restauration, l’œuvre de Corneille (les pièces complètes, en excluant les extraits, hommages etc.) ne représente que 0,3 % des spectacles. « Autrefois on fêtait Corneille par la représentation de quelques-uns de ses chefs-d’œuvre », ce qui n’est plus le cas, note un journaliste, qui ajoute ironiquement : « Qu’importe en effet ? Le vaudeville n’est-il pas là pour célébrer la gloire du père de la tragédie française ? » (Journal de Rouen, 181,30 juin 1835, p. 3, cité par Joann Élart, art. cité, p. 156-157).
44 Journal de Rouen, 30 juin 1805, p. 4, cité par J. Élart, art. cité, p. 163.
45 Marie-Clémence Régnier, Vies encloses, demeures écloses. Le grand écrivain français en sa maison-musée (1879-1937), thèse de l’Université Paris-Sorbonne, dir. Florence Naugrette et Françoise Mélonio, soutenue le 24 novembre 2017 ; Myriam Dufour-Maître, « Et Corneille devint normand (1767-1939) », dans Normands de plume. Les écrivains et la Normandie, entre identité et patrimoine, dir. Yvan Leclerc et Myriam Dufour-Maître, Études normandes, juin 2016, p. 7-20.
46 Olivier Nora, « La visite au grand écrivain », dans Les Lieux de mémoire II. La nation, op. cit., p. 563-587.
47 Jean-Claude Bonnet, Naissance du Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes, Paris, Fayard, 1998.
48 « De quel péril les phénomènes sont-ils sauvés ? Pas seulement, et pas principalement du discrédit et du mépris dans lesquels ils sont tombés, mais de la catastrophe que représente une certaine façon de les transmettre en les “célébrant” comme “patrimoine”. – Ils sont sauvés lorsqu’on met en évidence chez eux la fêlure. – Il y a une tradition qui est catastrophe. » (Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, Paris, Cerf, 1997, p. 490, cité par Christian Jouhaud, Sauver le Grand Siècle ? Présence et transmission du passé, Paris, Le Seuil, 2007, p. 7).
49 Théâtre de la Cité de Villeurbanne. Sur ce spectacle, voir Brigitte Prost, Le Répertoire classique sur la scène contemporaine. Les jeux de l’écart, Rennes, PUR, 2010, p. 55-65. On peut noter cependant, pour le xxe siècle, la rareté relative pour l’œuvre de Corneille de ces jeux de (mas)sacre, comparativement à ceux dont sont « victimes » Racine et Molière.
50 Max Vernet, « Discorde et interprétation », dans Concordia discors, Actes de la NASSCFL 2009, dir. Benoît Bolduc et Henriette Goldwyn, Tübingen, Narr, « Biblio17 » nos 194-195, 2011, t. I, p. 55-64.
51 Hannah Arendt, La Crise de la culture [1954 ; 1972 pour la traduction française], Paris, Folio Essais, 1995, p. 269. Nos italiques.
52 Ibid., p. 266.
53 https://dezede.org/dossiers, cité.
54 La diversité de ces gestes d’appropriation, des objets et des manifestations qui en résultent, était tout particulièrement montrée dans l’exposition Corneille et nous, organisée à l’automne 2014 par les Archives de la Seine-Maritime avec la collaboration du Mouvement Corneille : images et bons points scolaires, affiches et objets publicitaires, enseignes commerciales, cartes régionales, etc., témoignent d’une présence du grand homme dans la ville et dans la vie quotidienne, aux côtés des éloges, chansons, pastiches, parodies où se mêlent révérence et familiarité. Voir l’avant-propos de ce volume.
55 Si ce n’est peut-être que les metteurs en scène aujourd’hui ne se vantent guère des coupes et menues réécritures qu’ils opèrent, et qu’ils ne les mentionnent pas toujours.
56 Voltaire, épitre dédicatoire « À Monseigneur le duc de La Vallière », Sophonisbe, tragédie de Mairet, réparée à neuf par M. Lantin [Voltaire], Paris, Vve Duchesne, 1770 ; éd. critique par Christopher Todd, dans Voltaire, Œuvres complètes, Oxford, The Voltaire Foundation, vol. 71B, dir. Nicholas Cronk, 2005, p. 43-137, citation p. 50-51. L’invitation de Voltaire est suivie notamment par François Tronchin (Mes récréations dramatiques, Genève, Bonnant, 1779-1784, t. II p. 143-207), par François Andrieux (Anaximandre ou le Sacrifice aux Grâces [1782], Paris, Collin, 1805), par F. Brunot (Corneille au xixe siècle ou Œuvres de Corneille remises à la scène en 1804, BnF Ms-Fr 15078).
57 Christine Noille, « La forme du texte : rhétorique et/ou interprétation », Fabula-LhT, no 14, « Pourquoi l’interprétation ? », février 2015, URL : http://www.fabula.org/lht/14/noille.html, page consultée le 31 octobre 2016.
58 Clotilde Thouret et Lise Wajeman, Corps et interprétation (xvie-xviiie siècles), Amsterdam / New York, Rodopi, coll. « Faux Titre », 2012, Avant-propos, p. 7-18, citation p. 14. Voir aussi Emma Gilby, « Le sens commun et le “sentir en commun” », dans Les Émotions publiques et leurs langages, dir. Hélène Merlin-Kajman, Littératures classiques, no 68, 2009, p. 243-254.
59 On se rappelle le jugement de Sévigné : « Vive donc notre vieil ami Corneille ! Pardonnons-lui de méchants vers, en faveur des divines et sublimes beautés qui nous transportent ; ce sont des traits de maître qui sont inimitables. » (Madame de Sévigné, Correspondance, éd. Roger Duchêne, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, lettre du 16 mars 1672, p. 459).
60 Cette question est abordée notamment dans le collectif La Voix du public dirigé par Julia Gros de Gasquet et Sarah Nancy (Paris, Classiques Garnier, sous presse). Je me permets d’indiquer ma contribution, sous le titre « La voix de l’admiration : le théâtre du “vieux Corneille” et l’éclat du public ».
61 Parmi bien d’autres exemples, un à-propos d’Olivier de Gourcuff met en scène le fantôme de Rodrigue apparaissant à l’officier vaincu de 1870 : « Quand la lyre d’airain sur des cordes plus hautes / lance l’hymne vengeur, sonne avec plus d’éclat, / C’est Corneille qui dicte aux poètes, ses hôtes, / La Fille de Roland ou les Chants du soldat. // […] Ta leçon d’héroïsme est toujours écoutée, / […] Ce que Corneille écrit vibre éternellement. » (Pro Gallia. Les héros de Corneille, drame en un acte en vers, Paris, Sauvaitre, 1893, p. 14-15).
62 Les spectateurs peuvent « repasser sur ce qui les a touchés au Théâtre, pour reconnaître s’ils en sont venus par là à cette crainte réfléchie, et si elle a rectifié en eux la passion qui a causé la disgrâce qu’ils ont plainte », « Discours de la tragédie », dans Corneille, Trois Discours sur le poème dramatique, éd. Bénédicte Louvat et Marc Escola, Paris, GF Flammarion, 1999, p. 100 et passim.
63 Ainsi l’usage de célébrer Corneille par la mise en scène de fragments divers de ses chefs d’œuvre. Les extraits vont jusqu’à représenter 43 % de la programmation consacrée à Corneille par le Théâtre des Arts de Rouen entre 1843 et 1884 (Joann Élart, « D’un centenaire à l’autre », art. cité, p. 144, 151, 152, 157).
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en octobre 2014, publiés par Myriam Dufour-Maître
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 24, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/809.html.
Quelques mots à propos de : Myriam Dufour-Maître
Université Rouen-Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
