Sommaire
Le Lys recomposé
La représentation des pouvoirs sous l’Ancien Régime dans la littérature fictionnelle du xixe siècle (1800-1850)
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en mars 2018, publiés par Laurent Angard, Guillaume Cousin, et Blandine Poirier
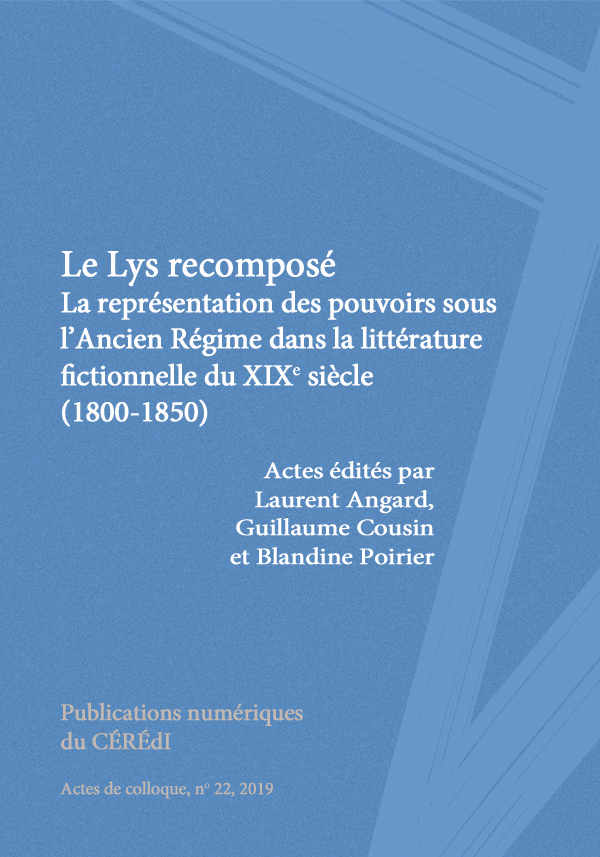
- Guillaume Cousin Introduction
- Patrick Berthier L’Ancien Régime de Balzac
- Anne-Marie Callet-Bianco Vive le roi quand même ? La noblesse entre ralliement et affrontement dans les cycles romanesques de Dumas
- Isabelle Safa Le conseiller du prince dans les cycles historiques d’Alexandre Dumas : entre condamnation romanesque et réhabilitation historique
- Marie-Agathe Tilliette La représentation de la Cour des miracles dans le roman historique : un contre-pouvoir judiciaire ?
- Flavien Bertran de Balanda Une Contre-utopie face à l’Histoire : l’Ancien Régime selon Bonald, une uchronie politique à l’âge romantique
- Sophie Vanden Abeele-Marchal Un lys « décomposé » dans « le nuage obscur des gens du roi ». Le roi, la noblesse et les favoris chez Vigny
- Laetitia Saintes Du roi d’Yvetot au marquis de Carabas. Figures du pouvoir et de la noblesse d’Ancien Régime dans l’œuvre de Pierre-Jean de Béranger
- Aurore Montesi Recomposer la majesté. Henri V et « l’invention » de Chambord comme monument national
- Thibaut Julian Louis XIII et Richelieu au théâtre sous Napoléon ou Napoléon au théâtre sous Louis XIII et Richelieu
- Florence Fix « Encore des barricades » ? Les États de Blois au théâtre (1810-1837)
- Sophie Mentzel Le lys décomposé : Bourbons sans majesté au théâtre
- Stéphane Arthur Ango ou la représentation du pouvoir à l’épreuve de la scène
- Barbara T. Cooper Le Moyen Âge comme palimpseste de la monarchie de Juillet ? La Peste noire, ou Paris en 1334, drame du vicomte d’Arlincourt
L’Ancien Régime en roman
La représentation de la Cour des miracles dans le roman historique : un contre-pouvoir judiciaire ?
Marie-Agathe Tilliette
1De la représentation de la Cour des miracles dans le roman du début du xixe siècle, on connaît surtout la description pittoresque qui en est faite dans Notre-Dame de Paris. C’est en suivant les errances vespérales de Pierre Gringoire que l’on pénètre dans ce cul-de-sac parisien à la détestable réputation, repaire nocturne de tous les gueux, vagabonds, Bohémiens, prostituées et autres individus peu recommandables, qui peuplent dans la journée les rues de la capitale. Cette cour interdite aux honnêtes bourgeois tient son nom du « miracle » qui s’y accomplit chaque soir : les mendiants se débarrassent de leurs divers déguisements et, d’infirmes et malades, redeviennent vigoureux et sains. Ainsi, dans Notre-Dame de Paris, Pierre Gringoire est suivi par trois mendiants très insistants, un cul-de-jatte, un « perclus » et un aveugle. Aux abords de la Cour, le cul-de-jatte retrouve ses jambes, le paralytique jette au loin ses béquilles et l’aveugle fixe Gringoire « avec des yeux flamboyants1 » : le miracle s’est accompli, Gringoire est entré dans le royaume des gueux. Il convient bien de parler de royaume, en effet, car le mot de « cour » peut être compris dans au moins deux sens : son sens spatial (espace entouré de murs, de haies ou de bâtiments) et son sens politique (lieu où réside un souverain et sa suite). Dans l’espace qu’est la Cour des miracles, les truands se sont constitués en royaume, dirigé par un souverain, nommé le Grand coësre ou le roi de Thunes. On verra, dans notre étude, que le sens juridique du mot (lieu où la justice est rendue) vient compléter cet usage déjà polysémique.
2Victor Hugo n’est pas le seul, dans la décennie 1825-1835, à insérer dans un roman la description de cette cour inquiétante et fascinante, qui deviendra, à partir de Notre-Dame de Paris, un lieu emblématique de l’esthétique des bas-fonds, comme l’a montré Dominique Kalifa2. C’est un motif que l’on retrouve particulièrement développé dans quatre autres romans de cette décennie, de part et d’autre de la révolution de Juillet : Raoul (1826), de G. de la Baume, Marie de Mancini (1830) de Marie Aycard3, La Cour des miracles (1832) de Théophile Dinocourt et Le Justicier du roi (1834) de V. Philippon de la Madelaine4. On laisse de côté les romans, en nombre non négligeable, où la Cour des miracles n’est que mentionnée ou rapidement décrite.
3En préambule, il convient de faire preuve de prudence vis-à-vis de l’expression de « roman historique ». Si l’on s’en tient à une définition large – on appelle roman historique tout roman qui mêle à une intrigue fictionnelle des événements et des personnages historiques –, nos cinq romans entrent tout à fait dans cette catégorie, d’autant plus que tous, à l’exception du roman de Théophile Dinocourt, inscrivent une date dans leur sous-titre. Si l’on essaie de circonscrire cette définition, les choses se compliquent quelque peu : par exemple Le Justicier du roi de Philippon de la Madelaine a beau être situé dans le temps et mettre en scène François Ier, il n’y a guère de volonté de reconstitution historique réaliste et l’appellation de « roman frénétique » correspond mieux à la nature échevelée des péripéties qui se succèdent. Il n’est pas plus simple de s’en tenir aux intentions ou déclarations des auteurs, puisqu’à ce compte, Notre-Dame de Paris ne serait pas un roman historique, dans la mesure où Victor Hugo affirme, dans une lettre de décembre 1868 à son éditeur Lacroix, ne jamais en avoir écrit5. Pour notre étude, il nous a semblé légitime de nous en tenir à une définition large du roman historique, sans chercher pour autant à rabattre nos cinq romans sur un modèle unique. Que l’objectif principal soit un pittoresque anhistorique ou une réflexion d’ordre historiographique, il n’en reste pas moins que les cinq romans ont choisi de s’attarder sur ce lieu du passé qu’est la Cour des miracles.
4La réalité historique de la Cour des miracles est sujette à caution. Des historiens tels que Bronisław Geremek ou Roger Chartier estiment qu’elle n’est pas un pur fantasme, mais la cristallisation imaginaire d’une réalité urbaine, dans la mesure où les mendiants et vagabonds tendaient à se regrouper soit dans les faubourgs, soit dans les cours ou impasses les moins praticables au sein de la ville6. Comme nous l’apprennent ces deux historiens, il existe une certaine diversité des sources historiques, ce que Roger Chartier appelle la « littérature de la gueuserie », qui décrit les subterfuges des mendiants pour apitoyer les passants ou qui énumère leurs divers lieux de rassemblement. Pourtant, les romans historiques qui nous intéressent ne font appel qu’à une référence, la plus récente et la plus accessible : l’ouvrage d’Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, écrit dans les années 1660, mais publié seulement en 1724, de manière posthume. Cet ouvrage, constitué de six livres, consacre un chapitre de quelques pages aux cours des miracles, et il est flagrant d’observer l’unité de toutes les descriptions autour de celle de Sauval. Cette source est parfois donnée au lecteur, mais dans tous les cas, l’exactitude historique n’est pas la priorité première, dans la mesure où cette même représentation est déplacée de siècle en siècle. Notre-Dame de Paris se déroule en 1482, à la toute fin du règne de Louis XI, Le Justicier du roi en 1539, sous le règne de François Ier, La Cour des miracles en 1629, sous Louis XIII, et Marie de Mancini en 1659, sous la régence d’Anne d’Autriche… Raoul, quant à lui, se déroule avant l’Ancien Régime, en 1228, sous la régence de Blanche de Castille. Il est vrai que la datation historique proposée par Sauval reste vague, puisqu’il estime que les cours des miracles sont « aussi anciennes à Paris que les gueux et la gueuserie », mais la description reprise par les romanciers est celle de la « Cour des miracles » à proprement parler (celle qui porte ce nom), située dans le quartier Montorgueil, et dont Sauval dit qu’elle existe encore au moment où il écrit, dans la seconde moitié du xviie siècle7.
5Malgré cet écart de datation, nos cinq descriptions de la Cour des Miracles sont très fidèles au texte de Sauval et à sa Cour des miracles du xviie siècle, allant parfois jusqu’à la reprise littérale8, mais le plus souvent se contentant de diverses variations. Le texte fondateur introduit ainsi sa description : « Elle consiste en une place d’une grandeur très considérable, et en un très grand cul-de-sac puant, boueux, irrégulier, qui n’est point pavé9. » À cette introduction on peut comparer celle de Marie Aycard : « C’était une grande place irrégulière, hérissée de huttes de terre qui formaient des rues tortueuses, et présentaient l’aspect le plus misérable et le plus hideux qu’il soit possible d’imaginer10 » ; ainsi que celle de Victor Hugo : « C’était une vaste place, irrégulière et mal pavée, comme toutes les places de Paris alors11. » Comme on le voit, les mêmes caractéristiques sont choisies pour présenter ce lieu : le centre de la Cour des miracles est constitué d’une place de grande taille, qui ne dispose pas de cette commodité essentielle de la ville moderne qu’est un pavement régulier. Cette absence fait de prime abord de ce lieu un espace marginal, à l’écart de la ville bien qu’il soit situé en son centre même, à l’écart du progrès urbain. La variation la plus intéressante entre ces trois phrases d’introduction est que Marie Aycard insiste sur le caractère unique du lieu, par l’intensité du vocabulaire choisi et les deux superlatifs, alors que Victor Hugo semble le nuancer par la comparaison généralisante. On peut mettre cette différence au compte de la datation (Hugo situe son roman en 1482, Aycard en 1659, près de deux siècles plus tard), mais aussi d’une volonté de reconstitution historique moindre chez Aycard qui ne propose aucune description de Paris dans son ensemble.
6Une fois passée cette introduction, on peut déduire, des six descriptions qui nous intéressent, deux caractéristiques principales de la Cour des miracles. La première, inhérente aux habitants du lieu, est l’immoralité, sous toutes ses formes : tout d’abord la pratique du vol et de la prostitution, mais aussi la promiscuité constante entre les sexes et le détournement superstitieux de la religion. Les descriptions insistent particulièrement sur les ruses des mendiants pour s’inventer des maladies repoussantes et ainsi attendrir les passants. Prenons l’exemple de la « jambe de Dieu », à laquelle trois de nos textes font allusion.
Ils se lient le plus fortement qu’ils peuvent avec une bande fort étroite ; si c’est une jambe, ils dansent dessus ; si c’est un bras, ils s’y appuient et ainsi des autres, jusqu’à ce que la partie devienne bien enflée. Cela fait, ils la déplient puis y mettent à l’heure même de l’éclaire, qu’ils y laissent toute la nuit, et qui a la propriété de couvrir la peau de cloches. Le matin ils les coupent, et comme il en sort de l’eau rousse, ils l’arrêtent avec de la poirée, qui la convertit en boue. Après tout pour rendre ces plaies plus vraies et plus vilaines, ils les entourent de sang de bœuf détrempé avec de la farine, et préparé comme j’ai dit par leurs apprentis. Une jambe en cet état s’appelle une jambe de Dieu12.
C’était une espèce de faux soldat, un narquois, comme on disait en argot, qui défaisait en sifflant les bandages de sa fausse blessure, et qui dégourdissait son genou sain et vigoureux, emmailloté depuis le matin dans mille ligatures. Au rebours, c’était un malingreux qui préparait avec de l’éclaire et du sang de bœuf sa jambe de Dieu du lendemain13.
Il avait en outre, croisée sur l’autre une jambe qui paraissait dévorée d’un ulcère affreux, et que des linges horriblement tachés rendaient encore plus dégoûtante à voir. La plaie qui apparaissait sur cette jambe de dieu comme on appelait parmi les gueux toutes celles qu’ils présentaient au public dans un état pareil, n’était pas, on doit bien le croire, plus réelle chez ce grand prince que la hideuse maladie dont il jugeait à propos de décorer sa tête. Cette jambe enflée de la grosseur du corps d’un enfant et tuméfiée en conséquence, pouvait, Sa Majesté le voulant, sous moins de vingt-quatre heures être rendue à ses proportions naturelles et redevenir aussi saine que s’il n’y fût jamais venu le moindre bouton14.
7On le voit, chaque texte a ses caractéristiques propres. Celui d’Henri Sauval hérite directement de la littérature de la gueuserie, à mi-chemin entre la description et la prescription, adressée à un public fictif, dans la mesure où cette littérature n’est évidemment pas destinée aux gueux eux-mêmes15. Victor Hugo préfère une simple allusion à la « jambe de Dieu », laissant le lecteur libre de s’imaginer les meilleures recettes avec de l’éclaire et du sang de bœuf. Théophile Dinocourt l’isole comme un procédé digne du Grand coësre, sans reprendre, lui non plus, le ton prescriptif de la littérature de la gueuserie – il est à noter que Dinocourt publie La Cour des miracles en 1832, sur l’inspiration directe de Victor Hugo, dont il cite explicitement le texte à plusieurs reprises. Les trois textes s’accordent en tout cas sur l’ingéniosité des mendiants à modifier leur apparence physique, élevant un tel savoir-faire à la dignité d’un véritable métier. Comme le rappelle l’intrigue de Notre-Dame de Paris au détriment de Pierre Gringoire, n’est pas truand qui veut, c’est un art qui doit être appris.
8Cette question technique nous amène à la seconde caractéristique du lieu qui est son organisation rigoureuse, malgré le chaos apparent, sur le modèle monarchique16. Une des caractéristiques récurrentes des descriptions est, à la suite de Sauval, l’énumération des titres des argotiers : narquois, marcandiers, rifodés, malingreux, courtaux de boutanche, francsmitoux, hubins, coquillarts, etc., sont des noms repris par tous les romanciers, pour la plus grande curiosité linguistique des lecteurs. Ce qui revient également, c’est l’organisation pyramidale des argotiers autour du roi, le Grand coësre ou roi de Thunes. Autour de son autorité se dessine une véritable contre-société, structurée par une hiérarchie précise, régie par ses lois propres et unifiée autour d’une langue commune, l’argot17. Dans un premier temps, cette contre-société apparaît comme une société à l’envers, qui renverse systématiquement les valeurs traditionnellement acceptées. Par exemple, explique Henri Sauval, contrairement aux règles sociales communes qui suggèrent de prévoir et d’épargner, la Cour des miracles est un royaume du présent, qui interdit formellement à ses membres de garder une quelconque ressource pour le lendemain18. Cette contre-société semble avoir figé en un lieu donné le temps borné de la fête des fous – ce n’est pas un hasard que Notre-Dame de Paris s’ouvre sur cette célébration. On peut prendre comme exemple de ce renversement systématique le texte de G. de la Baume.
Là, quiconque était rejeté de la société des gens de bien, rencontrait immédiatement sûreté, protection et impunité, pour commettre de nouveaux crimes ; là, ni baillif, ni juge, ni prévôt, n’avait la possibilité d’exercer le moindre pouvoir ; là, tout mendiant, tout voleur, tout meurtrier même, était sauvé, s’il parvenait à mettre le pied sur ce territoire privilégié ; et, pour tout dire enfin, là, comme dans un égout infect, se retirait, se ramassait, toute la vermine, toute l’ordure dégoûtante qu’engendre une grande ville, et dont l’expérience a prouvé qu’il est si difficile de se débarrasser19.
9Cette description insiste d’abord sur le caractère violent des habitants de la Cour des miracles, qui sont des mendiants, des voleurs et des meurtriers, mais elle souligne également le mécanisme d’inversion sociale : « quiconque » a violé l’ordre établi est le bienvenu dans la Cour des miracles, quel que soit son crime. L’idée est bien que la Cour constitue une contre-société des parias, où la hiérarchie sociale est rigoureusement inversée. On peut également citer V. Philippon de la Madelaine, lorsqu’il décrit le palais du Grand coësre, souverain tout-puissant du royaume d’Argot.
Les abords de cette demeure étaient d’une saleté repoussante ; des animaux immondes grouillaient sous les pieds, et les vagissements d’enfants idiots et affreux se mêlaient aux grognements d’un troupeau de porcs qui formaient comme une garde avancée20.
10On a là une description à rebours de la norme sociale : au lieu d’être un séjour de splendeur et de richesse, la demeure royale est repoussante de saleté et les gardes royaux sont constitués d’une troupe où se côtoient porcs et enfants « idiots et affreux ». L’animalisation des êtres humains est l’un des traits récurrents des descriptions de la Cour des miracles où, comme l’écrit Victor Hugo, on peut voir « passer un chien qui ressemblait à un homme, un homme qui ressemblait à un chien21». Le royaume d’Argot est donc, dans un premier temps, une société à l’envers, où les lois sont renversées, où la dignité royale est placée sous le signe de l’ordure, où humains et animaux se mêlent indissociablement.
11Cependant, la contre-société qu’est la Cour des miracles n’est pas seulement décrite comme une société à l’envers, elle est aussi une mise en abyme sérieuse de la société dans son ensemble, un royaume au sein du royaume, miroir peut-être plus révélateur que déformant du royaume de France. Comme l’écrit V. Philippon de la Madelaine dans Le Justicier du roi, le Grand coësre est « plus maître en ces lieux que le roi François lui-même22 » : il s’agit bien d’une autorité rivale de celle du roi de France, certes beaucoup plus limitée géographiquement, mais qui n’en est pas moins absolue sur son territoire. C’est ce que souligne également la description déjà citée dans Raoul : « là, ni baillif, ni juge, ni prévôt, n’avait la possibilité d’exercer le moindre pouvoir ». Cela ne signifie pas que la Cour des miracles soit une zone de non-droit, le pouvoir est exercé par le Grand coësre et ses officiers, les « archi-suppôts » de l’Argot, selon des règles connues de tous les membres de la communauté.
12On arrive au cœur même de notre sujet qui concerne, plus encore que les descriptions de la Cour des miracles, ses mises en intrigue. Comment le pouvoir politique du Grand coësre est-il représenté dans ces romans ? Les textes que nous étudions font tous le choix de représenter le pouvoir judiciaire exercé par le souverain, bien plus que son pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, quant à lui, n’est évoqué que de manière statique, par des lois que personne ne conteste. Cette prégnance du pouvoir judiciaire est d’autant plus remarquable que c’est une dimension qui n’est qu’à peine mentionnée par Henri Sauval. Il s’agit de la transformation la plus importante apportée au texte de l’historien, dont on a vu qu’il était fidèlement repris par les romanciers. Dans chacun des cinq romans, on trouve une mise en scène de la justice rendue par le roi de Thunes. Cette représentation ne fait pas de la Cour des miracles une caricature sociale, au contraire, elle suggère même que celle-ci pourrait être un modèle, ou tout au moins une pierre de touche du paradigme existant. Il faut distinguer le cas de la justice interne à la Cour des miracles, et celui de la justice qui touche le monde extérieur à celle-ci.
13Quatre de nos cinq romans mettent en scène la justice propre de la Cour des miracles, qui prend la forme d’un tribunal constitué au moins d’un accusateur et un accusé face au juge, et au plus de tous les habitants de la Cour des miracles. On trouve un exemple de cette mise en scène dans Raoul de G. de la Baume
Thunes, dans cette scène nouvelle, faisait le principal personnage. Assis sur un siège élevé, il avait devant lui deux de nos connaissances, dont l’une jouait jadis, en présence de notre héros, un rôle bien différent. C’était l’ami Priscus. À genoux maintenant, à quelques pas du redoutable maître de ces lieux, et les mains élevées vers lui comme pour implorer sa pitié, il ne se permettait que de sourds gémissements, auxquels ce dernier paraissait attacher fort peu de valeur. Plus loin, et dans une contenance demi-hardie, demi-respectueuse, se voyait le seigneur Léger, ce conducteur ou surveillant assez peu sûr du pauvre Juif […]. Vers l’entrée enfin, on distinguait cinq ou six hommes, dont le costume et les figures rébarbatives annonçaient assez le métier et qui, l’épée nue à la main, et le poignard à la ceinture, avaient l’air de n’attendre qu’un signal pour s’emparer du malheureux, destiné sans doute à devenir leur victime23.
14C’est un tableau très reconnaissable qui est ici présenté au lecteur : le juge siège entre l’accusateur et l’accusé. Le premier, Léger, semble serein et condescendant, le second, l’usurier juif Priscus, est dans une attitude de supplication. La justice rendue par le Grand coësre est plus équitable que ce à quoi le lecteur devait s’attendre, étant donné la situation (les cinq ou six hommes attendant l’épée à la main) et le fond antisémite du roman. Au contraire, le juge fait preuve de finesse en répartissant la responsabilité entre les deux protagonistes et en choisissant des peines proportionnées. La justice de la Cour des miracles apparaît donc comme valable, et même plus valable que la justice rendue par les autorités officielles, qui condamnent injustement le jeune héros, Raoul, à la peine capitale. On peut en donner un second exemple, tiré du roman de Marie Aycard, Marie de Mancini :
Le grand Coësre imposa silence à la multitude, et il commanda à ceux qui entouraient Jules Conti, de l’amener devant lui. La pâleur de son front, sa grande barbe, qui donnait quelque chose de vénérable à sa figure, et la douleur dont ses traits étaient empreints, donnaient, en ce moment, à cet homme que ses vices, sans doute, avaient conduit à la Cour des Miracles, l’aspect d’un magistrat respectable qui remplit avec impartialité ses fonctions augustes. L’horreur du meurtre qu’il avait sous les yeux inspirait, en effet, au Grand Coësre, les sentiments naturels, à tout juge humain et juste. Il pria Jean Buchat de vouloir bien écrire ses demandes et les réponses que lui ferait le jeune homme qui était devant lui, et quand tout fut prêt, il commença avec gravité son interrogatoire24.
15La scène comporte cette fois plus de personnages, puisque le jugement est rendu en pleine Cour des miracles. Il s’agit de rendre justice pour un meurtre qui vient d’avoir lieu, celui de la belle Noëmi, dont est accusé à tort le noble Jules Conti. Là encore, le sérieux de la scène et l’équité de la justice rendue – le Grand coësre innocente le jeune homme du crime qu’il n’a pas commis – contraste avec la description horrifiante de la Cour des miracles. L’apparence respectable du « magistrat » et la solennité de la scène font de cette justice un modèle paradoxal. Non seulement le Grand coësre saura démêler la vérité des mensonges et repérer les faux témoignages, mais ce procès prend les formes de la légalité (la mise en présence de l’accusateur et de l’accusé, la preuve du crime, en l’espèce du corps de la victime, la présence d’un médecin, qui fait aussi office de greffier, la prise en considération des témoignages, etc.). Comme dans Raoul, cette justice tranche avec la malhonnêteté chronique des autorités officielles, surtout représentées par les intrigues de cour, qui maltraitent l’héroïne éponyme Marie de Mancini. Néanmoins, il faut remarquer que l’aspect de monde à l’envers ne disparaît jamais entièrement : quelques pages avant ce grave jugement, le Grand coësre avait été interpellé par une vieille femme qui accusait un garçonnet d’avoir dérobé son lapin prénommé Jeannot, et le souverain s’était alors appliqué à tirer au clair la situation.
16La représentation de la justice de la Cour des miracles ne s’en tient pas à cette dimension interne. Non seulement cette Cour des miracles comme cour de justice invite à la comparaison avec les formes officielles de la justice, décrites dans le roman ou connues par le lecteur, mais surtout quatre de nos cinq auteurs font s’affronter directement les deux formes de justice, celle des cours officielles de justice et celle du Grand coësre. L’exception est le roman de Marie Aycard, qui en reste à la justice interne de la Cour des miracles.
17Dans Notre-Dame de Paris et La Cour des miracles, les deux pouvoirs judiciaires s’opposent frontalement, dans la mesure où ils prétendent tous deux constituer une autorité équivalente. Dans le roman de Victor Hugo, la justice de la Cour des miracles s’oppose à celle du parlement, puisque les truands croient que le parlement a obtenu que la Esméralda, réfugiée à Notre-Dame, lui soit livrée pour être exécutée. Une fois ses troupes réunies devant la cathédrale, le Grand coësre, baptisé Clopin Trouillefou par Victor Hugo, somme l’évêque de Paris de choisir entre la justice du parlement et celle de la Cour des miracles.
– À toi, Louis de Beaumont, évêque de Paris, conseiller en la cour de parlement, moi Clopin Trouillefou, roi de Thunes, grand coësre, prince de l’argot, évêque des fous, je dis : – Notre sœur, faussement condamnée pour magie, s’est réfugiée dans ton église. Tu lui dois asile et sauvegarde. Or la cour de parlement veut l’y reprendre, et tu y consens ; si bien qu’on la pendrait demain en Grève si Dieu et les truands n’étaient pas là. Donc nous venons à toi, évêque. Si ton église est sacrée, notre sœur l’est aussi ; si notre sœur n’est pas sacrée, ton église ne l’est pas non plus. C’est pourquoi nous te sommons de nous rendre la fille si tu veux sauver ton église, ou que nous reprendrons la fille, et que nous pillerons l’église. Ce qui sera bien. En foi de quoi je plante cy ma bannière, et Dieu te soit en garde, évêque de Paris25 !
18On voit qu’il y a équivalence entre les deux autorités. Clopin Trouillefou harangue l’évêque de Paris en prenant le titre d’« évêque des fous », la parole d’autorité est comparable. De plus, le souverain des truands se réclame de la justice divine, tout comme le feraient le parlement ou l’Église. La Cour des miracles s’oppose à la « cour de parlement » en tant que pouvoir judiciaire équivalent. C’est également le cas dans le roman de Théophile Dinocourt, dont la fin fait s’opposer de manière sinistre les deux justices. Le héros du roman, Oscar Dumont, devenu bandit de grand chemin suite à la trahison infâme de celui qu’il croyait être son meilleur ami, Hubert Dégottis, est exécuté en place de Grève, alors que Dégottis reçoit éhontément honneurs et richesses. Trois jours plus tard, un coffre est découvert à l’endroit même de l’exécution.
[…] à la place même où avait été dressé l’échafaud, on trouva de grand matin un vaste coffre où l’on ne vit pas, sans horreur, le corps d’un homme coupé par morceaux.
C’était le corps de Dégottis.
Il tenait serrée dans les dents, écrite avec du sang, c’était sans doute du sien, la confession de ses crimes ; confession que ses assassins avaient probablement obtenue de lui en le flattant de lui laisser une vie condamnée depuis trop longtemps à leur tribunal pour qu’ils se regardassent comme bien sérieusement enchaînés pas [sic] une pareille promesse.
Sur l’enveloppe qui contenait cet écrit, on lisait, en gros caractères, ces mots révélateurs, qui ne pouvaient laisser le moindre doute sur la qualité des auteurs de ce meurtre :
« À la stupide justice du prévôt de Paris, la justice éclairée de la Cour des miracles26 ! »
19Le « tribunal » de la Cour des miracles a rétabli la justice qui avait été bafouée par le prévôt de Paris, de manière sanglante et spectaculaire. Il faut remarquer que la violence de cette vengeance, désignée comme « meurtre » par le texte, n’en réduit pas la légitimité au sein du roman, dans la mesure où celui-ci s’attarde longuement sur les horribles supplices subis par le père d’Oscar lors de son exécution publique, pour le plus grand plaisir de la foule assemblée. À la violence première de la prévôté répond la violence de la Cour des miracles. Dans Notre-Dame de Paris tout comme dans La Cour des miracles, la justice du royaume des gueux s’oppose directement à celle du royaume de France et elle le fait à raison. Dans le premier roman, même si c’est en fait un malentendu et que la perspective du pillage entre en compte, c’est un acte généreux de la part des truands que de vouloir sauver la Esméralda. Dans le second, même si les moyens sont discutables, l’homme assassiné est infâme et, dans la logique du texte, légitimement condamné par les gueux, alors que les « gens de bien » l’avaient « stupidement » couvert d’honneurs. Le contre-pouvoir judiciaire de la Cour des miracles intervient donc pour s’opposer aux injustices légales.
20Dans les deux autres romans, Raoul et Le Justicier du roi, on a plutôt affaire à un pouvoir judiciaire au sens fonctionnel, dans la mesure où la Cour des miracles ne se constitue pas explicitement en tribunal, mais une décision de justice n’en est pas moins prise par le souverain, qui cherche à compenser les défaillances de la légalité par une action légitime. Dans Raoul, il s’agit de protéger la régence de Blanche de Castille contre des complots nobiliaires : le roi de Thunes juge et condamne le comportement des nobles qui ne restent pas fidèles à leur régente et il utilise la force armée de la Cour des miracles pour contrecarrer cette trahison. Dans Le Justicier du roi, la Cour des miracles, guidée par le Grand coësre, s’oppose aux injustices flagrantes de François Ier, représenté comme un roi débauché et cruel. Dans les deux cas, la justice de la Cour des miracles permet de compenser les manquements du pouvoir judiciaire.
21La première réflexion engendrée par ces intrigues est d’ordre historique, à une époque où l’on considère encore que le romancier, sur le modèle de Walter Scott, peut faire œuvre d’historien. Tous les romans mettent en évidence l’échec, délibéré ou subi, des différentes instances du pouvoir judiciaire dans la France de l’Ancien Régime, ou au Moyen Âge dans le cas de Raoul. Ils insistent sur la nécessité d’une compensation par l’intervention d’une autre forme de justice. Plutôt qu’un modèle antagoniste, le pouvoir judiciaire de la Cour des miracles apparaît comme un retour aux sources, une justice restée plus fidèle à la vérité que les formes officielles du pouvoir. Il ne contredit pas les fondements du pouvoir judiciaire, il rappelle leur existence. L’intrigue romanesque met en avant la faillite de la justice royale dans la France de l’Ancien Régime et invite ainsi à méditer, malgré l’écart historique, sur les causes de la Révolution française.
22Les romans permettent également de réfléchir aux enclaves locales résistant au pouvoir royal dans la capitale des siècles passés, à ces espaces qui n’étaient pas encore maîtrisés par le pouvoir central, pas encore pavés, comme on l’a vu, c’est-à-dire pas encore entrés dans l’ordre social. Cette représentation ne varie pas dans les romans selon les siècles, malgré le pouvoir centralisateur grandissant de la monarchie, ce qui tend à suggérer que la réflexion sur le contrôle social est à lire dans le temps de l’écriture. La représentation du pouvoir des gueux apparaît comme une projection exacerbée du peuple des faubourgs parisiens du début du xixe siècle. La réflexion historique sert ainsi d’éclairage pour des questions contemporaines de l’écriture.
23De manière plus générale, ces intrigues incitent à questionner les rapports entre légalité et légitimité, entre l’autorité de la loi et une forme d’autorité plus large, fondée sur la morale. Il ne semble pas pour autant que la question ainsi posée soit la plus importante ici. Certes, l’action de la Cour des miracles est montrée comme légitime, au détriment de l’action légale : dans Notre-Dame de Paris, elle protège une innocente ; dans le roman de Théophile Dinocourt, elle punit un coupable, au nom d’une vérité bafouée. Cependant, le trait spécifique de cette représentation est la capacité de la Cour des miracles à se constituer en pouvoir judiciaire, posant des questions politiques plus concrètes que les rapports entre légalité et légitimité. Il ne s’agit pas de savoir si la loi est toujours du côté de la morale – la réponse est négative, ce n’est pas une question ouverte –, mais bien de mettre à l’épreuve le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ainsi, la représentation de la Cour des miracles ne recoupe pas celle des brigands généreux, à la Robin des Bois27 : ceux-ci, en prenant aux riches pour donner aux pauvres, ont une action ponctuelle de compensation, qui n’est pas destinée à devenir structurelle. Au contraire, le tribunal des gueux instaure un pouvoir judiciaire à vocation permanente, qui se développe en parallèle de la justice royale et ne la croise qu’à certaines occasions. On ne peut pas non plus comparer le tribunal de la Cour des miracles au tribunal révolutionnaire : le premier est bel et bien un contre-pouvoir judiciaire, non pas réservé à un temps d’exception, mais instrument politique d’un ordre déjà établi.
24Si nos cinq auteurs ont choisi de rajouter, dans la description de la Cour des miracles, une dimension juridique qui n’existait pas chez Henri Sauval, c’est sans doute que cette dimension leur permet d’ancrer les romans dans le présent autant que dans le passé. La peinture d’un pouvoir judiciaire inefficace ou partial, qui doit être compensé par une autre autorité, plus proche des origines de la justice, peut être lue comme un avertissement au pouvoir judiciaire. Peut-il fonctionner pleinement sans pouvoir compensateur ? Réussit-il à trouver l’équilibre nécessaire entre légitimité et légalité, qui lui assure une action satisfaisante ? Ou est-il menacé par l’apparition d’un nouveau pouvoir judiciaire, plus primitif, comme celui de la Cour des miracles, et donc à la fois plus équitable et plus violent ?
25Les intrigues romanesques apparaissent comme un moyen efficace et séduisant de poser ces questions au pouvoir judiciaire et elles le font d’autant mieux qu’elles sont à la fois ancrées dans des événements historiques et profondément invraisemblables, ce qui les constitue en véritables épreuves de pensée. On l’a déjà dit, ce n’est pas l’exactitude historique qui compte, puisque la même Cour des miracles se retrouve à l’identique sur plus de quatre siècles. Néanmoins, la mise en intrigue de cet univers permet de poser au temps de l’écriture des questions radicales sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire, qui sont à lier au bouillonnement politique de la décennie 1825-1835, fracturée par la révolution de 1830. On peut reprendre une remarque de Dominique Kalifa, dans son étude sur l’imaginaire des bas-fonds, à propos de la représentation de la Cour des miracles dans Notre-Dame de Paris. Il suggère que la transposition de la description de Sauval dans le Paris du xve siècle a joué un rôle non négligeable dans le développement de l’imaginaire social des bas-fonds car, écrit-il, elle « assure la liaison, sur fond de romantisme, entre la vieille gueuserie qui n’a jamais vraiment désarmé et les nouveaux bas-fonds qui grondent dans le Paris de la monarchie de Juillet28 ». Il s’agit donc bien de traiter, par le double détour du passé et du romanesque, d’une question qui tourmente le présent et, à cet égard, ce n’est sans doute pas un hasard que les romans publiés après 1830 proposent une représentation plus efficace du tribunal des gueux. Certes, les masses paupérisées que découvre le xixe siècle n’ont sociologiquement rien à voir avec les truands de la Cour des miracles, mais ce tribunal des pauvres, si l’on peut dire, à la fois inquiétant et juste, violent et légitime, semble devoir servir d’avertissement dans une décennie d’agitation politique intense. En ce sens, et au-delà de son caractère pittoresque, la Cour des miracles est une représentation concentrée et poussée à l’extrême de la misère urbaine des années 1820-1830, de la confusion croissante entre classes laborieuses et classes dangereuses29. Les romans montrent que le tribunal des gueux a pour lui deux atouts dangereux : le sentiment de légitimité et une forme d’impunité. Les gueux n’ont rien à perdre et tout à gagner. Reste à se demander si ce n’est pas également le cas des laissés-pour-compte de la Révolution industrielle, bien plus nombreux que les habitants de la Cour des miracles et qui projettent sur ces romans destinés à un public bourgeois l’ombre inquiétante de leur présence.
1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482 [1831], Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 81.
2 Dominique Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013, p. 92-95.
3 Marie Aycard est bien un romancier, et non une romancière, comme le souligne Charles Monselet, dans sa Lorgnette littéraire. Dictionnaire des grands et des petits auteurs de mon temps, Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 2e éd., 1859, p. 39-40 : « Des personnes éloignées du mouvement parisien et quelques voyageurs de commerce croient encore que c’est une femme. Détrompons-les à jamais. M. Marie Aycard est trapu, barbu et Marseillais… »
4 Pour établir ce corpus, nous avons notamment utilisé la thèse de doctorat de Sébastien Bracciali, La Guerre de mille ans : L’obsédante téléologie révolutionnaire aux lumières du roman historique, 1815-1835, dirigée par Dominique Kalifa, Paris, Université Panthéon-Sorbonne, Histoire, 2010.
5 Voir Myriam Roman, « Victor Hugo et le roman historique », en ligne sur le site du Groupe Hugo, http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/95-11-25roman.htm, consulté le 25 janvier 2018.
6 Roger Chartier, « La “Monarchie d’argot” entre le mythe et l’histoire », dans Cahiers Jussieu, no 5, Les Marginaux et les Exclus dans l’histoire, présentation de Bernard Vincent, Paris, Union générale d’édition, « 10/18 », 1979, p. 275-311 ; Bronisław Geremek, Les Marginaux parisiens aux xive et xve siècles, Paris, Flammarion, 1979. Pour une référence plus récente sur la question de la hiérarchie de la Cour des miracles, on renvoie à l’ouvrage dirigé par Torsten Hiltmann, Les « Autres » Rois. Études sur la royauté comme notion hiérarchique dans la société du bas Moyen Âge, Munich / Paris, Oldenbourg Verlag / Institut historique, coll. « Ateliers des DHIP », no 4, 2010.
7 De fait, il y aurait eu expulsion de la Cour des miracles de la rue Neuve-Saint-Sauveur par le lieutenant de police La Reynie en 1667. Voir Dominique Kalifa, Jean-Claude Farcy, Atlas du crime à Paris. Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Parigramme, 2015, p. 34-35.
8 Un exemple parmi d’autres : que l’on compare cette phrase d’Henri Sauval, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris, Paris, C. Moette, 1724, t. I, p. 512 : « Des filles & des femmes les moins laides se prostituaient pour deux liards, les autres pour un double, la plupart pour rien », à celle de Marie Aycard, Marie de Mancini. Histoire de 1659, Paris, Lecointe, 1830, t. II, p. 84-85 : « Des filles et des femmes, les moins laides, la plupart se prostituait pour deux liards, les autres pour un double (deux deniers), presque toutes pour rien. »
9 Henri Sauval, op. cit., t. I, p. 511.
10 Marie Aycard, op. cit., t. II, p. 97-98.
11 Victor Hugo, op. cit., p. 82.
12 Henri Sauval, op. cit., t. I, p. 516.
13 Victor Hugo, op. cit., p. 84.
14 Théophile Dinocourt, La Cour des miracles, Paris, Vimont, 1832, t. II, p. 107-108.
15 Roger Chartier, op. cit., p. 304-305.
16 En ce qui concerne les voleurs, le modèle corporatiste est également employé, mais il prend moins d’importance dans les descriptions.
17 Henri Sauval, op. cit., t. I, p. 514 : les argotiers « sont tant qu’ils composent un gros Royaume : ils ont un Roi, des Loix, des Officiers, des États, & un Langage tout particulier ».
18 Henri Sauval, op. cit., t. 1, p. 512.
19 G. de la Baume, Raoul, ou Quinze Jours de l’année douze cent vingt-huit, Paris, Verdière, 1826, t. II, p. 95-96.
20 V. Philippon de la Madelaine, Le Justicier du roi. An 1539, Paris, Dumont, 1834, t. II, p. 200-201.
21 Victor Hugo, op. cit., p. 82.
22 V. Philippon de la Madelaine, op. cit., p. 200.
23 G. de la Baume, op. cit., t. III, p. 45-47.
24 Marie Aycard, op. cit., t. II, p. 138-139.
25 Victor Hugo, op. cit., p. 410.
26 Théophile Dinocourt, op. cit., t. II, p. 476.
27 On s’inspire ici de la réflexion d’Eric Hobsbawm sur les « nobble robbers », dans Bandits, London, Weidenfeld & Nicolson, 1969.
28 Dominique Kalifa, op. cit., p. 95.
29 Voir Louis Chevalier, Classes laborieuses et classe dangereuses à Paris pendant la première moitié du xixe siècle, Paris, Plon, 1958, rééd. 2002.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en mars 2018, publiés par Laurent Angard, Guillaume Cousin, et Blandine Poirier
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 22, 2019
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/670.html.
Quelques mots à propos de : Marie-Agathe Tilliette
Université Paris Nanterre
Centre de recherches en littérature et poétique comparées
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Paris et agrégée de Lettres modernes, Marie-Agathe Tilliette enseigne et prépare une thèse en littérature comparée à l’Université Paris Nanterre depuis septembre 2016. Elle travaille, sous la direction de Karen Haddad, sur la représentation des marginaux dans le roman historique européen de 1814 à 1848.
