Sommaire
Francisque Sarcey : un critique dramatique à contre-courant de l’histoire du théâtre ?
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en janvier 2014, publiés par Marianne Bouchardon
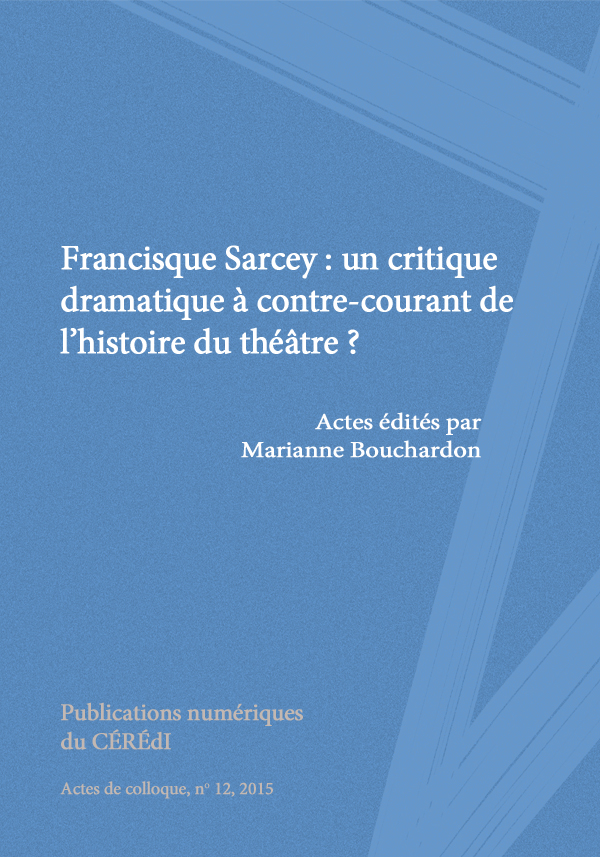
- Marianne Bouchardon Introduction
- Sarcey dans l’histoire
- Patrick Berthier Théophile Gautier, prédécesseur et confrère de Sarcey
- Olivier Bara Contre Sarcey, ou les raisons d’un acharnement fin de siècle
- Le jeu des acteurs
- Anne Pellois Les Physiologies de l’acteur de Francisque Sarcey
- Julia Gros de Gasquet Sarcey et la notion d’interprétation : l’exemple de Molière
Une approche systématique ?
Sarcey et la « tradition » : l’exemple de la revue de fin d’année
Romain Piana
1À plusieurs reprises, dans les feuilletons qu’il consacre, généralement en partie, à des revues de fin d’année, Sarcey en appelle à son amour de la tradition pour rappeler certaines règles infrangibles du genre. C’est ce qu’il fait encore, en 1887, à propos de Paris sans Paris1 – spectacle qu’il apprécie fort, du reste –, pour rappeler l’importance du meneur de jeu, traditionnellement appelé compère, dans la revue de fin d’année :
Un compère est aussi indispensable à une revue que Polichinelle à Guignol. […] Du moment que je vais à une revue, je m’attends à un compère […]. Il ne faut pas que l’on touche à ces traditions, sans quoi je fais comme l’enfant à qui l’on conte pour la centième fois l’histoire du Petit Poucet et qui y prend toujours le même plaisir. Si la nourrice s’avise de changer une phrase au texte habituel, le bébé se récrie et réclame, ce qui ne l’empêche pas de frémir quand l’ogre entre, son grand couteau à la main2.
2Le paradoxe de cet appel à la tradition est que la revue est un genre récent, à peine émancipé du vaudeville à la fin des années 1830, et que ladite « tradition » ne remonte guère qu’aux années d’enfance de Francisque Sarcey – qui confesse avoir vu, tout jeune, en 1846 ou 1847, Les Pommes de terre malades3, un des premiers chefs d’œuvre – si l’on peut dire – du genre. Si le principe de la revue, un défilé d’actualités de l’année incarnées, accompagné de couplets sur des airs connus, conduit par un duo généralement masculin et féminin, ne varie guère, sa forme spectaculaire évolue notablement au cours du xixe siècle. Sous l’Empire, la revue s’agrandit, recourt de plus en plus au spectaculaire, sa structure dramatique se dilue, avant de se réaffirmer fortement dans les trente dernières années du siècle, qui la voient cependant se diversifier encore, notamment dans les cercles amateurs et les cafés-concerts. De la satire chantante au grand spectacle à femmes, elle oscille ainsi entre deux pôles qui ne cessent de se concurrencer4.
3La « tradition » que revendique Sarcey dans son rapport à la revue n’est, du coup, conservatrice et passéiste qu’en apparence ; son approche de ce spectacle paraît en réalité exemplaire de sa méthode. Sarcey part d’une méfiance initiale, qu’il partage avec le goût du spectateur de théâtre un peu cultivé, pour aboutir à un rapport de « plaisir » avec ce spectacle divertissant et sans prétention, qui est, sous la Troisième République, fort prisé des Parisiens5. Les débuts de critique de Sarcey au Temps le voient d’abord censeur plutôt rigide de l’évolution du genre sous l’Empire, qu’il qualifie, au nom d’un idéal primitif, de décadence. Au fur et à mesure que son intérêt pour la revue croît, il se met à construire une véritable poétique normative du genre, qui, d’abord tâtonnante, se fixe, s’affine et se décline dans la plupart de ses critiques. La revue constitue ainsi un bon observatoire de la méthode critique de Sarcey, qu’on pourrait qualifier d’inductive-déductive, et qui construit, à partir d’exemples de réussites ou d’échecs, une norme pour l’appliquer ensuite à l’évaluation des productions, dans une rigidité apparente qui n’empêche pas une grande ouverture aux évolutions concrètes de la scène.
4On proposera ici une réflexion en deux temps, qui suivent du reste la chronologie, avant d’ouvrir, en conclusion, sur la souplesse de Sarcey observateur des pratiques théâtrales. Il s’agira d’abord de voir comment la référence à la tradition est convoquée pour condamner la dégénérescence spectaculaire du genre, à la fin du Second Empire. On s’attachera dans un deuxième temps à la construction progressive d’une poétique de la revue, forme plus élaborée, si l’on veut, de la « tradition » – poétique qui n’est autre que la formulation, pour ce genre spécifique, de ce que Sarcey appelle les « lois du théâtre ». On évoquera pour conclure les inflexions qu’il apporte, notamment à la fin de sa carrière, à cette approche apparemment dogmatique, en accueillant favorablement la diversification du genre.
Une condamnation initiale : la référence à la tradition
5Quand Sarcey reprend le feuilleton du Temps, la revue est en pleine mutation. De la fin des années 1850 aux années 1870, le vaudeville-revue a continué l’hybridation avec la féerie qu’il avait commencée avant la Révolution de Juillet, sous la houlette notamment de Clairville et Cogniard, qui en avaient développé l’aspect visuel. Sous le Second Empire, tandis que les petits théâtres se mettent, pour certains, aux « pièces à femmes », l’actualité devenant prétexte à des exhibitions un peu décolletées de « petites femmes » à la limite de la lorette6, et tandis que les théâtres de genre expérimentent des formules de plus en plus décousues, la revue vise parfois au grand spectacle, notamment au Châtelet. Apparitions, panoramas et apothéoses alternent avec le défilé chantant des actualités, tandis que le peu de structure du genre tend à se défaire. Cette évolution, souvent décriée dans la presse, paraît à Sarcey, à la fin du Second Empire, le signe d’une décadence irrémédiable. Il aura ainsi, à plusieurs reprises, ce mot définitif : la revue est un « genre épuisé ». Il prophétise par exemple, à propos de la revue de la Porte-Saint-Martin en 1868, sa disparition : « Elle aura cela de bon, qu’elle lui donnera le coup de grâce. MM. Choler et Koning, en signant 1867, auront mis leur nom au bas d’un acte mortuaire7. » L’année précédente déjà, à propos de la revue des Variétés, « tombée […] honteusement au milieu d’un dégoût universel », le critique fustigeait « le degré d’ineptie où tombent ceux qui cultivent ce genre épuisé8 ». Un mois plus tôt, il rêvait déjà à la chute du spectacle, espérant que « le public marque par son absence qu’il se dégoûte enfin de ces longues et absurdes partitions », en forçant les directeurs à leur offrir « de vraies pièces9 ».
6Le verdict que Sarcey fait tomber sur le genre, et qu’il relie à ce qu’il qualifie d’« offenbachisme chronique10 » chez les directeurs, se fonde sur la décadence que les faiseurs, même chevronnés comme Ernest Blum, Clairville ou Siraudin, ont imposée à la revue, désormais privée de la forme traditionnelle qui lui donnait son attrait, et frappée d’une triple dégénérescence : un développement pathologique du spectaculaire, et un abâtardissement par dégradation générique d’une part et par métissage géographique d’autre part.
7C’est en effet d’abord à l’aune de la forme traditionnelle, donnée pour immuable, de la revue, que se comprend, en 1868, sa mortelle chute. Sarcey évoque ainsi la revue d’autrefois, précisant qu’elle « ne convenait guère qu’au cadre des petits théâtres » :
On choisissait une jolie femme, que l’on habillait d’un costume de fée. On lui adjoignait, pour compère, un acteur aimé du public. Tous deux s’en allaient de compagnie à travers les ridicules ou les grandeurs de l’année qui venait de finir et le compère, à chaque nouvel objet qui passait, personnifié devant ses yeux, disait son mot, qui se trouvait être celui du public. C’était une suite d’articles du petit journal mis en action, et tournés en rondeaux11.
8La revue que définit ici Sarcey, et qui se pratique encore, précise-t-il, aux Folies-Marigny (où l’acteur-compère Montrouge en continuait la tradition), correspond parfaitement au modèle élaboré entre les années 1830 et 1860, et théorisé par Théophile Gautier. Dès 1846 le critique de La Presse formulait de façon limpide les linéaments de la poétique du genre : « Le cadre de ces sortes de choses est invariable : c’est toujours un génie quelconque qui fait défiler devant un niais encore plus quelconque, les sottises ou les merveilles de l’année12. »
9Défilé allégorique, satirique ou encomiastique, suscité par une sorte de « génie » – plus tard nommé « commère » – et commenté par un naïf représentant du public – qui s’appellera « compère » dès les années 1850 –, la revue consiste en effet dans une sorte de mise en actions et en chansons des actualités. Sa proximité avec la petite presse, effective, et thématisée par la revue elle-même, lui donnait une dimension transmédiale que Gautier, là encore, avait le premier mise en évidence13. Genre sans prétention – et que du reste Gautier ne prisa qu’un court moment –, il se juge à l’aune du rire qu’il déclenche ; Sarcey y ajoute la qualité des mots et des couplets, et l’originalité éventuelle de certaines situations.
10C’est donc en successeur de Gautier, dont la définition sert à poser une « loi » générique, que Sarcey s’attaque aux innovations fatales, à son sens, au genre. « Voilà la revue, la vraie revue », dit-il, toujours en 1868 : « elle a ses lois, comme les autres genres, – et les méconnaître ou les forcer, c’est courir à des chutes certaines14 ». Nombre de ses altérations proviennent selon lui d’un changement de format : passée dans les grandes salles, la revue se mue en succession de tableaux spectaculaires et perd sa lisibilité satirique, jusques et y compris dans sa spatialisation scénique :
Quand la revue passa des petits théâtres aux grands, on sentit le besoin de la mise en scène. Les conditions du genre furent altérées, mais non détruites. Le compère traversa de plus beaux spectacles, mais il les domina encore ; c’était, en fin de compte, autour de lui que tournaient tous les tableaux ; c’était lui qui chantait le couplet définitif.
Mais, une fois lancé sur une pente, on ne s’arrête plus. La mise en scène alla toujours prenant plus d’importance et occupant plus de place. Une revue tendit bientôt à n’être plus qu’une suite de tableaux, où l’on rappelait tour à tour, sous une forme plus ou moins vive, les différents souvenirs de l’année écoulée. Le compère ne fut plus qu’une superfétation inutile, dont on se délivra en bien des circonstances15.
11En deux paragraphes, Sarcey résume ici parfaitement l’évolution du genre sous le Second Empire, celle d’une spectacularisation de plus en plus forte, où le cadre vaudevillesque initial, par contamination avec la féerie, tend à se diluer dans le spectacle oculaire. La revue de l’année 1867 de la Porte-Saint-Martin – théâtre dirigé par Marc Fournier, le metteur en scène de La Biche au bois16 – en représente à son sens l’évolution ultime : « Elle n’est qu’une série d’exhibitions, qu’aucun fil ne relie les unes aux autres17 », critique-t-il. Or cette dilution du satirique dans le spectacle pur, qui jalonne l’histoire de la revue, et que Sarcey aborde en censeur apparemment passéiste, s’accompagne de deux détournements majeurs. En multipliant les « exhibitions » (nains, jongleurs, chanteurs comme Darcier ou Thérésa, chevaux, vues dioramiques), la revue de la Porte Saint-Martin se rapproche dangereusement du café-concert :
Je demande en quoi un semblable spectacle diffère de ceux qu’offre l’Eldorado ou l’Alcazar à ses habitués. Là aussi, des danseurs de corde succèdent à des chanteurs tyroliens, qui eux-mêmes ont remplacé des pantomimes, lesquels étaient venus après des jongleurs indiens18.
12Or cette substitution est scandaleuse, car le café-concert ne prétend à aucun moment donner à ces numéros le statut de pièce de théâtre ; la revue, prétendant encore être du théâtre, devient ainsi une « marchandise frauduleuse19 ».
13Cette contamination du café-concert se double – plus grave encore peut-être – d’un métissage. À propos d’une « revue-férie » du Châtelet, en 1870, Sarcey met en avant, à côté du modèle des cafés-concerts, celui du music-hall anglais : les revues des grandes salles, Porte-Saint-Martin ou Châtelet, rappellent immanquablement selon lui « les Alhambras de Londres », entre leurs exhibitions excentriques et la munificence clinquante des décors, avec « de l’or partout, et la lumière électrique en plus ». La condamnation de ce luxe féerique tape-à-l’œil venu, selon Sarcey, d’Angleterre n’est pas sans quelques relents xénophobes :
Il n’y a pas ombre d’art dans ce déploiement de magnificences jaunes. La foule se récrie […] ; mais je m’étonne toujours que ces spectacles, bons pour des matelots anglais, aient obtenu tant de succès en France, où l’on a plus de goût20.
14La revue de l’Empire finissant apparaît donc généralement21 à Sarcey un spectacle bâtard et importé. Un tel jugement ne le distingue pas forcément de ses confrères. Mais l’argumentation qui le soutient manifeste en revanche un passéisme revendiqué, qui pointe plus largement la condamnation de l’évolution récente de l’art théâtral : un refus de l’envahissement de la mise en scène d’une part, une nostalgie du cloisonnement des genres d’autre part, et une hantise, probablement, celle de la porosité des espaces – et de la fragilité des limites entre théâtre et café-concert. La « tradition » invoquée par Sarcey se comprend ainsi à la lumière de la disparition du boulevard du Temple et à celle de la liberté des théâtres.
15Cette définition traditionnelle de la revue ne cessera d’informer sa critique sous la Troisième République. Le feuilleton répète dès qu’il le peut, et jusque dans les années 1890, que le genre est un genre « intime22 », qu’il « a besoin de petites salles23 », et que le contact vivant du compère avec le public lui est indispensable. Il s’insurge régulièrement contre le mélange des genres, refusant toute hybridation. Il critiquera ainsi une revue du Théâtre Cluny parce qu’elle commence par une pantomime24. Mendès et Courteline subissent aussi les foudres de Francisque lorsqu’ils donnent, en 1892, Les Joyeuses Commères de Paris au Nouveau Théâtre, spectacle qui n’est « ni une féerie, ni une revue, ni une comédie satirique, ni un drame », mais « un mélange de tout cela, un mélange si incohérent que l’on se prend à se serrer la tête entre les mains et à se demander si l’on est devenu fou25 ». C’est notamment le cadrage de la revue par le compère qui sert, précisément, de garde-fou et permet d’indiquer la ligne à ne pas franchir. Sarcey revient plusieurs fois, de manière fréquemment insistante, sur la nécessité de son rôle, à la fois parfaitement traditionnel et absolument indispensable. Il écrit ainsi, en 1895 : « moi, je suis pour les vieux us » : « une revue sans compère, ça trouble mes habitudes, ça me désoblige ». Pour une raison simple : « le compère, c’est l’élément constitutif de la revue26 ».
La construction d’une poétique normative
16Le recours à la tradition, s’il n’est pas dénué d’affectivité ou de conservatisme assumé, semble ainsi lié à la mise en avant de règles formelles fondamentales qui définissent l’essence du genre, et autorisent, sur le plan théorique, sa critique. Ainsi sensibilité et raison s’appuient-elles mutuellement. Or ce mouvement, chez Sarcey, semble loin d’être figé ; au contraire, la théorisation, dans sa fixité apparente, est évolutive, et cette évolution est elle-même fonction du goût du critique, qui résonne avec celui du public. Loin en effet d’en rester à la vulgate héritée de Théophile Gautier, Sarcey tente progressivement, après les années 1870, alors que la revue de fin d’année est en train de vivre son deuxième âge d’or, d’en redéfinir la poétique. Il aboutit ainsi à une définition normative du genre et de ses conditions de succès, définition que les feuilletons singuliers mettront en œuvre dans l’élaboration du jugement critique. Entretemps, son avis sur la revue a totalement changé ; à l’image du public parisien, amateur de ce spectacle sans prétention, il avoue fréquemment son faible pour le genre.
17Ce revirement du critique du Temps à l’égard d’un spectacle honni à la fin des années 1860, il s’en explique lui-même, sur le tard, en 1887, dans un feuilleton consacré à Paris sans Paris, où il rapporte une conversation avec un de ses jeunes et brillants condisciples critiques :
Un de mes plus brillants confrères, M. Émile Faguet, qui est sorti, comme nous, de l’École normale, me demandait, après la revue de la Renaissance : Est-ce que vraiment ça vous amuse, ce défilé de scènes sans queue ni tête, cette averse de couplets chantés d’une voix fausse par des femmes, qui ne savent ni se tenir, ni marcher ? Oui, lui disais-je, cela m’amuse, et beaucoup ; et si vous ne vous y amusez pas, c’est que vous cherchez dans une revue d’autres éléments de plaisir que ceux que le genre comporte. Vous passez par une crise que j’ai traversée moi-même. Il ne m’a pas fallu moins de dix années pour m’accoutumer à cette olla podrida ; mes instincts de logique, mes habitudes de développement littéraire en étaient révoltés. À présent, j’aime la revue pour elle-même. Je vais les voir toutes, dans les cafés-concerts comme dans les théâtres. Il y en a chaque année une ou deux qui sont des chefs-d’œuvre du genre, un genre très difficile, vous le verrez bien, plus tard, quand vous serez familiarisé avec lui27.
18Ce passionnant témoignage est confirmé par la lecture des feuilletons même, où les chroniques de revues, des grandes scènes aux petits cafés-concerts, abondent, et dans lesquels Sarcey rappelle presque systématiquement son amour du genre. Le critique fait état de manière sincère de son revirement et de son propre travail d’accommodement à une forme si présente dans le paysage théâtral qu’il lui semblait impossible de l’ignorer. Le récit de l’échange avec Faguet, dans sa dimension de compagnonnage intellectuel normalien, a également en réalité, valeur de leçon, à tous les sens du terme. À l’étape de la « familiarisation » auquel devra arriver le critique confirmé, succède en effet celle de la capacité à hiérarchiser les productions du genre, et à évaluer ses difficultés propres. Sarcey continue, en énonçant la règle fondamentale qu’il lui attribue désormais :
Il s’agit, non, comme on le croit généralement, de piquer dans le dialogue les mots d’esprit que les événements de l’année ont fait, au jour le jour, jaillir de la presse ; un mot de journal est rarement un mot de théâtre. Il s’agit de trouver une forme dramatique à une critique morale ou littéraire. Eh bien ! rien n’est plus malaisé ; car il faut pour cela un don spécial d’invention qui n’est pas commun28.
19À la conception immédiate et habituelle de l’écriture de la revue comme jeu d’esprit, Sarcey substitue en effet une définition spécifiquement théâtrale, celle de la transposition de la satire en forme dramatique. On passe ainsi d’une première définition, transmédiale, du genre – de l’esprit de journal dialogué –, à une définition proprement dramaturgique. En réalité, il ne s’agit là que de la énième variante d’une définition que Sarcey reprend, depuis déjà plusieurs années, à longueur de feuilleton, comme il le fera jusqu’à la fin de sa carrière. Or la genèse de cette définition, concomitante à l’intérêt grandissant du critique pour le genre de la revue, montre un véritable travail de conceptualisation et d’affinement progressif d’un outil théorique qui soit également un critère de discrimination.
20Assez tôt, en effet, Sarcey formule l’application à ce genre inférieur de sa théorie générale de la dramaticité : bien plus que de l’esprit de mots, « le premier mérite » dans l’art de la revue est selon lui « de trouver des formes dramatiques29 ». Il en donne ainsi, en 1873, une formulation ramassée et percutante : « Un trait d’esprit amuse un instant, et encore faut-il qu’il passe la rampe. Mais l’art du faiseur de revues consiste surtout à mettre une critique ou une parodie sous une forme sensible, appropriée à ce milieu tout spécial du théâtre30. »
21Une telle définition dramatique de la revue, pensée comme une forme incarnée, est une nouveauté par rapport à la vulgate critique initiée par Gautier, qui met l’accent sur la transposition médiatique. Selon cette vulgate, la revue est perçue comme un « journal en chansons » qui emprunterait à la caricature – donc, à la petite presse, sa dimension visuelle. C’est cet ensemble de déterminations qui qualifient, depuis les années 1840, la revue comme un genre « aristophanesque31 ». Au fur et à mesure qu’il revient sur sa définition du genre, Sarcey n’aura de cesse d’affiner cette prise de distance par rapport au modèle journalistique, en approfondissant, exemples à l’appui, la notion d’« idée dramatique » appliquée à la revue. En 1879, à propos de Paris en actions, revue des Nouveautés32 qui lui semble « une des plus jolies, des plus spirituelles qu’[il] ait jamais vues », il développe sa théorie en revenant de manière décisive sur le modèle aristophanesque :
On croit volontiers qu’une revue n’est guère qu’un feuilleton moitié parlé, moitié chanté, et que la grâce et la malice des traits satiriques lancés contre les choses du jour […] est le premier charme d’une revue. Et l’on cite là-dessus Aristophane. Mais on oublie qu’Aristophane […] était avant tout un auteur dramatique. Il a ce don précieux, ce don inestimable, et sans lequel il n’est point de théâtre, de traduire les idées abstraites sous des formes sensibles, de les incarner dans des personnages vivants qu’il met aux prises, d’imaginer des situations qui rendent son idée visible à la foule33.
22Et Sarcey de prendre l’exemple de la dispute d’Eschyle et d’Euripide dans Les Grenouilles, où les « arguments purement littéraires » sont « présentés sous une forme vivante et dramatique ». Si la revue est aristophanesque, ce n’est donc plus dans sa dimension de journal parlé et chanté, mais bien par la dramatisation de la critique qu’elle met en œuvre, et par sa capacité, pour reprendre les mots du feuilletoniste, à « revêtir une idée abstraite d’une forme sensible34 ».
23Dès lors, Sarcey n’aura de cesse de rappeler cette définition minimale du véritable art de la revue, quitte, périodiquement, à en refaire un exposé développé. Celui-ci trouve bientôt l’appui d’une anecdote biographique, qui semble apparaître pour la première fois en 1886. Elle remonte à ses années de proche camaraderie avec Edmond About ; ce dernier, déjà nanti d’une certaine notoriété, est approché par les directeurs du Palais-Royal qui lui proposent d’écrire une revue en collaboration avec le vaudevilliste Dumanoir, un spécialiste du genre. About se jette dans l’écriture, rédige deux scènes pleines de fantaisie et d’esprit, et les apporte à Dumanoir qui les lui rend en lui expliquant que tout est à refaire :
Dumanoir lui avait fait la théorie de la revue, une théorie qui avait fort déconcerté About, qui me fit bondir, car j’ignorais le théâtre, mais que j’ai reconnu depuis être bien vraie. L’esprit de mots et la vivacité de dialogue, ne sont que des qualités secondaires dans la revue ; ce qu’il faut, c’est trouver la forme visible du fait qu’on porte à la scène ; une fois cette forme trouvée, le dialogue suit de soi, ou plutôt il n’y a plus besoin, pour ainsi dire, de dialogue. […] Prenez, ajoutait Dumanoir, prenez les revues qui ont le plus amusé les Parisiens […]. Les scènes les plus désopilantes sont celles où le fait a été présenté sous une forme qui parle soit aux yeux, soit à l’imagination du spectateur35.
24Cet exemplum doublement exemplaire, en ce sens qu’il met aux prises deux autorités – un auteur très célèbre, About, un carcassier reconnu, Dumanoir –, colle évidemment à merveille à la théorie élaborée par Sarcey. Elle va fonder désormais sa définition de l’« idée de revue », cœur selon lui de l’art du revuiste. Il reprendra plusieurs fois ce récit fondateur, dans les feuilletons où il redéploie intégralement sa théorie critique à propos de la revue. La narration de l’histoire d’About et Dumanoir sert alors de confirmation à l’énoncé de la théorie. Mais celle-ci est toujours suivie d’un ou deux exemples de ces « idées dramatiques », que Sarcey repère dans la revue chroniquée, et qui est souvent un des morceaux de bravoure du feuilleton. On en trouve un bon exemple dans le compte rendu de Forte en gueule36, dans le feuilleton même où apparaît la théorie de l’idée de revue ; il s’agit d’une scène critiquant l’uniformité des actrices sortant du Conservatoire :
On annonce au compère, dans la revue, que trois actrices se sont disputé la prééminence dans le rôle d’Agnès. Je voudrais bien les voir et les entendre, dit le compère. Et trois jeunes filles entrent aussitôt ; elles sont habillées de même, elles ont même visage et même voix. Elles commencent ensemble le même morceau, le fameux récit du second acte ; elles le ponctuent des mêmes gestes et des mêmes sourires, l’accentuent des mêmes inflexions, si bien que les trois récits n’en font qu’un à l’oreille et à l’œil. Qu’a fait là l’auteur dramatique ? Il a pris une critique que nous avions tous formulée, nous autres feuilletonistes, et il l’a revêtue d’une forme sensible, d’une forme appropriée au milieu du théâtre37.
25Presque tous les feuilletons de Sarcey consacrés aux revues comportent des analyses de ce genre. La « théorie » de la revue n’est en effet en rien abstraite ; elle a une fonction discriminante et opératoire. Une critique de revue, sous sa forme développée, comporte en effet le rappel de la règle de l’« idée dramatique » et sa transformation en « critères d’évaluation ». Une revue réussie, pour Sarcey, doit comporter deux ou trois « scènes de revues » ou « idées de revues », parfois également nommées « trouvailles » ; c’est à l’aune de ce critère que le jugement esthétique, corroboré par l’impression du critique et du public, est formulé. Contrairement aux chroniques de ses confrères, qui se contentent généralement d’énumérer les séquences et les temps forts des spectacles, Sarcey passe les revues au crible de ce paramètre principal, identifiant les « idées de revue » et les décrivant quand c’est possible. Cette description inclut systématiquement le rappel du fait d’actualité colporté par la presse et présent dans la mémoire du spectateur, et l’exposé de sa transposition dramatique, ramenée à sa dimension irréductiblement théâtrale – par quoi la scène de revue se rattache aux fameuses « lois du théâtre ».
26Sarcey applique donc à la revue, finalement, la même méthode qu’aux autres formes ; ayant formulé la loi théâtrale du genre, il en tire un critère d’appréciation. L’application peut en paraître parfois rigide, et systématique, et tourner au procédé. Dans un feuilleton de 1886, Sarcey évalue ainsi deux revues, Pêle-mêle gazette des revuistes Monréal et Blondeau, et Les Nouveautés de Paris de Blum, Toché et Wolf aux Nouveautés38. La première ne lui paraît pas à la hauteur d’autres productions de ses auteurs, et il précise : « il y a des longueurs, et je n’y ai trouvé qu’une seule de ses idées que j’appelle des idées de revue, et dont je vous ai plusieurs fois expliqué la genèse39. » Dans la seconde revue, continue Sarcey, « nous ne trouvons également qu’une idée de revue, plus fine […] mais moins à effet et moins gaie40. » De là à en conclure que la revue est mauvaise, il n’y a qu’un pas…
Une ouverture aux évolutions des esthétiques scéniques
27Mais, contrairement à ses habitudes, Sarcey, en l’occurrence ne franchit pas le pas, et ne conclut pas sur la revue des Nouveautés. La rigidité du cadre interprétatif qu’il pose dans son approche du genre s’accompagne en effet, de manière frappante, au fur et à mesure des années, d’une liberté ou d’un laxisme de plus en plus marqués. L’adéquation du cadre formel et théorique posé par Sarcey avec les spectacles eux-mêmes et l’évolution des formes est en réalité parfois sujette à caution et vacillante. Face à ce vacillement, Sarcey, qui est aussi un observateur de première force des esthétiques théâtrales, de leur histoire et de leur transformation, maintient les énoncés normatifs, mais opère des aménagements dans leur portée évaluative. C’est sur cette souplesse du critique, sur son ouverture aux évolutions, que l’on conclura par quelques remarques.
28La théorie des « idées de revue » de Sarcey, née d’une série de tentatives de formulations d’une spécificité du genre, appuyée – a posteriori, semble-t-il – sur l’anecdote d’About et de Dumanoir, et affinée pendant de longues années, est sans doute – c’est là son très grand mérite – la première poétique de la revue qui tiennent compte de son caractère théâtral, en substituant au modèle de la transposition journalistique celui la dramatisation satirique. Cette théorie permet de faire entrer la revue dans un cadre dramatique, loin des errements spectaculaires et érotiques du grand spectacle et des exhibitions à l’anglaise des premiers music-halls. Mais elle aussi tout à fait en phase avec l’évolution du genre, qui trouve un nouvel élan dans les années 1870, notamment sous l’influence d’Hector Monréal et Henri Blondeau, lesquels amènent la revue à sa maturité. Or Sarcey a très vite repéré ce tandem célèbre de l’époque, dès leur troisième production, et le hisse très tôt au sommet de la production du genre.
29Mais l’évolution de la revue, dans les années 1880, amène un certain nombre d’inflexions dans sa critique. Le nombre minimal d’« idées de revue » nécessaire pour qu’une revue soit déclarée bonne, notamment, diminue. Il en fallait trois dans les années 1870, on se contente d’une seule à partir du milieu des années 1880. Sarcey se fonde sur la réception du public, sur le plaisir qu’il prend au divertissement, et que lui-même avoue prendre, pour élargir ses critères d’appréciations, ou donner plus d’importance à certains éléments : le jeu du compère, la qualité du chant, la réussite des parodies des pièces de l’année, le charme des actrices, tous les éléments constitutifs de la revue peuvent donner lieu à une appréciation différentielle. Bien davantage, certaines évolutions d’abord condamnées, comme l’invasion des bataillons de jolies femmes et de la grivoiserie, finissent par trouver grâce à ses yeux. Attentif aux nouveautés, Sarcey apprécie et chronique les revues amateur des cercles41 ; il met en évidence l’apparition, au théâtre d’Application de la Bodinière, de ce qu’il appelle la « revue de poche42 » ; dans les années 1890, il suit de près le développement tous azimuts de la revue de café-concert, qu’il met parfois au-dessus des revues de théâtre. Il célèbre l’Éden-Concert, et lance, en 1896, à propos de la revue du Concert de La Fourmi : « le café-concert, c’est une des formes du théâtre contemporain43. » On le voit ainsi, à la toute fin de sa vie, repérer des noms qui fleuriront dans les cabarets artistiques et les cafés-concerts de la Belle-Époque : Paul Gavault, Victor de Cottens, Henri Fursy, Gaston de Caillavet…
30Sarcey serait-il devenu montmartrois ? Les revuistes de la Butte ne se priveront guère de le dire, témoin Charles Quinel et son complice au crayon Marcel Chatelaine, qui le représentent, un peu rougeaud, en frontispice de la revue fictive de l’hebdomadaire satirique La Caricature, en 1898, dans un théâtricule quelconque, au milieu de « toutes ces dames en culotte44 ». Sarcey leur a déjà rendu la politesse, évoquant, quelques mois plus tôt, la Cigale et le Divan japonais :
Je vois se reformer peu à peu au pied de notre butte quelque chose comme a été jadis le fameux boulevard du Crime, que j’ai connu en mon enfance, qui a laissé de si longs et de si joyeux souvenirs chez les hommes de ma génération45.
31Nouvelle jeunesse ou regard passéiste ? Pressentant l’importance du creuset artistique et populaire que devient Montmartre, Sarcey la salue au nom d’une tradition perdue et déjà mythique, dont il paraît comme le témoin privilégié et le garant. Une tradition qui n’est peut-être pas autre chose, en l’occurrence, que la mémoire d’un spectateur heureux.
1 Revue de Charles Clairville, Paul Ferrier et Ernest Depré, Théâtre de la Renaissance, 4 octobre 1887.
2 Le Temps, 10 octobre 1887.
3 Revue de Philippe-François Dumanoir et Louis-François Nicolaïe, dit Clairville, Théâtre du Palais-Royal, 20 décembre 1845.
4 Voir le dossier « La revue de fin d’année » dirigé par Olivier Bara, Romain Piana et Jean-Claude Yon, Revue d’Histoire du théâtre, no 266, deuxième trimestre 2015.
5 Selon le témoignage d’Émile Zola, peu suspect de complaisance (« Revue dramatique et littéraire », Le Bien Public, 31 décembre 1877).
6 Voir Romain Piana, « “Pièces à spectacle” et “pièces à femmes” : féeries, revues et “délassements comiques” », dans Jean-Claude Yon (dir.), Les Spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 2010, p. 328-338.
7 Le Temps, 6 janvier 1868.
8 Le Temps, 30 décembre 1867.
9 Le Temps, 9 décembre 1867.
10 Le Temps, 30 décembre 1867.
11 Le Temps, 6 janvier 1868.
12 Théophile Gautier, La Presse, 14 décembre 1846.
13 Voir Romain Piana, « L’imaginaire de la presse dans la revue théâtrale », Médias 19 [En ligne], Publications, Olivier Bara et Marie-Ève Thérenty (dir.), Presse et scène au xixe siècle, http://www.medias19.org/index.php?id=3005.
14 Le Temps, 6 janvier 1868.
15 Ibid.
16 Célèbre féerie à grand spectacle des frères Cogniard, créée à la Porte-Saint-Martin en 1845 et que Marc Fournier avait reprise et augmentée en 1865 (voir Romain Piana, « “Pièces à spectacle” et “pièces à femmes” : féeries, revues et “délassements comiques” », art. cité).
17 Le Temps, 6 janvier 1868.
18 Ibid.
19 Ibid.
20 Le Temps, 2 janvier 1870.
21 Les revues des Folies-Marigny ou des Menus-Plaisirs – où débutent Hector Monréal et Henri Blondeau, qui deviendront les rois de la revue après 1880, échappent à cette critique.
22 Le Temps, 12 décembre 1890.
23 Le Temps, 2 janvier 1870.
24 Le Temps, 20 novembre 1893.
25 Le Temps, 18 avril 1892.
26 Le Temps, 23 septembre 1895.
27 Le Temps, 10 octobre 1887.
28 Ibid.
29 Le Temps, 29 décembre 1873.
30 Ibid.
31 Voir Romain Piana, La Réception d’Aristophane en France de Palissot à Vitez, thèse de doctorat, Université Paris 8, 2005, chapitre IV.
32 Revue d’Albert Wolff et Raoul Toché (première le 15 décembre 1879).
33 Le Temps, 22 décembre 1879.
34 Ibid.
35 Le Temps, 13 septembre 1886.
36 Revue de Clairville et William Busnach, Théâtre du Château-d’Eau, 22 décembre 1873.
37 Le Temps, 29 décembre 1873.
38 Théâtre des Menus-Plaisirs, 31 décembre 1885 et Théâtre des Nouveautés, 28 décembre 1885.
39 Le Temps, 4 janvier 1886.
40 Ibid.
41 Voir par exemple Le Temps, 13 septembre 1886 ou 11 avril 1887.
42 Le Temps, 18 février 1895.
43 Le Temps, 20 janvier 1896.
44 M[arcel] Chatelaine, « Toutes ces dames en culotte, revue de l’année 1897 », texte Charles Quinel, La Caricature, 1er janvier 1898.
45 Le Temps, 26 juillet 1897.
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en janvier 2014, publiés par Marianne Bouchardon
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 12, 2015
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/577.html.
Quelques mots à propos de : Romain Piana
Université de Paris 3-Sorbonne Nouvelle
