Sommaire
Francisque Sarcey : un critique dramatique à contre-courant de l’histoire du théâtre ?
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en janvier 2014, publiés par Marianne Bouchardon
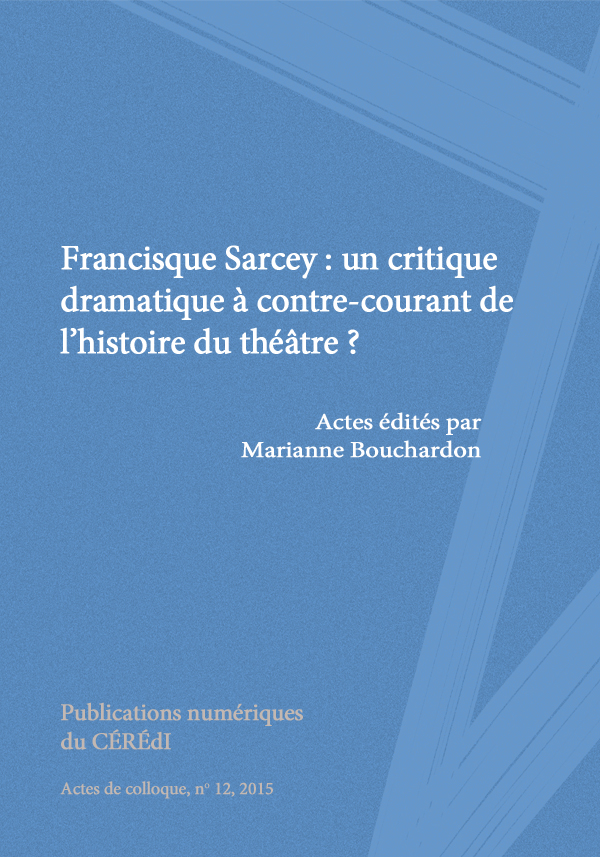
- Marianne Bouchardon Introduction
- Sarcey dans l’histoire
- Patrick Berthier Théophile Gautier, prédécesseur et confrère de Sarcey
- Olivier Bara Contre Sarcey, ou les raisons d’un acharnement fin de siècle
- Le jeu des acteurs
- Anne Pellois Les Physiologies de l’acteur de Francisque Sarcey
- Julia Gros de Gasquet Sarcey et la notion d’interprétation : l’exemple de Molière
Francisque Sarcey : un critique dramatique à contre-courant de l’histoire du théâtre ?
Introduction
Marianne Bouchardon
1« Francisque Sarcey qui avait souvent tort en tout », lisais-je récemment, par hasard, dans un numéro de La Tribune de Genève daté de 1964 – et sans doute n’aurais-je pas même relevé ce qui est devenu l’épithète homérique associée au nom de Francisque Sarcey, si je n’avais eu en ligne de mire notre rencontre autour de la figure de « L’Oncle ». Entouré d’une véritable légende, Sarcey est, en effet, plus connu par ses caricatures que par ses portraits ; plus par les textes dont il est le personnage que par ceux dont il est l’auteur. Il aura été un objet de moquerie et de sarcasme avant de devenir un sujet d’étude et de réflexion. Quiconque s’intéresse au théâtre du xixᵉ siècle le rencontre très vite, mais toujours d’abord par le biais de ses prestigieux adversaires : Émile Zola, Octave Mirbeau, Henry Becque, Alphonse Allais. De leurs attaques plus ou moins convergentes est né le mythe d’un Monsieur Prudhomme de la critique dramatique – et le printemps en fleur brille, depuis lors, sur les pantoufles du feuilletoniste du Temps… Si l’on veut bien laisser de côté les charges régulièrement dirigées, non sans violence ni bassesse, contre la personne même de Sarcey, contre ses « grosses cuisses » et son « ventre énorme1 » qui le désignent comme un homme soumis au « bas corporel », au jugement altéré par les digestions lourdes ou par les femmes légères, deux grandes idées reçues circulent à son propos.
2D’une part, celle selon laquelle Sarcey aurait régné, pendant tout le dernier quart du xixᵉ siècle, sur le monde du théâtre parisien. Dès 1877, Zola note ainsi :
M. Sarcey trône aux premières représentations, il fait l’admiration de la salle. Dès qu’il entre, un murmure court de loge en loge. On se penche pour l’apercevoir, des maris le montrent à leurs femmes, des jeunes filles le contemplent. Je connais des gens de province qui sont venus exprès à Paris pour avoir le bonheur de connaître son visage. Les chuchotements sont longs à s’apaiser : « Sarcey ! Sarcey ! Où donc ?… Tenez, ce gros qui manque d’écraser une dame… C’est lui, vous êtes sûr ?… Oui, oui… Regardez Sarcey, regardez Sarcey… ». Les comédiens, les auteurs, les directeurs, le redoutent et s’inclinent devant lui. Dès qu’on joue une œuvre nouvelle, la première question dans les coulisses est celle-ci : « Sarcey a-t-il ri ? Sarcey a-t-il pleuré ? » S’il applaudit, la fortune de la pièce est faite ; s’il bâille, tout est perdu2.
3En 1884, Mirbeau, à son tour, évoque « les auteurs qui tremblent devant lui, les directeurs qui le saluent très bas, les ingénues qui promènent leurs petites mains dans sa barbe aux poils durs et blancs, et lui disent : “Mon gros loulouˮ, pour l’attendrir3 ».
4D’autre part, celle selon laquelle cette influence considérable de Sarcey aurait été préjudiciable au renouvellement de l’art dramatique. Critique bourgeois et philistin, ennemi des beaux-arts, défenseur des vieilles recettes plutôt que de la nouvelle école, du théâtre de divertissement plutôt que du théâtre d’art, la « faiseuse d’anges du Temps », selon le titre que lui décerne Lucien Descaves dans L’Art dramatique en 1890, aurait travaillé à briser le talent, pour lequel il aurait eu, aux dires de Maxime du Camp dans une lettre à Flaubert de 1866, le mépris des « oies » pour les « rossignols ». C’est ainsi que dans un pastiche intitulé « Feuilleton du Temps du 8 août 1667 », Becque le croque en piètre prophète : il lui fait voir dans la Phèdre de Pradon une « maîtresse pièce » qui « traversera les âges et que nos arrière-neveux admireront encore quand celle de M. Jean Racine sera oubliée depuis longtemps » et dans « M. de Molier » une figure des « jeunes gens » de la « nouvelle école » :
Ces messieurs aujourd’hui n’ont qu’une préoccupation en tête : c’est d’indisposer, de heurter, de blesser, d’irriter le public. […] Je vous ai dit que Tartufe attendait Elmire. À peine a-t-elle eu le temps de s’asseoir […], il se précipite sur elle, il lui pince la jambe, il lui palpe la poitrine, en un mot, il se conduit avec une inconvenance telle que la dernière des créatures, une femme qui ferait de ses charmes métier et marchandise, le jetterait à la porte incontinent. Ah ! ces jeunes gens ! quel tort ils se font avec leur parti-pris de brutalité voulue ! Ils confondent la force avec la grossièreté. Mais s’il ne s’agissait que d’être grossier, j’en ferais aussi des pièces au lieu d’écrire des feuilletons4.
5Mirbeau ne lui prête pas plus de discernement, dans une parodie de L’Intruse de Maeterlinck, parue dans L’Écho en 1891, avant d’être recueillie dans Gens de théâtre en 1924 :
Le salon d’une petite villa des environs de Paris. Près d’une table où sont disposés un encrier, un porte-plume, du papier blanc, M. Francisque Sarcey sommeille. Autour de la table se tiennent silencieux M. Gandillot, M. Hector Pessard, M. Brisson. Sur la cheminée, le buste lauré de M. Scribe. Une lampe éclaire faiblement la scène.
[…]
M. Brisson
Vous vous étiez endormi, mon cher beau-père.
M. Pessard
Vous avez beaucoup mangé ce soir…
[…]
M. Brisson
Et le feuilleton, mon cher beau-père ?
M. Sarcey
Quel feuilleton ?
M. Brisson
Mais votre feuilleton !… y a-t-il donc d’autres feuilletons ?
M. Sarcey
Oh ! sacristi !…
M. Brisson
Vous allez encore être obligé de vous presser, et de dire un tas de bêtises, comme la dernière fois.
M. Sarcey, regardant l’encrier, le porte-plume, le papier blanc.
Du diable, par exemple, si je me souviens de quelque chose… Ma foi ! je vais encore y aller de mes colonnes sur Gandillot !…
M. Brisson
Mais vous avez L’Intruse, cette semaine.
M. Sarcey
L’Intruse ? Qu’est-ce que c’est que ça ?… Ca n’est pas de Gandillot.
M. Brisson
Vous savez bien, cette pièce au Vaudeville, dans la matinée.
M. Sarcey, cherchant à se souvenir.
Attendez donc !… Oui, je me rappelle… Il y a un corbeau dans cette pièce…
M. Brisson
Mais non !… vous confondez !… c’est dans une autre pièce qu’il y a un corbeau…
M. Sarcey
Il n’y a pas un corbeau, dans L’Intruse ?
M. Brisson
Non, il n’y a pas de corbeau dans L’Intruse !
M. Sarcey
Alors, ça n’est pas de Becque, L’Intruse ?
M. Brisson
Mais non !… L’Intruse n’est pas de Becque… Pourquoi voulez-vous qu’elle soit de Becque ?
M. Sarcey
Je n’y suis plus du tout, mon ami… Ah ! si… attends un peu… Je me souviens !… Il y a des Lapons dans cette pièce… des décors polaires, des ours blancs… Et c’est en vers !
M. Brisson
Vous confondez encore… Il n’y a rien de tel… Ça se passe dans une chambre, le soir… Des gens sont réunis autour d’une table et ils causent… À côté, dans une autre chambre, est une malade qui va mourir.
M. Sarcey
En voilà des inventions !… Est-ce gai, au moins ?
M. Brisson
Comment voulez-vous que ce soit gai, puisque je vous dis que la malade va mourir et que l’enfant de la malade, qui est lui-même malade, va mourir également !
M. Sarcey
Eh bien ! qu’est-ce que cela fait ?… On peut mourir et que ce soit gai… Gandillot, lui, ferait ça gai… Tout le monde se tordrait ! C’est drôle ! Je ne me souviens pas du tout !… Dis-moi, Brisson, est-ce un peu cochon ? Chante-t-on des couplets un peu… un peu cochons ?
M. Brisson
Mais non ! mais non !
M. Sarcey
Comment ! ça n’est pas gai ? ça n’est pas cochon ? Il n’y a pas le moindre couplet ? Et tu voudrais que je dise du bien de cette ordure-là ?… Ah ça ! mon gaillard, est-ce que tu deviendrais symboliste, toi aussi ? J’aurais moi, Francisque Sarcey, un gendre symboliste !… Quelle pièce pour Gandillot !
M. Brisson
Je ne vous dis pas d’en dire du bien, moi !…
M. Sarcey, furieux.
De qui ?… de Gandillot ? Tu ne veux pas que je dise du bien de Gandillot ?
M. Brisson
Et qui vous parle de Gandillot ? Je vous parle de Maeterlinck.
M. Sarcey
Allons bon !… Qui ça Maeterlinck ?
M. Brisson
L’auteur de L’Intruse !
M. Sarcey
Tu perds la tête !… Ne viens-tu pas de me dire que l’auteur de L’Intruse, c’est Becque ?
M. Brisson, découragé.
Tenez ! Vous feriez mieux d’aller vous coucher !
M. Sarcey
Tout cela n’est pas très clair… laisse-moi tranquille. (Il s’approche de la table, retrousse ses manches, empoigne son porte-plume.) Allons-y !… (Il écrit avec rage… Les feuillets s’entassent les uns sur les autres, et l’on entend de loin en loin, tandis que grince la plume sur le papier, ces mots, en bout de phrases tronquées !…) « Molière… Gandillot !… Nous nous tordions… un rude gaillard… un fameux lapin… Gandillot ! Molière !… Nous nous tordions5…
6Pour expliquer l’obstination avec laquelle Sarcey aurait méjugé ses contemporains, trois raisons sont tour à tour invoquées – qui se contredisent, d’ailleurs, les unes les autres. La première est la malhonnêteté : Sarcey serait un homme de réseau et de coterie, au service des intérêts particuliers, et spécialement à la solde de Jules Claretie, l’administrateur de la Comédie-Française. La deuxième postule, au contraire, la sincérité Sarcey : celui-ci serait, en tant que « Mouton de Panurge de la critique6 », selon sa propre expression, le représentant de l’opinion commune, le porte-parole d’un public dont il partage le goût vulgaire pour la gaieté voire la gaudriole. La troisième, à l’inverse, lui prête une méthode non pas empirique mais dogmatique : Sarcey aurait l’esprit de système, défendrait une conception figée et essentialiste du théâtre, inspirée par la « pièce bien faite » de Scribe.
7Lire ou relire Sarcey, sinon les 150 000 pages dont il serait l’auteur, à en croire Jules Lemaître, du moins quelques-unes des chroniques recueillies dans Quarante ans de théâtre, l’anthologie en huit volumes réalisée après sa mort par Adolphe Brisson, conduit, bien entendu, à réviser ces idées reçues.
8À constater, d’abord, que Sarcey soutient une haute idée du théâtre, qui le porte à défendre intégrité du poème dramatique. S’il manifeste tant de réticences face à la mise en scène naissante, c’est que, pour lui, une trop grande place accordée au décor, aux accessoires, aux costumes détourne l’attention due au texte et, par conséquent, nuit aux bonnes pièces qui se suffisent à elles-mêmes et favorise les mauvaises pièces qui ne peuvent se passer de tout ce « bric-à-brac7 ». En ce sens, l’argumentation qu’il déploie dans feuilleton de l’été 1883 rejoint celle de Becq de Fouquières dans son essai de 1884. Pour l’un comme pour l’autre, s’opposer à mise en scène, c’est défendre l’idée d’un théâtre qui s’adresse à l’intelligence et non aux sens du spectateur, c’est faire croisade pour l’art dramatique contre art l’industriel : « L’industrie s’est réservée la quatrième page des journaux, j’écris dans les deux premières8 », proclame-t-il ainsi.
9En outre, s’il manque parfois de clairvoyance et de lucidité dans les jugements qu’il porte sur ses contemporains, la méthode sur laquelle se fondent ces observations et appréciations anticipe, en revanche, celle que le structuralisme mettra à l’honneur près d’un siècle plus tard. Jean Hartweg l’a brillamment montré dans sa thèse9 : Sarcey jette les bases d’une approche scientifique du texte dramatique. Conjuguant dans ses feuilletons deux gestes d’écriture, celui du journaliste, qui rend compte de l’actualité, et celui du théoricien, qui s’interroge sur les ressorts du succès ou de l’échec, il passe sans cesse du particulier au général, des analyses de détails à la réflexion de fond. Au fil de ses chroniques, un « système » se dégage alors, qui présente l’intérêt d’envisager les pièces sous l’angle non pas des idées, de la philosophie ou de la psychologie, mais de leur composition, de leur plus ou moins grande soumission à un principe de nécessité interne, d’enchaînement des causes et des effets. Arnolphe et Agnès, par exemple, lui apparaissent comme
deux forces en présence, qui vont entrer en lutte l’une contre l’autre. […] Et vous vous écriez : « Quelle profondeur d’observation philosophique ! Quel analyste des passions humaines que ce Molière ! » Et moi, je vous interromps : « Non, ce n’est pas cela. Mais quel homme de théâtre que ce Molière ! Avec quelle franchise, après avoir amené une situation, il la pousse jusqu’au bout et en tire tout ce qu’elle enferme de douleurs ou de rire10 ! »
10Enfin, qu’il soit l’auteur d’un système ne condamne pas, pour autant, Sarcey aux jugements à l’emporte-pièce. Loin que sa conception de ce qu’est ou n’est pas le théâtre, pour reprendre la formule régulièrement parodiée, soit unique et définitive, il insiste sans cesse sur la relativité des conventions, répète inlassablement qu’elles changent avec les époques, les publics, les genres. Réputé ardent défenseur de la triade Augier, Dumas fils, Sardou, âpre détracteur de Becque, il suffit de le lire pour constater que le dithyrambe et la diatribe ne se répartissent jamais chez lui de façon binaire. C’est ainsi qu’il voit dans Divorçons (1880) une œuvre de « pornographie pure11 » et dans Les Corbeaux (1882) la marque d’un « talent incontestable12 ». Et parce que le plaisir est, au bout du compte, le critère qui l’emporte chez lui sur tous les autres, il se contredit bien souvent. Par exemple à propos du Gendre de M. Poirier d’Augier : après avoir salué la pièce, à sa création, en 1854, comme « un des chefs d’œuvre de ce temps-ci13 », puis constaté, lors d’une reprise, dix ans après, que la pièce « a quelque peu vieilli et s’est fanée par endroits14 », il affirme, encore vingt-trois ans plus tard : « La pièce n’a pas vieilli d’un jour. Il serait impossible d’y découvrir une ride. Il ne s’y rencontre pas une scène ou un mot que l’on voulût retrancher ; c’est la belle et égale humeur des œuvres classiques15. » De sorte que, pour reprendre distinction proposée par Georges Banu entre deux formes de rapport au spectacle16, d’une part celle régie par le « goût », d’autre part celle régie par « l’utopie », d’une part celle de l’amateur qui, au gré de ses humeurs et ses envies, dessine un zig-zag, d’autre part celle du dramaturge (au sens allemand) qui, au nom d’une certitude ou d’une théorie, suit une ligne droite, il semble que la posture de Sarcey tienne au moins autant de la première que de la seconde.
11Quant à cette image de bourgeois prudhommesque, érigeant le bon sens et la juste mesure en valeurs suprêmes, nul doute que lui-même n’ait contribué à la forger, en choisissant de faire reposer la force de persuasion de son discours sur la construction d’une personnalité oratoire – ce que les anciens appelaient un ethos. Sa représentation en « spectateur moyen idéal17 » doit en effet être ressaisie en termes de stratégie rhétorique, comme le résultat d’une mise en scène de soi et, plus précisément, d’une négociation entre deux scénographies : celle de la conversation mondaine entre spectateurs qui partagent les mêmes attentes et peuvent donc s’accorder sur les défauts et les qualités d’une pièce ; celle du cours magistral dispensé par un professeur capable d’expliquer à ses élèves les raisons de leurs enthousiasmes et de leurs déceptions. Pour tenir ensemble ces deux positions de parole, le modèle de la « causerie » s’impose naturellement à lui. Même quand il ne prend pas la forme d’un dialogue au sens strict, le propos de Sarcey fait toujours la part belle au dialogisme et à la polyphonie. Volontiers, il accueille la voix de l’autre, et ce perpétuel dédoublement énonciatif devient chez lui un redoutable procédé oratoire, qui lui permet de priver l’adversaire de ses armes, en les utilisant à sa place et en les tournant contre lui. Soit qu’il lui emprunte son style pour le frapper de dérision. Ainsi dans le compte rendu de L’Assommoir (1879) adapté par Busnach et Gastineau :
Nous en avons assez de tous ces ivrognes-là. Qu’il boive et qu’il crève tout de suite, l’animal, et n’en parlons plus. Il est retourné à son vomissement, pour parler la langue des Écritures et du roman naturaliste. Gervaise cherche des vieilles croûtes. Virginie propose de laver la vaisselle. Comme tout cela est régalant ! Mais attendez : voilà Coupeau qui revient de l’hôpital. Le médecin lui a dit que, s’il buvait seulement un verre d’eau-de-vie, il serait fichu (style de l’endroit). […] Tout ça, pour user de la langue de L’Assommoir, n’est décidément pas assez rigolo18.
12Soit qu’il lui rappelle ses mots d’ordre, pour observer qu’il y déroge. Aux réalistes qui se réclament de la nature et de la vérité, il reproche ainsi de retomber dans la convention. Zola croit-il audacieux de faire porter aux actrices de Pot-Bouille (1884) des robes salies, Sarcey souligne sa « timidité » :
Il est vrai qu’une couche de boue a été artistement collée sur le bas des jupes, mais le reste du costume est tout frais, et frange de boue à part, ces dames semblent sortir d’une boîte. La pluie ne les a donc pas mouillées par en haut. J’imagine qu’au bal elles ont sué, que leurs teints se sont plombés, que leurs cheveux se sont collés aux tempes. Pourquoi ne vois-je rien de tout cela sur leur visage ou sur leurs vêtements19 ?
13Soit que, par le biais d’un échange fictif, il tienne deux discours à la fois, celui de l’éloge et celui du blâme. Ainsi dans sa chronique consacrée à Pelléas et Mélisande, Sarcey se réserve-t-il le rôle de l’imbécile et du crétin pour déléguer à une supposée voisine celui de l’initiée aux arcanes du symbolisme. Au néophyte qui s’étonne que les personnages répètent tout deux fois, elle explique que c’est parce qu’ils « flottent dans l’irréel » qu’ils balbutient :
Vous allez voir tout à l’heure, Mélisande ; elle c’est une autre affaire : elle répète trois fois chaque mot. Elle ne dit pas, comme vous ou moi, qui vivons dans le réel : « Je me suis enfuie », mais bien « Je me suis enfuie, enfuie, enfuie ». Cela est très bien. Il faut l’admirer20.
14En même temps que l’argumentation mise dans la bouche de la voisine dédouane le critique du soupçon d’incompréhension, la voix ironique qui se superpose à la voix laudative retourne, bien entendu, l’apologie en attaque, et Sarcey fait ici coup double.
15Forçant ainsi la complicité de son lecteur, qu’il somme d’adhérer avec lui aux goûts dominants de l’époque, Sarcey s’érige en homme de son temps : il est celui qui « dit la vérité du jour21 ». Si aujourd’hui, il s’attire, à ce titre, le mépris des poéticiens, plus attentifs, pour dégager la singularité des œuvres, aux écarts par rapport à la norme, il s’impose, en revanche, comme un objet d’étude privilégié aux historiens soucieux de faire revivre les dernières décennies de ce que Jean-Claude Yon appelle la « dramatocratie22 » du xixᵉ siècle – et je remercie très chaleureusement tous les intervenants de cette journée, rendue possible grâce au CÉRÉdI, d’avoir bien voulu y apporter leurs contributions.
1 Octave Mirbeau, « Une visite à M. Francisque Sarcey », Le Journal, 2 janvier 1898, repris dans Gens de théâtre, Paris, Flammarion, 1924, p. 98.
2 Émile Zola, « L’Oncle Francisque », cité dans Un siècle de critique dramatique, sous la direction de Chantal Meyer-Plantureux, Bruxelles, Complexe, 2012.
3 Octave Mirbeau, « La victime de M. Francisque Sarcey », Le Gaulois, 22 septembre 1884, repris dans Gens de théâtre, op. cit., p. 13.
4 Henry Becque, « Sarcey critique théâtral », Souvenirs d’un auteur dramatique (1895), dans Œuvres complètes, Paris, G. Grès, 1926, tome VI, p. 24-41.
5 Octave Mirbeau, « L’Intruse à Nanterre », L’Écho du 26 mai 1891, repris dans Gens de théâtre, op. cit., p. 100-104.
6 L’Opinion nationale, 16 et 23 juillet 1860, repris dans Quarante ans de théâtre, Paris, Bibliothèque des annales politiques et littéraires, 1900-1902, t. I, p. 54.
7 Le Temps, 29 décembre 1884.
8 Cité par Jean Hartweg, Esthétique et dramaturgie dans l’œuvre critique de Francisque Sarcey, thèse de doctorat, sous la direction de Jean-Thomas Nordmann, Université de Picardie, 2008, p. 113.
9 Jean Hartweg, op. cit.
10 Le Temps, 23 août 1886, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. II, p. 72.
11 Le Temps, 13 décembre 1880, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. VI, p. 111.
12 Le Temps, 18 septembre 1882, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. VI, p. 356.
13 Le Temps, 9 mai 1864, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. V, p. 16.
14 Le Temps, ibid.
15 Le Temps, 4 juillet 1887 repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. V, p. 21.
16 Georges Banu, « La critique : utopie et autobiographie », dans Théâtre public, no 50, 1983, cité dans Un siècle de critique dramatique, op. cit.
17 Bernard Dort, « Trois façons d’en parler », dans Le Monde, 1982, cité Un siècle de critique dramatique, op. cit.
18 Le Temps, 20 janvier 1879, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. VII, p. 20.
19 Le Temps, 7 janvier 1884, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. VII, p. 24.
20 Le Temps, 22 mai 1893, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. VIII, p. 410.
21 Feuilletons de L’Opinion nationale des 16 et 23 juillet 1860, repris dans Quarante ans de théâtre, op. cit., t. I, p. 54.
22 Jean-Claude Yon, Une histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Aubier, 2012, p. 7.
Actes de la journée d’étude organisée à l’Université de Rouen en janvier 2014, publiés par Marianne Bouchardon
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 12, 2015
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/566.html.
Quelques mots à propos de : Marianne Bouchardon
Université de Rouen
CÉRÉdI – EA 3229
