Sommaire
Journée des doctorants 2017
organisée par Sophia Mehrbrey et Angélique Salaün à l’Université de Rouen le 10 mai 2017
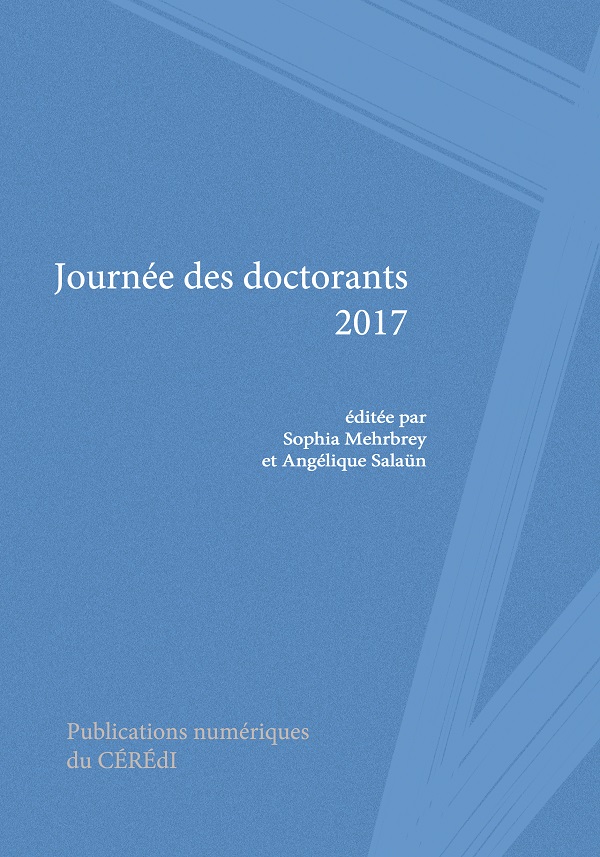
- Aurélien d’Avout La part politique du roman à suspense : D’entre les morts de Boileau-Narcejac
- Alex Pepino Renaissance de Lucrèce : enjeux de réception
- Angélique Salaun La femme guerrière : typologie d’un personnage à la marge
- Thibault Vermot La ville fantastique dans trois récits : L’Homme des foules (Poe), La Nuit (Maupassant), À s’y méprendre (Villiers de L’Isle-Adam)
Journée des doctorants 2017
La ville fantastique dans trois récits : L’Homme des foules (Poe), La Nuit (Maupassant), À s’y méprendre (Villiers de L’Isle-Adam)
Thibault Vermot
1Dès sa préface à une Anthologie du fantastique (1966), Roger Caillois affirme que « le fantastique est partout postérieur à l’image d’un monde sans miracle, soumis à une causalité rigoureuse1. » Enfanté par le siècle des Lumières, adoptant pour raison le progrès, cultivant un effort intense de définition et d’établissement de normes, le xixe siècle engendre en contrepoint la tentation esthétique du fantastique. Raison et déraison semblent inextricablement liées dans ce moment de l’histoire humaine, que Pierre-Georges Castex nomme : « renaissance de l’irrationnel2 ». Le fantastique, dit Gwenhaël Ponnau, « apparaît, à ce titre, comme la réponse singulière et exemplaire de l’imaginaire aux efforts de rationalisation qui caractérisent l’idéologie du progrès3 ». Pendant que Philippe Pinel écrit sa Nosographie philosophique, dont le premier tome paraît en 1797 et où Pinel entend appliquer à la médecine « la marche rigoureuse de l’observation4 », Goya grave ses Caprichos (1797-1798) ; l’un d’entre eux est titré : Le Songe de la raison engendre des monstres. Au début de la décennie 1820, Géricault fait voir ceux qu’on a enfermés loin de la foule des hommes et peint ses portraits de monomanes. Il exhibe les monstres sociaux.
2Le xixe siècle connaît dans le même temps un mouvement d’urbanisation sans précédent, et remodelés par les poussées démographiques – le Londres post-Great Stink dont on creuse le réseau d’égouts pour éviter la pollution de la Tamise qui généra une insoutenable puanteur à l’été 1858, ou le Paris de Haussmann (1852-1870) – deviennent au milieu du siècle les parangons de la modernité, car on pense ces villes comme le miroir d’un progrès qui vise à la rationalisation des déplacements ou à l’assainissement du lieu de vie.
Nous savons que la transformation de la capitale intervient dans le contexte d’une demande diffuse d’amélioration du cadre urbain et notamment des conditions d’hygiène. Il suffit pour s’en convaincre de regarder la production d’enquêtes, d’opuscules et de propositions sur le sujet qui précèdent le Second Empire et ses initiatives. Tous semblent d’accord pour dire que la ville est malade, qu’il faut donc l’assainir en apportant air et lumière là où elle apparaît sale, insalubre et dangereuse5.
3Le genre fantastique cultivant le goût pour l’irrationnel et pour l’anomalie, il nous a semblé opportun de nous pencher sur les quelques textes à teneur fantastique qui prennent pour décor la grande ville moderne, celle envisagée par Walter Benjamin (dans Paris, capitale du xixe siècle) et d’étudier cet entremêlement de la cité claire et aérée avec le sentiment de malaise propre à l’Unheimliche freudien, l’un des embranchements du genre fantastique. Rappelons brièvement à notre auditoire ce que Freud nomme Unheimliche, traduit par Marie Bonaparte en « inquiétante étrangeté6 », et plus exactement par Philippe Forget en « infamilier7 » : Freud voyage dans un train, il se lève de sa banquette pour appeler le contrôleur. Lorsqu’il se lève, il voit un homme, à l’extérieur de son compartiment, à la silhouette antipathique, désagréable, voire inquiétante. Cet homme qu’il aperçoit sans réellement distinguer ses traits est en fait son reflet que lui renvoie la vitre de la porte. Dans notre souvenir, de nombreux récits issus de notre corpus d’étude (Hoffmann, Poe, Maupassant, Villiers) mettaient en scène l’infamilier dans la ville ; et c’est avec une sorte d’effroi que, soudain lecteur en terre presque inconnue, j’ai réalisé que fort peu de ces textes donnaient véritablement chair à ce que j’avais fini par nommer fantastique de boulevard. C’est ainsi que pour cette communication je finis par ne retenir que trois textes cependant emblématiques du fantastique : L’Homme des foules d’Edgar Poe (1840), À s’y méprendre de Villiers de L’Isle-Adam (1883), et La Nuit de Maupassant (1887), trois textes qui portent la marque sincère de leur auteur, loin de la répétition, de la commande ou de la parodie (puissance de spéculation de Poe au service de l’angoisse, intimité de la folie chez Maupassant, cynisme sans parodie chez Villiers) – trois récits nous montrant un « je » flâneur, confronté, en pleine ville, au sentiment d’Unheimliche. En regard de ces rares textes urbains, on ne compte plus en revanche chez leurs auteurs respectifs les récits portant la marque du romantisme noir ou du roman gothique, nous montrant des cavaliers parcourant des landes désertes et sauvages avant d’accéder à quelque manoir délabré découpant ses tourelles dans l’horizon fuligineux. Relisons l’emblématique Duke of Portland de Villiers :
Puis, – réclusion aussi soudaine qu’étrange, – le duc s’était retiré dans son familial manoir ; il s’était fait l’habitant solitaire de ce massif manoir à créneaux, construit en de vieux âges, au milieu de sombres jardins et de pelouses boisées, sur le cap de Portland.
Là, pour tout voisinage, un feu rouge, qui éclaire à toute heure, à travers la brume, les lourds steamers tanguant au large et entrecroisant leurs lignes de fumée sur l’horizon.
Une sorte de sentier, en pente vers la mer, une sinueuse allée, creusée entre des étendues de roches et bordée, tout au long, de pins sauvages, ouvre, en bas, ses lourdes grilles dorées sur le sable même de la plage, immergé aux heures du reflux.
Sous le règne de Henri VI, des légendes se dégagèrent de ce château-fort, dont l’intérieur, au jour des vitraux, resplendit de richesses féodales.
Sur la plate-forme qui en relie les sept tours veillent encore, entre chaque embrasure, ici, un groupe d’archers, là, quelque chevalier de pierre, sculptés, au temps des croisades, dans des attitudes de combat.
La nuit, ces statues, – dont les figures, maintenant effacées par les lourdes pluies d’orage et les frimas de plusieurs centaines d’hivers, sont d’expressions maintes fois changées par les retouches de la foudre, – offrent un aspect vague qui se prête aux plus superstitieuses visions. Et, lorsque, soulevés en masses multiformes par une tempête, les flots se ruent, dans l’obscurité, contre le promontoire de Portland, l’imagination du passant perdu qui se hâte sur les grèves, – aidée, surtout, des flammes versées par la lune à ces ombres granitiques, – peut songer, en face de ce castel, à quelque éternel assaut soutenu par une héroïque garnison d’hommes d’armes fantômes contre une légion de mauvais esprits8.
4Jusqu’à la fin du siècle, le fantastique répète à l’envi ces paysages, marqués au sceau de la sauvagerie et de la solitude, et qui sont devenus à force des lieux communs, voire des facilités d’écrivain dès qu’il s’agit de planter le décor de l’action. Si l’anomalie doit pénétrer insidieusement tel narrateur, c’est au cœur d’un paysage lui aussi anomal (donc sans nom, ou innommable, laissant libre cours au chaos, au désordre de la nature), qui se fait le miroir de l’infamilier. Le fantastique, pour résumer les choses, trouve son terrain de prédilection dans les campagnes, où la trace du divin ou du surnaturel est plus palpable qu’à la lueur des becs de gaz. Hoffmann a déjà conscience avec Der Sandmann que l’Unheimliche, pour trouver son développement le plus insidieux et le plus profond dans le cœur des hommes, a moins besoin d’un décor exubérant que familier, celui d’une ville de province sans histoire où faire ses études. La ville dans le conte d’Hoffmann est élémentaire : il suffit d’une rue où deux maisons se font face, grâce à quoi Nathanaël peut observer Olympia ; d’un beffroi surplombant une place de marché d’où il tâche de précipiter Clara. Cette forme de fantastique, moins démonstrative, mais plus intime, plus secrète, tient plus au subjectif qu’au phénomène.
5Paradoxalement, l’Unheimliche, qui est donc indissociable du sentiment d’un sujet, trouve ses développements dans un dialogue entre l’homme et son décor. Nous avons vu dans une précédente communication qu’Edgar Poe avait tendance à inverser le primat entre protagoniste et décor, et que, plus précisément, ses héroïnes trouvaient leur plus haut degré d’influence quand elles devenaient une partie de ce décor : sous forme de portrait (Le Portrait ovale), de statue, de prolongement naturel de la pierre (Madeline Usher dans La Chute de la Maison Usher) ou de l’eau (L’Île de la fée). L’action est seconde, la contemplation première. Si l’on étend ce postulat aux autres textes fantastiques, on s’aperçoit – effectivement – que le décor occupe parfois une place fondamentale dans un monde déserté par les autres hommes et par Dieu, et que ce décor génère l’Unheimliche par une sorte de phénomène optique obsessionnel.
6C’est justement à la lueur des becs de gaz que se produisent les phénomènes les plus intéressants à notre sens, quand le sentiment d’Unheimliche saisit notre narrateur et que la lumière ne parvient pas à dissiper le doute profond qui s’empare de lui. La lumière, du reste joue un rôle fondamental dans ces trois nouvelles, par le jour étrange, artificiel, qu’elle fait tomber sur les choses, leur donnant cette dimension d’infamiliarité : dans L’Homme des foules de Poe, la tombée de la nuit et l’allumage des réverbères donne un jour nouveau à la foule qu’observe le « je » du récit, et génère chez lui une disposition particulière d’esprit qui va le porter à observer puis à suivre un homme étrange qui s’ingénie à courir de boulevards noirs de monde en sorties populeuses de théâtres :
Mais, à la tombée de la nuit, la foule s’accrut de minute en minute ; et, quand tous les réverbères furent allumés, deux courants de la population s’écoulaient, épais et continus, devant la porte. Je ne m’étais jamais senti dans une situation semblable à celle où je me trouvais en ce moment particulier de la soirée, et ce tumultueux océan de têtes humaines me remplissait d’une délicieuse émotion toute nouvelle9.
7Puis, conditionnant l’apparition de l’Homme des foules :
[…] mais les rayons des becs de gaz, faibles d’abord quand ils luttaient avec le jour mourant, avaient maintenant pris le dessus et jetaient sur toutes choses une lumière étincelante agitée. Tout était noir, mais éclatant – comme cette ébène à laquelle on a comparé le style de Tertullien. Les étranges effets de la lumière me forcèrent à examiner les figures des individus ; et, bien que la rapidité avec laquelle ce monde de lumière fuyait devant la fenêtre m’empêchât de jeter plus d’un coup d’œil sur chaque visage, il me semblait toutefois que, grâce à ma singulière disposition morale, je pouvais souvent lire dans ce bref intervalle d’un coup d’œil l’histoire de longues années10.
8À s’y méprendre de Villiers est un texte diurne où le narrateur court à un rendez-vous d’affaires, entre d’abord dans une salle de morgue, puis dans le café où l’attend son homme, et trouve aux deux lieux une étrange ressemblance. Le court récit, presque un poème en prose, entretient une ambiance fantomatique où le soleil oublie de percer : « Par une grise matinée de novembre, je descendais les quais d’un pas hâtif. Une bruine froide mouillait l’atmosphère. Des passants noirs, obombrés de parapluies difformes, s’entrecroisaient. La Seine jaunie charriait ses bateaux marchands pareils à des hannetons démesurés11. » ; « […] j’entrai, souriant, et me trouvai, de plain-pied, devant une espèce de salle à toiture vitrée, d’où le jour tombait, livide12. » ; « Les gouttes de pluie qui tombaient sur le vitrage supérieur obscurcissaient encore la pâle lueur du soleil13. »
9Enfin, le récit de Maupassant, La Nuit, nous montre un « je » exalté par l’ambiance nocturne de Paris, remontant les Champs-Élysées pour gagner le bois de Boulogne, puis revenant sur ses pas pour trouver toute chose changée et sinistre ; texte lui aussi parcouru de notes sur la lumière artificielle des becs de gaz, dont la plus curieuse est probablement ce passage :
Je gagnai les Champs-Élysées ou les cafés-concerts semblaient des foyers d’incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l’air peints, un air d’arbres phosphorescents. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale, les filets de gaz, de vilain gaz sale, et les guirlandes de verres de couleur14.
10À la lumière d’un jour artificiel ou filtré, nos trois textes génèrent chez le « je » un sentiment poignant d’Unheimliche. Rappelons cette formule de Schelling, qui définit comme unheimlich « tout ce qui devait rester secret, dans l’ombre, et qui en est sorti15. » L’ouverture et la clôture de L’Homme des foules sont estampillées d’une formule allemande, Es lässt sich nicht lesen (Il ne se laisse pas lire), qui participe de cette esthétique du secret, et donne une sorte de clef étrange au récit, qui n’ouvre aucune porte, si l’on doit en croire l’excipit : « Le pire cœur du monde est un livre plus rebutant que le Hortulus animæ, et peut-être est-ce une des grandes miséricordes de Dieu que es lässt sich nicht lesen, – qu’il ne se laisse pas lire16. »
11Il faut attendre la moitié du récit de Poe pour que l’Homme des foules, type excessivement singulier de flâneur urbain, soit décelé par l’insistance du narrateur, observateur aigu de la sociologie de la grande ville, occupé dans la première moitié du texte par l’examen physiognomonique et le classement des catégories de personnes qui marchent sur le boulevard, hommes d’affaire, commis, joueurs, colporteurs, mendiants ; classement soudain troublé par l’apparition d’une figure frappante :
Le front collé à la vitre, j’étais ainsi occupé à examiner la foule, quand soudainement apparut une physionomie (celle d’un vieux homme décrépit de soixante-cinq à soixante et dix ans), – une physionomie qui tout d’abord arrêta et absorba toute mon attention, en raison de l’absolue idiosyncrasie de son expression. Jusqu’alors, je n’avais jamais rien vu qui ressemblât à cette expression, même à un degré très éloigné. Je me rappelle bien que ma première pensée, en le voyant, fut que Retzch, s’il l’avait contemplé, l’aurait grandement préféré aux figures dans lesquelles il a essayé d’incarner le démon. Comme je tâchais, durant le court instant de mon premier coup d’œil, de former une analyse quelconque du sentiment général qui m’était communiqué, je sentis s’élever confusément et paradoxalement dans mon esprit les idées de vaste intelligence, de circonspection, de lésinerie, de cupidité, de sang-froid, de méchanceté, de soif sanguinaire, de triomphe, d’allégresse, d’excessive terreur, d’intense et suprême désespoir. Je me sentis singulièrement éveillé, saisi, fasciné. « Quelle étrange histoire, me dis-je à moi-même, est écrite dans cette poitrine ! » Il me vint alors un désir ardent de ne pas perdre l’homme de vue, – d’en savoir plus long sur lui. Je mis précipitamment mon paletot, je saisis mon chapeau et ma canne, je me jetai dans la rue, et me poussai à travers la foule dans la direction que je lui avais vu prendre ; car il avait déjà disparu17.
12La ville moderne semble avoir enfanté cette anomalie de société, celle d’un homme à la figure à la fois polymorphe et atone qui, sans chercher à se dissimuler cependant, est en même temps presque indécelable tant la masse de la foule garantit son anonymat ; un homme qui est devenu en quelque sorte un vampire, et qui arpente sans but apparent et sans fatigue le pavé à la recherche du flux vital de la foule :
Le soleil se leva pendant que nous poursuivions notre course, et, quand nous eûmes une fois encore atteint le rendez-vous commercial de la populeuse cité, la rue de l’hôtel D…, celle-ci présentait un aspect d’activité et de mouvement humains presque égal à ce que j’avais vu dans la soirée précédente. Et, là encore, au milieu de la confusion toujours croissante, longtemps je persistai dans ma poursuite de l’inconnu. Mais, comme d’ordinaire, il allait et venait, et de la journée entière il ne sortit pas du tourbillon de cette rue. Et, comme les ombres du second soir approchaient, je me sentais brisé jusqu’à la mort, et, m’arrêtant tout droit devant l’homme errant, je le regardai intrépidement en face. Il ne fit pas attention à moi, mais reprit sa solennelle promenade, pendant que, renonçant à le poursuivre, je restais absorbé dans cette contemplation.
Ce vieux homme, – me dis-je à la longue, – est le type et le génie du crime profond. Il refuse d’être seul. Il est l’homme des foules. Il serait vain de le suivre ; car je n’apprendrai rien de plus de lui ni de ses actions18.
13Autre clef étrange, celle qui verrouille la lecture d’À s’y méprendre de Villiers, où le narrateur, jeté le long des quais par un rendez-vous d’affaires, est porté à entrer successivement dans une morgue (par hasard) et le café d’affaires où il doit se rendre, double vision qui finit par faire se superposer exactement les morts aux hommes d’affaires, et où le fragment de texte qui suit se lit à la lettre près dans la description des deux lieux :
[Je] me trouvai, de plain-pied, devant une espèce de salle à toiture vitrée, d’où le jour tombait, livide.
À des colonnes étaient appendus des vêtements, des cache-nez, des chapeaux.
Des tables de marbre étaient disposées de toutes parts.
Plusieurs individus, les jambes allongées, la tête élevée, les yeux fixes, l’air positif, paraissaient méditer.
Et les regards étaient sans pensée, les visages couleur du temps.
Il y avait des portefeuilles ouverts, des papiers dépliés auprès de chacun d’eux19.
14Sa hâte le long des quais, l’entrée imprévue dans la morgue portent finalement le narrateur à une conclusion définitive :
– À coup sûr, me dis-je, il faut que ce cocher ait été frappé, à la longue, d’une sorte d’hébétude, pour m’avoir ramené, après tant de circonvolutions, simplement à notre point de départ ? Toutefois, je l’avoue (s’il y a méprise), le second coup d’œil est plus sinistre que le premier !… Je refermai donc, en silence, la porte vitrée et je revins chez moi, – bien décidé, au mépris de l’exemple, – et quoi qu’il pût m’en advenir, – à ne jamais faire d’affaires20.
15Doit-on considérer comme Walter Benjamin que la ville est parcourue de limites secrètes que l’on franchit par hasard et qui nous portent à envisager les choses sous un jour inconnu jusqu’alors ? « La limite traverse les rues ; c’est un seuil ; on entre dans un nouveau fief en faisant un pas dans le vide, comme si on avait franchi une marche qu’on ne voyait pas21. » C’est ce qui semble advenir au narrateur, qui croit avoir retrouvé son point de départ, ayant pourtant parcouru une partie de la ville :
J’avisai la voiture déserte et je dis au cocher :
– Passage de l’Opéra !
Quelque temps après, aux boulevards, le temps me sembla plus couvert, faute d’horizon. Les arbustes, végétations squelettes, avaient l’air, du bout de leurs branchettes noires, d’indiquer vaguement les piétons aux gens de police ensommeillés encore.
La voiture se hâtait.
Les passants, à travers la vitre, me donnaient l’idée de l’eau qui coule.
Une fois à destination, je sautai sur le trottoir et m’engageai dans le passage encombré de figures soucieuses22.
16Nul horizon, une végétation squelettique, une foule qui semble un fleuve, des fronts plissés par le souci encombrant le passage, il ne manque plus qu’à renverser d’un quart de tour une lettre, et faire du cocher un nocher, qui a conduit le narrateur de l’autre côté de la barrière – narrateur qui a compris à la fin du texte l’analogie secrète (mais inexplicable) qui se tient entre la mort et l’idée de faire des affaires. Là encore, le chemin parcouru dans À s’y méprendre fait écho à l’idée de Walter Benjamin selon laquelle une société ayant choisi pour fantasme une « représentation chosiste de la civilisation23 », la réduplication des objets, « les nouvelles créations à base économique et technique24 », une nouveauté illusoire – une telle société engendre à la longue un type nouveau d’angoisse, lié à la perte de la transcendance. Le Paris moderne d’À s’y méprendre est le lieu identifié de cette angoisse :
Quant à la fantasmagorie de la civilisation elle-même, elle a trouvé son champion dans Haussmann, et son expression manifeste dans ses transformations de Paris. – Cet éclat cependant et cette splendeur dont s’entoure ainsi la société productrice de marchandises, et le sentiment illusoire de sa sécurité ne sont pas à l’abri des menaces ; l’écroulement du Second Empire, et la Commune de Paris le lui remettent en mémoire. À la même époque, l’adversaire le plus redouté de cette société, Blanqui, lui a révélé dans son dernier écrit les traits effrayants de cette fantasmagorie. L’humanité y fait figure de damnée. Tout ce qu’elle pourra espérer de neuf se dévoilera n’être qu’une réalité depuis toujours présente ; et ce nouveau sera aussi peu capable de lui fournir une solution libératrice qu’une mode nouvelle l’est de renouveler la société25.
17L’angoisse profonde liée au seul fait de déambuler au beau milieu des lumières artificielles de Paris est le propos de La Nuit de Maupassant, et ce récit comporte en filigrane le sentiment obscur que l’artifice a remplacé la Nature, et qu’une fois que le « je » s’est retrempé au contact de la nature et revient sur ses pas, toutes lumières éteintes, plus rien n’existe à quoi se raccrocher, pas même le ciel, pas même le sentiment du temps, pas même l’eau qui coule. L’eau qui coule, métaphore urbaine présente aussi chez Poe et chez Villiers qui lui comparent la foule, est présente chez Maupassant dès les premières pages du texte où la nuit fait au-dessus de la tête du narrateur qui descend les boulevards un
fleuve noir et plein d’étoiles découpé dans le ciel par les toits de la rue qui tournait et faisait onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres. Tout était clair dans l’air léger, depuis les planètes jusqu’aux becs de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses26.
18Cette rivière chaude et vivante de la nuit étoilée, planètes entremêlées des globes artificiels des becs de gaz, trouve son écho néfaste à la fin du texte avec la Seine glacée, mourante :
J’étais aux quais, et une fraîcheur glaciale montait de la rivière.
La Seine coulait-elle encore ?
Je voulus savoir, je trouvai l’escalier, je descendis… Je n’entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont… Des marches encore… puis du sable… de la vase… puis de l’eau… j’y trempai mon bras… elle coulait… elle coulait… froide… froide… froide… presque gelée… presque tarie… presque morte27.
19La mutation de la ville en quelque chose qui tienne soudain du désert a lieu à la moitié du récit, lorsque le narrateur quitte les Champs-Élysées pour entrer dans le bois de Boulogne :
[…] j’y restai longtemps, longtemps. Un frisson singulier m’avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie.
Je marchai longtemps, longtemps. Puis je revins.
Quelle heure était-il quand je repassai sous l’Arc de Triomphe ? Je ne sais pas […].
Pour la première fois je sentis qu’il allait arriver quelque chose d’étrange, de nouveau. Il me sembla qu’il faisait froid, que l’air s’épaississait, que la nuit, que ma nuit bien-aimée, devenait lourde sur mon cœur. L’avenue était déserte, maintenant28.
20Cette longue marche dans le bois, dont on ne sait rien, a pour effet d’offrir à l’œil un contraste entre nature et ville ; c’est après seulement être ressorti du bois que la mutation du sentiment du narrateur est redoublée par la disparition de la lumière artificielle, qui donne soudain à Paris cet aspect de ville morte, comme si dans une certaine mesure le passage dans le bois avait révélé la vraie nature de la ville : « Alors je m’aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints29. » Dès lors, la flânerie joyeuse du récit est transformée en marche forcée à travers un paysage aveugle :
Une force me poussait, un besoin de marcher. J’allai donc jusqu’à la Bastille. Là, je m’aperçus que je n’avais jamais vu une nuit si sombre, car je ne distinguais pas même la colonne de Juillet, dont le Génie d’or était perdu dans l’impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l’immensité, avait noyé les étoiles, et semblait s’abaisser sur la terre pour l’anéantir30.
21L’autre effet de la longue marche dans le bois est le trouble de perception du temps qui frappe le narrateur. Celui-ci, ayant perdu le repère de la ville lumineuse, se raccroche à sa montre, demande l’heure à un passant qui n’en a pas, ne peut la lire sur la sienne propre puisqu’il n’a pas d’allumette, et enfin constate que le battement de l’aiguille s’est arrêté – et en même temps que le battement d’aiguille, tout son dans la ville :
Mais l’heure ? l’heure ? qui me dirait l’heure ? Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensai : « Je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l’aiguille avec mes doigts. » Je tirai ma montre… elle ne battait plus… elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l’air. Rien ! plus rien ! plus même le roulement lointain du fiacre, – plus rien31 !
22La ville comme lieu de passage fonctionne effectivement chez Poe, chez Villiers et chez Maupassant dans les trois textes que nous avons passés en revue, comme lieu métaphorique du passage, d’une réalité familière à une autre, infamilière, à la défaveur d’un changement de jour. Ce lieu où l’on marche, s’il révèle la véritable essence des choses dans À s’y méprendre, fait aussi penser au vers final de L’Angoisse de Verlaine, où l’âme « pour d’affreux naufrages appareille32 », tant cette angoisse semble étreindre de façon improductive le « je » de L’Homme des foules, qui refuse de lire plus loin dans le cœur du vieil homme obsédé par la foule – de peur peut-être d’y trouver son miroir – ou le « je » de La Nuit, qui se trouve incapable d’expliquer la nuit qui a gagné son âme de façon irrémédiable :
Ce qu’on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m’arrive ? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter ? Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est. – Voilà. […] Mais depuis quand la nuit dure-t-elle ? Depuis quand33 ?
23Cette question de l’infamiliarité qui prend à la gorge en pleine ville se retrouve dans de nombreux textes qui n’appartiennent pas expressément au genre fantastique ; mais relisons Walter Benjamin, et constatons que l’angoisse est coïncidente avec le développement d’une civilisation fondée sur le seul aspect de confort matériel, dont le Paris bourgeois de Louis-Philippe développe le modèle. Meliora probant, deteriora sequuntur34 : imaginer le bien entraîne le plus grand mal. Cette angoisse n’est pas seulement propre à la déambulation au milieu de la foule des boulevards ; elle gagne insidieusement les intérieurs. Si selon Benjamin « l’intérieur n’est pas seulement l’univers du particulier, il est encore son étui35 », parfois l’étui se révèle inapte à contenir son objet. Edgar Poe en a la prescience dans sa Philosophie de l’ameublement, où, décrivant un intérieur bourgeois, il place aux murs des tableaux qui offrent à l’œil un miroir dérangeant de la chambre : « Plusieurs peintures coupent çà et là l’étendue du papier. Ce sont principalement des paysages d’un style imaginatif, tels Les Grottes des fées, de Stanfield, ou L’Étang lugubre, de Chapman36. » Mais que le moderne donne une forme à l’angoisse, confort devenu inconfortable, que le mobilier finisse par révéler les inadéquations de la vie en communauté, c’est la leçon de cet extrait d’À Rebours de Huysmans (1884) :
[Des Esseintes] revoyait, avec une surprenante lucidité, la gêne de son camarade d’Aigurande, lorsque, dans une réunion de persévérants célibataires, il avait dû avouer les derniers apprêts d’un mariage. On se récria, on lui peignit les abominations des sommeils dans le même linge ; rien n’y fit : la tête perdue, il croyait à l’intelligence de sa future femme et prétendait avoir discerné chez elle d’exceptionnelles qualités de dévouement et de tendresse.
Seul, parmi ces jeunes gens, des Esseintes encouragea ses résolutions dès qu’il eut appris que sa fiancée désirait loger au coin d’un nouveau boulevard, dans l’un de ces modernes appartements tournés en rotonde.
Convaincu de l’impitoyable puissance des petites misères, plus désastreuses pour les tempéraments bien trempés que les grandes et, se basant sur ce fait que d’Aigurande ne possédait aucune fortune et que la dot de sa femme était à peu près nulle, il aperçut, dans ce simple souhait, une perspective infinie de ridicules maux.
En effet, d’Aigurande acheta des meubles façonnés en rond, des consoles évidées par derrière, faisant le cercle, des supports de rideaux en forme d’arc, des tapis taillés en croissants, tout un mobilier fabriqué sur commande. Il dépensa le double des autres, puis, quand sa femme, à court d’argent pour ses toilettes, se lassa d’habiter cette rotonde et s’en fut occuper un appartement carré, moins cher, aucun meuble ne put ni cadrer ni tenir. Peu à peu, cet encombrant mobilier devint une source d’interminables ennuis ; l’entente déjà fêlée par une vie commune, s’effrita de semaine en semaine ; ils s’indignèrent, se reprochant mutuellement de ne pouvoir demeurer dans ce salon où les canapés et les consoles ne touchaient pas aux murs et branlaient aussitôt qu’on les frôlait, malgré leurs cales. Les fonds manquèrent pour des réparations du reste presque impossibles. Tout devint sujet à aigreurs et à querelles, tout depuis les tiroirs qui avaient joué dans les meubles mal d’aplomb jusqu’aux larcins de la bonne qui profitait de l’inattention des disputes pour piller la caisse ; bref, la vie leur fut insupportable ; lui, s’égaya au dehors ; elle, quêta, parmi les expédients de l’adultère, l’oubli de sa vie pluvieuse et plate. D’un commun avis, ils résilièrent leur bail et requirent la séparation de corps37.
1 Roger Caillois, Images, images, Paris, José Corti, 1996, p. 26.
2 Dans Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant, Paris, José Corti, 1951 ; l’expression « Renaissance de l’irrationnel » y est le titre d’une section de la préface.
3 Gwenhaël Ponnau, La Folie dans la littérature fantastique, Paris, PUF, 1997 (rééd.), p. 370.
4 Philippe Pinel, Nosographie philosophique ou la méthode de l’analyse appliquée à la médecine, Paris, Maradan, 1797, p. II.
5 Rosa Tamborrino, Mathieu Cloarec. « Le plan d’Haussmann en 1864 », dans Genèses, no 15. Innovations institutionnelles, dir. Susanna Magri, Paris, Berlin, 1994, p. 138.
6 Sigmund Freud, « L’inquiétante étrangeté », dans Essais de psychanalyse appliquée, trad. M. Bonaparte et D. Marty, Paris, Gallimard, 1933.
7 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Tableaux nocturnes, tome I, trad. Philippe Forget, Paris, Imprimerie Nationale, coll. « La Salamandre », 1999-2002, p. 47.
8 Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, « Duke of Portland », dans Contes Cruels, Paris, Calmann-Lévy, 1893, p. 84-85.
9 Edgar Allan Poe, L’Homme des foules, dans Nouvelles histoires extraordinaires, trad. Charles Baudelaire, Paris, A. Quantin, 1884, p. 54.
10 Ibid., p. 58-59.
11 Auguste de Villiers de L’Isle-Adam, À s’y méprendre, dans Contes Cruels, Paris, Calmann-Lévy, 1893, p. 132.
12 Ibid., p. 133.
13 Ibid., p. 135.
14 Guy de Maupassant, La Nuit, dans Clair de lune, Paris, E. Monnier, 1905, p. 290.
15 Lilyane Deroche-Gurcel, « L’inquiétante étrangeté ou le regard comme modalité de la modernité », dans Communications, no 75, Le Sens du regard, dir. Claudine Haroche et Georges Vigarello, Paris, Seuil, 2004, p. 180.
16 Ibid., p. 64.
17 Ibid., p. 59.
18 Ibid., p. 64.
19 Ibid., p. 133 puis p. 135.
20 Ibid., p. 136.
21 Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, Paris, Éditions du Cerf, 1993, p. 113.
22 Ibid., p. 134.
23 Jean Lacoste, L’Aura et la rupture : Walter Benjamin, Paris, Nadeau, 2003, p. 32.
24 Jean-Michel Palmier, Walter Benjamin : l’ange, le chiffonnier et le petit bossu, Paris, Klincksieck, 2006, p. 459.
25 Miguel Abensour, L’Utopie de Thomas More à Walter Benjamin, Paris, Sens & Tonka, 2000, p. 185.
26 Ibid., p. 289-290.
27 Ibid., p. 299.
28 Ibid., p. 291.
29 Ibid., p. 295.
30 Ibid., p. 292.
31 Ibid., p. 298.
32 Paul Verlaine, Œuvres complètes, vol. 1, Paris, Vanier, 1902, p. 17.
33 Ibid., p. 289.
34 Cette sentence tirée des Métamorphoses d’Ovide, se retrouve dans la Philosophie de l’ameublement de Poe (Edgar Allan Poe, Philosophie de l’ameublement, dans Histoires grotesques et sérieuses, trad. Charles Baudelaire, Paris, Michel Lévy frères, 1871, p. 319).
35 Walter Benjamin, Paris, capitale du xixe siècle, éd. citée, p. 53.
36 Ibid., p. 332.
37 Joris-Karl Huysmans, À Rebours, Paris, Georges Crès, 1922, p. 89-90.
organisée par Sophia Mehrbrey et Angélique Salaün à l’Université de Rouen le 10 mai 2017
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 13, 2018
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/511.html.
Quelques mots à propos de : Thibault Vermot
Université de Rouen-Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
