Sommaire
Les Gestes du poème
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en avril 2015, publiés par Caroline Andriot-Saillant et Thierry Roger (CÉRÉdI)
Comité scientifique :
Henri Béhar (Université Sorbonne Nouvelle) ; Laurent Jenny (Université de Genève) ; Dominique Rabaté (Université Paris VII) ; Anne Tomiche (Université Paris-Sorbonne) ; Bernard Vouilloux (Université Paris-Sorbonne)
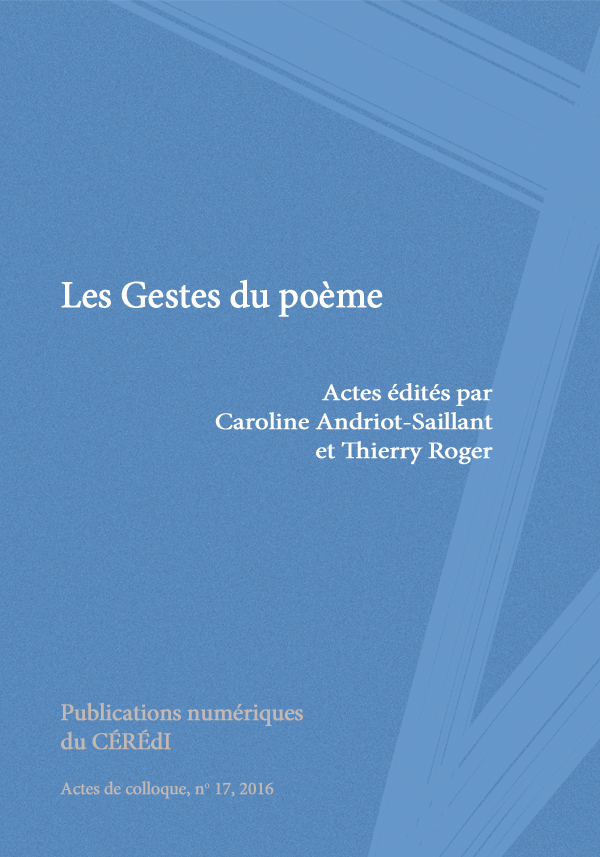
- Introductions
- Caroline Andriot-Saillant Praxis du geste : du bâtir à lʼagir
- Thierry Roger Mimiques : notes sur le geste poétique
- Dominique Rabaté Retour sur la notion de gestes lyriques
- Terres du sujet et gestes de langue
- Estelle Piolet-Ferrux « Faire corps avec notre fragilité essentielle » : Quête de soi et gestes du poème dans la poésie de Georges Perros
- Béatrice Bonhomme James Sacré : des gestes et des mots
- Vincent Zonca Le poème comme site archéologique. Creuser le chant dans les œuvres de Bernard Noël, Jaime Siles et Nuno Júdice : pour une poétique du recouvrement
- Gestes graphiques, de la page à l’espace
- Lucie Lavergne Engendrer, éprouver, dissoudre : gestualité de l’œil, de la langue et de la main chez quelques poètes espagnols contemporains, à la croisée des poésies verbales et visuelles
- Aurélie Mouton Rezzouk Déployer le poème. La poésie dans l’exposition : de la mise en espace de l’œuvre au parcours des corps
- Conclusions
- Thierry Roger et Caroline Andriot-Saillant Gestes en poésie moderne et contemporaine : pour un bilan provisoire
- Bibliographie
- Thierry Roger et Caroline Andriot-Saillant Bibliographie sur le geste et ses relations avec l’art et la littérature
Terres du sujet et gestes de langue
Le poème comme site archéologique. Creuser le chant dans les œuvres de Bernard Noël, Jaime Siles et Nuno Júdice : pour une poétique du recouvrement
Vincent Zonca
Retours poétiques
1La fin du xxe siècle, après l’effervescence des théories et avant-gardes des années 1960 et 1970, se caractérise par un mouvement de repli ou de retour, par une réarticulation postmoderne à des traditions littéraires parfois lointaines. Volontiers mélancolique, elle prend conscience de la nécessité de réancrer la voix poétique dans l’individu. Comme l’écrit le poète portugais Nuno Júdice, cette littérature témoignerait de « la conscience que nous sommes arrivés à la fin d’une époque de certitudes et de triomphes, et qu’il faut tout recommencer à partir de l’expérience individuelle ». En Espagne et au Portugal, ce phénomène coïncide, de plus, avec les questionnements de l’après-dictature. Ces deux pays sortent, en effet, de quarante années de régime autoritaire (celui de Salazar ayant eu lieu de 1933 à 1974, celui de Franco de 1939 à 1975) : l’enjeu est donc, aussi, de redonner voix à une intimité longtemps tue et meurtrie. Plus globalement, l’écriture se réarticule à une recherche autobiographique, voire généalogique, redonne voix à un « sujet ». Elle pose la question de ce qui peut rester à la fin du siècle dans la mémoire individuelle, de ce qui peut rester dans le poème et dans le pronom « je » après un siècle de critique de la notion de « sujet », de ce qu’il est (encore) possible de dire – et de comment dire ce qui vient de se produire. La poésie se fait volontiers narrative, redonne une présence au « je » poématique après avoir acté la « mort de l’auteur » (Barthes) et rejeté le « cancer romantico-lyrique » (Ponge) et la « béance baveuse du moi » (Prigent) au profit d’une poésie « anti-lyrique », voire d’une « non-poésie ». Caractéristique de ce que Jean-Michel Maulpoix appelle un « nouveau lyrisme » ou « lyrisme critique », de ce que Jean-Claude Pinson dénomme « bas-lyrisme », la poésie, à partir des années 1980 se réarticule à un cadre spatio-temporel, à une voix personnifiée et identifiée. Et cette réévaluation du poème est réinterrogation de son origine. Le poème devient le lieu privilégié de l’introspection, d’une archéologie du sujet, et peut tendre, chez certains poètes, aux limites d’une confession de type néo-romantique. Ce retour du lyrisme s’accompagne, ainsi, d’un lyrisme du retour. De nombreux recueils sont traversés par une dynamique mémorielle, dont la force de poussée donne souffle, énergie au poème. Convoquant volontiers des genres poétiques anciens, les poètes contemporains exhument de façon spectaculaire celui de l’élégie, à la tradition riche, de l’Antiquité gréco-latine aux romantismes et à la modernité. Nous nous intéresserons moins, ici, au processus archéologique proprement dit, qu’à la conception matérielle du poème et du lyrisme sur laquelle celui-ci repose, faisant du poème lieu actif, un geste d’exhumation, d’extraction, de creusement.
Portraits du poète en archéologue
2Signe de cette vision de l’anamnèse poétique comme pratique matérielle, le modèle de l’archéologie est régulièrement convoqué par les poètes contemporains. Certains d’entre eux sont même fascinés par cette science des origines. Bernard Noël pratique l’archéologie depuis son enfance – il raconte même avoir effectué une découverte importante dans son village1, au point qu’il rêvait de devenir archéologue – jusqu’à l’exploration des ruines du mont Athos qui a servi de cadre au recueil Le Reste du voyage (1997). Il participe d’ailleurs en tant qu’enquêteur au film réalisé en 1989 par Raoul Sangla sur l’archéologie en France2, qui l’amène à visiter une douzaine de sites représentatifs de différentes méthodes d’investigation. Il est également grand lecteur des essais du paléontologue André Leroi-Gourhan (1911-1986), ce qui participe de sa volonté de « déconstruction » culturelle, de type nietzschéen, visant à établir une « archéologie des espaces mentaux ». Il se passionne, enfin, pour les créations archéologiques du sculpteur Jean-Paul Philippe qui dialoguent avec les sites antiques de la Méditerranée3. De même, Nuno Júdice évoque son enfance en Algarve et son exploration récurrente d’une église en ruine, « pour envahir un monde secret de couloirs et de combles où s’entassaient des statues d’anges et de saints qu’un sacristain avait brisées dans un accès de folie4 ». Comme chez Bernard Noël lors de son séjour dans les ruines des monastères orthodoxes du mont Athos, on retrouve cette fascination pour un état de ruines du monde contemporain, mais aussi du sacré. Enfin, le poète espagnol Jaime Siles, qui appartient à la génération dite des Novísimos, lie son écriture culturaliste et ses activités de professeur de lettres classiques à une pratique d’épigraphiste, au contact des inscriptions gravées sur les ruines antiques de la côte méditerranéenne : il soutient ainsi en 1976 une thèse d’épigraphie latine intitulée Lexique des inscriptions ibériques5, qu’il décrit lui-même comme participant d’une quête identitaire l’ayant amené à « étudier les ancêtres de la Méditerranée ». Ruines de l’Antiquité gréco-latine que l’on retrouve très présentes dans la poésie de Nuno Júdice, Emmanuel Hocquard, Antonio Colinas ou encore Luis Antonio de Villena. Tout se passe comme si, en ce tournant de siècle, l’accent était mis sur un présent de la ruine et sur les origines méditerranéennes de ces espaces européens, sur la recherche d’un « site fondationnel6 » (Colinas) et sur un dialogue étroit avec l’Antiquité – dont participe pleinement, par exemple, l’exhumation du genre élégiaque.
3L’archéologie sert de modèle actif à une pratique de la poésie. Il est, en effet, frappant d’observer dans les discours de poètes aussi différents que Jaime Siles, Bernard Noël, Nuno Júdice ou encore Emmanuel Hocquard, la présence récurrente de la figure du poète-archéologue. Dans « Le langage poétique », texte publié en guise de préface aux traductions françaises d’Un chant dans l’épaisseur du temps et de Méditations sur des ruines en 1995, Júdice écrit :
Ce retour aux endroits que seule la mémoire conserve reste toujours dans l’ordre du mythique, sauf si le poème est là. Le soir où je l’écris, même si toutes ces images d’enfance m’ont quitté depuis longtemps, j’arrive à les recouvrer sous la musique des mots. Par analogie, je pourrais parler d’un travail d’archéologue. Chaque poème, en effet, est un morceau de plus qui permet de retrouver une totalité que le temps a recouverte de ses flots noirs. C’est un sentiment très bref, qui dure le temps où il faut retrouver la langue natale – celle du poème, – et pendant lequel l’impression d’inventer chaque mot, de le créer à partir d’une innocence primordiale devient possible7.
4Le mouvement intérieur de l’anamnèse est comparé, ici, au geste concret et scientifique de l’archéologue et permet de retrouver les « images de l’enfance », ainsi qu’une « langue natale ». Ce modèle est, chez Júdice, analogique. Il permet de formuler le principe d’une écriture mémorielle qui prend appui sur une conception matérielle du poème8. Le poème est un vestige exhumé, un fragment de langue natale à valeur métonymique qui permet de retrouver une totalité perdue et de garantir une réalité d’ordre non-mythique à ce retour. Même s’il est noué à une visée ontologique, le poème est avant tout le résultat d’un travail méthodique du langage, d’un geste artisanal, aboutissant à une suspension du sens : « Tout ce que je fais est de voir si [le poème] a cette musique, cette harmonie d’images et de constructions verbales, qui permettent d’établir une logique dont je n’éprouve pas le besoin de chercher le sens9. » Également traversée par une quête ontologique, la poésie de Siles est définie comme une archéologie linguistique : « poétiser est un acte de Réalité et de langage : transformer les noms jusqu’au substrat primitif, enquêter après le concept originaire, presser l’Être de l’un jusqu’au multiple, rendre la réalité à la Réalité10. » Cette méthode se fait subversive, visant à renouveler le langage à l’origine, et repose sur une conception du poème comme « acte de langage » ou « acte de parole » au contact des travaux de linguistique des années 1960. L’introspection élégiaque, entreprise dans les derniers recueils, développe cette image :
Mais ce qui se meut dans le poème n’est pas le temps – même pas le temps de la mémoire qui parfois se confond avec l’expérience ou la sensation du réel – mais la partie immobile de la mémoire : les souvenirs, convertis en fragments de notre propre identité. Ces fragments que le poème recueille des limbes où la mémoire les a déposés sont aussi ceux qui permettent de reconstruire dans le poème notre moi. Le poète se comporte, donc, comme un archéologue qui ne peut ressusciter le temps de lui-même, mais reconstruire – à partir de quelques tesselles conservées – la mosaïque de ce que un jour dans le passé, dans le présent ou dans le futur, a été, est ou sera notre propre moi11.
5On retrouve, chez Siles, une même volonté de recouvrement du passé, typique de l’élégie, et de reconstitution d’une identité à partir de « fragments » – mot employé par les deux poètes – et qui se dit sur le modèle de l’archéologie (ici, sur le mode de la comparaison). Le « poème-fragment » se veut aussi métonymique, visant à se réinscrire dans un Tout, à tracer l’identité du sujet (soulignons l’universalité du propos : c’est bien le « moi collectif » que vise le poème silésien, non le moi anecdotique et confessionnel). Mais, à nouveau, cette quête se révèle déceptive : elle ne permet pas de « ressusciter le temps » mais de « reconstruire […] la mosaïque » du moi. L’élégie se fait élégie de l’élégie, le lyrisme du deuil, deuil du lyrisme. Le principe d’identité du sujet, battu en brèche aux xixe et xxe siècles, implique de ne découvrir qu’une ontologie fragmentaire du sujet, la ruine d’un « je » total. L’archéologie en cela, à la différence de l’histoire, est fragmentaire, ne permet pas une lecture linéaire, la mise en récit d’un sujet. Chez Júdice, l’écriture, volontiers ironique et suspensive, aboutit à une « ontologie liquide » de l’être biographique, dont la réalité ne peut qu’être « mise en scène » le temps du poème. L’écriture du fragment s’effectue donc dans le cadre postmoderne d’un monde désenchanté et ruiné, d’un « lyrisme horizontal » (Pinson) ; le lyrisme se fait « critique » (Maulpoix). La quête ontologique du poème, ramenée à la vision désenchantée et linguistique du sujet poématique, donne ainsi tout son sens à cette image du geste archéologique. Elle est encore plus signifiante chez des poètes français comme Noël et Hocquard, qui fondent précisément leur écriture dans la rupture entre sujet et langage, prenant appui sur une conception immanente, objectivée, du poétique. Depuis Extraits du corps (1958), Bernard Noël n’a eu de cesse de chercher une écriture qui traduise la réalité du corps, jusqu’à abolir la distinction sujet / objet et à mettre à l’épreuve les frontières du « je » locuteur. Selon lui, l’espace du poème est avant tout corporel, il rend donc possible la traduction d’un geste archéologique. Celui-ci est visible très explicitement dans Le Reste du voyage (1995), qui réunit des notes issues de son séjour de quelques semaines au mont Athos et de ses voyages dans différentes villes. Sur l’île, va naître son désir de transcrire son expérience des ruines dans l’état desquelles se trouvent certaines parties des monastères.
Je passais une partie de ma journée à parcourir les ruines et très souvent je ne retrouvais pas le lieu qui m’avait frappé et où j’avais envie de retourner. […] Il y avait une espèce d’errance double : une errance naturelle et puis une errance imposée par la ruine. […] J’ai été à la fois explorateur, archéologue et adolescent. C’était un magnifique lieu d’exploration et de découverte. […] Mon adolescence a été obsédée par l’exploration des souterrains médiévaux. J’avais une passion12.
6Le texte porte trace de cette errance du « je »-promeneur, qui est avant tout une errance visuelle – d’où la composante ekphrastique du recueil. L’espace du poème devient un espace exploratoire, qui cherche à traduire corporellement les errements du « je » locuteur. Cette recherche poétique est évoquée en termes de conflit ou de défi, en ce que les rapports entre écriture et corporéité sont depuis toujours, pour Noël, un horizon problématique.
J’ai emporté mon carnet dans mes explorations parce que j’étais débordé par la ruine et que je voulais rivaliser avec son chaos en dénommant ses effets. Mais la dénomination est impuissante devant la profusion de la vie et de la destruction. Je le sais depuis toujours. Les effets de réalité qu’a parfois l’écriture ne sont pas fonction de la littéralité ni du réalisme, mais j’ai périodiquement envie de relever le défi du spectacle des choses. Ici, des choses travaillées par la ruine13.
7L’écriture cherche à incorporer le geste archéologique en trouvant une autre voie que celle de la littéralité ou du réalisme, voies habituelles pour traduire le réel dans le langage par le biais d’une opération de calque, de copie. Le « réelisme » noëlien est une phénoménologie du regard qui élude la « représentation » au profit d’une « présentation » du réel. Elle prend appui sur un objet qui est, ici, l’espace, travaillé par le temps historique, temps qui est aussi celui du « passant » qui le croise, et dont l’écriture constitue une trace, une empreinte. Enfin, comme l’archéologue ou le détective privé, auxquels il aime à s’identifier, Emmanuel Hocquard, procède à partir de fragments, de « tessons de choses », collecte des archives ou des indices matériels, s’attache à l’élucidation d’une énigme. Le modèle archéologique cherche dans ce cas à formuler une vision objectiviste de l’écriture, ne reposant plus sur l’illusion linguistique qui assimile le langage (le signe) à la représentation, et un travail concret du matériau textuel à partir d’archives de textes et d’images, de la juxtaposition de fragments linguistiques fonctionnant comme des énoncés, des atomes de langage. Le poème hocquardien convoque également le mot de « fragment », mais cette fois dans un sens lavé de toute prétention métaphysique et métaphorique. Les traces du passé du sujet, fragmentaires, ne permettent pas de reconstitution, elles ne trouvent sens que dans une redistribution active au présent :
Cette irréductibilité du fragment à réintégrer l’ensemble originel amorça, par le biais des lacunes, la disparition du support et la perte définitive du modèle, l’hypothèse d’une nouvelle redistribution du monde, née du hasard de ces éclats auxquels quinze siècles d’ensablement avaient conservé aux couleurs une étonnante fraîcheur14.
8Un tel dispositif est présenté dans Théorie des tables (1992) comme « méthode de travail, d’écriture et de traduction ». Le poète est un « traducteur de cailloux », son geste consistant à « jeter, à plat, une collection aléatoire d’objets de mémoire », puis à les formuler, dans des connexions logiques non causales et non chronologiques. La page du poème est un espace tabulaire, une surface plane qui, comme la table, accueille les éléments recueillis par l’archéologue. L’élégie inverse prend la forme d’une liste d’indices, d’un rapport d’enquête, s’ouvre à l’atomisation de son discours : la reconstitution laisse alors place à la recréation.
Le poème comme site archéologique
9La science archéologique est convoquée ainsi de façon récurrente pour modéliser des poétiques élégiaques très différentes qui font néanmoins du passé du « je » le terrain privilégié de leur chant ou le point d’ancrage artificiel de leur voix. Le geste de la fouille, de l’exploration archéologique, se révèle même être plus qu’une simple métaphore en ce que, chez Noël et Hocquard surtout, elles servent de fondement à une pratique matérielle du poétique. Dans tous les cas, la page du poème apparaît comme un site archéologique, le lieu d’une enquête en train de se faire, d’une profondeur en train de se creuser – ou de s’aplanir. Elle témoigne d’une forme de « géopoétique ».
10Le geste exploratoire de l’archéologue repose sur une réalité de la ruine et se construit sur des sources mortes. Là où Júdice évoque des « méditations sur des ruines », Noël parle de « notes ». Si la seconde expression connote l’idée d’instantanéité et d’objectivité, la première évoque, elle, une temporalité plus longue, voire un lien avec une forme de transcendance. Dans les deux cas, les poèmes apparaissent comme l’empreinte de ce geste archéologique visant à enquêter sur le « je » et le monde. Il est traversé par une dynamique de remémoration qui est celle de l’élégie et qui emprunte une voie matérielle (la déambulation dans la ville de Lisbonne, sur le mont Athos, la rencontre d’un tableau) pour se cristalliser. L’anamnèse est, en ce sens, matérielle et matérialisée.
11Le geste de l’archéologue qui enquête sur site pour collecter des vestiges devient l’actio du poète qui creuse le chant, la langue, sa mémoire, dans une volonté de recouvrement ou de ressaisissement. D’où une écriture du fragment (et de ses corollaires : ruine, cendre, vestige, trace, dépôt, etc.) et de la claudication élégiaque (creuser le sol de la mémoire aboutit parfois à creuser la tombe). L’espace de l’élégie, par essence introspectif, sert de cadre aux interrogations du « je » dans La Chute des temps (1983) : le cri du « qui » vient scander les chants et contre-chants du recueil, s’interrogeant sur l’existence de l’allocutaire mais aussi du locuteur. Cependant, ce qui résulte de cette écriture de la ruine dans La Chute des temps c’est, concrètement, une chute des temps verbaux, au profit du pur présent, du hic et nunc. Réflexion prolongée dans Le Livre de l’oubli (livre paru en 2012 mais à partir de notes écrites en 1979, à la même époque), l’enquête archéologique noëlienne s’effectue de façon originale dans le présent de la découverte in situ et non dans la rétrospection du passé :
je fais comme si
je me souvenais mais tout cela
précède et qu’importe si je préfère
parler du futur au passé
ce qui sera et ce qui fut portent
notre maintenant il ne faut pas
trop de réalité à la fois15.
12D’où l’éloge de la vertu de l’oubli : « Le passé ne doit pas durer sauf / dans l’oubli16. » L’archéologie est horizontale plus que verticale. Le modèle convoqué dans Lettres verticales (recueil publié en 2001 et regroupant des poèmes-lettres adressés à des proches entre 1973 et 2000) est celui de l’« archéologie horizontale » imaginée par le paléontologue français André Leroi-Gourhan. Celui-ci initie au milieu du xxe siècle un nouveau système de fouilles fonctionnant non pas par découpes mais par strates. Procédant par le décapage et l’étude méticuleuse des vestiges, même fugaces, d’un sol correspondant à époque unique, l’archéologie horizontale vise à analyser les relations spatiales entre ces vestiges, liant ainsi archéologie et ethnologie. Cette technique fut appliquée pour la première fois dans la grotte d’Arcy-sur-Cure. Pour Noël, le poème est de la même façon une « page de terre », trace d’un événement, d’une présence. S’il y a verticalité, c’est seulement celle de la page : « des notes que je qualifiais de “verticales” parce qu’elles se sont tout de suite disposées dans mon carnet comme des vers17 », dit-il au sujet du Reste du voyage. Dans ses Lettres verticales, c’est le procédé de l’acrostiche qui donne une cohérence verticale formelle à tous les poèmes (chaque poème est construit à partir d’un vers lisible en acrostiche incluant le nom et le prénom du destinataire du poème-lettre). C’est que la forme est aussi, pour Noël, ce qui permet de donner corps au poème, en lui apportant une ossature, un squelette. Si l’acrostiche constitue l’épine dorsale des Lettres verticales, c’est l’hendécasyllabe qui joue le rôle de basse continue dans Le Reste du voyage. En ce sens, le geste de l’archéologue se double du geste du sculpteur qui est aussi un geste rituel :
J’écris un poème […] en vers de onze syllabes. C’est un vers qu’on ne sent pas, il n’a pas de rythme et cependant une très forte contrainte justement parce que son rythme ne porte pas. C’est un vers qui ne chante pas, et voilà ce qui m’intéresse. Un vers bâtard rarement utilisé, et dont la structure correspond bien à ce que je recherchais pour parler de mon séjour au mont Athos. Quelque chose qui soit très contraignant et invisible comme une règle monastique18.
Par ce geste, j’ai appris qu’il est possible de partager un rite sans en partager la raison d’être. Le rite est une sorte de métrique, et je peux en appliquer le rythme à un tout autre contenu […]. Le rite structure un espace19.
13L’hendécasyllabe, qui permet de « faire poème » et de décanter-déchanter à la fois, qui rappelle également le déséquilibre du distique élégiaque antique, est présenté comme le geste d’un rituel profane, où Dieu « a tellement noirci qu’il est négatif20 ». Noël ressent ainsi, au tournant du xxe siècle, la nécessité d’une conscience métrique, d’une poésie qui repose sur une chorégraphie partagée au lecteur.
14Dans Himnos tardíos (1999) et Pasos en la nieve (2004), Jaime Siles convoque le genre de l’élégie pour relier sa quête poétique au champ de l’existence. C’est bien, comme chez Júdice, dans « l’épaisseur du temps » qu’a lieu le geste de l’anamnèse aboutissant à une réalité ruinée, négative : l’interrogation sur la possibilité de donner un lieu, une assise, une identité au « je » reste lettre morte. Le mouvement ascensionnel et spiralé de l’anamnèse devient celui de « lames giratoires / d’une tronçonneuse qui découpe en spirale21 ». Chez Júdice, l’enquête archéologique s’effectue au contact d’images, de paysages, le geste est celui d’Orphée qui fait volte-face et cherche à retenir Eurydice. « J’ôte la peau / de cette pêche, et je retombe / en enfance […] d’autres, en répétant / mon geste, découvriront / que le poème a nourri / cette racine avec l’engrais / de ses mots22. » Le poème est recherche d’une langue natale. Le retour à l’origine s’effectue par le geste vital et sensuel de la dénudation du fruit. Un geste qui, comme chez Bernard Noël, revêt une valeur rituelle : il est destiné à être reproduit par d’autres.
Inscrire le corps, incorporer le mot
15En effet, si le poème apparaît comme un site archéologique, destiné à l’exploration de soi et à un recouvrement ruiné du monde et de l’individu, c’est surtout en ce qu’il porte la trace d’un corps. La quête archéologique entreprise dans ces différents recueils convoque la matérialité de cette science afin de dire une recherche qui est avant tout charnelle, celle du corps du « je ». Elle s’ancre dans le corps du promeneur et du rêve chez Júdice, elle se dit dans les images baroques et expressionnistes des élégies silésiennes, elle trouve son point d’origine dans le regard noëlien et le geste du peintre :
le regard s’ensevelit puis se retourne
espérant saisir la chose qui menace
et qui pourtant n’est nulle part une rouille
de l’air un eczéma sur la peau du jour23.
16Mettant au jour un « cénotaphe24 », la poésie silésienne dit charnellement la douleur d’une ontologie ruinée au contact de l’existence. Elle fait le constat d’un corps absent, ou fait le deuil d’un corps du « je » à jamais accessible à la parole et réductible au pronom « je ». Renversant cette tragédie de l’être, le passé en présent et le « je » en « tu », Noël prône l’oubli et l’altérité pour faire coïncider corps et langage. Pour reprendre les expressions d’Hugues Marchal25, au contact de la méthodologie de Leroi-Gourhan, l’écriture noëlienne des derniers recueils ne cherche plus à présenter une « vision interne » mais une « projection externe » de la fonction organique. Elle constitue la trace d’un événement, l’empreinte d’un regard. Et cette conception du poème comme « empreinte », impliquant en creux la présence d’un corps, est récurrente chez ces auteurs. Dans Pasos en la nieve (2004), Siles fait le constat du néant de la page où le « je » apparaît comme pure fiction. Et c’est le lecteur qui peut ensuite lui donner chair, à la lecture. De même, Noël invite le lecteur à emboîter le pas à l’écriture : « Toute œuvre est ce qu’elle est : un récit, un poème, mais elle est, en plus, une empreinte. Et cette empreinte, qui est la trace de son auteur, offre un accès, comme si, par elle, le lecteur pouvait mettre ses pas dans les pas du créateur26. »
Pragmatiques de la lecture
17Le geste archéologique, fondé sur une écriture corporelle, s’appuie donc sur le relais du lecteur. Site élégiaque, le poème est enfin le lieu d’une rencontre. Et ceci participe d’un phénomène contemporain : le poème ne se clôt plus sur lui-même dans l’autotélie de ses significations mais dépend de plus en plus du regard du lecteur, d’une contingence. Pour ces trois auteurs, le lecteur joue un rôle actif dans l’œuvre. Dans Himnos tardíos, le « je » interpelle fréquemment le lecteur, qui est ainsi intégré directement à l’espace dialogique de l’élégie. C’est sur lui que repose la fictionnalisation de la personne poématique.
La personne poématique n’est pas une prolongation du je mais le je est une réalité produite seulement par les poèmes et inventée par le lecteur que tout poète, pour l’être, est. Le poète existe seulement comme personne poématique, et le lecteur, à sa façon, également27.
18L’écriture est errance, elle n’impose plus un sens unique, vertical : c’est au lecteur de le lui donner : « l’ordre final, c’est le lecteur qui devra le rechercher – et c’est dans cette quête, qui n’aboutit jamais à autre chose qu’à un nouveau commencement, que la poétique trouve sa place28 », écrit Júdice.
19L’anamnèse se construit ainsi sur une participation active du lecteur, qui redouble le geste du poète-archéologue. Pour Noël, dans ses Lettres verticales, c’est en effet le lecteur qui devient le garant de l’incorporation de la parole : en faisant de la page du poème une « page de terre », en fondant une herméneutique sur le modèle de l’archéologie horizontale de Leroi-Gourhan, Noël invite le lecteur à déchiffrer des empreintes et des vestiges, à reconstituer un corps, à redoubler le geste de l’archéologue. Hugues Marchal écrit, à ce sujet :
L’espace graphique appelle un même type de lecture, se muant en une sorte de partition pour le récepteur […]. Le lecteur est comme annexé au corps scripteur, puisque le geste pensé ou prescrit par l’un se voit accompli par l’autre, dans une relation de complémentarité ou de gouvernement à distance29.
20Dans ces poésies du retour, le mouvement intérieur de l’anamnèse s’extériorise, ainsi que le montre le modèle archéologique. Fondant des écritures postmodernes, où le poème s’inscrit ou plutôt s’altère dans le corps et dans le lecteur, le geste archéologique n’aboutit pas à la reconstitution d’une histoire ni à la plainte romantique mais à un lyrisme ruiné, ruinant le sujet et le sens.
1 Il y mit au jour un souterrain médiéval inondé.
2 Raoul Sangla, L’Archéologie, une idée à creuser, documentaire vidéo, 1989.
3 Bernard Noël écrit deux textes sur Jean-Paul Philippe : Site transitoire. Jean-Paul Philippe, Le Faouët, Du Scorff, 1997 et Jean-Paul Philippe. Archéologies intérieures, ouvrage collectif avec Antonio Prete, Laurent Germeau et Alessandra Rey, Fonds Mercator, 2008.
4 Nuno Júdice, « Le langage poétique », dans Un chant dans l’épaisseur du temps, suivi de Méditations sur des ruines, traduction de Michel Chandeigne, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1996 [1992 ; 1994], p. 7.
5 Jaime Siles, Sobre un posible préstamo griego en ibérico, Valence, Servicio de Investigación Prehistórica, 1976.
6 « Ruinas vivas. Entrevista a Antonio Colinas », réalisé par Bruno Marcos le 22 mars 2013, disponible en ligne sur le site de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia.
7 Nuno Júdice, « Le langage poétique », op. cit., p. 14.
8 A Matéria do Poema est le nom d’un recueil publié en 2008 (Lisbonne, Dom Quixote).
9 « Le langage poétique », op. cit., p. 11.
10 José Batlló, Poetas españoles poscontemporáneos, Barcelone, El Bardo, 1974, p. 325.
11 Jaime Siles, entretien avec Sergio Arlandis du 30 avril 2011, paru le site Internet Editorial Academia del Hispanismo (URL : http://www.academiaeditorial.com/web/hispanismodialogos_academicosjaime-siles-2).
12 Bernard Noël, L’Espace du poème. Entretiens avec Dominique Sampiero, Paris, POL, 1998, p. 126-127.
13 Ibid., p. 128-131.
14 Emmanuel Hocquard, Album d’images de la Villa Harris, Paris, Hachette, 1977, p. 32.
15 Bernard Noël, La Chute des temps, suivi de L’Été langue morte, La Moitié du geste, La Rumeur de l’air, Sur un pli du temps (Poèmes 2), Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2000, p. 26.
16 Ibid., p. 24.
17 Bernard Noël, L’Espace du poème, op. cit., p. 130.
18 Ibid., p. 47.
19 Ibid., p. 128-129.
20 Bernard Noël, Le Reste du voyage et autres poèmes, Paris, Seuil, coll. « Points », 2006, p. 11.
21 Jaime Siles, Hymnes tardifs, traduction Henry Gil, Belval, Circé, 2003, p. 69.
22 Nuno Júdice, Géométrie variable, traduction Cristina de Melo, Pont-Aven, Vagamundo, 2011 [2005].
23 Bernard Noël, Le Reste du voyage, op. cit., p. 18.
24 Tel est le titre de la plus récente anthologie de l’œuvre poétique silésienne : Cenotafio. Antología poética 1969-2009, édition de Sergio Arlandis, Madrid, Cátedra, coll. « Letras Hispánicas », 2011.
25 Voir, à ce sujet : Hugues Marchal, « Des corps en extension. Bernard Noël et André Leroi-Gourhan », dans Fabio Scotto (dir.), Bernard Noël : le corps du verbe, Lyon, ENS Éditions, coll. « Signes », 2008, p. 129-142.
26 Bernard Noël, L’Espace du poème, op. cit., p. 134.
27 Jaime Siles, « El texto y su doble. Notas para una posible poética y dudas para una poética posible », dans Les Polyphonies poétiques. Formes et territoires de la poésie contemporaine en langues romanes, Claude Le Bigot (dir.), Rennes, PUR, 2003, p. 299.
28 Nuno Júdice, « Le langage poétique », op. cit., p. 13.
29 Hugues Marchal, op. cit., p. 138.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en avril 2015, publiés par Caroline Andriot-Saillant et Thierry Roger (CÉRÉdI)
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 17, 2016
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/345.html.
Quelques mots à propos de : Vincent Zonca
ENS de Lyon
CERCC
