Sommaire
Dramaturgie du conseil et de la délibération
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en mars 2015, publiés par Xavier Bonnier et Ariane Ferry.
Conseil scientifique :
Jean-Philippe Agresti (Université d’Aix-Marseille, Droit) ; Jean-Claude Arnould (Université de Rouen, Directeur du CÉRÉdI) ; Éric Avocat (Université de Kyoto, Japon) ; Antoine Compagnon (Collège de France / Columbia University) ; Pierre Czernichow (PU-PH Université de Rouen) ; Myriam Dufour-Maître (Université de Rouen, CÉRÉdI, Présidente du Mouvement Corneille) ; Annie Hourcade (Université de Rouen, ÉRIAC) ; Mireille Losco-Léna (ENSATT-EA 4160 Passages XX-XXI) ; John D. Lyons, (Université de Virginie, Charlottesville) ; Christophe Martin (Université Paris IV- Sorbonne) ; Witold Konstanty Pietrzak (Université de Lodz, Pologne).
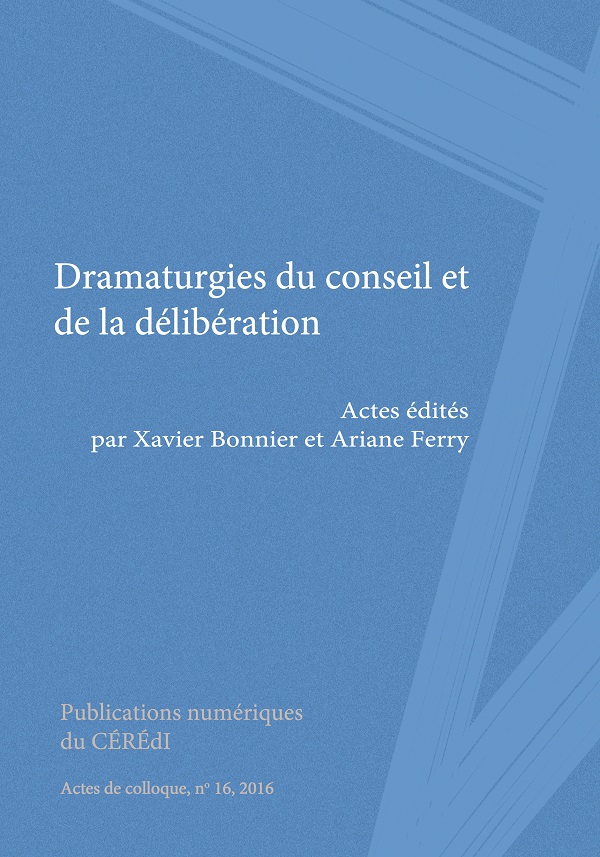
- Xavier Bonnier et Ariane Ferry Avant-propos
- Claude Gontran Dramaturgie du conseil et de la délibération dans le Philoctète de Sophocle
- Tiphaine Karsenti Entre topique et matériau théâtral : le conseil dans la tragédie française au tournant des xvie et xviie siècles
- Delphine Amstutz Favoris et conseillers sur la scène tragique du premier xviie siècle
- Katsuya Nagamori Confidents et conseillers du roi dans la tragédie du xviie siècle
- Tony Gheeraert Héros et / ou orateur ? Conseil et délibération dans le dernier acte d’Horace de Pierre Corneille
- Myriam Dufour-Maître Délibérer, dialoguer, décider dans les tragédies tardives de Corneille
- Tomoko Takase Le « théâtre de famille » de Madame de Staël après 1800 : une dramaturgie du for intérieur
- Filippo Bruschi Wagner et Mallarmé : deux hypothèses pour un théâtre de la cité
- Antoine Muikilu Ndaye Conseil dans Pas de feu pour les antilopes de Norbert Mikanza et concertation dans Ton combat, femme noire de Katende Katsh
- Célia Bussi Le théâtre de narration, un espace privilégié de la délibération
- Milagros Torres Doute, conseil et dramatisation dans El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel : le « sucre » et l’ordre
- Gérard Milhe Poutingon Panurge le décalé. L’imaginaire concrétisant du conseil et de la délibération au xvie siècle
- Nadège Langbour Délibérer avec soi-même : la théâtralisation du jugement critique dans les Salons de Diderot
- Bérengère Voisin La délibération mise en scène : Prenez soin de vous (2007) de Sophie Calle ou les vertus du chœur
- Gaspard Delon et Sandra Provini Les représentations du conseil du roi à l’origine du massacre de la Saint-Barthélemy : des témoignages contemporains à La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994)
- Benjamin Lenglet De l’engagement et de son insuffisance : les exemples de 12 Angry Men de Sidney Lumet et 12 de Nikita Mikhalkov
- André Bayrou Le conseil rejeté. Mises en scène de la transgression dans la vie et la carrière des humanistes français
- Sandrine Caroff-Urfer Scènes de conseil et de délibération dans les Mémoires du cardinal de Retz : une dramaturgie au service de l’héroïsation de soi
- Camille Kerbaol Les scènes de conseil et de délibération dans les Mémoires de Saint-Simon : une tragédie de la parole politique
- Éric Avocat Du théâtre à la théâtralité : la scène parlementaire et la pluralité des mondes dramaturgiques
- Yves-Marie Péréon Mettre en scène le cerveau du président : Roosevelt et le brain-trust, 1932-1945
- Luc Benoit à la Guillaume La mise en scène reaganienne des discours sur l’état de l’Union
- Klaas Tindemans La dramaturgie de la négociation politique. La frontière poreuse entre la politique réelle et la fiction politique
- Jean-Louis Jeannelle Le Temps d’apprendre à vivre de Régis Debray : un Breviarum politicorum à l’âge de la médiologie
- Éric Avocat et Marcel Lemonde Le pas boiteux de la justice
Conseil et délibération sur les tréteaux de l’Histoire du monde
Scènes de conseil et de délibération dans les Mémoires du cardinal de Retz : une dramaturgie au service de l’héroïsation de soi
Sandrine Caroff-Urfer
1Le cardinal de Retz, né Jean-François-Paul de Gondi, est connu pour son rôle actif dans l’épisode de la Fronde, mouvement de révolte parlementaire et nobiliaire qui secoua la France sous la régence d’Anne d’Autriche, des années 1648 à 1652. Vingt-cinq ans plus tard, dans un royaume muselé par l’absolutisme triomphant, et lors d’une retraite religieuse qui signait, croyait-il, son exclusion définitive de la vie mondaine et publique, Retz entreprend la rédaction de ses Mémoires1. C’est l’occasion pour lui de se replonger dans les moments les plus mouvementés et les plus intenses de cette époque un peu folle de son existence, comme de l’histoire de la France, et qui se solda par son emprisonnement et par un exil forcé de six années.
2Les situations de conseil et de délibération sont au cœur de l’expérience politique et diplomatique de ce prélat, rompu à l’éloquence sacrée aussi bien que profane. Il n’est donc pas surprenant qu’elles occupent aussi une place importante dans les Mémoires, le narrateur les sauvant de l’oubli de manière privilégiée, et les sélectionnant volontiers dans le disparate et le confus de la vie, afin d’en prolonger l’existence dans la mémoire du lecteur. Le récit offre un ensemble extraordinairement varié de ces échanges, témoignage de la richesse d’expérience de ce grand témoin et acteur. Signe aussi d’un goût marqué chez lui pour l’exercice de la parole en lien avec l’action, une parole performative plutôt qu’assertive, toujours adressée et dynamisée par un enjeu agonistique, puisqu’il faut convaincre, et enjoindre le destinataire d’agir dans le sens des désirs et des projets de Retz. Le rôle de conseiller endossé peut être celui du prédicateur à ses ouailles2, du ministre au prince auprès duquel il est placé3, et même du pédagogue à ses élèves. Selon un procédé de mise en abyme assez conventionnel, les Mémoires deviennent en effet une immense situation de conseil, le narrateur justifiant son entreprise rédactionnelle par la volonté, dit-il, de « laisser des Mémoires qui pussent être de quelque instruction à messieurs vos enfants4 ».
3Le conteur sait du reste faire de ces échanges de parole sous tension, et souvent sous couvert, un usage puissamment dramatique. Ces scènes relèvent en effet de la stratégie du secret dévoilé, et il est excitant pour le lecteur de pénétrer à la suite du narrateur, et comme par effraction, dans les cabinets retirés et dans les ruelles des lits, où se tirent les ficelles de ce grand spectacle à machines qu’est l’Histoire. Retz a le plaisir ainsi de se mettre en scène avec les plus grands. Ses rencontres avec Condé notamment, qu’il admire beaucoup, et leurs échanges, sont des moments particulièrement soignés. En outre dans ce récit qui se dirige pourtant inexorablement vers l’échec de son héros, rien ne semble joué d’avance, et les scènes de débat d’idées et de confrontation d’opinions en vue d’une décision à prendre se rejouent sous nos yeux comme si un autre dénouement était possible, maintenant ainsi un effet de suspense qui participe du plaisir commun à l’écriture et à la lecture.
4Enfin, ces scènes participent pleinement de l’intention apologétique au cœur de ce récit de soi, le narrateur œuvrant dans le sens d’une véritable héroïsation de son personnage, par le moyen d’une dramaturgie que nous nous proposons d’analyser. Par dramaturgie, nous entendons l’art, ou l’ensemble des règles, présidant à la composition d’une pièce de théâtre ainsi qu’à sa mise en scène. L’emploi de ce terme, qui vient qualifier à la fois l’agencement de la fable et l’organisation de sa représentation, alors que nous avons affaire à une œuvre narrative à caractère historique, nécessite évidemment d’être justifié et expliqué.
5On peut souligner tout d’abord que Retz nourrit une conception dramatique de son existence : il pense et présente son parcours de vie (au moins pour l’épisode de la Fronde, qui constitue l’essentiel de l’œuvre) comme la résultante de conflits entre les personnages, traduits en échanges agonistiques, et conduisant l’action de péripéties en péripéties jusqu’à son dénouement5.
6Ensuite, ces scènes de conseil et de délibération, qui sont d’abord des scènes dans le sens narratologique du terme6, sont racontées comme s’il s’agissait de scènes de théâtre, et comme si le lecteur assistait à une représentation. En ce qui concerne la langue, cela se traduit notamment par le recours à un arsenal de métaphores théâtrales, depuis longtemps repérées par la critique littéraire, et diversement justifiées7. Mais cette manière de théâtraliser le contenu du récit va bien au-delà des simples aspects stylistiques, et se traduit dans une organisation qui touche à la fois la scène elle-même, et plus largement, son insertion dans une macrostructure qui joue de l’agencement des scènes entre elles. Retz, en effet, manifeste le souci du rythme, en faisant alterner les scènes de délibération en groupes avec des scènes de duel, et avec des monologues délibératifs. Le tout pour nourrir « une certaine idée8 » qu’il se fait de lui-même, et qu’il veut rendre manifeste dans ses Mémoires. Alors que son entreprise s’inscrit de manière revendiquée dans le champ du discours de vérité9, il opère néanmoins des choix dans le matériau fabulaire que lui propose l’Histoire, et imprime sur les événements qu’il rapporte une vision toute subjective, sensible jusque dans la scénographie qu’il choisit. Comme si l’Histoire n’était pas déjà écrite, et sa fable déjà contrainte. Comme si le spectacle n’avait pas déjà été donné, et sa scénographie déjà figée.
7Qu’il existe donc, dans les Mémoires de Retz, une réelle dramaturgie au service d’une vision de soi et de l’Histoire, propice à l’héroïsation de son personnage, c’est ce dont nous souhaiterions à présent faire la démonstration par l’analyse de deux scènes. Dans l’ensemble très riche des scènes de conseil que nous proposent les Mémoires, nous nous intéresserons à celles qui ponctuent la journée du 26 août 1648. Cette journée, connue sous le nom de « journée des barricades », constitue dans la chronologie de la Fronde un moment d’une grande intensité dramatique, puisqu’on voit le peuple de Paris investir les rues de la capitale, dans un mouvement de contestation à l’autorité royale qui n’avait plus pris cette forme depuis les événements de la Ligue au siècle passé. Cette journée n’est pas moins décisive pour notre prélat : ouverte sur un conseil de Régence, et se clôturant sur une délibération solitaire, elle marque son passage de l’allégeance à la sédition. Ces scènes se situent donc à un moment charnière du récit ; elles constituent une étape essentielle dans la construction de la figure de Gondi10, et dans l’adhésion du lecteur à cette figure.
8Nous assistons d’abord au conseil de Régence, convoqué dans l’urgence au Palais-Royal autour d’Anne d’Autriche et de Mazarin11. La cour consulte pour savoir quelle attitude adopter face à cette « révolution », selon le lexique consacré à l’époque pour désigner les révoltes. Alerté par les premières manifestations de colère populaire, Gondi a quitté la coadjutorerie où il déjeunait avec des amis, et traversé Paris pour se rendre auprès de la reine. Il a vu les boutiques qu’on ferme précipitamment, les premières pierres lancées contre les soldats, et la foule hurlante qui se déverse dans les rues, réclamant à corps et à cris la libération des magistrats que la reine vient de faire arrêter12. Encore imprégné du spectacle mouvementé dont il a été le témoin, Gondi pénètre dans le grand cabinet de la Reine.
9La scène s’ouvre sur l’équivalent d’une didascalie initiale présentant le lieu, et la composition du conseil. Les membres en sont nommés dans l’ordre décroissant de leur importance sociale, ce qui est à la fois l’ordre de la préséance et l’ordre de présentation d’une liste de personnages dans une pièce de théâtre. Le vocabulaire théâtral est très présent, et la clé pour comprendre ce qui se passe livrée bientôt par Retz en une formule lapidaire : « La vérité est que tout ce qui était dans ce cabinet jouait la comédie13. » À la source d’une telle métaphore, évidemment le topos du theatrum mundi, qui assimile la vie à une représentation dramatique. Sans doute aussi la théâtralité inhérente à cette société de la représentation, où l’on est ce que l’on donne à voir. Enfin la simulation et la feinte au cœur du jeu politique auquel se livrent les Grands, chacun avançant masqué, en même temps que conscient des effets d’image qu’il doit susciter, attendant d’être dans la coulisse pour révéler son vrai visage.
10Cette éthique de la dissimulation s’illustre dans une galerie de portraits animés que brosse Retz, fondée sur l’opposition entre apparence et réalité, personnage et personne, scène et coulisses :
je faisais l’innocent, et je ne l’étais pas […] ; le Cardinal faisait l’assuré, et il ne l’était pas si fort qu’il paraissait ; il y eut quelques moments où la Reine contrefit la douce, et elle ne fut jamais plus aigre ; M. de Longueville témoignait de la tristesse, et il était dans une joie sensible, parce que c’était l’homme du monde qui aimait le mieux les commencements de toutes affaires ; M. le duc d’Orléans faisait l’empressé et le passionné en parlant à la Reine, et je ne l’ai jamais vu siffler avec plus d’indolence qu’il siffla une demi-heure en entretenant Guerchi dans la petite chambre grise ; le maréchal de Villeroy faisait le gai pour faire sa cour au ministre, et il m’avouait en particulier, les larmes aux yeux, que l’État était au bord du précipice ; Bautru et Nogent bouffonnaient […], quoiqu’ils connussent très bien l’un et l’autre que la tragédie ne serait peut-être pas fort éloignée de la farce. Le seul et unique abbé de La Rivière était convaincu que l’émotion du peuple n’était qu’une fumée14.
11Cette facilité du « je » à déjouer les apparences trouve son origine tout d’abord dans la compression, en cette seule scène du conseil de Régence, de l’espace-temps de plusieurs autres scènes qui se jouèrent plus tard, en d’autres lieux : par exemple celle du duc d’Orléans et de Guerchi dans la chambre grise, ou le dialogue confidentiel du maréchal de Villeroy à Gondi. Ce faisant, le « je » à l’œuvre dans le texte se dote aussi de pouvoirs particuliers, rendus possibles par la confusion sur cette instance énonciatrice des compétences réunies de Gondi et de Retz. Un exemple éclaire particulièrement bien cette idée. Le coadjuteur, inquiet de ce qu’il a vu dans les rues, tente de convaincre la reine du danger de la situation. Celle-ci s’emporte, et le menace verbalement, avant de revenir à une attitude plus calme, sous les injonctions de Mazarin : « elle me fit des honnêtetés, et j’y répondis par un profond respect, et par une mine si niaise, que La Rivière dit à l’oreille de Bautru, de qui je le sus quatre jours après : “Voyez ce que c’est que de n’être pas jour et nuit en ce pays-ci. Le coadjuteur est homme du monde ; il a de l’esprit : il prend pour bon ce que la Reine lui vient de dire15.” » Cette réplique, insérée au discours direct, d’un propos tenu en aparté que le personnage de Gondi ne peut avoir entendu au moment où il a été prononcé, confère une dimension syncrétique à la figure qu’il incarne, et qui réunit en elle seule les trois statuts du personnage, du spectateur, et du metteur en scène. Elle offre une compréhension plus complète de la scène, contournant ainsi la limitation du point de vue qu’entraîne nécessairement le récit à la première personne, et munit le coadjuteur d’une connaissance dont il était en réalité privé lorsque la scène se joua. Inscrivant l’œuvre dans un imaginaire de la transparence et dans une dynamique de la révélation, cette instance omnisciente devient le lieu essentiel d’un regard de lucidité et d’un discours de vérité, en même temps qu’elle prend le lecteur au piège d’une stratégie énonciative qui contamine puissamment la réception de l’œuvre, par les effets de sympathie et d’autorité qu’elle rend possibles.
12Le choix du registre renforce aussi cette emprise persuasive sur le lecteur. Si le moment est solennel et la distribution prestigieuse, le mémorialiste semble toutefois hésiter sur le traitement à proposer de cette scène, comme hésitent aussi les acteurs qui l’interprètent, conscients, on l’a vu, « que la tragédie ne serait peut-être pas fort éloignée de la farce16 ». L’événement est donc à l’image de ce que fut la Fronde toute entière : un épisode dont on ne saurait dire s’il faut en rire ou en pleurer, si les acteurs qui l’animent sont des héros ou des bouffons. Un épisode qui opère le brouillage des frontières entre les catégories esthétiques et morales17.
13Néanmoins, bien vite, un glissement s’opère vers le comique. Du fait d’abord de la force des émotions ressenties par les personnages, qui déforment les traits de leur visage jusqu’à les figer dans une expression qui tient du masque, et accentuent leur comportement de manière caricaturale, comme s’il relevait du type. Ce dont atteste le recours aux modèles de la farce et de la comédie italienne. C’est ainsi que La Meilleraye prend tout à coup la posture du va-t-en-guerre :
Afin qu’il ne manquât aucun personnage au théâtre, le maréchal de La Meilleraye, qui jusque-là était demeuré très ferme avec moi à représenter la conséquence du tumulte, prit celui du capitan […], il se mit en colère jusques à l’emportement et même jusques à la fureur. Il s’écria qu’il fallait périr plutôt que souffrir cette insolence, et il pressa que l’on lui permît de prendre les gardes, les officiers de la maison et tous les courtisans qui étaient dans les antichambres, en assurant qu’il terrasserait toute la canaille18.
14Un peu plus tard, c’est au tour du lieutenant civil de jouer le type du poltron :
[Il] entra […] dans le cabinet avec une pâleur mortelle sur le visage, et je n’ai jamais vu à la comédie italienne de peur si naïvement et si ridiculement représentée que celle qu’il fit voir à la Reine en lui racontant des aventures de rien qui lui étaient arrivées depuis son logis jusques au palais-Royal19.
15Bautru et Nogent, de leurs côtés, endossant le type du farceur, se lancent dans un numéro d’acteurs comiques, et proposent un divertissement burlesque, dans une scène de théâtre dans le théâtre qui n’est pas sans rappeler le goût baroque : ils « représentaient, pour plaire à la reine, la nourrice du vieux Broussel (remarquez, je vous supplie, qu’il avait quatre-vingts ans), qui animait le peuple à la sédition20. »
16La reine pour sa part, incarnant le type de la furieuse, est caractérisée théâtralement par son « fausset aigri21 », manifestation vocale de son irascibilité qui peut aller jusqu’à la fureur et la perte de contrôle de soi. Comme lorsque, aveuglée par la colère qui lui empourpre le visage, elle s’avance sur Gondi, levant vers son visage ses deux mains ouvertes, dans un simulacre d’étranglement22. Mazarin en revanche est le type même du méfiant dont il faut se méfier. Son discours est conciliant et flatteur. Mais sa duplicité se révèle tout entière quand il sourit « malignement23 ». Couvert et dissimulé, il est en outre incapable d’accorder sa confiance, ce que lui reproche systématiquement Retz, qui voit en ce trait un signe rédhibitoire de faiblesse24. L’autorité du conseil de Régence, parce qu’elle est incarnée de manière bicéphale par deux tempéraments agissant selon des modalités opposées, mais tous deux marqués par une dimension un peu mécanique qui les fait glisser dans le registre comique, et tous deux incompatibles avec l’exercice raisonné du pouvoir, explique l’échec de Gondi à faire entendre son expertise sur la révolte populaire qui gronde, et à endosser la figure de conseiller écouté et suivi25.
17Enfin, la scène de conseil est orchestrée selon une dramaturgie qui joue des effets de rythmes, et qui amplifie la tension au fur et à mesure des entrées successives de personnages extérieurs. On voit ainsi surgir le hors-scène dans l’espace feutré et confiné du cabinet, sous la forme de témoins qui viennent de la rue et racontent ce qu’ils y ont vu ou vécu, dont les entrées constituent de réelles péripéties, et génèrent un comique de répétition. L’émotion croît sans cesse jusqu’au dénouement tant attendu, la prise de décision par Mazarin. Va-t-il trancher en décidant de libérer Broussel et Blancmesnil, ou bien opter plutôt pour une répression de la révolte populaire par la violence ? Finalement, pour se permettre de reporter sa décision à plus tard, Mazarin missionne le coadjuteur dans la rue, comme porte-parole de la cour, afin de négocier la libération des parlementaires, en récompense de la pacification préalable de la foule. Gondi tente en vain de résister à cette décision, dont il entrevoit immédiatement le piège qu’elle constitue pour lui en termes d’image, si la cour décidait in fine de ne pas tenir ses engagements. La clausule de cette scène, particulièrement soignée par Retz, s’inscrit dans la continuité de la veine burlesque qu’il a choisi d’adopter, en dépit de l’enjeu politique grave.
En un mot l’on se moqua de moi, et je me trouvai tout d’un coup dans la cruelle nécessité de jouer le plus méchant personnage où peut-être jamais particulier se soit rencontré. Je voulus répliquer ; mais la Reine entra brusquement dans sa chambre grise ; Monsieur me poussa tendrement avec ses deux mains en me disant : « Rendez le repos à l’État » ; le maréchal m’entraîna, et tous les gardes du corps me portaient amoureusement sur leurs bras en criant : « Il n’y a que vous qui puissiez remédier au mal. » Je sortis avec mon rochet et mon camail, en donnant des bénédictions à droite et à gauche, et vous croyez bien que cette occupation ne m’empêchait pas de faire toutes les réflexions convenables à l’embarras dans lequel je me trouvais26.
18Le conseil débouche donc sur une mesure dilatoire de Mazarin, autrement dit, selon les critères de Retz, sur une absence de décision27. L’attente de Gondi, et celle de son lecteur qui partage ses vues, est donc trompée et la fin de la scène déceptive d’un point de vue politique. Mais non pas d’un point de vue dramaturgique pour le spectateur, qui goûte la chorégraphie décalée et pleine d’humour dont Gondi fait les frais. Ni même d’un point de vue stratégique pour le narrateur qui récolte les bénéfices en termes de connivence avec son public. Le coadjuteur a certes été joué, mais il n’en est pas dupe, et il accepte d’endosser le mauvais rôle qu’on lui réserve au nom des règles d’un certain jeu aristocratique, qui dicte le comportement approprié à ce genre de situation, fait de détachement et du respect de la bienséance.
19Enfin, traiter une scène de conseil selon des codes plus proches de L’Illusion comique ou même d’une pièce du répertoire de la commedia dell’arte, plutôt que de celle d’Horace, contribue à la dévaluation de tous les acteurs présents, et permet notamment de délégitimer le pouvoir exercé par Mazarin, et l’ascendant qu’il a pris sur la reine. Cela donne à voir une cour complètement coupée des réalités de la rue dont elle ignore tout, condamnée à s’en remettre à des flatteurs soucieux d’abord de leur intérêt particulier, incapable finalement de reconnaître en Gondi le conseiller lucide et informé dont elle a tant besoin. Cette représentation féroce de la comédie du pouvoir, traversée par une sensibilité toute baroque pour le théâtre des apparences, sert évidemment le propos apologétique qui s’élabore.
20Reprenons en effet le fil du récit. Voici Gondi missionné pour calmer la foule. Dans une scène romanesque et palpitante, Retz nous montre comment le coadjuteur s’acquitte de cette mission au péril même de sa vie, puisqu’il reçoit une blessure à la tempe et manque de mourir assassiné par un insurgé qui ne l’avait pas reconnu. Le récit éclaire d’un jour flatteur son sang-froid dans l’action, ainsi que le magnétisme de sa parole qui suffit à calmer la foule. Après avoir fait son rapport à la reine, et constaté non sans incompréhension l’ironie avec laquelle il est remercié de ses services, il traverse à nouveau Paris, calme à nouveau les agitateurs, et rentre se soigner chez lui. Alors que la nuit s’avance, convergent peu à peu vers son logis des informateurs alarmés et alarmistes qui sortent du souper de la reine. Il apprend tour à tour qu’il fait les frais de la médisance moqueuse du cercle d’Anne d’Autriche, qu’on le tient pour responsable de l’agitation populaire qu’il a au contraire apaisée avec succès, et qu’il est même question de le faire emprisonner dès le lendemain matin comme opposant politique. Alors que ses conseillers et amis s’agitent autour de lui, il s’isole un quart d’heure. Se tient alors la seconde scène qui nous intéresse, et qui consiste en une délibération solitaire, qui lève le voile sur ce que Retz nomme son « mouvement intérieur28 ».
21Cette délibération se construit en antithèse avec la scène de conseil. À la dévaluation burlesque de la comédie du conseil, Retz substitue une psychomachie traitée de manière épique. Le combat que se livrent dans son âme des passions contraires est déployé de manière rigoureuse mais souple, selon le modèle du monologue délibératif. Les références utilisées font appel à un imaginaire héroïque. Le lexique est celui des valeurs aristocratiques : il y est question de gloire, d’honneur, de vertu. On pense ici au Corneille des tragédies politiques.
22L’enjeu est un enjeu de devoir : « je ne fis pas seulement réflexion sur ce que je pouvais, parce que j’en étais très assuré : je pensai seulement à ce que je devais, et je fus embarrassé29. » Il s’agit d’abord de ce que Gondi doit à la Reine. Mais la manière dont il a été joué le délivre de toute obligation à son égard. Il campe désormais le type du conseiller frappé par l’ingratitude royale, ce qui justifie à ses yeux le passage à la sédition. Second terme de l’enjeu : ce qu’il se doit à lui-même. Il est délicat en effet pour un homme d’Église de s’engager dans le combat contre l’autorité royale, combat qui prendra même une dimension physique. Cela entraînerait un brouillage d’image qui pourrait nuire à Gondi et le condamner au ridicule. Ce qu’il n’évitera pas finalement, comme en témoignent les mazarinades de l’époque. Mais il préfère ce ridicule-là à celui qu’il encourt par ses mœurs licencieuses. Il aime l’aventure et le leadership, il aime aussi les femmes, talents incompatibles avec le port de la robe ecclésiastique. Le statut de chef de parti, dont il rêve depuis toujours, lui semble l’opportunité de résoudre ce dilemme, comme il l’explique dans une célèbre maxime : « Les affaires brouillent les espèces, elles honorent même ce qu’elles ne justifient pas ; et les vices d’un archevêque peuvent être, dans une infinité de rencontres, les vertus d’un chef de parti30. »
23La scène est bornée temporellement : un quart d’heure seulement. Ce qui vient souligner la rapidité dans la prise de décision, et qui contraste avec les nombreuses volte-face de la cour. Au collectif stérile du conseil s’oppose donc la solitude efficace. À l’illusion et au déguisement se substituent la sincérité et la lucidité dans l’analyse des motivations. Après le mimodrame qui s’est joué dans le grand cabinet, alors que le « galimatias » de Mazarin semblait inapte à générer une action politique, Retz fait entendre la parole performative du chef de parti, à même de fédérer les troupes et de les jeter dans l’action. Alors que minuit sonne, il annonce à tous sa décision par une déclaration très théâtrale : « Je serai demain, devant midi, maître de Paris31. » On sent bien comment se déploie ici un imaginaire puissant qui confère à la scène une charge solennelle. L’imaginaire de minuit, heure fatidique et point de bascule. L’imaginaire de la nuit, espace-temps qui porte en germe toutes les virtualités de l’existence.
24En conclusion, il faut souligner le plaisir de lecture que génère cette séquence narrative, qui s’ouvre sur une scène de conseil d’État et se clôt sur une délibération solitaire. Ces deux scènes se construisent selon les deux figures du parallélisme et de l’antithèse, procédés par lesquels se justifie le passage à la sédition et s’accroît le prestige du séditieux. Elles constituent un espace où convergent le théâtre, voire le théâtral, la rhétorique et la politique, et dont l’enjeu principal est le pouvoir.
25La stratégie a consisté, on l’a vu, à proposer à distance les portraits en parallèle et en action de deux hommes politiques que tout oppose. Alors que la première scène se clôt sur une chute comique, vise à faire tomber les masques et à montrer, derrière les apparences, la réalité des impérities du pouvoir, la seconde lève le voile sur un homme providentiel improbable et presque disconvenant en la personne d’un ecclésiastique, et vient clore un mouvement général d’ascension vers son épiphanie héroïque.
26Mais qu’en est-il réellement du pouvoir que Gondi croit prendre dans cette scène où il décide du passage à la sédition ? Délibérer pour se libérer, dit-on. Sans doute en effet se libère-t-il des liens d’obéissance qui le rattachaient encore à la reine. Mais n’est-ce pas pour tomber dans des rets encore plus puissants, ceux de son imaginaire héroïque, qui lui font voir vingt-cinq ans encore après les faits ce moment comme celui de la réconciliation à soi-même et de l’accès à la gloire, alors que l’histoire s’est chargée d’apprendre à tous qu’il s’agissait en réalité du moment de la catastrophe ?
1 Le Cardinal de Retz, Mémoires précédés de La Conjuration du comte de Fiesque, texte établi, présenté et annoté par Simone Bertière, Paris, Classiques Garnier, coll. « La Pochothèque », 2003, [1987]. Sauf avis contraire, nos références aux Mémoires seront établies dans cette édition.
2 Si les Mémoires ne donnent pas à lire de sermons, à plusieurs reprises néanmoins, le narrateur met son personnage en scène dans ses fonctions de coadjuteur de Paris, monté en chaire lors de messes qu’il conduit à Notre-Dame-de-Paris. Les témoignages contemporains nous permettent de mesurer l’engouement et l’admiration que suscitaient ses prédications, divertissement mondain alors très prisé.
3 On pense ici plus particulièrement à la période au cours de laquelle, à partir de septembre 1650, Retz est placé comme conseiller auprès du duc d’Orléans, un des meneurs de la Fronde aristocratique. La tâche est rendue bien difficile par le caractère de ce prince, réputé pour son indécision et pour sa lâcheté, pour la facilité avec laquelle il se laisse influencer, et pour sa crainte de paraître l’être trop ; en un mot gouverné par la peur, il ne peut l’être par rien ni personne d’autre. La situation est encore aggravée par l’inquiétude qu’a Retz de passer dans le public pour le favori du duc, ce qui lui aurait « trop donné l’air de courtisan », (op. cit., p. 653). De manière plus informelle, Retz a aussi joué le rôle de conseiller auprès du duc de Bouillon lors de la première fronde parlementaire. Enfin, on le voit à plusieurs reprises dans le récit tenter de prendre de l’ascendant sur la personne même de la reine Anne d’Autriche.
4 Ibid., p. 1213. Cette justification arrive bien tard dans le texte, il est vrai, dans les toutes dernières pages, comme pour légitimer a posteriori un peu sérieusement ce qui vient de s’écrire. L’intention didactique est certes indéniable et permanente : on la détecte dans l’effort de clarification du contexte politique, dans la divulgation des ressorts cachés de l’histoire, dans la présence même de maximes qui émaillent le récit, et font de l’œuvre un bréviaire politique, dans lequel un jeune homme qui s’engage dans le monde trouvera en effet de précieux conseils. Néanmoins, l’impulsion rédactionnelle trouve plus vraisemblablement son origine dans un mouvement jubilatoire généré par le récit de souvenirs, et dans un jeu galant de dévoilement de soi devant un public féminin conquis d’avance.
5 Deux moments néanmoins échappent à cette règle : l’essentiel de la première partie des Mémoires, consacrée au récit des jeunes années, et la fin de la deuxième partie, qui propose le récit de l’emprisonnement, de l’évasion, et de la fuite mouvementée vers l’Italie. Ces deux passages se caractérisent davantage par une coloration proprement romanesque, l’action avançant au gré des mésaventures et des opportunités que le hasard semble dresser sur la route du héros, et non pas au rythme d’échanges argumentés entre partisans de camps adverses ou tenants de thèses opposées.
6 Dans ces scènes en effet, la vitesse narrative se modifie, le temps du récit se ralentit et vient se calquer sur le temps de l’histoire, au gré du rythme des dialogues. (Pour les notions de narratologie auxquelles nous recourons, voir Gérard Genette, Figures III, Paris, Le Seuil, 1972). Plus généralement, sur la conduite du récit dans les Mémoires, nous renvoyons à André Bertière, Le Cardinal de Retz mémorialiste, Paris, Klincksieck, 2005 [1977], p. 450 sq. Il montre comment se tisse la toile de fond un peu grise et austère de la narration, organisée de manière chronologique, désinvestie d’un point de vue stylistique, et calquée sur le Journal du Parlement qui soutient la mémoire défaillante du narrateur, à vingt-cinq années de distance des événements rapportés. Ce fil narratif factuel ne semble exister que pour faire le lien entre des unités narratives autonomes, hautes en couleur et qui constituent un contraste d’autant plus saisissant avec l’arrière-plan terne sur lequel elles se détachent. En termes de narratologie, le récit s’organise donc par alternance de sommaires et de scènes. Les seuils de ces scènes sont le plus souvent marqués de manière ritualisée. À l’ouverture, par une adresse à la destinataire remplissant une fonction de régie : il s’agit de justifier l’insertion de cette scène et d’en préparer la réception. À la clausule, par une maxime qui sert de pointe et donne parfois à cette unité narrative la dimension d’un apologue, le narrateur assurant alors une fonction idéologique.
7 Voir notamment Derek A. Watts, « le sens des métaphores théâtrales chez le cardinal de Retz et quelques écrivains contemporains », dans Noémi Hepp, Robert Mauzi et Claude Pichois (dir.), Mélanges offerts à René Pintard, Paris, Klincksieck, 1975.
8 Nous pensons ici à l’ouverture des Mémoires de guerre de Charles de Gaulle qui proclame : « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France… », Mémoires de guerre, t. 1, L’appel : 1940-142, 3 volumes, Paris, Plon, coll. « Pocket », 2010 [1954], p. 7. Cette expression nous semble particulièrement révélatrice de l’existence chez le témoin et acteur de l’Histoire (et nous pensons ici aussi bien à Retz qu’à de Gaulle) d’une subjectivité forte, traduisible dans le champ de l’imaginaire, qui vient colorer la vision qu’ils portent sur l’événement, expliquer la nature de leur engagement dans l’action, et marquer le récit a posteriori qu’ils en font.
9 L’incipit de l’œuvre s’ouvre ainsi sans ambiguïté sur un pacte inaugural promettant vérité et sincérité, s’appuyant pour y parvenir sur la dynamique du dévoilement, et sur la rhétorique de l’aveu.
10 Par commodité, nous tenterons désormais de distinguer les deux « je » du texte, en les désignant différemment. Lorsque nous parlerons de Retz, il sera question du narrateur, le vieillard fatigué et malade qui se remémore sa jeunesse et la consigne dans ses Mémoires, depuis l’abbaye de Saint-Mihiel où il s’est retiré. Quant au nom de Gondi, il nous permettra de désigner le personnage du coadjuteur de Paris, c’est-à-dire l’évêque auxiliaire du premier archevêque de Paris, plongé au cœur des événements contestataires de la Fronde. Nous ne nions pas, néanmoins, le caractère un peu artificiel de ce procédé, dont la difficulté principale réside dans la confusion entre ces deux « je », orchestrée souvent par Retz, comme nous aurons l’occasion de la montrer. Prêter au coadjuteur la clairvoyance et la maturité du vieux cardinal revenu de tout participe en effet des stratégies mises en œuvre dans un but apologétique.
11 Pour lire cette scène, on se reportera aux Mémoires, op. cit., p. 325-330.
12 L’opposition larvée à Mazarin s’est radicalisée sous l’impulsion des magistrats de Paris, menacés dans leurs privilèges par la suppression annoncée de la Paulette. Cette taxe annuelle leur permettait d’obtenir la transmission prioritaire de leurs offices à des membres de leur famille. La reine orchestre la riposte, et tente de faire rentrer les magistrats dans le rang, en ordonnant l’arrestation de deux de leurs membres : Blancmesnil, et le très populaire Broussel.
13 Ibid., p. 327.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 La Fronde en effet fut vécue comme une comédie par beaucoup de ceux qui y prirent part, ce dont témoignent les mémoires de l’époque. Parmi tant d’autres exemples, on pourrait évoquer les particularités de la figure de Mazarin, Italien dont le français est marqué d’un accent très fort, et qui suscita souvent le rire moqueur, faisant basculer la réalité parfois grave de la Fronde du côté de la dévaluation burlesque. Dans ses Mémoires, Mme de Nemours rapporte ainsi comment les parlementaires le « tournèrent dans un très grand ridicule […] sur ce qu’au lieu de dire l’Arrêt d’union, il avait dit l’Arrêt d’oignon, par la difficulté qu’il avait à parler bon Français », Madame la Duchesse de Nemours, Mémoires, Amsterdam, chez Jean Frédéric Bernard, 1718, p. 6.
18 Ibid., p. 327-328.
19 Ibid., p. 329.
20 Ibid., p. 327.
21 Ibid., p. 326.
22 Ibid., p. 329. Sur le personnage de la reine, et sur sa fonction théâtrale qui est d’incarner l’antagonisme ouvert à Gondi, on pourra lire Pierre Ronzeaud, « Les voix du théâtre politique de Retz », dans, Parcours critique, dir. Pierre Ronzeaud, Paris, Klincksieck, 2005 [1990], p. 175-185.
23 Mémoires, op. cit., p. 326.
24 Ce qu’il exprime dans une maxime assénée plus tôt dans le texte : « On est plus souvent dupe par la défiance que par la confiance. », ibid., p. 297. La capacité à faire confiance est, aux yeux de Retz, une qualité politique essentielle, comme on le voit dans le portrait élogieux qu’il dresse de la Princesse Palatine : « Je la trouvai d’une capacité étonnante, ce qui me parut particulièrement en ce qu’elle savait se fier. C’est une qualité très rare, et qui marque autant un esprit élevé au-dessus du commun. », ibid., p. 686.
25 Cette expertise qu’il revendique s’appuie tout d’abord sur sa mission pastorale, qui le met au contact de la population parisienne. Il peut donc s’enorgueillir d’une connaissance pragmatique, fondée sur l’expérience. Il est riche en outre d’une mémoire de la Ligue, modèle historique à travers lequel il analyse souvent la Fronde. On se souvient que dans cet épisode subversif du xvie siècle, le peuple parisien, instrumentalisé par les clans qui s’opposent, dresse les premières barricades politiques de l’histoire parisienne, faisant ainsi du cadre urbain à la fois le décor de scènes mouvementées et un enjeu de conquête politique. Cette mémoire de la Ligue a été transmise à Retz par l’histoire familiale, son grand-oncle, le cardinal de Gondi était en effet évêque de Paris pendant les troubles. Mazarin et Anne d’Autriche, en revanche, sont privés de cette expertise du peuple parisien et de ses soubresauts qui peuvent être violents.
26 Ibid., p. 330.
27 Même si en réalité décider qu’on attend, c’est aussi prendre une décision. Et jouer la montre peut se révéler payant. On sait de quel succès s’accompagna souvent cette stratégie propre au ministre italien. Mais les Mémoires, à charge contre Mazarin, ne lui reconnaissent aucun talent.
28 L’expression se trouve dans les Mémoires, op. cit., p. 321. Pour lire le récit de cette délibération solitaire, on se reportera aux pages 336-338.
29 Ibid., p. 336-337.
30 Ibid., p. 337.
31 Ibid., p. 338.
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en mars 2015, publiés par Xavier Bonnier et Ariane Ferry.
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 16, 2016
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/305.html.
Quelques mots à propos de : Sandrine Caroff-Urfer
Université de Nantes
L’AMo
Sandrine Caroff-Urfer est doctorante en littérature française à l’Université de Nantes. Elle prépare une thèse sur l’imaginaire héroïque chez le cardinal de Retz, sous la direction de Jean Garapon. Ses travaux portent aussi sur les pratiques aristocratiques de l’écriture de soi sous l’Ancien Régime. Et sur la poétique du discours de vérité, et les genres qui lui sont associés : mémoires, histoire, autobiographie.
