Sommaire
Journée des doctorants 2016
organisée par Guillaume Cousin et Sophia Mehrbrey à l’Université de Rouen le 18 mai 2016
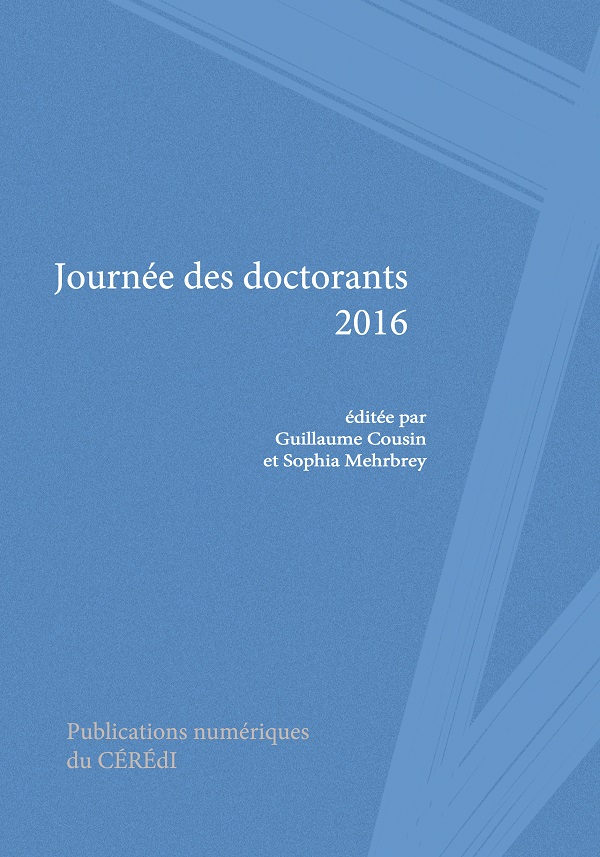
- Stéphane Pouyaud La question du modèle dans la parodie romanesque
- Thibault Vermot Représentations de la femme et poétique fantastique dans les Tales d’Edgar Poe
- Carole Bourle « Quand la violence réveille les sens ». L’ambiguïté de la représentation du plaisir féminin dans le romantisme
- Sophia Mehrbrey « Le moineau trouva son nid ». La sexualité enfantine entre initiation et transgression
- Camille Chollet Carmontelle, un théâtre du dérisoire
Journée des doctorants 2016
« Quand la violence réveille les sens ». L’ambiguïté de la représentation du plaisir féminin dans le romantisme
Carole Bourle
1Il existe un rapport étroit, particulièrement ambigu, entre la violence et la représentation du plaisir féminin1, spécifique aux œuvres romantiques. Avant d’étudier ce point précis plus en détail, quelques rappels sont sans doute nécessaires pour situer en quoi le romantisme est novateur sur la question de la représentation du plaisir d’une manière générale. Comme l’a noté Georges Gusdorf dans L’Homme romantique, le romantisme, parce qu’il tend vers la plénitude, « répudie le dualisme de l’âme et du corps et adopte une perception moniste du phénomène humain2 » ; en cela, il se place en-deçà de toute considération morale telles l’impudeur ou l’impudence. Cette volonté de réconcilier l’idéalité et la jouissance du corps bouleverse de fait le système de représentation traditionnel. Dans sa préface au Dictionnaire du Romantisme, Alain Vaillant l’a parfaitement démontré ; il note à ce propos :
Sous l’Ancien Régime, coexistaient deux discours à peu près totalement indépendants l’un de l’autre. D’un côté, des considérations psychologiques et surtout morales sur le sentiment amoureux et les devoirs qu’il imposait (en principe) aux deux amants ; de l’autre, des récits grivois, érotiques, pornographiques ou simplement lestes sur les relations sexuelles, où l’affectivité était absente ou traitée sur le mode ironique3.
2Dans une volonté d’harmonisation, et quoiqu’elle soit toujours hantée par cette dualité âme / corps, la nouvelle école aspire à réconcilier les deux sphères (les exaltations de l’âme et le plaisir du corps) quitte à être discréditée par une partie de la critique qui lui reproche son immoralité. Désormais, lorsque les auteurs continuent d’évoquer la double nature de l’amour, c’est dans l’optique de mieux dénoncer les ravages provoqués par un sentiment d’incomplétude. C’est tout le drame de Lélia, l’héroïne de Sand, qui souffre d’une incapacité à jouir, comme elle l’explique à sa sœur, la courtisane Pulchérie :
La froideur de mes sens me plaçait au-dessous des plus abjectes femmes, l’exaltation de mes pensées m’élevait au-dessus des hommes les plus passionnés. J’aimais par besoin, par nécessité ; mais ne goûtant point les joies que je donnais, je ne pouvais m’attacher par aucun sentiment réel, par aucune reconnaissance fondée, à l’objet de mes sacrifices. Ce désir effréné de bonheur que je poursuivais et qu’aucune jouissance humaine ne pouvait assouvir était une torture éternelle et profonde4.
3Avec un aplomb particulièrement scandaleux pour l’époque, Sand crée une héroïne qui n’hésite pas à révéler les troubles que provoque l’insatisfaction sexuelle. Impuissante et froide, Lélia se désole de ne pouvoir « mêler les jouissances épurées de l’esprit aux jouissances fiévreuses du corps5 ». Mais, ce que révèle également le roman, c’est que la question du plaisir féminin – à l’instar du plaisir masculin – est inhérente à celle, plus précise, du corps.
L’importance du corps dans le romantisme
4François Kerlouégan a prouvé par ses études que le motif du corps devient, sous la monarchie de Juillet, l’un des objets privilégiés de la représentation romanesque6. Violenté, morcelé, exalté, idéalisé, le corps se place désormais au centre des interrogations. À cette question du corps, s’inscrit en creux celle, plus taboue, du plaisir féminin. La jouissance féminine hante particulièrement la sphère médicale – qui cherche à découvrir ses secrets et les moyens de la contrôler – mais aussi les législateurs. En sus d’affirmer la totale incapacité juridique de la femme mariée, la jurisprudence s’attaque en effet directement au corps de la femme mariée : « la femme et ses entrailles sont la propriété de l’homme » lit-on ainsi dans le Code civil napoléonien.
5C’est dans ce contexte qu’il importe de voir quelle est la position du romantisme. En tant que mouvement révolté, les écrivains condamnent avec virulence les atteintes faites au corps de la femme : l’assimilation du mariage à une prostitution légalisée et la violence de la nuit de noces deviennent dans leurs récits de véritables topoï ; en 1836, dans La Confession d’un enfant du siècle, le cynique Desgenais s’insurge en ces termes :
Dans nos villes et selon nos mœurs, la vierge faite pour courir au soleil, pour admirer les lutteurs nus, comme à Lacédémone, pour choisir, pour aimer, on l’enferme, on la verrouille […]. Puis tout d’un coup on la tire de là, ne sachant rien, n’aimant rien, désirant tout ; une vieille l’endoctrine, on lui chuchote un mot obscène à l’oreille, et on la jette dans le lit d’un inconnu qui la viole7.
6La jeune fille est maudite parce que les lois sociales nuisent à son épanouissement ; maintenue dans l’ignorance, sexuellement inexpérimentée, elle est condamnée à vivre avec un « inconnu qui la viole » quand elle devrait jouir de sa liberté (« courir au soleil » et « admirer les lutteurs nus »).
L’ambigüité : la violence émancipatrice
7Toutefois, malgré ces prises de position virulentes, les écrivains romantiques instaurent en même temps – dans le domaine de la représentation – le paradoxe d’une violence masculine émancipatrice.
8Il est important de faire ici une parenthèse et de rappeler avant toute chose que la génération de 1830 est en proie à la désespérance et qu’elle est majoritairement nostalgique des guerres napoléoniennes.
9L’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe, le roi bourgeois, gèle en effet les derniers feux de l’ambition. Pour le jeune homme de 1830, se distinguer est devenu une chose impossible : l’obsession mercantile du nouveau gouvernement juste-milieu étouffe les aspirations idéalistes, et réactive de fait la légende napoléonienne et ses promesses de gloire militaire. La seule possibilité de se distinguer est désormais dans l’amour ; le désir de conquête se déplace et il passe du terrain militaire aux corps féminins car, même si la guerre n’est plus, le jeune homme reste sommé d’être viril et de le prouver. Comme l’a montré Alain Corbin, cette injonction virile propre à l’époque n’est pas sans incidence sur le système des représentations dans le premier xixe siècle ; il note à cet égard que les métaphores guerrières « s’associent étroitement au schème de la domination, de la défaite, de la blessure que subit la femme8 », ajoutant par ailleurs que « cet hymne à la vigueur, ces allusions à la victoire et à la défaite tendent à justifier la violence, fût-elle simulée9 ».
10Certes, les métaphores guerrières ne naissent pas avec le romantisme, et la littérature libertine, notamment, a déjà exploité de telles analogies, mais, désormais, la violence n’est plus systématiquement synonyme de stratégie. Elle peut encore l’être, comme dans Le Rouge et le Noir où Julien fomente toute une stratégie pour posséder Madame de Rênal, ou bien encore, dans Les Caprices de Marianne, lorsqu’Octave cède son rendez-vous galant à son ami Cœlio et qu’il lui dit :
Octave
Attache ce chiffon à ton bras droit, Cœlio ; prends ta guitare et ton épée. – Tu es l’amant de Marianne. […] Tu n’es pas encore parti ? Je te dis que tout est convenu. Une chanson sous la fenêtre ; cache-toi un peu le nez dans ton manteau, afin que les espions du mari ne te reconnaissent pas. Sois sans crainte, afin qu’on te craigne ; et si elle résiste, prouve-lui qu’il est un peu tard10.
11Dans ce passage, Octave, en véritable chef militaire, arrange la « prise » Marianne comme on le ferait d’une place forte ; l’incitation au viol est évidente, et Frank Lestringant n’a d’ailleurs pas manqué de relever le caractère explicite de la menace dans son édition11. Marianne doit cesser ses caprices quitte à être soumise par la force.
12Cependant, la terminologie militaire et la violence peuvent dorénavant servir à prouver la sincérité du personnage : est violent celui qui agit par passion, presque de manière impulsive. Dans La Chartreuse de Parme, par exemple, l’assaut violent de Fabrice n’est pas prémédité ; c’est une impulsion :
Elle était si belle, à demi vêtue et dans cet état d’extrême passion, que Fabrice ne put résister à un mouvement presque involontaire. Aucune résistance ne fut opposée12.
13La vue de Clélia provoque chez Fabrice un désir tel qu’il ne peut y résister ; son « mouvement presque involontaire » trahit son impétuosité et il sous-entend la sincérité de ses sentiments. La jeune femme, ici, n’est plus une proie qu’il faut posséder à tout prix, mais une amante depuis longtemps désirée et aimée sincèrement. Le geste violent – et c’est là une transformation majeure du romantisme – perd toute coloration néfaste : l’outrage, si brutal soit-il, est représenté comme un geste d’amour. Les réactions conjointes de Fabrice et de Clélia prouvent toutefois l’extrême ambivalence de la situation :
Dans l’enthousiasme de passion et de générosité qui suit un bonheur extrême, il lui dit étourdiment :
– Il ne faut pas qu’un indigne mensonge vienne souiller les premiers instants de notre bonheur : sans ton courage je ne serais plus qu’un cadavre, ou je me débattrais contre d’atroces douleurs ; mais j’allais commencer à dîner lorsque tu es entrée, et je n’ai point touché à ces plats.
Fabrice s’étendait sur ces images atroces pour conjurer l’indignation qu’il lisait déjà dans les yeux de Clélia. Elle le regarda quelques instants, combattue par deux sentiments violents et opposés, puis elle se jeta dans ses bras13.
14Si Fabrice tente de faire diversion, c’est parce qu’il a parfaitement conscience de la brutalité de son geste, quand Clélia, de son côté, est médusée par ce qu’il vient de se passer. Incapable de réagir, la jeune femme est en proie au doute : doit-elle remercier Fabrice pour son bonheur ou bien le blâmer pour l’affront qu’il vient de lui faire subir ? Cette réaction de pudeur a posteriori est troublante : se pose-t-elle comme la preuve de la moralité de Clélia ou comme celle de l’acceptation de sa défaite ? Pour le lecteur de 1839, il ne fait pas de doute que la femme doit jouer le jeu de la pudeur offensée (le contraire serait scandaleux et immoral) mais, pour le lecteur contemporain, un tel système de représentation dérange parce qu’il crée une corrélation ambigüe entre la violence masculine et le plaisir féminin.
15Cette nouvelle équation est encore plus évidente lorsque l’on analyse le personnage typique qu’est la mal mariée. Dans cette seconde configuration, l’ambivalence est encore plus prégnante puisqu’il incombe à l’amant de briser – toujours par la violence – le tabou de l’adultère. Ainsi, dans Le Lys dans la vallée, le désir de Madame de Morstauf naît d’un outrage originel :
Mes yeux furent tout à coup frappés par de blanches épaules rebondies sur lesquelles j’aurais voulu pouvoir me rouler, des épaules légèrement rosées qui semblaient rougir comme si elles se trouvaient nues pour la première fois, de pudiques épaules qui avaient une âme, et dont la peau satinée éclatait à la lumière comme un tissu de soie. Ces épaules étaient partagées par une raie, le long de laquelle coula mon regard, plus hardi que ma main. Je me haussai tout palpitant pour voir le corsage et fus complètement fasciné par une gorge chastement couverte d’une gaze, mais dont les globes azurés et d’une rondeur parfaite étaient douillettement couchés dans des flots de dentelle. […] Après m’être assuré que personne ne me voyait, je me plongeai dans ce dos comme un enfant qui se jette dans le sein de sa mère, et je baisai toutes ces épaules en y roulant ma tête14.
16Félix, dans cette scène torride, agresse littéralement Madame de Morstauf, mais la violence de ce baiser volé n’est, une fois de plus, chargée d’aucune connotation négative ; bien au contraire, l’offense permet de réveiller la sensualité de la jeune femme, sensualité qui, jusqu’à l’heure, était engourdie par un mauvais mariage. L’outrage masculin permet à la femme mariée de lui rappeler qu’elle a un corps, et sous-entend même qu’elle a le droit d’en disposer à sa guise. L’agressivité masculine revêt dès lors une dimension altruiste ; elle est un signe de révolte, de contestation de l’ordre établi ; elle semble déclarer que le Code civil se trompe et que la femme peut disposer de ses entrailles comme elle l’entend. En outre, cette violence physique apparaît comme la seule voie possible et honorable pour la femme pudique et mariée : puisqu’elle est passive et qu’elle subit un outrage, sa moralité n’a pas à être remise en cause. L’outrage devient donc, avec le romantisme, un geste ultime de galanterie.
17De fait, c’est « logiquement » après cet assaut que la chaste Madame de Morstauf comprend l’entière nécessité de se réconcilier avec son corps (et a fortiori avec le plaisir). Enflammée par le désir, elle décide de troquer son prénom pour Félix, et d’abandonner pour lui seul le trop éthérée « Blanche » au profit d’« Henriette » : Patrick Berthier a relevé le calembour – d’un goût douteux – transformant la jeune femme en une appétissante terrine (« Henriette » se prononçant comme « en rillettes15 »). Si Félix est ravi de ce privilège, il ne s’en montrera pourtant jamais digne. Ne comprenant pas toute la dimension altruiste que revêt la violence pour la femme mariée, il persiste à maintenir une relation platonique, qui s’avérera particulièrement destructrice pour la jeune femme. Contrainte de rester dans les sphères angéliques de l’âme, Madame de Morstauf agonise en reprochant à Félix de n’avoir pas su l’aimer :
Comme autrefois vous allez me rendre la santé, Félix, dit-elle, et ma vallée me sera bienfaisante. […] Ils croient que ma plus vive douleur est la soif. Oh ! oui, j’ai bien soif, mon ami. […] J’avais soif de toi, me dit-elle d’une voix étouffée en me prenant les mains dans ses mains brûlantes et m’attirant à elle pour me jeter ces paroles à l’oreille : mon agonie a été de ne pas te voir ! Ne m’as-tu pas dit de vivre ? je veux vivre. Je veux monter à cheval aussi, moi ! je veux tout connaître, Paris, les fêtes, les plaisirs16.
18Seule l’agonie permet de passer outre les sentiments de réserve et de pudeur mêlés : au seuil de sa vie, Henriette réclame le droit de disposer de son corps et d’en jouir, mais il est trop tard. Félix, inexpert psychologue de la sexualité de la femme romantique, est condamné à la solitude : « Quand on a sur la conscience de pareils crimes, au moins ne faut-il pas les dire17 » lui dira Natalie, la confidente aimée, dans une élégante et moqueuse lettre de rupture.
La violence, une esthétique
19Si la violence se pose comme une condition nécessaire au plaisir féminin elle est, en outre, une caractéristique esthétique essentielle du romantisme. Désormais, rien n’est plus beau que la volupté agonisante ; sur scène, les morts érotiques se multiplient et les spectateurs eux-mêmes se mettent à rêver d’amours sanglantes et cruelles. Certes, l’association entre Éros et Thanatos n’est pas neuve, mais donner à voir des trépas lascifs, tout en cherchant à rivaliser avec le genre noble de la tragédie, s’avère, en revanche, particulièrement osé. Dans son essai Des Feux dans l’ombre, Sylvain Ledda montre ainsi que la représentation de la mort sur scène constitue un enjeu majeur du romantisme18. C’est le célèbre scandale d’Hernani, où la scène finale du trépas est érotisée à l’extrême en dépit de toute pudeur. Les convulsions de Doña Sol, violentes et sensuelles, heurtent les convenances esthétiques et morales : qu’une femme issue de la grande noblesse puisse se retrouver allongée sur la scène, les cheveux en désordre, à souffrir des spasmes parce qu’elle s’est empoisonnée, résonne comme une provocation. Comme l’a montré Florence Naugrette, « l’irruption du matériel sur la scène tragique19 » semble inconcevable, et le public, pourtant habitué aux outrances du mélodrame, est ici choqué par le mélange des genres ; de plus, la forte présence du corps « heurte la distinction entre genre noble et genre bas20 ». Autant dire qu’avec ce drame, Hugo s’attaque aux grands tabous de l’époque (mélange des genres, représentation de la mort, représentation du plaisir féminin). La douleur physique de son héroïne, métamorphosée en volupté, prend des accents presque religieux ; elle annonce déjà les jouissances maladives de certains personnages décadents et notamment celles de la sainte Lydwine de Schiedam contée par Huysmans.
Conclusion
20Si le mouvement romantique est ambigu, c’est parce qu’il défend les femmes tout en mettant en place un système de représentation trouble, où le plaisir féminin est subordonné à la violence. Cette violence peut certes être une résurgence du libertinage, mais, d’une manière plus troublante, elle devient également, sous la plume des écrivains romantiques, une manière galante d’émanciper la femme et de la libérer des tabous de la pudeur et de l’adultère. La femme peut disposer de son corps et en jouir, mais ce n’est qu’au prix d’une violence originelle. En outre, cette violence s’inscrit désormais dans un combat esthétique et rien ne semble plus beau que l’outrage fait au corps ou la jouissance dans la mort.
1 Lorsque je parle du « plaisir féminin », j’entends le plaisir « du corps ».
2 Georges Gusdorf, L’Homme romantique, Paris, Payot, 1984, p. 225.
3 « Introduction. Pour une histoire globale du romantisme », dans Dictionnaire du Romantisme, dir. Alain Vaillant, Paris, CNRS Éditions, 2012, p. XLVIII.
4 George Sand, Lélia [1833 pour la première édition, 1839 pour la seconde], éd. Pierre Reboul, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2010 [1re édition, 1985], p. 169-170.
5 Ibid., p. 171.
6 François Kerlouégan, Ce fatal excès du désir. Poétique du corps romantique, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernités », vol. 93, 2006, p. 23-25.
7 Alfred de Musset, La Confession d’un enfant du siècle, éd. Sylvain Ledda, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2010, p. 106.
8 Alain Corbin, Histoire de la virilité, tome 2. Le triomphe de la virilité. Le xixe siècle, dir. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’Univers historique », 2011, p. 129.
9 Ibid.
10 Alfred de Musset, Les Caprices de Marianne, éd. Frank Lestringant, Paris, Gallimard, coll. « Folio théâtre », 2001, II, 4, p. 90.
11 Ibid., p. 91, n. 1.
12 Stendhal, La Chartreuse de Parme, éd. Michel Crouzet, Paris, Le Livre de poche, coll. « Les Classiques de Poche », 2006, p. 573.
13 Ibid.
14 Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, éd. Nicole Mozet, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2010, p. 49.
15 Philippe Berthier, « Des rillettes à l’étoile ou les avatars de la sublimation » dans Balzac, Le Lys dans la vallée, « cet orage des choses célestes », études réunies par José-Luis Diaz, Paris, SEDES, 1993, p. 118, n. 4.
16 Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée, op. cit., p. 301.
17 Ibid., p. 331.
18 Sylvain Ledda, Des Feux dans l’ombre ; la représentation de la mort sur la scène romantique (1827-1835), Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2009. Voir la première partie de l’essai, et plus particulièrement les pages 32 à 84.
19 Florence Naugrette, « Préface » à Hugo, Hernani, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2012, p. 21.
20 Ibid.
organisée par Guillaume Cousin et Sophia Mehrbrey à l’Université de Rouen le 18 mai 2016
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 10, 2016
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/242.html.
Quelques mots à propos de : Carole Bourle
Université de Rouen-Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
