Sommaire
Journée des doctorants 2016
organisée par Guillaume Cousin et Sophia Mehrbrey à l’Université de Rouen le 18 mai 2016
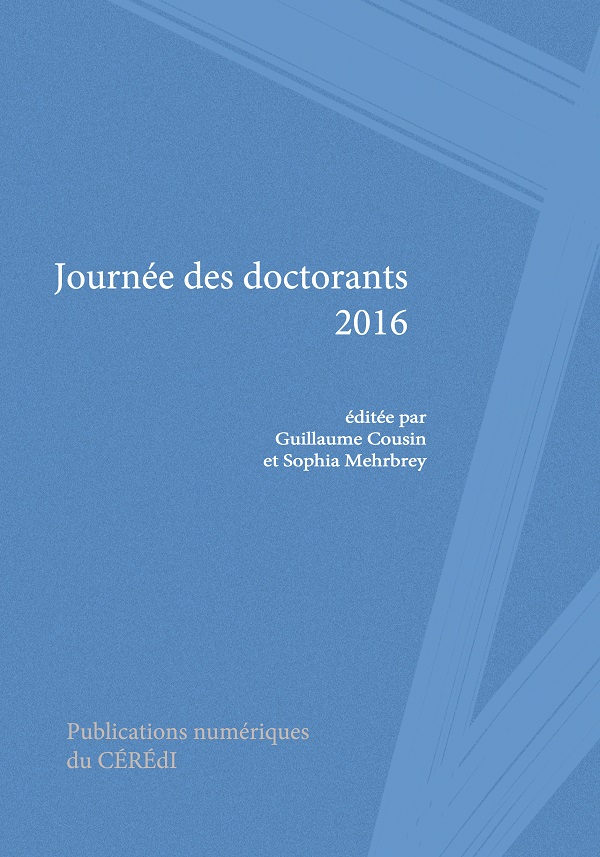
- Stéphane Pouyaud La question du modèle dans la parodie romanesque
- Thibault Vermot Représentations de la femme et poétique fantastique dans les Tales d’Edgar Poe
- Carole Bourle « Quand la violence réveille les sens ». L’ambiguïté de la représentation du plaisir féminin dans le romantisme
- Sophia Mehrbrey « Le moineau trouva son nid ». La sexualité enfantine entre initiation et transgression
- Camille Chollet Carmontelle, un théâtre du dérisoire
Journée des doctorants 2016
Représentations de la femme et poétique fantastique dans les Tales d’Edgar Poe
Thibault Vermot
1Lire et analyser sont deux démarches fréquemment contradictoires ; c’est là un lieu commun qui traverse l’esprit de quiconque prétend adopter la posture universitaire du critique littéraire ; contradictoires, autant que peuvent l’être le plaisir de sentir et le plaisir de raisonner. Edgar Poe parvient à toucher au cœur le lecteur des Tales, malgré un style minutieux, analytique, peu propre a priori aux flottements du rêve. « Le style [chez Poe, écrit Baudelaire] est serré, concaténé ; la mauvaise volonté du lecteur ou sa paresse ne pourront pas passer à travers les mailles de ce réseau tressé par la logique. Toutes les idées, comme des flèches obéissantes, volent au même but1. » Ce « réseau tressé par la logique » dans les Tales de Poe participent à la mise en scène d’une mécanique de l’effroi qui doit conduire à la fascination du lecteur. La blessure est durable ; et seize ans après avoir lu pour la première fois Edgar Poe, j’y retourne comme un insecte attiré par une noire lumière, tour à tour amusé et irrité par la fausse érudition, gêné par les divagations métaphysiques2, énervé par avance de l’atmosphère fin de race qui constamment s’en dégage, mais, me cognant au verre de la lampe fumeuse qu’il allume, irrémédiablement, irrémédiablement fasciné. Et qu’est-ce qui chez Poe peut bien fasciner ? La tentation qu’il a de crypter son récit par le jeu des références et des symboles3 ? Sa propension à fouiller les recoins de cerveaux malades ? Son obsession du double4, qui le pousse à scinder souvent son texte en deux parties, qui se réfléchissent l’une l’autre ainsi que des miroirs – obsession du double qui le pousse à dupliquer ses textes, enfantant Ligeia d’après Morella, Éléonore d’après L’Île de la Fée, Le Cottage Landor « pour faire pendant5 » au Domaine d’Arnheim ? Le lecteur peut se contenter de lire, porté par la machine du texte, de temps à autres saisi par les correspondances obscures qu’il a pressenties ; le chercheur, lui, exhume ces correspondances, les classe, les compare, et voudrait dans cette archéologie élucider la raison de l’effroi.
2On voit tout ce qui se tient d’ironique dans cette démarche d’élucider Poe – c’est-à-dire d’illuminer les ténèbres. Car les Tales résistent – ou, pour reprendre la clôture de L’Homme des foules : « Es lässt sich nicht lesen6 ». Et comme dans Le Portrait ovale, si l’on peut approcher parfois le candélabre de la crypte où se renfonce le moteur secret du texte et le révéler à la lumière fugace de l’esprit, le moindre mouvement7, le moindre changement d’angle plonge à nouveau cette cavité dans l’ombre. « La question du modus operandi n’est pas encore résolue8. » Or, il faut toujours avoir en tête, lorsqu’on lit Poe, que l’écrivain lui-même a théorisé ce modus operandi que l’on nomme ici mécanique de l’effroi, et qu’il en a réduit a posteriori le principe à une idée essentielle : celle de l’effet à produire, dans un texte fameux, The Philosophy of Composition (1846). Quand le lecteur frissonne, l’écrivain, lui, calcule attentivement son effet. Un récit terrifiant comme peut l’être Ligeia, comme peut l’être Bérénice, est composé avec minutie, et peut-être avec la froideur du démiurge qui choisit l’effet à produire au sein d’un panel d’émotions humaines.
Je préfère initier [le processus de création] en envisageant un effet, toujours en gardant en ligne de mire [l’idée] d’originalité – car il se ment à lui-même celui qui s’aventure à laisser de côté un moyen d’intérêt aussi évident et aussi facile à mettre en place. Avant toute chose, je me dis : « Des innombrables effets, ou impressions, que le cœur, l’intellect ou (plus généralement) l’âme est susceptible [de produire], lequel devrais-je, en cette occasion précise, sélectionner9 » ?
3Poe construit donc son œuvre comme une pièce au mécanisme complexe, à l’instar d’un automate qui, lit-on dans Le Joueur d’échecs de Maelzel « prenant son point de départ dans les données de la question à résoudre, continuera ses mouvements régulièrement, progressivement, sans déviation aucune vers la solution demandée10. » Une définition de la fiction, « qui forme précisément l’objet de ce qu’analyse Poe en termes de poetic principle, pourrait se faire dans ces termes, employés par Jean-Claude Beaune quand il caractérisait l’automate comme un objet qui “cache la cause première de son mouvement et fait croire à son organicité11” ».
4Ce qui nous intéresse ici est précisément la cause première du mouvement – la matrice du texte. Dans quelle mesure, dans les Tales d’Edgar Poe, la figure féminine, parce qu’elle cristallise les aspects infamiliers12 du récit, joue-t-elle le rôle de principe caché interne à la diégèse, moteur de l’étonnement ou de l’effroi ? Telle est l’hypothèse que l’on se propose d’examiner ici, dans le cadre de travaux portant sur la littérature fantastique comme miroir vacillant de la Cité, envisageant la puissance allégorique et les résistances aux idéologies dominantes dans les récits fantastiques allemands, français et américains (1797-1891).
5Se proposer de porter l’attention sur la figure féminine dans l’œuvre de Poe semble a priori, là encore, un exercice paradoxal.
Un autre caractère particulier de sa littérature [souligne délicatement Baudelaire] est qu’elle est tout à fait anti-féminine. Je m’explique. Les femmes écrivent, écrivent avec une rapidité débordante ; leur cœur bavarde à la rame. Elles ne connaissent généralement ni l’art, ni la mesure, ni la logique ; leur style traîne et ondoie comme leurs vêtements. Un très grand et très justement illustre écrivain, George Sand elle-même, n’a pas tout à fait, malgré sa supériorité, échappé à cette loi du tempérament ; elle jette ses chefs-d’œuvre à la poste comme des lettres. Ne dit-on pas qu’elle écrit ses livres sur du papier à lettres ? […] J’ai traversé [chez Poe] une longue enfilade de contes sans trouver une histoire d’amour13.
6Sans commenter outre mesure le mépris baudelairien pour ce qu’il nomme « littérature féminine », remarquons simplement que la femme semble ne pas avoir de place privilégiée dans l’œuvre de Poe. C’est aussi le sentiment premier qui nous a mené à envisager le sujet de cette étude – le fait qu’à première lecture, la littérature poesque était une littérature d’abord virile, reléguant la femme à une place subalterne, à l’état de tapisserie au même titre que le décor, lui refusant la dimension de personnage ; et qu’elle n’avait que peu d’utilité au sein des Tales qui nous intéressent. À seconde lecture cependant, ces opinions se sont avérées en partie erronées. Car s’il est vrai qu’assez peu de nouvelles parmi les soixante-six composées par Edgar Poe intègrent la figure féminine, un petit quart d’entre elles (nous en avons retenu quinze14) laissent aux femmes une place essentielle dans la conduite de la narration. Cette idée de place essentielle est à nuancer à son tour, puisque lorsque les femmes apparaissent au détour des nouvelles de Poe, c’est selon le mode de la statue, du spectre, ou de l’absente. « Aussi les paysages qui servent quelquefois de fond à ses fictions fébriles sont-ils pâles comme des fantômes15. » De même au fil des Tales les figures féminines. Leur présence physique au sein du texte, leurs mouvements, leurs paroles, sont le plus souvent réduits au hiératique, au diaphane, voire au fantomatique. Quelques titres de nouvelles contiennent le nom d’une femme16. Quelques autres placent une figure de femme au centre, ou non loin17 ; pour autant, les mots eux-mêmes, woman ou son dérivé juvénile, girl, n’apparaissent que rarement dans la masse textuelle. Oxymore propre au fantastique, le caractère infime du mot est la marque d’une force spectaculaire de la chose, optique ou psychologique. Et par un processus d’inversion des perspectives, le lecteur averti en vient à considérer les paysages et les décors comme le véritable sujet du texte, et le narrateur (le je si paresseusement employé, dit Baudelaire, pointant la propension monotone de Poe à oublier la variation des narrateurs18) comme seul vecteur ou seul guide à travers la succession des paysages, des tableaux. Il suffit de relire La Chute de la Maison Usher ou Le Rendez-vous – ou encore Le Cottage Landor – pour prendre conscience de ce fait : la péripétie n’intéresse jamais Poe, seules comptent la contemplation, la spéculation, la déduction qui procèdent d’un don particulier, une acuité de l’observation. La déambulation, le voyage n’intéressent l’auteur que pour mener son narrateur au point d’intérêt où se développe la tension maximale (Usher, Landor). À cet égard, l’usage systématique que fait Poe de l’expression elliptique at length (traduite « à la longue » par Baudelaire) pour resserrer l’action, est remarquable. L’union des âmes, il ne la traite que comme un élément digne de mépris : « et [lit-on dans Bérénice], dans un mauvais moment, je lui parlai de mariage19. » Les mariages, chez Poe, sont toujours frappés au sceau du malheur, de la dégénérescence (voir également Le Chat noir). Dans Bérénice, l’union a lieu ; mais Poe focalise toute son attention de styliste acéré sur la description des dents de Bérénice, objet de l’obsession ultérieure de son narrateur. La maladie qui frappe la femme aimée n’est toujours qu’un accident lapidaire20 ; c’est l’après, le devenir de la morte, qui intéresse Poe. Jetons seulement un œil à Morella :
Mais elle retourna son visage sur l’oreiller ; un léger tremblement courut sur ses membres, elle mourut, et je n’entendis plus sa voix.
Cependant, comme elle l’avait prédit, son enfant, – auquel en mourant elle avait donné naissance, et qui ne respira qu’après que la mère eut cessé de respirer, – son enfant, une fille, vécut. Et elle grandit étrangement en taille et en intelligence, et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie21.
7La femme chez Poe est d’abord douée d’une typologie (noms, figures) peu variable. Floyd Stovall note en 1925 que
La plupart des femmes de Poe possèdent les mêmes traits d’apparence et de caractère. Il apprécie particulièrement la femme au « visage classique » et aux « cheveux d’hyacinthe », qui apparaissent dans le premier À Hélène et dans deux de ses nouvelles, Le Rendez-vous et Ligeia. Ces traits habituels sont généralement associés à un maintien royal, un front pâli, des yeux clairs et une voix musicale. Les cheveux sont généralement très sombres ou très blonds, et presque toujours frisés. Les femmes de Poe sont soit extrêmement naïves et peu sophistiquées, comme le sont Éléonore et Annabel Lee, ou anormalement réfléchies, ainsi que Ligeia et Morella. Elles sont toutes nobles et bonnes, et naturellement très belles, quoique parfois la maladie les rende horribles, comme on le voit avec Bérénice. Le plus remarquable de tout est leur amour passionné et durable pour leur héros22.
8Cette typologie, peut-on remarquer, fait partie des marqueurs canoniques de l’ambiance poesque23, au même titre que la nuit, la solitude, les paysages plantés d’asphodèles (Éléonore, Bérénice), le motif de l’enfermement, les lourdes tentures ornées d’arabesques. La femme chez Poe a trait à l’Unheimliche freudien, l’atmosphère d’infamiliarité : spectrale et obsessionnelle.
9Elle est d’abord hiératique ; elle a toutes les propriétés de la statue, ou du tableau, et en tant que telle, elle forme, au milieu du diorama, un élément de décor. Les descriptions de Ligeia ou de la marquise Aphrodite forment dans cette perspective de véritables ekphrasis inversées24 :
J’examinais le contour du front haut et pâle, – un front irréprochable, – combien ce mot est froid appliqué à une majesté aussi divine ! – la peau rivalisant avec le plus pur ivoire, la largeur imposante, le calme, la gracieuse proéminence des régions au-dessus des tempes, et puis cette chevelure d’un noir de corbeau, lustrée, luxuriante, naturellement bouclée et démontrant toute la force de l’expression homérique : chevelure d’hyacinthe. […] J’analysais la forme du menton, et, là aussi, je trouvais la grâce dans la largeur, la douceur et la majesté, la plénitude et la spiritualité grecques, ce contour que le dieu Apollon ne révéla qu’en rêve à Cléomènes, fils de Cléomènes d’Athènes ; et puis je regardais dans les grands yeux de Ligeia25.
10Voyons Aphrodite :
Elle reste isolée au milieu des groupes formés à l’entrée du palais. Ses petits pieds nus et argentés se reflètent dans le miroir de marbre noir du perron. Ses cheveux, presque à moitié défaits pour la nuit au sortir de quelque bal, et où scintille encore une pluie de diamants, s’enroulent, se tordent autour de sa tête classique en boucles d’un noir bleuâtre, qui imitent les reflets de l’hyacinthe. Une draperie blanche comme la neige, légère comme la gaze, semble seule couvrir son corps délicat ; mais pas un souffle ne vient animer la lourde atmosphère de cette chaude nuit d’été, ni agiter les plis de la robe vaporeuse qui retombe autour d’elle comme son vêtement de marbre autour de la Niobé antique26 […].
11À huit années d’écart, c’est toujours le classicisme apparent de la figure qui prévaut ; l’Unheimliche est ailleurs – dans une particularité physique, dans les dents27, dans l’œil28. Ligeia :
Les prunelles étaient du noir le plus brillant et surplombées par des cils de jais très-longs ; ses sourcils, d’un dessin légèrement irrégulier, avaient la même couleur ; toutefois, l’étrangeté que je trouvais dans les yeux était indépendante de leur forme, de leur couleur et de leur éclat, et devait décidément être attribuée à l’expression29.
12La marquise Aphrodite :
Pourtant – fascination étrange ! – les grands yeux lumineux de la marquise ne s’abaissent pas sur la tombe qui vient d’engloutir son plus cher espoir : ils sont fixés dans une tout autre direction. […] Ne savons-nous pas que, dans un pareil moment, l’œil humain, semblable à un miroir brisé, multiplie les images de la douleur et contemple en maint endroit lointain la cause d’une angoisse présente30 ?
13Cependant, comme statues ou peintures, leurs mouvements sont nuls ; les femmes chez Poe valent mieux immobiles que vivaces – les illustrateurs de Poe au xxe siècle (Aubrey Beardsley, Harry Clark, Wilfried Satty) ne s’y trompent pas, gravant des scènes hiératiques, où les personnages demeurent figés dans leur emphase. La femme est toujours statique quand elle est produite aux yeux du lecteur ; elle est l’evidence dans toute sa polysémie : preuve, évidence, témoignage, signe, marque. De quoi ? C’est ce que nous allons voir. Le Portrait ovale nous mène à lire l’histoire d’un jeune modèle dont la vie est transmise, peu à peu, dans le portrait qu’en fait son peintre. Ce portrait se trouve dissimulé dans une alcôve, qui nécessite un mouvement particulier du candélabre, porteur de lumière31, pour révéler son charme. « J’avais deviné, déduit le narrateur, que le charme de la peinture était une expression vitale absolument adéquate à la vie elle-même, qui d’abord m’avait fait tressaillir, et finalement m’avait confondu, subjugué, épouvanté32. » Cette idée du vivant transcendé dans le portrait, on la retrouve également à la fin du Rendez-vous, où le narrateur découvre une peinture qui restitue à l’identique la vision de la marquise Aphrodite :
Jamais l’art humain n’a mieux rendu une beauté surhumaine. La vision éthérée qui m’était apparue la nuit précédente sur le perron du palais ducal se dressa de nouveau devant moi. Mais dans l’expression de ce visage, tout resplendissant de sourires, on retrouvait, étrange anomalie ! cette vague tristesse qui est la compagne inséparable de la beauté idéale. Le bras droit était croisé sur la poitrine ; tandis que la main gauche, abaissée, indiquait un vase de forme bizarre. Un de ses petits pieds, le seul qu’on aperçût, semblait à peine effleurer le sol, et derrière elle, presque invisibles dans la brillante atmosphère qui semblait envelopper et diviniser sa beauté, flottaient deux ailes aussi délicates, aussi légères qu’il est possible d’imaginer33.
14La vie quitte le mouvant pour se fondre dans l’immobile ; cette idée de mobile et d’immobile, nous en reparlerons, constituant l’un des pivots du fantastique, de l’infamilier chez Poe. Mais ce qui donne l’illusion du mouvement à ces figures féminines, c’est l’automatisme du texte, construit comme une spirale descendant vers l’idée de mort. Que l’on convoque ici La Chute de la Maison Usher : Madeline, quasi-absente, est le centre textuel autour duquel tourne la construction du récit, mais son retour parmi les vivants n’apparaît qu’en clôture : c’est pourtant lui qui donne tout son sens au récit, qui a préparé ce retour dès les prémisses, par les détours du symbole et de l’analogie. Madeline concentre – comme la majeure partie du personnel féminin dans les Tales – tous les symptômes du spectre : faible présence, absence qui la confine au monde des morts, capacité exceptionnelle à obséder les vivants. Madeline n’apparaît que trois fois dans cette nouvelle, l’une des plus longues que Poe ait écrite ; mais à chaque fois son apparition marque un tournant de la narration, un changement de tableau. À première vue, Madeline n’est qu’une apparition, qui passe sans que le narrateur, stupéfié, puisse la décrire ; cette stupéfaction met en miroir l’homme et la femme, deux mondes irréconciliables puisque celui qui a la parole se voit privé de mots, et tandis que l’une passe, l’autre se fige :
Pendant qu’il parlait, lady Madeline, – c’est ainsi qu’elle se nommait, – passa lentement dans une partie reculée de la chambre, et disparut sans avoir pris garde à ma présence. Je la regardai avec un immense étonnement, où se mêlait quelque terreur ; mais il me sembla impossible de me rendre compte de mes sentiments. Une sensation de stupeur m’oppressait, pendant que mes yeux suivaient ses pas qui s’éloignaient34.
15La seconde apparition, tout en apportant quelques pâles couleurs au gisant, inverse également les états de mobilité :
Le mal qui avait mis au tombeau lady Madeline dans la plénitude de sa jeunesse avait laissé, comme cela arrive ordinairement dans toutes les maladies d’un caractère strictement cataleptique, l’ironie d’une faible coloration sur le sein et sur la face, et sur la lèvre ce sourire équivoque et languissant qui est si terrible dans la mort35.
16La dernière apparition, parodie de résurrection, exploitant le thème obsessionnel chez Poe de l’enterrement vivant, complète les contrastes et donne une taille à la statue macabre de Madeline Usher ; et c’est au moment où cette dernière tombe sur Roderick Usher – qu’elle le touche – que tous deux meurent, car la mort seule peut concilier deux pôles antagonistes, et que doit s’écrouler, pour la parachever, la Maison Usher :
À l’instant même, comme si l’énergie surhumaine de sa parole eût acquis la toute-puissance d’un charme, les vastes et antiques panneaux que désignait Usher entrouvrirent lentement leurs lourdes mâchoires d’ébène. C’était l’œuvre d’un furieux coup de vent ; – mais derrière cette porte se tenait alors la haute figure de lady Madeline Usher, enveloppée de son suaire. Il y avait du sang sur ses vêtements blancs, et toute sa personne amaigrie portait les traces évidentes de quelque horrible lutte. Pendant un moment, elle resta tremblante et vacillante sur le seuil ; – puis, avec un cri plaintif et profond, elle tomba lourdement en avant sur son frère, et, dans sa violente et définitive agonie, elle l’entraîna à terre, – cadavre maintenant et victime de ses terreurs anticipées36.
17Le demeurant du texte décrit une arabesque mortelle – celle de la Chute – tournoyant tout autour de Madeline, quoique son nom soit rarement cité (six fois), et quoique sa présence physique ne soit que peu attestée. L’architecture (« À part cet indice d’un vaste délabrement, l’édifice ne donnait aucun symptôme de fragilité. Peut-être l’œil d’un observateur minutieux aurait-il découvert une fissure à peine visible, qui, partant du toit de la façade, se frayait une route en zigzag à travers le mur et allait se perdre dans les eaux funestes de l’étang37 »), la prédiction (« Je sens, affirme Roderick Usher au narrateur qui lui rend visite, que tôt ou tard le moment viendra où la vie et la raison m’abandonneront à la fois, dans quelque lutte inégale avec le sinistre fantôme, – LA PEUR38 ! »), la peinture (« C’était un petit tableau représentant l’intérieur d’une cave ou d’un souterrain immensément long, rectangulaire, avec des murs bas, polis, blancs, sans aucun ornement, sans aucune interruption. Certains détails accessoires de la composition servaient à faire comprendre que cette galerie se trouvait à une profondeur excessive au-dessous de la surface de la terre. On n’apercevait aucune issue dans son immense parcours39 »), la musique (la rapsodie du Palais hanté), les lectures de Roderick Usher40 (« Il faisait néanmoins ses principales délices de la lecture d’un in-quarto gothique excessivement rare et curieux, – le manuel d’une église oubliée, – les Vigiliæ Mortuorum secundum Chorum Ecclesiæ Maguntinæ41. »), la lecture finale du Mad Trist de Sir Launcelot Canning42 (« la porte de l’ermite enfoncée, et le râle du dragon, et le retentissement du bouclier ! – Dites plutôt le bruit de sa bière, et le grincement des gonds de fer de sa prison, et son affreuse lutte dans le vestibule de cuivre43 ? »), tout un jeu d’analogies44 concourent à épaissir l’atmosphère, et à faire se lézarder la raison, à précipiter la folie – pour produire finalement aux yeux du lecteur Madeline, dont le nom même porte en lui la racine de la folie : Mad-. Sa présence psychique baigne la nouvelle ; et dans cette perspective, il n’est pas difficile d’affirmer que Madeline en est la matrice, porteuse de l’idée de mort et de chute. Comme mode de lecture, le motif de l’arabesque, étudié par la critique anglo-saxonne, peut faire système chez Poe, dès lors que l’on considère l’écrivain auteur de la Philosophy of Composition comme un écrivain à système.
L’étude de Rae Gordon, « Interior Decoration in Poe and Gilman », met l’accent sur le lien entre l’arabesque, la folie et le mouvement de l’écriture dans « Ligeia » et « Berenice » (Gordon, 1991, 85-93), tandis que dans « Poe’s Arabesque », Patricia Smith montre que, dans les contes, l’arabesque a le plus souvent partie liée à un mouvement de dissolution et l’arrivée imminente de la mort (Smith, 1974, 45)45.
18L’axe de cette arabesque, dans les nouvelles qui nous intéressent ici, est systématiquement la figure de la femme, son apparition. Le portrait de la jeune femme, dans Le Portrait ovale, est le centre de cercles concentriques se réduisant peu à peu vers l’ovale du cadre et celui du visage46. Le Cottage Landor peut être lu comme une promenade au travers de paysages ordonnés de manière à sertir le cottage lui-même – lequel cottage renferme comme un joyau précieux la fugace et quasi-spectrale Annie :
Comme je n’apercevais pas de cloche, je frappai avec ma canne contre la porte, qui était à moitié ouverte. Immédiatement une personne s’avança vers le seuil, – une jeune femme de vingt-huit ans environ, – élancée ou plutôt légère, et d’une taille un peu au-dessous de la moyenne. Comme elle s’approchait, avec une démarche à la fois modeste et décidée, absolument indescriptible, je me dis en moi-même : « J’ai sûrement trouvé ici la perfection de la grâce naturelle, en antithèse avec l’artificielle. » La seconde impression qu’elle produisit sur moi, et qui fut de beaucoup la plus vive des deux, fut une impression d’enthousiasme. […] Les yeux d’Annie (j’entendis quelqu’un qui de l’intérieur appelait sa « chère Annie ») étaient d’un gris céleste [spiritual grey] ; sa chevelure, d’un blond châtain ; ce fut tout ce que j’eus le temps d’observer en elle47.
19Au sein des textes à paysages de Poe48, L’Île de la fée (1841) présente un autre exemple de ces fascinantes femmes-arabesques dont le mouvement hypnotise et mène à la nuit, au no more :
Et de nouveau le petit bateau apparut, avec la Fée ; mais dans son attitude il y avait plus de souci et d’indécision, et moins d’élastique allégresse. Elle navigua de nouveau de la lumière vers l’obscurité, – qui s’approfondissait à chaque minute, – et de nouveau son ombre, se détachant, tomba dans l’ébène liquide et fut absorbée par les ténèbres. – Et plusieurs fois encore elle fit le circuit de l’île, – pendant que le soleil se précipitait vers son lit, – et, à chaque fois qu’elle émergeait dans la lumière, il y avait plus de chagrin dans sa personne, et elle devenait plus faible, et plus abattue, et plus indistincte ; et, à chaque fois qu’elle passait dans l’obscurité, il se détachait d’elle un spectre plus obscur qui était submergé par une ombre plus noire. Mais à la fin, quand le soleil eut totalement disparu, la Fée, maintenant pur fantôme d’elle-même, entra avec son bateau, pauvre inconsolable ! dans la région du fleuve d’ébène, – et, si elle en sortit jamais, je ne puis le dire, – car les ténèbres tombèrent sur toutes choses, et je ne vis plus son enchanteresse figure [and I beheld her magical figure no more]49.
20Puissance intellectuelle immense (Ligeia, Morella) ou son exact inverse, naïveté originelle (Éléonore, l’Annie du Cottage Landor, Bérénice, « sylphe des bocages d’Arnheim50 »), ascendant psychologique hypnotique sur le narrateur – et sur le lecteur –, sont des traits constants de la figure féminine chez Poe. Mais sa faculté anti-génitrice retient particulièrement notre attention ici. La femme, matrice du texte, n’est pas destinée à perpétuer la race. Quand elle enfante, c’est pour le pire : le suicide chez Aphrodite, la réincarnation du double pour Morella. Ligeia, Morella, Éléonore, Bérénice, Madeline Usher, la marquise Aphrodite sont les témoins d’anciennes générations, qui finissent avec elles. « Et maintenant, pendant que j’écris, il me revient, comme une lueur, que je n’ai jamais su le nom de famille de celle qui fut mon amie et ma fiancée, qui devint mon compagnon d’études, et enfin l’épouse de mon cœur51 », peut-on lire de Ligeia. D’Éléonore : « J’ai perdu ma mère de bonne heure ; elle avait une sœur, – une seule ; – celle que j’ai aimée dans ma jeunesse, et dont ma plume retrace aujourd’hui le souvenir avec calme et clarté, était la fille unique de cette sœur52. » Elles refusent l’idée de descendance, la pervertissent, la contaminent. Morella se réincarne, ainsi qu’une succube, dans sa fille, et, morte, son nom clôt pourtant de manière glaçante le récit (procédé repris dans Ligeia) : « Mais [mon enfant] mourut, et, de mes propres mains je la portai à sa tombe, et je ris d’un amer et long rire, quand, dans le caveau où je déposai la seconde, je ne découvris aucune trace de la première – Morella53. » Si les femmes meurent – et chez Poe elles sont vouées nécessairement à une mort qui clôt la première partie des récits –, c’est pour mieux hanter le texte de leur présence (Morella, Ligeia, Éléonore) et de leurs restes (Bérénice). Engendrer, pour la femme poesque, c’est engendrer le Vide, souvent symbolisé par une érudition immense et stérile (puisque sans praxis), ou c’est engendrer le Même.
Finalement, ces récits d’amour sont histoires de vampires et de revenantes : la femme aimée, objet d’une observation constante et méticuleuse de la part du narrateur en même temps qu’il se nourrit de son savoir, est vampirisée et fait retour dans la réalité pour hanter celui par qui elle est morte. Mais ces histoires sont aussi récits mélancoliques d’un amour impossible et destiné, au moment même où il apparaît, à finir dans la mort54.
21Nous avons évoqué tout à l’heure la propension de Poe à faire des femmes qui peuplent ses récits des statues, des tableaux, à les fondre dans le décor ; nous avons évoqué sa tendance à faire du paysage, du décor, des protagonistes du récit, dans la mesure où le narrateur joue avant tout le rôle de cicerone du lecteur au milieu de la ruine qui s’annonce, et que l’atmosphère prend sur les personnages un inquiétant ascendant. Le texte s’agrège autour de la figure féminine, comme le médaillon d’un camée, et enferme narrateur et lecteur dans la même spirale qui le mène vers la fin – celle de la parole, de l’écriture, symbolisée par la page blanche.
Le récit poesque […] a pour finalité […] son achèvement représenté la plupart du temps dans une scène mortuaire symbolique ou réelle, signifiant la mort du récit et la plongée du lecteur dans le silence d’une page dont la blancheur […] renvoie à la vision de la Totalité de l’être universel55.
22Et cette fin du texte, très souvent, renvoie à son ouverture ; Ligeia s’achève sur le nom de Ligeia ; Morella sur celui de Morella. Les extérieurs poesques sont trompeurs, et renvoient toujours à l’enfermement, à l’intériorité. Le narrateur est un prisonnier ; le lecteur, agrippé au je quasi-systématique, le suit dans le mouvement de la chute. Et dans une certaine mesure, la littérature poesque nous conduit hors du sens, et hors du monde.
23Comme esprit porté à la spéculation, de telles conclusions comblent mon désir de sens. Invoquer, par exemple, l’épanadiplose, permettant de considérer le texte poesque comme une boucle infinie – ou interroger le sens même d’épanadiplose, qui contient l’idée de retour du double (« διπλόος »), sont des artefacts critiques, des opérations de l’esprit, qui exhument et synthétisent un sens véritable du récit. Mais comme homme vivant dans le monde, cette conclusion que la littérature poesque nous entraîne hors du sens et du monde ne tarde pas à engendrer en moi un mouvement de bascule, qui me porte à soulever l’utilité d’une telle littérature, le sens que l’on peut donner à un tel arrachement du monde des vivants.
24« Du sein d’un monde goulu, affamé de matérialités, Poe s’est élancé dans les rêves [nous dit Baudelaire]. [Il est l’] auteur qui, dans le Colloque entre Monos et Una, lâche à torrents son mépris et son dégoût sur la démocratie, le progrès et la civilisation56. » Étouffé qu’il était par l’atmosphère américaine, il a écrit en tête d’Eureka : « J’offre ce livre à ceux qui ont mis leur foi dans les rêves comme dans les seules réalités57 ! » Dans un moment où en Amérique coïncident idéologie matérialiste, expérience de la démocratie et fondation d’une littérature nationale, que nous disent de la Cité, en en distordant la vision, les immatérielles et singulières femmes-fantômes de Poe ? Objet esthétisé, ayant part lié au motif arabesque, la femme poesque est le symbole immuable et obsédant d’un réel empreint de la faiblesse des maladies, qui a part liée avec le surnaturel, la nostalgie, la mort et le retour d’entre les morts – topoï fantastiques, assurément. Mais la descente dans le Maëlstrom qu’elle provoque n’est-elle pas aussi le symptôme d’un monde qui ne peut se résoudre à la seule raison historique du Progrès ? « Le récit poesque, nous dit Montandon, [est une] narration de la métamorphose de l’histoire en eschatologie58 ». Cette dimension de fin du monde est abordée explicitement dans Conversation d’Eiros avec Charmion (1839), où deux âmes – féminines ou féminisées par la Mort – exposent à travers leur conversation comment une comète a déjoué toutes les projections scientifiques pour détruire la Terre. Au fur et à mesure qu’alternent discours de Science et prédictions religieuses, la comète approche, inexorable :
Mais, relativement à l’agent immédiat de la ruine, la pensée humaine était en défaut depuis l’époque où la science astronomique avait dépouillé les comètes de leur effrayant caractère incendiaire. La très médiocre densité de ces corps avait été bien démontrée. […] Comme par un soudain effort convulsif, la raison avait d’un seul coup culbuté la superstition de son trône. […] Et toute la masse d’éther environnante, au sein de laquelle nous vivions, éclata d’un seul coup en une espèce de flamme intense, dont la merveilleuse clarté et la chaleur dévorante n’ont pas de nom, même parmi les Anges dans le haut Ciel de la science pure. Ainsi finirent toutes choses [Thus ended all]59.
25Le discours scientifique finit par s’adapter au phénomène. « Quel devait être le résultat d’une totale extraction de l’azote ? Une combustion irrésistible, dévorante, toute-puissante, immédiate60 ». Mais leur coïncidence est le signe de l’apocalypse, et ce qui l’emporte est finalement l’idée incommensurable du Vide : « Ainsi finirent toutes choses. » La science comme raison de l’histoire serait-elle impuissante par essence à envisager sa fin ? Rappelons ces paroles tirées du Colloque entre Monos et Una, en guise d’« avertissement clair » : « la science n’était pas bonne pour l’homme pendant la minorité de son âme61. »
26Il est remarquable d’ailleurs, tant qu’à évoquer l’idée de finalité, que la femme savante poesque, qui possède à un haut degré l’érudition, correspond en tout point à la définition de l’être raisonnable donnée par Kant dans les Fondements de la métaphysique des mœurs lorsqu’il définit le règne des fins – mais inverse. Soit l’être raisonnable, « un être pleinement indépendant, sans besoin, et avec un pouvoir qui est sans restriction, adéquat à sa volonté62. » Telles semblent Ligeia ou Morella – mais leur pouvoir est mû par une folie vertigineuse qui les pousse à se redoubler en autrui, non par la raison. « La morale, dit encore Kant, considère le règne possible des fins comme un règne de la nature63 ». La finalité de Ligeia ou de Morella, qui choisissent la régénération en lieu et place de la génération, apparaît dans la perspective kantienne hautement anti-naturelle. Il n’est pas fantaisiste de prendre comme point d’appui antagoniste Kant pour l’opposer à Poe dès lors que l’on considère, à l’exemple de Gwenhaël Ponnau, que le fantastique « apparaît […] comme la réponse singulière et exemplaire de l’imaginaire aux efforts de rationalisation qui caractérisent l’idéologie du progrès64. »
27Un dernier texte, la Philosophie de l’ameublement, nous permet d’aborder plus précisément le motif de la femme-arabesque et sa signification politique. Après avoir dénoncé dans un premier temps le mauvais goût de ses contemporains, l’auteur entreprend de meubler dans un second temps une pièce idéale. Les Tales que nous étudions ici construisent toujours autour de la figure féminine de tels décors où vient s’abîmer ou se reposer le narrateur. Les couleurs sont sobres et se répondent harmonieusement pour plonger la chambre dans une atmosphère pourprée ; les arabesques du papier-peint font écho à celles du tapis ; sur les murs, les tableaux alternent entre représentations paysagères (« les Grottes des fées, de Stanfield, ou l’Étang lugubre, de Chapman65 ») et portraits de femmes, tandis qu’un seul miroir est accroché, mais il est positionné de telle sorte qu’il ne risque de refléter aucun des occupants de la pièce à moins de se tenir juste devant lui. « On a souvent vu, stipule Thomas Constantinesco, dans cette perfection quasi immobile, ce calme rassurant, un contrepoint aux contes de terreur où chambres et salons sont des lieux d’angoisse et de mort66. » Jacob Berman, cependant, insiste sur l’ambivalence caractéristique de l’arabesque qui, motif statique d’un intérieur bourgeois, fait pourtant signe vers le mouvant et le menaçant :
L’arabesque déstabilise la sécurité de la maison par sa proximité avec le primitif et le monstrueux. Le choix de meubles européens qui accompagne l’appartement paradigmatique de Poe, s’accompagne de motifs arabesques, et du paysage des Grottes des Fées de Stanfield. Déduisons donc que la menace d’une terreur domestique est contenue dans cette scène de tranquillité domestique, dès lors que l’arabesque et les Grottes forment une menace latente au sein de l’atmosphère de calme et de méditation que les éléments cosmopolites de l’ameublement tentent de former67.
28« En fin de compte, la philosophie de l’ameublement s’apparente donc à une mimésis non-mimétique [sic] où la projection de soi dans l’espace domestique ne ramène pas à l’identité, mais ouvre sur le vertige de la différence68. » Dans cette perspective, alliée à la représentation de grottes et de plans d’eau lugubres, l’arabesque apparaît comme le signe privilégié de l’infamilier, puisqu’elle introduit une disruption instable au sein d’un milieu stable. Les plans d’eau ou les miroirs, les symboles de l’acuité visuelle, les lieux de réclusion encyclopédiques où s’amassent avec « des magnificences plus que royales69 » tapis, tentures, livres et portraits, sont toujours présents dans les Tales – où la femme enclenche le mouvement arabesque, circulaire et descendant, vers la folie et la mort : dans La Chute de la Maison Usher, dans Éléonore, dans Le Rendez-vous, dans Le Portrait ovale, dans Ligeia, dans Bérénice. La femme poesque est dans cette perspective une figure aristocratique du refus – refus de la raison et de l’utile, refus de l’histoire et de sa conséquence démocratique, refus de la nature – et signe de renversement du progrès.
1 Charles Baudelaire, Œuvres posthumes, Paris, Mercure de France, 1908, p. 235.
2 Daniel Grojnowski indique entre autres : « J’ai demandé à un bon spécialiste d’histoire de la “philosophie”, Patrick Hochart, de considérer les nombreuses références qui figurent dans “Morella”. Après les avoir élucidées une à une, il conclut qu’“il n’y a sans doute pas lieu de trop les débrouiller”. » (« Faire rêver le lecteur. Saturation et indétermination dans quelques nouvelles d’Edgar Poe : Bérénice, Morella, Ligeia, Eléonora » dans Littérature, no 108, 1997. p. 6).
3 Citons là encore cette formule de Daniel Grojnowski, particulièrement synthétique : « Par l’importance que Poe accorde explicitement aux composantes spéculatives, il surcharge ses récits de valeur exemplaire. Par toutes sortes de stratagèmes que mettent en œuvre les paratextes, les références, la typographie, les leitmotive, les jeux d’échos, de symétrie ou d’opposition, il « donne à penser » à son lecteur sans que celui-ci puisse dite précisément quoi. Car il invente, dans une société puritaine qui affectionne les apologues édifiants, un type de récit dont les signes se refusent à livrer un sens clair. […] Les narrateurs des récits de Poe font naître la suspicion. » (Ibid., p. 10).
4 Obsession qui contrevient à la manière d’écrire un article à la Blackwood (novembre 1838) : « Ne dites pas un mot de l’Infernale Dualité. » (E. A. Poe, Comment écrire un article à la Blackwood, dans Derniers contes, trad. Félix Rabbe, Paris, Albert Savine, 1887, p. 114).
5 Le Cottage Landor, pour faire pendant au Domaine d’Arnheim est la traduction choisie par Baudelaire du titre original de Poe : Landor’s Cottage, A pendant to ‘The Domain of Arnheim’.
6 « Le pire cœur du monde est un livre plus rebutant que le Hortulus animæ, et peut-être est-ce une des grandes miséricordes de Dieu que es lässt sich nicht lesen, – qu’il ne se laisse pas lire. » (E. A. Poe, L’Homme des foules, dans Nouvelles histoires extraordinaires, trad. Charles Baudelaire, Paris, Quantin, 1884, p. 64).
7 « Mais l’action produisit un effet absolument inattendu. Les rayons des nombreuses bougies (car il y en avait beaucoup) tombèrent alors sur une niche de la chambre que l’une des colonnes du lit avait jusque-là couverte d’une ombre profonde. J’aperçus dans une vive lumière une peinture qui m’avait d’abord échappé. C’était le portrait d’une jeune fille déjà mûrissante et presque femme. » (E. A. Poe, Le Portrait ovale, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 274).
8 Incipit du Joueur d’échecs de Maelzel (dans Histoires grotesques et sérieuses, trad. Charles Baudelaire, Paris, Michel Lévy frères, 1871, p. 112).
9 Le texte original est le suivant : « I prefer commencing with the consideration of an effect. Keeping originality always in view – for he is false to himself who ventures to dispense with so obvious and so easily attainable a source of interest – I say to myself, in the first place, “Of the innumerable effects, or impressions, of which the heart, the intellect, or (more generally) the soul is susceptible, what one shall I, on the present occasion, select?” » Cette nuance de sélection, Baudelaire la laisse un peu de côté dans sa traduction de 1846, en rejetant le select (processus de désignation) de Poe au milieu des compléments, et en le traduisant par choisir, moins concret (processus de pesée) : « […] parmi les innombrables effets ou impressions que le cœur, l’intelligence ou, pour parler plus généralement, l’âme est susceptible de recevoir, quel est l’unique effet que je dois choisir dans le cas présent ? » (E. A. Poe, Méthode de composition, dans Histoires grotesques et sérieuses, éd. citée, p. 346).
10 Extrait du Joueur d’échecs de Maelzel (dans Histoires grotesques et sérieuses, éd. citée, p. 119). Cet automate est la machine à calculer de Babbage qui, fonctionnant à vapeur, est « une mécanique de bois et de métal qui non seulement peut computer les tables astronomiques et nautiques jusqu’à n’importe quel point donné, mais encore confirmer la certitude mathématique de ses opérations par la faculté de corriger les erreurs possibles » et « imprime matériellement les résultats de ses calculs compliqués, aussitôt qu’ils sont obtenus, et sans la plus légère intervention de l’intelligence humaine » (ibid., p. 118).
11 Mireille Ruppli et Sylvie Thorel-Cailleteau, Mallarmé, La Grammaire et le grimoire, Genève, Droz, 2005, p. 25-26.
12 Ce que Freud nomme Unheimlich et la critique anglo-saxonne uncanny.
13 Charles Baudelaire, L’Art romantique, éd. L. J. Austin, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1968, p. 142.
14 Morella (1835), Bérénice (1835), Ligeia (1838), La Chute de la Maison Usher (1839), Conversation d’Eiros avec Charmion (1839), Colloque entre Monos et Una (1841), L’Île de la fée (1841), Éléonore (1841), Le Portrait ovale (1842), Le Mystère de Marie Roget (1842-43), Le Chat noir (1843), Les Lunettes (1844), La Caisse oblongue (1844), Le Rendez-vous (1845), Le Cottage Landor (1849).
15 Charles Baudelaire, Œuvres posthumes, éd. citée, p. 236.
16 Morella, Bérénice, Ligeia, Colloque entre Monos et Una, Éléonore, Le Mystère de Marie Roget.
17 La Chute de la Maison Usher, L’Île de la fée, Le Portrait ovale, Le Chat noir, La Caisse oblongue, Le Cottage Landor.
18 « Il abuse du je avec une cynique monotonie. » (Charles Baudelaire, Œuvres posthumes, éd. citée, p. 234).
19 E. A. Poe, L’Homme des foules, dans op. cit., p. 79.
20 Parmi d’autres, La Caisse oblongue (1844) produit l’une de ces morts exemplaires : « […] elle était tout à coup tombée malade et elle mourut. » (E. A. Poe, La Caisse oblongue, dans Contes grotesques, trad. Émile Hennequin, Paris, Ollendorf, 1882, p. 151).
21 E. A. Poe, Morella, dans Histoires extraordinaires, trad. Charles Baudelaire, Paris, Michel Lévy frères, 1869, p. 394.
22 Floyd Stovall, « The women of Poe’s poems and tales » dans Studies in English, no 5, Austin, University of Texas Press, 1925, p. 197.
23 « C’est sur le même patron, en effet, que, de 1835 à 1845, il écrit tour à tour “Bérénice” (1835, deuxième version en 1845), “Morella” (1835), “Ligeia” (1838) et “Éléonora” (1842), des récits qu’il appelle, selon les cas, “a tale” ou “a fable” (3). Dans chacun d’eux un homme relate sa relation avec une femme que la mort lui ravit, sans que cette relation soit pour autant abrogée. Car la défunte – qui dans tous les cas donne son titre au récit – se manifeste chaque fois, après sa disparition, comme une médiatrice du mystère de l’être ou de l’au-delà. » (Daniel Grojnowski, art. cité, p. 5).
24 L’ekphrasis étant la description vivace d’une œuvre d’art, décrire des êtres humains comme s’ils étaient des œuvres d’art figées pourrait constituer une inversion de l’ekphrasis.
25 Ligeia, dans Baltimore American Museum, Baltimore, septembre 1838 (Ligeia, dans Histoires extraordinaires, trad. Charles Baudelaire, Paris, Michel Lévy frères, 1856, p. 402).
26 The Assignation, dans Broadway Journal, New York, juin 1845 (E.A. Poe, Le Rendez-vous, dans Contes inédits, trad. de l’anglais (USA) par W. Little Hughes, Paris, Hetzel, 1862, p. 4).
27 Voir Bérénice : « Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans pupilles, et involontairement je détournai ma vue de leur fixité vitreuse pour contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s’ouvrirent, et dans un sourire singulièrement significatif les dents de la nouvelle Bérénice se révélèrent lentement à ma vue. Plût à Dieu que je ne les eusse jamais regardées, ou que, les ayant regardées, je fusse mort ! » (E. A. Poe, Bérénice, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 80. Poe souligne ici).
28 Hors corpus choisi, quant à la prééminence d’un fantastique généré par l’œil chez Poe, une nouvelle particulièrement éloquente à ce sujet, sans parler des comiques Lunettes (1844), est Le Sphinx (1846), où la vision effrayante d’un monstre ailé est déterminée par l’acuité de vision du narrateur posté près d’un vitrage. On se rapportera aussi à Frédéric Yvan, « La femme, l’amour, la mort et l’effraction du cadre chez Poe », Savoirs et clinique, 2008/1, no 9, p. 57.
29 E. A. Poe, Ligeia, éd. citée, p. 403.
30 E. A. Poe, Le Rendez-vous, éd. citée, p. 5.
31 Osons : lucifer. La lumière, comme dans Le Cœur révélateur (1843), joue le rôle troublant du déclencheur de l’émotion infamilière – un signe de la déchéance. Fermer les yeux, dans le Portrait, est ce qui mène le narrateur à la déduction des causes de son trouble – hors de la lumière.
32 E. A. Poe, Le Portrait ovale, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 275. Poe souligne.
33 E. A. Poe, Le Rendez-vous, éd. citée, p. 19-20. Nous soulignons ici.
34 E. A. Poe, La Chute de la Maison Usher, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 93. Nous soulignons ici.
35 Ibid., p. 100-101. Nous soulignons ici.
36 Ibid., p. 108. Nous soulignons ici.
37 Ibid., p. 89.
38 Ibid., p. 92.
39 Ibid., p. 95.
40 Quant à l’importance de la référence livresque au cœur des Tales de Poe : « Les nouvelles qu’E. Poe consacre aux figures de la Femme peuvent être lues sous des jours différents. Dans tous les cas, elles se présentent comme des récits spéculatifs portant sur la permanence de l’être. […] Ces questions se posent sur le mode aigu, à la fois lancinantes et insolubles, elles relèvent d’une métaphysique ordinaire. Inscrites dans la lettre de chaque nouvelle, elles la constituent en récit hanté par la maîtrise d’un sens que détiennent les livres. Sous les avatars divers de la bibliothèque, de la citation ou de la propagation d’un texte dans l’histoire, se manifeste la suprématie des savoirs que le Livre réserve à des initiés. Le Livre apparaît tantôt sous forme de référent privilégié, tantôt sous forme de citation, tantôt encore il se transfère dans le récit qu’on lit. » (Daniel Grojnowski, op. cit., p. 5-6).
41 E. A. Poe, La Chute de la Maison Usher, éd. citée, p. 99 ; soit : Les Gardiens des Morts, selon l’usage des Églises de Mayence. Madeline Usher est enterrée vivante dans une crypte.
42 Sir Launcelot Canning est une invention d’Edgar Poe, issu à la fois du William Canynge de Chatterton, tiré des Rowley Poems, et du chevalier des légendes arthuriennes. Quelques vers attribués à Sir Launcelot Canning furent utilisés postérieurement par Poe dans un prospectus de 1843 (La Chute de la Maison Usher a paru en septembre 1839) au sujet du magazine qu’il projetait d’éditer, The Stylus. Ces vers avaient été composés par Poe lui-même.
43 E. A. Poe, La Chute de la Maison Usher, éd. citée, p. 107.
44 Citons là encore Daniel Grojnowski : « [Poe] se plaît, par ailleurs, à établir entre [l]es informations des relations (échos, redites, parallélismes, oppositions) qui en balisent le parcours. Les descriptions de lieux, les caractérisations des personnages, donnent à voir et à savoir, comme si les composantes de la fiction se doublaient de significations disséminées » (op. cit., p. 8).
45 Thomas Constantinesco, « Edgar Allan Poe et les meubles de la philosophie », Transatlantica, 1/2013, mis en ligne le 14 février 2014, consulté le 14 mai 2016, http://transatlantica.revues.org/6370. Rae Beth Gordon, « Interior Decoration in Poe and Gilman », Literature, Interpretation, Theory, no 3, Gordon and Breach Science Publishers S. A., 1991, p. 85-99. Patricia C. Smith, « Poe’s Arabesque », Poe Studies 7, no 2, Baltimore, Edgar Allan Poe Society of Baltimore, décembre 1974, p. 42-45.
46 « Ce portrait est en effet encadré par tout un dispositif architectural et narratif. D’un point de vue architectural, le portrait, bordé d’un cadre de goût moresque, se trouve dans une niche derrière un lit à rideaux, dans la chambre d’un appartement situé dans une tourelle à l’écart du bâtiment. Ces lieux sont autant de cadres ou de boîtes enchâssant le portrait […]. Et ce sont tous ces cadres que le narrateur traverse pour accéder au portrait. » (Frédéric Yvan, art. cité, p. 59).
47 E. A. Poe, Le Cottage Landor, dans Histoires grotesques et sérieuses, éd. citée, p. 315. Poe souligne.
48 Comptons Éléonore (1841), L’Île de la fée (1841) et Le Cottage Landor (1849).
49 E. A. Poe, L’Île de la fée, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 271.
50 E. A. Poe, Bérénice, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 75.
51 E. A. Poe, Ligeia, dans Histoires extraordinaires, éd. citée, p. 400.
52 E. A. Poe, Éléonore, dans Contes inédits, éd. citée, p. 25.
53 E. A. Poe, Morella, dans Histoires extraordinaires, éd. citée, p. 398.
54 Frédéric Yvan, art. cité, p. 58.
55 Alain Montandon, « Le point final d’Edgar Poe » dans Le Point final, actes du colloque international de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1984, Fascicule 20, p. 101-102.
56 Charles Baudelaire, « Notes nouvelles sur Edgar Poe », dans E. A. Poe, Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. III.
57 E. A. Poe, Eureka, trad. Charles Baudelaire, Paris, Michel Lévy frères, 1848, p. VI.
58 Ibid.
59 E. A. Poe, Conversation d’Eiros avec Charmion, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 254.
60 Ibid., p. 253.
61 E. A. Poe, Colloque entre Monos et Una, dans Nouvelles histoires extraordinaires, éd. citée, p. 237.
62 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 2e section, trad. Victor Delbos, Paris, Vrin, 2002.
63 Ibid.
64 Gwenhaël Ponnau, La Folie dans la littérature fantastique, Paris, PUF, 1997, p. III.
65 E. A. Poe, Philosophie de l’ameublement, dans Histoires grotesques et sérieuses, éd. citée, p. 331.
66 Thomas Constantinesco, art. cité, p. 10.
67 Jacob Rama Berman, « Domestic Terror and Poe’s Arabesque Interior » dans ESC: English Studies in Canada, 31, no 1, mars 2005, p. 137.
68 Thomas Constantinesco, art. cité, p. 15.
69 E. A. Poe, Ligeia, éd. citée, p. 411.
organisée par Guillaume Cousin et Sophia Mehrbrey à l’Université de Rouen le 18 mai 2016
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 10, 2016
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/241.html.
Quelques mots à propos de : Thibault Vermot
Université de Rouen-Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
