Sommaire
L’Œuvre inclassable
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2015, publiés par Marianne Bouchardon et Michèle Guéret-Laferté
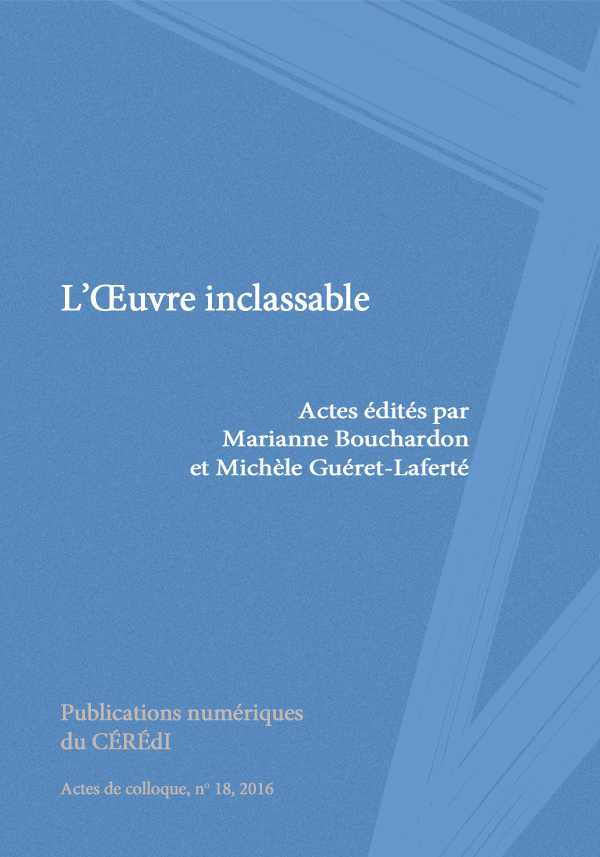
- Introduction
- Jean-Louis Jeannelle L’unique et la série : comment classer l’inclassable ?
- Penser / Classer le Moyen Âge
- Laurence Mathey-Maille Le Roman de Brut de Wace : une œuvre inclassable ?
- Françoise Laurent Hagiographie, historiographie : comment classer la Vie de saint Thomas Becket de Guernes de Pont-Sainte-Maxence ?
- Inclassables classiques
- Gérard Milhe Poutingon Les romans de Rabelais, « choses non encore veues »
- Laurence Macé L’Ingénu ou la tentation du roman ?
- Les œuvres monstres
- Marguerite Mouton L’épopée, genre littéraire de l’absolu ?
- Florence Naugrette Comment lire William Shakespeare de Victor Hugo ?
- Casser les classes
- Aurélie Briquet Œuvres inclassables et refus de classer chez les symbolistes
- Thierry Roger La table de dissection : penser / classer le « texte surréaliste »
- Robert Kahn Déclasser les « Aphorismes de Zürau »
- Lucie Bertrand-Luthereau De l’œuvre inclassable à un nouveau genre pour classer : le cas du « récit concentrationnaire »
Les œuvres monstres
L’épopée, genre littéraire de l’absolu ?
Marguerite Mouton
1Peut-on concevoir une classe de chefs-d’œuvre inclassables ? L’histoire littéraire a retenu comme « épopées » des œuvres radicalement inédites et qui se sont avérées inégalables, aussi bien le Mahabhârata et le Râmâyana indiens, L’Épopée de Gilgamesh, que l’Iliade et l’Odyssée, l’Énéide ou La Chanson de Roland, voire le Paradis perdu de Milton ou le Kalevala finnois. Plus récemment, des œuvres au vaste déploiement sont en lice pour inscrire leur nom dans cette liste prestigieuse : il en est ainsi de recueils comme La Légende des siècles, mais aussi de cycles romanesques comme La Guerre et la Paix ou Les Misérables, voire de certaines productions de la littérature de l’imaginaire aux xxe et xxie siècles.
2Pour mettre de l’ordre dans un genre dont la cohérence ne va pas de soi, on a souvent recours à la distinction entre l’épopée et l’épique, entre le genre et le registre, dont l’attribution est moins contraignante. Cependant, même parmi les seules « épopées » canoniques, quel rapport entre l’Iliade et l’Odyssée, entre la Henriade, les textes indiens et finnois ?
3D’autre part, depuis les années 1930, des philologues, linguistes, anthropologues et ethnologues ont élargi le corpus des œuvres réclamant le nom d’épopée par la découverte de pratiques épiques encore actuellement vivantes. En effet, dans certaines parties des Balkans, de l’Europe de l’Est ou de l’Afrique, des performances orales réunissent une communauté de personnes autour d’un barde ou d’un griot qui récite ce qu’il est convenu d’appeler épopée.
4Dès lors, la question n’est plus la distinction entre l’épique et l’épopée : il semble bien plutôt qu’il n’y ait guère deux œuvres épiques qui se ressemblent par moitié. Comment comprendre la cohérence d’un genre à laquelle la tradition ou les traditions attribuent des œuvres ayant si peu de liens thématiques ou formels entre elles ? Après avoir examiné en quoi l’épopée se présente comme un genre littéraire problématique, on tentera une analyse du fonctionnement de ce genre littéraire à la lumière de la notion d’absolu héritée du romantisme.
L’épopée, un genre littéraire problématique
5D’abord, les épopées, œuvres complexes, présentent un défi aux approches génériques traditionnelles. L’entreprise de définition des genres a revêtu historiquement trois formes principales, si l’on reprend l’analyse de Jean-Marie Schaeffer. Il s’agit de la définition normative-prescriptive (d’Aristote aux xviie-xviiie siècles), de la conception essentialiste-historiciste (autour de Hegel), et enfin de la tendance descriptive-analytique, qui est globalement la modalité actuelle1.
6Or, chacune de ces approches a eu un rapport problématique avec l’épopée : la surenchère dans l’établissement de normes du genre a progressivement étouffé la production à l’époque classique parce que l’idéal apparaissait comme inaccessible2 ; plus tard, le développement de l’historicisme a conduit à proclamer l’incompatibilité de l’épopée avec l’époque plus récente au titre qu’elle ne correspondrait pas à la mentalité moderne ; enfin, pour une approche descriptive-analytique, il est devenu impossible de déterminer les critères communs de l’épopée à partir d’œuvres aussi variées du point de vue des formes, des thèmes et des tonalités concernées (de la poésie versifiée à la prose, du pouvoir politique aux intrigues familiales, de l’individuel au collectif, de la description au registre tragique). Une telle difficulté est amplifiée par le fait que les œuvres inventent souvent un dispositif souple et ouvert original, lié à une oralité réelle ou construite, plus ou moins consciemment associée à ce type d’œuvre ; et ce sans que l’on puisse pour autant en faire un critère systématique du genre.
7Enfin, on a pu dire que ces œuvres produisent leur propre lignée interprétative. L’étude de l’épopée a été inaugurée par Aristote, qui inscrit d’emblée son analyse sous l’égide des chefs-d’œuvre homériques, auxquels il identifie le genre. Si Aristote part ainsi d’un chef-d’œuvre et instaure un modèle théorique du genre pour la postérité, Auerbach développe cette tendance : il met en parallèle l’œuvre homérique et les récits bibliques pour définir deux modèles épiques d’herméneutique et de représentation du réel contradictoires3. Ce faisant, d’une part il érige l’épopée en genre fondateur de lignées de visions du monde ; d’autre part, il fait coexister au sein d’un même genre deux modèles de compréhension du monde, deux traditions d’interprétation opposées.
8Certes, les difficultés soulevées par la question générique ne sont pas propres à la théorisation de l’épopée et elles ont, on le sait, conduit tout un pan de la critique littéraire à rejeter ces classifications en genres. Cependant, l’épopée semble amplifier les problèmes de définition typiques des genres littéraires et la sophistication des débats autour du genre épique lui confère une place privilégiée au sein des remises en cause de la notion même de genre littéraire.
9Depuis les penseurs du romantisme comme le Victor Hugo de la « Préface » de 1826 aux Odes et Ballades, jusqu’aux « textualistes », aux théoriciens des années 1960, le genre littéraire apparaît en effet comme une notion controversée. Le premier argument généralement invoqué est nominaliste : les termes génériques sont vides, déconnectés de la réalité des œuvres concrètes, la réalité n’étant constituée que de phénomènes singuliers. Le second argument, paradoxalement, met en avant un absolu du beau et du vrai, de l’œuvre d’art, microcosme qui renvoie à la totalité de la littérature.
10D’un côté, des critiques comme Blanchot, Barthes ou Kristeva insistent sur la clôture du signifiant et l’autotélie du texte littéraire, refusant qu’il soit (je cite Barthes) « pris dans une hiérarchie ni même un simple découpage des genres4 ». Cependant, ils érigent le texte en un absolu assimilé à la littérature toute entière, qui, comme le dit Michel Foucault, « rompt avec toute définition de “genres” […], et devient pure et simple manifestation [de] l’essence de toute littérature5 ».
11Or, cette conception du texte le déconnecte du réel, du rapport avec l’extérieur. Dominique Combe remarque ainsi qu’« [e]n assimilant le “texte moderne” (Barthes)6 […] au tout de la “Littérature”, qui ne connaît plus ni divisions, ni distinctions, ces théories font de la “Littérature” une exigence totalement détachée […] de toute visée référentielle7 ». Or les distinctions génériques ont toujours une fonction pragmatique, une destination extérieure, hétéronome8.
12Entre une aspiration à l’absolu littéraire et un nominalisme difficiles à tenir ensemble, l’outil générique se présente au contraire comme une médiation qui permet à l’œuvre de ne pas s’abîmer dans un isolement idéaliste et au lecteur de pouvoir l’approcher avec une certaine compétence préalable9. Le genre littéraire a donc en effet à voir avec un lien au réel, et d’abord aux conditions de réception du texte.
13Or, il s’agit là d’un aspect fondamental de l’épopée telle qu’elle apparaît aux chercheurs contemporains, avec la variété et la vitalité d’un genre transmis oralement, donc souple et mobile et qui façonne directement la société réunie sous forme de petites communautés pendant la performance épique. Plus largement, Florence Goyet a étudié cette dimension performative du genre épique et a ainsi identifié une « fonction » fondamentale de l’épopée, désignée sous le nom de « travail épique10 ». L’expression renvoie à la dynamique d’œuvres qui, métaphorisant à travers une narration guerrière les crises traversées par la société qui leur est contemporaine, en problématisent les données et explorent des solutions possibles. Du fait de l’ampleur de la réception des plus « grandes » épopées auprès d’un vaste public, ainsi que du caractère oral de celles-ci, qui en favorise l’appropriation, les œuvres épiques contribuent à faire apparaître une nouveauté politique. Dès lors, comment concevoir un genre constitué d’œuvres aussi polymorphes, mais dont la destination est extérieure, en direction du monde réel, et qui par-là relèvent éminemment d’une dimension générique, d’un genre en tant que celui-ci a une fonction pragmatique ?
14Si l’on considère sa tendance à l’insertion dans des cycles toujours plus vastes, à l’adoption d’une structure épisodique favorisant l’allongement indéfini, à la multiplicité des manuscrits, des réécritures, des exégèses, si l’on prend en compte également ses modes d’appropriation par le public, l’épopée semble présenter trois principes : celui d’une certaine performativité, celui de l’explosion exponentielle de l’œuvre (à la fois dans son dispositif d’édition et dans sa réception) et celui de sa capacité à produire sa propre lignée interprétative, voire à inverser le rapport à ses prédécesseurs – au sens où Judith Schlanger analyse le « précurseur11 » en littérature comme celui qui est premier historiquement, mais qui passe à l’arrière-plan dans la temporalité propre à l’interprétation et n’existe que de manière relative à l’œuvre plus récente. Cette théorie permet d’approcher une réalité de la réception, celle de l’impression particulière produite par des œuvres qui donnent au lecteur le sentiment que l’histoire littéraire s’organise autour d’elles.
15Notre hypothèse ici est que ces trois phénomènes (performativité, explosion exponentielle et production de sa propre lignée interprétative) constituent la manière propre que l’épopée a de prendre sa position de chef-d’œuvre. L’histoire de l’épopée aurait ceci de particulier qu’elle consisterait en une chaîne de « chefs-d’œuvre » répondant à cette description. Il devient alors complexe de penser un genre susceptible de contenir plusieurs œuvres ayant ce fonctionnement exponentiel, polarisant, transformant, qui devrait logiquement tendre à faire éclater tout cadre préexistant pour proposer un modèle original. Or, ce serait précisément cette chaîne paradoxale que l’on appelle genre de l’épopée. Pour que celui-ci puisse être cohérent, il est nécessaire de pouvoir concevoir une suite bien particulière, qui refuse la définition par isolement de critères et la représentation linéaire, mais tient dans autre chose. En effet, si les œuvres qualifiées d’épopées tendent à déborder de tout cadre, à imposer une nouveauté radicale dans l’histoire littéraire voire dans le monde, comment concevoir un genre cohérent qui les réunisse ?
La notion d’absolu comme outil de critique littéraire
16Dans William Shakespeare, Victor Hugo propose d’identifier la particularité du chef-d’œuvre (que l’on comparera ici au fonctionnement de l’épopée) en termes d’« absolu » : « Les chefs-d’œuvre ont un niveau, le même pour tous, l’absolu12. » À condition de la discuter et de la préciser, cette notion mise en avant par les romantiques offre un outil utile pour cerner le paradoxe du genre épique.
17Elle présente pour notre propos plusieurs avantages. Elle permet ainsi d’exprimer la capacité de ces œuvres à poser et imposer un nouveau modèle, qui transforme et réorganise l’espace littéraire. En cela, elle réalise une forme analogique de travail épique, pour reprendre la formule de Florence Goyet. Cette puissance esthétique est en effet la face proprement littéraire du fonctionnement général de l’épopée dans le monde. La notion d’absolu implique également une tension vers l’extrême, une intensité croissante qui informe l’épopée au niveau des moyens littéraires, par exemple du style ou de la construction dramatique.
18Une telle description suppose de distinguer soigneusement une conception dynamique de l’absolu d’une perspective immobiliste. L’idée selon laquelle il s’agirait d’un idéal figé ou sclérosé est largement répandue et, sous une forme positive, trouve un écho dans la description qu’en fait Hugo : « Une fois l’absolu atteint, tout est dit. Cela ne se dépasse plus. L’œil n’a qu’une quantité d’éblouissement possible13. » Victor Hugo envisage ici « l’absolu », notion qui permet pour lui d’identifier le chef-d’œuvre, comme une sorte de plafond, ou du moins de « sommet » ou de « cime ». L’auteur développe en effet l’image de l’ascension d’une montagne au début du deuxième chapitre du livre II de William Shakespeare intitulé « Les Génies ». Le modèle de ces sommets serait alors Homère, que tout « génie » est appelé à rejoindre : « [c]elui qui arrive au sommet est ton égal, Homère », puisque « [l]’art suprême est la région des Égaux14 ».
19Ce maximum, cet achèvement est un sommet d’intensité, que l’image scientifique de l’ébullition vient compléter d’une valeur chiffrée maximale : « Comme l’eau qui, chauffée à cent degrés, n’est plus capable d’augmentation calorique et ne peut s’élever plus haut, la pensée humaine atteint dans certains hommes sa complète intensité15. » Le chef-d’œuvre, dont Homère est l’archétype, serait donc une totalité close, un « monde » qui « dur[e] à jamais », dans une sorte de figement, dans la mesure où « [l]a beauté de l’art, c’est de n’être pas susceptible de perfectionnement16 ».
20Dans ces passages de William Shakespeare, l’objet de Victor Hugo est d’opposer le mode de fonctionnement de la science, toujours en progrès, à celui de l’art, constitué de sommets indépassables, afin de mettre au jour une « région » des « génies ». La nécessité pour lui d’exclure un progrès « intrinsèque » de l’histoire de l’art le conduit à donner une image immobiliste de ces grandes œuvres.
21La forme dynamique des œuvres qualifiées d’« épopées », leur perpétuel débordement, invite au contraire à repenser cet « absolu » qui les caractériserait, en se gardant de tout mimétisme par rapport au discours de Victor Hugo. En effet, il ne s’agit plus d’un achèvement idéal et figé, tandis que seule la science serait en prise sur un réel mobile et changeant ; il s’agit de la réalisation continuée, à travers les lectures multiples, d’une puissance esthétique plutôt que d’une beauté inerte.
22Il est alors possible de réinterpréter le motif de l’éblouissement auquel Hugo recourt pour exprimer le « niveau » de ces chefs-d’œuvre : « L’œil n’a qu’une quantité d’éblouissement possible. » L’image porte en effet les sèmes de cette vitalité, de cette dynamique intensive et de ce pouvoir d’accroissement indéfini, bien qu’elle attire l’attention sur la capacité limitée des récepteurs. La difficulté est alors la tendance évidente à assimiler notre conception de l’œuvre à ce que nous sommes à-mêmes d’en percevoir à un moment donné et ainsi, tout en en reconnaissant la valeur artistique, à la limiter et à la figer.
23Emprunter la notion d’absolu au romantisme nécessite un examen rigoureux, pour évaluer dans quelle mesure le recours à une théorie « romantique17 » peut être utile au critique littéraire actuel. L’étude du débat qui s’élève autour de la question des genres a montré la résistance de la notion d’absolu dans la conception de la littérature à l’époque moderne. L’appréhender directement permet ainsi de la redéfinir, d’en adapter les contenus et d’en évaluer les transformations, plutôt que d’en retrouver involontairement le principe sous d’autres dénominations.
24En effet, si, dans les années 1960, les objections à la notion de genre portaient sur son incapacité à prendre en considération à la fois l’universel de la littérature et la singularité de l’œuvre, l’épopée, entendue comme un genre de l’absolu, apporte pour sa part une réponse à ces contestations. Elle offre un moyen de réfléchir au fonctionnement particulier d’une œuvre qui, dans une dynamique continuelle, déborde tous les cadres et implique à la fois une originalité radicale et une capacité à réorganiser l’ensemble du champ littéraire. De plus, on l’a vu, la notion de genre a toujours une destination hétéronome ; elle permet la mise en rapport de l’œuvre avec ce qui lui est extérieur : son contexte, son lecteur, le monde. Concevoir un genre capable d’accueillir un absolu dynamique ainsi défini offre alors un angle d’approche pour penser le lien des œuvres avec le réel, à travers leur puissance esthétique.
25En effet, si l’absolu est dynamisme, tension, intensité croissante, il est aussi, et par-là même, puissance d’action. C’est ce que manifeste l’étymologie du terme, remontant au latin absolvere18. Le mot est donc au départ issu d’un verbe, dont il n’existe pas d’équivalent en français19 : si le nom « absolu » s’est figé, il faisait à l’origine signe vers une puissance de transformation du réel. La substantivation met l’accent sur la possibilité d’une réalité dont l’intégrité, l’achèvement au sens d’une plénitude non pas tant immobile que dynamique, lui confère en retour cette puissance du verbe d’origine.
26Il convient également de noter la déclinaison adjectivale du terme « absolu », qui complique cette interprétation : issue du latin absolutus, « achevé », elle semble contredire le dynamisme partagé par le nom et le verbe, tandis que sa forme grammaticale d’adjectif, d’« ajout » (adjectivum ˂nomen˃), réintroduit une notion de dépendance à l’égard d’un nom autre. Or, c’est précisément cette tension entre une vitalité intensive et une relativité jamais totalement dépassée qui est au cœur du genre de l’épopée.
27L’œuvre épique se présente en effet avant tout comme un nom, partageant ce caractère substantival de l’absolu : elle apparaît comme un chef-d’œuvre capable d’imposer son identité propre, de s’ériger en un modèle de compréhension et de réalisation d’autres compositions, et de réorganiser l’histoire littéraire autour de lui. Toutefois, la dimension adjectivale de l’absolu éclaire à son tour la production épique, notamment celle des xixe et xxe siècles et les tensions qui la traversent, entre l’éclatement de l’épopée en un registre parmi d’autres et la résistance holistique du genre. Plus fondamentalement, si ce dernier peut accueillir ces contradictions, c’est en vertu de son dynamisme et de sa fonction : l’absolu entendu comme verbe participe à l’opération de transformation et à la performativité de l’épopée.
Conclusion. Le genre épique et la littérature : le « degré » absolu
28Absolue comme nom, comme adjectif et comme verbe, l’épopée constitue enfin un « degré absolu » du fonctionnement de la littérature. En effet, ses fonctions (« grammaticales » – nom, adjectif, verbe) ne sont-elles pas celles de toute œuvre littéraire, qui est à la fois chef-d’œuvre, registre et action ? Néanmoins, l’épopée en présente une réalisation particulièrement intense de par l’ampleur de ses productions, les paradoxes de son histoire récente et sa tradition d’une diffusion à la fois auprès d’un public large et selon un mode participatif20.
29Enfin, si l’œuvre épique constitue ainsi un degré absolu du fonctionnement d’autres œuvres littéraires, le genre littéraire de l’épopée lui-même relève le défi de l’absolu posé à la théorie générique. Il tient en effet l’équilibre entre l’ensemble de la littérature et la particularité irréductible du texte, illustrant un absolu littéraire qui ne se dissout pas dans l’abstraction, mais reste éminemment en prise sur le réel, agissant directement pour sa transformation.
30Par rapport à l’ensemble de la littérature, l’épopée entretient alors une différence de degré et non de nature. Cette conception de l’absolu de l’épopée comme un degré prévient en effet à la fois une idéalisation et un totalitarisme du genre, l’absolu ne résidant pas dans l’immobilité d’œuvres géniales figées et inaccessibles, mais dans le débordement jamais épuisé, dans le constant mouvement.
31L’enjeu de cette réflexion sur l’épopée n’est donc pas seulement de savoir où classer le livre-monstre épique, mais de redéfinir le chef-d’œuvre non comme une autorité définitive et sclérosante, mais comme une création continuée, réconciliant sur la page du livre ou sur les lèvres du conteur la singularité et l’universel, comme le lieu où la créativité littéraire permet de tutoyer l’absolu.
1 Selon Schaeffer, ces types de définitions étaient déjà présents chez Aristote, mais se sont ensuite séparés, formant trois approches successives. Voir Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Paris, Éditions du Seuil, 1989, p. 7-63.
2 Voir Siegbert Himmelsbach, L’Épopée ou la « case vide » : la réflexion poétologique sur l’épopée nationale en France, Tübingen, M. Niemeyer, 1988.
3 Voir Erich Auerbach, Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], trad. Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1992. Pour Auerbach, là où Homère a tendance à tout rendre explicite, de sorte que le sens est toujours déjà interprété et de manière systématique, la tradition biblique ne donne au contraire jamais plus de connaissances de l’arrière-plan ou d’explications qu’il n’est absolument nécessaire pour le développement dramatique des scènes, le sens restant crypté et requérant l’interprétation.
4 Roland Barthes, Œuvres complètes, éd. Éric Marty, Paris, Éditions du Seuil, 1994, vol. 2, p. 1212.
5 Michel Foucault, Les Mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, p. 313.
6 D’Artaud ou de Bataille par exemple.
7 Dominique Combe, « Modernité et refus des genres » dans L’Éclatement des genres au xxe siècle, dir. Marc Dambre et Monique Gosselin-Noat, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2001, p. 57.
8 Sur cette question, voir par exemple Daniel Mortier dans l’introduction aux études qu’il a réunies, Les Grands Genres littéraires, Paris, Honoré Champion, 2001.
9 Voir le collectif Le Savoir des genres, dir. Raphaël Baroni et Marielle Macé, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
10 Voir Florence Goyet, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, Paris, Honoré Champion, 2006.
11 Judith Schlanger, « Le Précurseur » dans Le Temps des œuvres. Mémoire et préfiguration, dir. Jacques Neefs, Paris, Presses Universitaires de Vincennes, 2001, p. 13-26. Cette possibilité d’une réversibilité du temps est étudiée dès 1966 par Gérard Genette, pour qui la « source » peut être « en aval » et « l’influence de Kafka sur Cervantès n’est pas moindre que l’influence de Cervantès sur Kafka » (Figures I, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p. 131). Cette question a été reprise plus récemment par Pierre Bayard (Le Plagiat par anticipation, Paris, Éditions de Minuit, 2009).
12 William Shakespeare, I, III, 3, dans Œuvres complètes, éd. Jacques Seebacher et Guy Rosa, vol. « Critique », Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1985, p. 295.
13 Ibid.
14 Ibid., p. 263-264.
15 Ibid., p. 263.
16 Ibid., p. 294-295.
17 L’intérêt du romantisme pour l’« absolu littéraire » est synthétisé et illustré de textes théoriques de l’époque dans L’Absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand, dir. Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, Paris, Éditions du Seuil, 1978.
18 « Dans ses deux sens bien distincts : délier, dégager, affranchir d’une part, et de l’autre achever, rendre parfait » (André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1999, vol. 1, p. 7.)
19 Le néologisme « absolutiser », largement péjoratif, ne répond pas à cette lacune, n’ayant pas le même sens.
20 Ce degré « superlatif » de l’épopée par rapport aux autres genres rejoint l’analyse du « travail épique » développée par Florence Goyet, qui considère celui-ci comme « une potentialité forte de la littérature » (Florence Goyet, Penser sans concepts : fonction de l’épopée guerrière, op. cit., p. 569) et non une « exclusivité du genre », quoique l’épopée soit « probablement le genre qui porte cette potentialité au plus haut point de perfection » (Florence Goyet, L’Épopée, en ligne sur http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/goyet.html, juin 2009).
Actes du colloque organisé à l’Université de Rouen en novembre 2015, publiés par Marianne Bouchardon et Michèle Guéret-Laferté
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 18, 2016
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/232.html.
Quelques mots à propos de : Marguerite Mouton
Université de Cergy-Pontoise
