Sommaire
La Place Royale, Le Menteur, La Suite du Menteur de Pierre Corneille
sous la direction de Yohann Deguin et Bénédicte Louvat
Numéro spécial « Agrégation 2025 – Lettres modernes » no 3, 2024.
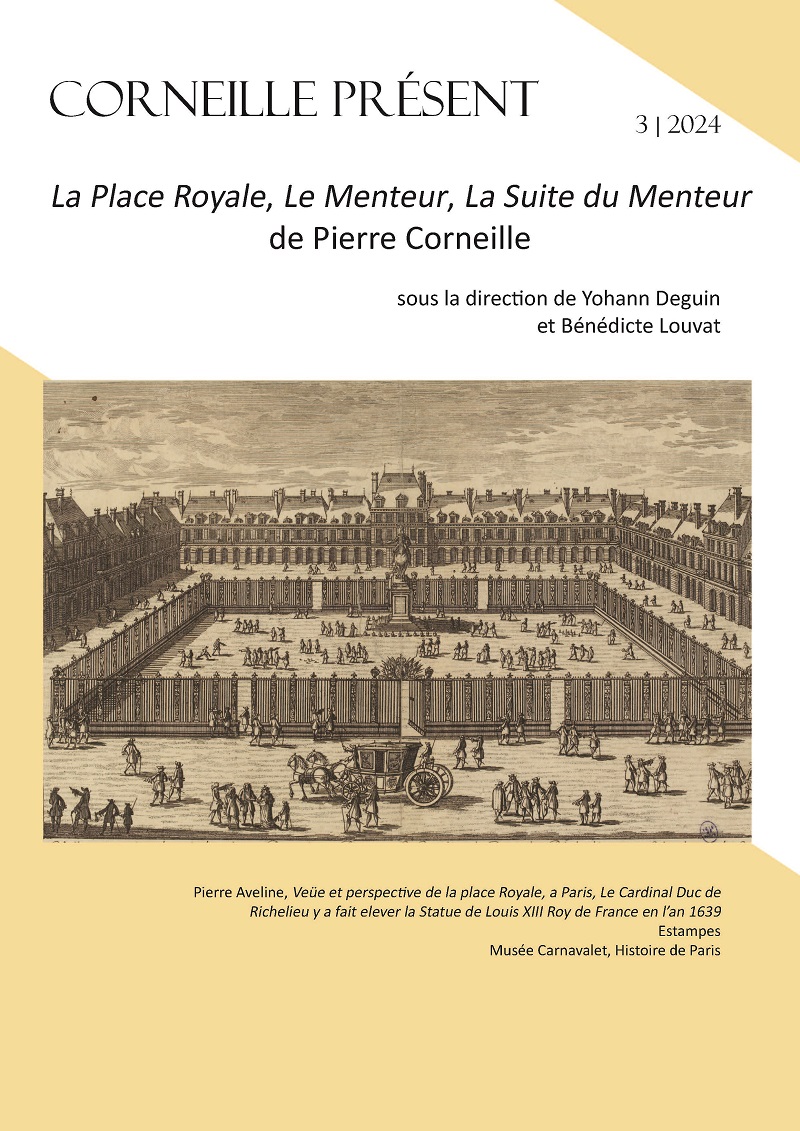
- Bénédicte Louvat et Yohann Deguin Introduction
- Liliane Picciola La distanciation à l’espagnole revisitée par Corneille
- Marc Douguet Le personnage de Cléandre dans La Suite du Menteur
- Marc Escola Finir la comédie. Les dénouements de La Place Royale et du Menteur
- Bénédicte Louvat La Suite du Menteur, vraie suite du Menteur ?
- Lauriane Maisonneuve L’éloquence du style naïf : quand la tirade comique se fait rhétorique
- Florence Dumora Mensonge, quiproquo, change et équivoque dans trois comédies de Corneille
- Sylvain Garnier L’emploi des stances et autres vers lyriques dans La Place Royale, Le Menteur et La Suite du Menteur de Corneille
- Marine Roussillon Une lecture politique des comédies de Corneille est-elle possible ?
La Place Royale, Le Menteur, La Suite du Menteur de Pierre Corneille
Mensonge, quiproquo, change et équivoque dans trois comédies de Corneille
Florence Dumora
Un trompeur en moi trouve un trompeur et demi1
1Le mensonge est au cœur des comédies de Corneille, les menteurs y sont partout : leur auteur l’a écrit lui-même, l’intrigue des pièces est fondée sur un ensemble de fourbes, feintes, mécomptes et méprises. Le mensonge est proche parent de l’illusion, cet autre paradigme de la comédie cornélienne. Comme celle-ci dans L’Illusion comique, il se trouve élevé à la dignité du titre dans le diptyque du Menteur et de La Suite du Menteur, créé par Corneille à partir de deux comédies d’Alarcón et de Lope de Vega2. La Place Royale de 1634, antérieure à cette veine de la comedia espagnole, ne se justifie pas seulement par l’arbitraire relatif d’un programme d’agrégation, mais par ses affinités avec Le Menteur, du fait de son dénouement et du rôle qu’y jouent, tout près du mensonge, le quiproquo et ce qu’on appelait alors « le change ».
2Tenter de donner une place à Corneille dans l’histoire du mensonge entre Montaigne d’un côté, Pascal, La Rochefoucauld et les moralistes de l’autre, c’est quitter le garde-fou de la poétique pour postuler l’intérêt des comédies dans une histoire qui excède et englobe l’histoire du théâtre. Mais dans le cadre même de cette dernière, il s’agit de contester l’opposition à propos du mensonge au théâtre entre « un certain confort cognitif accordé au spectateur » du théâtre classique3 et l’inconfort supposé du spectateur du théâtre de Beckett : dans le cas de La Place Royale et du Menteur en tout cas, le confort cognitif du spectateur ou du lecteur de Corneille laisse quelque peu à désirer.
3Les commentateurs traditionnels sont dubitatifs sur l’apport des œuvres à une telle réflexion. Georges Couton s’interroge : « quelles révélations sur le mensonge pourrions-nous en attendre ? », après Péguy qui affirmait en 1948, à propos du « noble jeu » de la pièce : « Et il est merveilleux de constater que Le Menteur n’est pas la comédie du Menteur, ni du menteur, ni du mensonge. » Octave Nadal énonce une hypothèse paradoxale, mais qu’il évince rapidement : « Faudrait-il toujours supposer ce mensonge à soi dans les actes nobles, désintéressés ? Le tremplin de ce théâtre sublime serait-il le mensonge4 ? » Pour d’autres raisons, Louis Marin, auteur d’une brève étude du Menteur à l’occasion de la mise en scène d’Alain Françon en 1986, juge inutile, voire ridicule de proposer une lecture du Menteur, du fait de son sens « foisonnant, ou plutôt instable ou métastable5 ». Plus largement, la critique cornélienne récente, forte des résultats incontestables de l’approche poéticienne fondée sur l’appareil théorique de l’œuvre (Épîtres liminaires, Examens et Discours), tend à intimider les pulsions herméneutiques.
4On tiendra cependant le pari que la constellation remarquablement riche du mensonge dans les trois pièces n’est pas sans lien avec cette inquiétude dont Corneille soutient qu’elle joue dans les comédies le rôle que joue le péril dans la tragédie.
Mensonge et quiproquo
5Les « menteries » et les « fourberies » des personnages font les « intriques » de la comédie depuis Mélite, en embrouillent le nœud, comme le fait la « violence dans les alliances » dans la tragédie.
6Dans La Place Royale et dans Le Menteur, la fourbe se combine avec la méprise : l’imbroglio comique tient à la combinaison de deux types de fausseté : d’un côté, la fausseté délibérée du mensonge, de l’autre, l’erreur involontaire du quiproquo.
7Fourbe et quiproquo peuvent avoir des effets distincts sur l’action : dans La Place Royale ou l’amoureux extravagant, Alidor, pour se débarrasser « d’un amour qui l’attache trop6 », détourne volontairement vers la parfaite Angélique, par le biais de son valet, une fausse lettre de déclaration à une autre femme, puis, après l’échec de cette première ruse, et toujours dans le but de jeter Angélique dans les bras de son ami Cléandre, substitue la signature de Cléandre au bas de la promesse de mariage ; à cette double fourbe fait suite, dans la nuit et à la faveur d’un jeu de portes, la substitution à Angélique de son amie Phylis lors de l’enlèvement prévu par les deux complices : l’interversion involontaire des femmes correspond à l’échange calculé des signatures. Cette combinaison de la fourbe et du quiproquo a pour effet de faire éclater le mensonge7, et inversement de révéler la justesse inattendue du quiproquo, en transformant l’enlèvement en un ravissement du ravisseur : Cléandre, quittant l’amour d’Angélique pour celui de Phylis qu’il a enlevée, souligne avec insistance la conversion amoureuse liée à ce tour de passe-passe8 : à ravie, ravi et demi – ce qui ne manque pas de faire écho à une sorte de rapt inverse par Phylis de Cléandre, intercepté en chemin vers Angélique à la fin de l’acte II, dont elle vantait la rouerie par un « Quelque fin que tu sois tiens-toi pour affiné9 » au début de l’acte III.
8Si mensonge et quiproquo s’enchaînent dans La Place Royale, ils sont inextricables dans Le Menteur, et exhibent une forme inattendue de porosité entre les deux notions.
9Dorante, qui par deux fois au premier acte se fait passer pour un autre, guerrier d’Allemagne et donneur de bal nocturne, est dévoilé dès le début de l’acte II comme menteur et brillant affabulateur. Mais ses mensonges ne cessent de se compliquer de quiproquos, donnant lieu aux « fâcheux intriques » (v. 370) prévus par Cliton, dont le démêlement ne dure pas moins de quatre actes. Le quiproquo principal est celui de l’identité des deux femmes rencontrées aux Tuileries, qui tient à un jugement difficile à évaluer du point de vue de la véridicité : il naît en effet de la réponse – erronée – que donne Dorante à l’énigme selon laquelle « La plus belle des deux » « se nomme Lucrèce10 ». La pièce de Corneille après tout ne tranchera pas positivement : qui, du valet et du cocher, ou de l’étudiant-chevalier galant, a dit le vrai sur ce point ? Que le Menteur lui-même oscille, ou pour le dire autrement, change d’avis, n’implique pas qu’il s’était trompé…
10À ce quiproquo matriciel s’ajoute le quiproquo secondaire tenant à l’erreur du page de Clarice, qui a confondu Clarice et Lucrèce avec Hippolyte et Daphné11, leurs deux amies dont on ne saura rien, sinon qu’un inconnu les a régalées d’une fête nocturne.
12Grands fauteurs de trouble (comme on le remarque à la difficulté de ces résumés…) les mensonges de Dorante ne relèvent pas exactement des fourbes habituelles des personnages de la comédie cornélienne depuis Mélite : ils n’ont d’autre but, comme l’explique le menteur à son valet, que de lui donner bonne figure dans une situation galante, ou, dans le cas du mensonge du mariage à Poitiers, de déjouer le péril d’une proposition paternelle, en trouvant le moyen de refuser Clarice, pour conserver son cœur… à Clarice15. Dans ses affabulations, ce menteur-improvisateur est au fond moins calculateur qu’Alidor, ou même que Clarice et Lucrèce. Clarice substitue en effet, comme l’avait fait Alidor dans La Place Royale, la signature de Lucrèce à la sienne au bas de la lettre d’invitation faite à Dorante, avant de se tenir de nuit à la fenêtre de celle-ci16. La nouvelle combinaison entre cette fourberie des deux femmes et le quiproquo initial conduit à interpréter les erreurs de Dorante, qui nomme naturellement Clarice « Lucrèce », comme mensonges intentionnels et impostures ou « pièce nouvelle17 », selon la leçon énoncée en fin de l’acte III par Cliton sur le rapport de la vérité et du menteur : « En passant par sa bouche elle perd son crédit18. » Ce quiproquo au second degré, qui consiste à prendre l’erreur (involontaire) pour le mensonge (intentionnel) doit être renvoyé au principe même qui donne son titre à la comedia d’Alarcón, selon lequel toute vérité énoncée par un menteur devient suspecte. C’est cette vérité impossible dans la bouche du menteur qui est la conséquence vicieuse de la rupture de la confiance minimale dans la parole qui tient la société humaine, selon la forte expression de Montaigne : « En vérité le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes, et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole19. »
13La condamnation du poison moral et social du mensonge, cohérente avec les traités du temps sur les liens du mensonge, de l’honneur et du démenti20, est bien présente dans la pièce de Corneille (« Qui se dit gentilhomme, et ment comme tu fais, / Il ment quand il le dit, et ne le fut jamais21 »), mais s’y trouve amoindrie par la suppression du châtiment final de la comedia, et par la portée parodique du pastiche de Don Diègue dans le monologue de Géronte, « Ô vieillesse facile » (v. 1489 sq22). Corneille mènera la réflexion sur un autre plan dans La Suite du Menteur en explorant les conditions de possibilité du mensonge honnête, c’est-à-dire du mensonge de l’honnête homme qu’est devenu Dorante.
14La loi de la vérité suspecte a d’autres conséquences : écouter un menteur, c’est être pris soi-même dans le mensonge. Non seulement quand on est dupe du mensonge et qu’on s’en fait le « trompette », comme s’en plaint Géronte23, mais quand, averti, on s’en méfie et qu’on est conduit par soupçon à imaginer des stratagèmes intentionnels là où il n’y en a pas. Cliton s’en plaint : « […] quoique vous disiez, je l’entends au rebours24. » Les raisonnements des personnages méfiants confinent à leur tour à l’affabulation25.
15Mais on peut imaginer que Corneille homme de théâtre a surtout apprécié dans l’invention par Alarcón de la combinaison du mensonge et du quiproquo la conséquence littéralement spectaculaire de dissociation des composantes d’un personnage de théâtre : son corps, son nom, sa voix, sa place même sur scène, et son histoire26. Tous ces paramètres sont répartis de façon inextricable entre les deux femmes, dont les noms français sont d’ailleurs quasiment des anagrammes, Clarice et Lucrèce. Le quiproquo oblige la langue à mentir, à décrocher le lien entre voix, visage, nom, histoire, à produire un être hybride. Le comique généré par cette confusion conduit à l’expression récurrente d’un égarement des personnages, dont aucun n’est à sa place27, tout à fait dans l’air du temps à l’époque des comédies de Rotrou. De cet égarement comique on n’a pas d’expression plus forte, lors de la scène nocturne durant laquelle le menteur ne cesse de proclamer son amour pour « Lucrèce » et son « mépris pour Clarice », que la tautologie indignée de Clarice tentant désespérément de rassembler sa propre unité : « Je ne puis plus souffrir une telle impudence, / Après ce que j’ai vu moi-même en ma présence » (v. 1057-1058). Cet égarement redouble lors de la scène diurne en écho de l’acte V (scène 6), durant laquelle le même Dorante déclare au visage visible de Clarice ce qu’il déclarait à l’acte III à sa voix, assortie de la fenêtre et du nom de Lucrèce. Les deux femmes désorientées avouent tour à tour : « Je ne sais où j’en suis. […] » (v. 1685), « Je ne sais plus moi-même à mon tour où j’en suis. » (v. 1716). À supposer qu’il ait bien suivi l’intrigue, le spectateur éclairé jouit effectivement en ce cas de sa propre maîtrise.
16Quant aux personnages, il leur faudra quatre actes pour que se déroule, par une série d’illusions et de désillusions28, la lente levée du quiproquo, immédiate pour le lecteur informé par le nom des personnages féminins, rapide pour le spectateur guidé par l’appellation « Belle et sage Clarice » de Géronte (v. 385), mais entravée sur scène par la confirmation de l’erreur d’identité chez Cliton, qui « se rend » à l’avis erroné de son maître lors de la scène de la fenêtre (v. 948) : « C’est elle ». Ce n’est qu’au vers 1717 que cesse le chassé-croisé commencé au vers 203, et que se rétablit enfin l’attribution correcte des noms grâce à l’apostrophe directe de Clarice à Lucrèce devant les deux hommes ; à peine le quiproquo est-il éclairci que Dorante déclare ouvert un « nouveau jeu29 », lequel se traduit par l’invention de mensonges rétrospectifs à propos de ses erreurs, destinés à emporter la partie par une revanche explicite sur les deux femmes, qu’il réduit de fait au silence30.
17Cette conjonction de mensonge et de quiproquo, ressort de la comedia d’Alarcón, se trouve compliquée dans Le Menteur du fait d’un ajout apparemment indépendant de l’intrigue, au début du cinquième acte, celui du « change » de Dorante, qui ayant aimé Clarice sous le nom de « Lucrèce », commence à trouver que la vraie Lucrèce la vaut bien31. Contrairement à ce que suggère Corneille, ce « change » (d’une femme à l’autre) n’infléchit pas seulement le dénouement mais affecte a posteriori l’ensemble de la pièce de Corneille.
Mensonge et change
18Lié au mensonge, le change l’est aussi à la question de « l’inégalité de mœurs », enjeu reconnu dans les trois comédies.
19Dans l’Examen de La Place Royale, Corneille incrimine comme inégalité de mœurs le dénouement qui désunit les deux amants parfaits, Alidor et Angélique. Les stances finales d’Alidor, se réjouissant de la retraite d’Angélique dans un couvent, reçoivent des interprétations contradictoires : Alidor triomphe, il sauve la face. L’interprétation du ton avec lequel sont prononcées ces stances après l’adieu d’Angélique (« Que par cette retraite elle me favorise ! », v. 1554) reste indécidable : soit réaffirmation exaltée, par l’« amoureux extravagant », du principe défendu avec force au premier acte d’une liberté d’indifférence, soit façon de donner le change – éventuellement les larmes aux yeux32 – en défiant l’amour une fois la défaite amoureuse irrévocable33.
20La question du « change » dans La Suite du Menteur est posée explicitement par Cliton : Dorante le menteur, dont le talent a lancé à Paris l’expression proverbiale « revenir de Poitiers34 », s’est-il vraiment amendé après son voyage en Italie, comme il le prétend, ou reste-t-il menteur comme le suppose l’allusion ironique de Cliton à autre proverbe en écho, attesté celui-là : « Vous êtes amendé du voyage de Rome35 » ? La réponse est nuancée, sans être contradictoire : Dorante reste un menteur, mais c’est son mensonge qui a changé de nature et s’est lui-même amendé. La question de l’appréhension casuistique du mensonge, comme « cas de conscience », apparaît en clair à plusieurs reprises dans la pièce36, assortie de quelques termes techniques plaisamment repris par Dorante : « L’occasion convie, aide, engage, dispense37. » Cliton comptabilise soigneusement les mensonges de son maître (« Par générosité / Par adresse d’amour, et par nécessité38 »), et les scènes finales de chaque acte, ajoutées au patron de la pièce de Lope de Vega, contiennent un commentaire continu des mensonges et l’examen moral de leurs circonstances : répondant à la dernière réplique de Cliton dans la pièce précédente, « Par un si rare exemple apprenez à mentir » (v. 1804), La Suite tout entière déploie une École du menteur, avec discussion théorique et initiation pratique de Cliton – qui jure de ne jamais mentir (« Si vous m’y surprenez, étrillez-y moi bien39 ») mais se laisse gagner par le mal et commet son premier mensonge au dernier acte (V, 7), démentant la ligne morale globale d’un renoncement au mensonge. Cette « école du menteur » s’entrelace à une comedia sur l’amour en partie opposée, elle aussi, à la précédente.
21La question du « change » dans Le Menteur est plus complexe, et son interprétation pose des problèmes analogues à celle de la fin de La Place Royale. De fait, les critiques de la pièce ne s’accordent pas sur le « trouble nouveau » de Dorante à la scène 4 de l’acte V (v. 1607).
22En 1660, Corneille explique avoir voulu atténuer la dureté du dénouement de la pièce espagnole – lui qui ne s’embarrassait pourtant pas de douceur dans celui de La Place Royale.
23Certains y voient une faute de goût, comme Octave Nadal jadis : ce revirement, c’est la « première laideur » d’un Dorante héros généreux40. Considérée sous l’angle de la poétique cornélienne, il s’agit en somme d’une regrettable inégalité de mœurs.
24D’autres intègrent au contraire ce « change » à la série des mensonges d’un Dorante, qui, une fois de plus, sauverait sa peau en mentant après la menace de Géronte de laver son honneur dans le sang de son fils à « […] la moindre fourbe ou la moindre finesse41 ». Dorante n’aime pas vraiment Lucrèce, ce revirement n’est qu’une parade. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur en feignant d’aimer celle qu’il est contraint d’épouser, il rejoint un Alidor malheureux sauvant la face à la fin de La Place Royale. Conçu comme mensonge, le « change » final de Dorante sauve l’égalité de mœurs d’un menteur qui se livre à une manœuvre défensive, comme il l’a fait face à son père à l’acte III avec les affabulations poitevines… L’inconvénient de cette lecture est de reléguer au rang des faux-semblants l’étonnante réplique sur le trouble intérieur et l’« esprit ébranlé » de l’acte V (v. 1639). Contrairement aux mensonges précédents, celui-ci n’est en effet attesté ni par le personnage, qui expose à Cliton au contraire son hésitation entre les deux femmes, ni par l’auteur, qui le justifie par le goût français pour les dénouements heureux. L’hypothèse d’un « change » tactique a donc un coût, celui de supposer, contre la lettre des répliques du personnage, une intention cachée (voire inconsciente) jamais énoncée par Dorante, et une motivation (la crainte de la menace paternelle) qui va même à l’encontre de sa déclaration explicite à Cliton : « Je crains peu les effets d’une telle menace42 », qu’il faut donc interpréter comme dénégation. C’est également camper un Dorante menteur mais constant en amour. Ce choix engage le sens d’une réplique ambiguë : l’allusion de Dorante, lors du dénouement, au secret qu’il partage avec Clarice43 est alors conçue comme confirmation de la constance amoureuse. Elle peut être entendue autrement dans l’hypothèse suivante.
25Car il est possible de faire entier crédit à l’aveu explicite de l’inclination nouvelle44 du menteur. Le changement d’objet amoureux en cours de comédie n’est pas inusité : dans L’Illusion comique, Clindor amant d’Isabelle courtise Lyse à l’acte III, et joue dans la tragédie un personnage qui meurt des suites de son infidélité auprès de Rosine45. Dorante s’avère en ce cas à la fois menteur et inconstant. Dans cette (quatrième !) hypothèse, l’égalité de mœurs est sauvée, quoique paradoxale : c’est en étant inconstant que le menteur, disciple de Protée, respecte son caractère métamorphique. Il ne cessera d’ailleurs pas de se métamorphoser entre la pièce et sa suite. Cette interprétation met en valeur chez Corneille, à côté de l’exaltation de la volonté bien connue, le plan de l’incertitude passionnelle, de l’équivoque des sentiments, d’une division du for intérieur qui ne se raidit pas en hypocrisie, comme elle le fera en contexte augustinien chez les moralistes.
26À nouveau, ce change effectif peut être compris de deux façons.
27D’une part, comme improvisation. Grand improvisateur, Dorante, qui semble décliner toutes les catégories de mensonges à l’exception notable de l’hypocrisie, loin de donner le change prend le change parce qu’il est l’homme de l’occasion, celui qui sait la saisir et suivre tout à coup un chemin imprévisible, la « pente » que lui a donnée l’auteur au dernier acte. Le change de Dorante n’est autre chose que la conduite logique de celui qui obéit au kairos, dans sa parole comme dans ses sentiments. Sa subite bifurcation amoureuse ressemble à celle qui lui permet, en cours de réplique, d’imaginer une suite à l’histoire du mariage à Poitiers, d’inventer une grossesse, de justifier les deux noms de son beau-père imaginaire. L’impromptu de l’esprit se retrouve dans celui du cœur. La révélation sur le vrai objet d’amour peut être représentée comme une révélation pour tout le monde, menteur compris. Celui-ci « invente » son amour comme le reste, non qu’il le feigne, mais qu’il le rencontre, au sens étymologique de cette invention. Cette improvisation fait en outre partie du jeu : et Dorante évoquant à demi-mot devant Clarice la galanterie passée ne l’assure pas nécessairement de son amour intact, mais lui signifie qu’il a gagné en droit (non en fait) la partie aussi sur son époux Alcippe46, puisqu’il n’a tenu qu’à lui qu’il n’obtienne sa main.
28Cependant, l’improvisation suppose la présence d’esprit, et à ce sujet un autre paradoxe doit être considéré : d’un côté l’improvisateur ment comme il respire, c’est un virtuose dont Corneille salue en 1660 la maîtrise de la parole dans le Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique : de même qu’on admire dans Rodogune la grandeur de Cléopâtre dans le crime, explique-t-il, on admire la « présence d’esprit » et la « vivacité » de Dorante dans un vice « dont les sots ne sont pas capables47 ». Or ce don de mentir48 qui permet à Dorante d’exalter sur scène ses talents d’acteur s’allie paradoxalement, dans la pièce de Corneille, à ce qu’on peut décrire au contraire comme une non-présence à son esprit, une non-vivacité, le décalage avec lequel il se découvre une inclination nouvelle. C’est en effet après avoir confirmé auprès de Géronte sa foi commise à Lucrèce, puis l’avoir répété à Cliton (« Je l’aime, et sur ce point ta défiance est vaine », v. 1613), que Dorante confie à son valet interloqué :
D’un trouble tout nouveau j’ai l’esprit agité.
[…]
J’ai tantôt vu passer cet objet si charmant :
Sa compagne, ou je meure49, a beaucoup d’agrément.
Aujourd’hui que mes yeux l’ont mieux examinée,
De mon premier amour j’ai l’âme un peu gênée,
Mon cœur entre les deux est presque partagé,
Et celle-ci l’aurait s’il n’était engagé50.
29Ce forgeur de paroles « en l’air » a beau avoir une maîtrise éblouissante de la parole, il lui arrive donc, littéralement, de ne pas savoir ce qu’il dit51 : il peut dire le vrai sans le savoir, et inversement. Voire, il peut se trouver dans la situation de n’avoir aucune vérité à dire à ce moment précis de l’intrigue où il promet « la vérité pure » (v. 1557). D’où l’aveu d’impuissance : ce mouvement incertain, Géronte ne l’eût pas cru.
30Cliton décrit nonobstant ce partage intérieur comme une forme paradoxale de mensonge : « Quoi ! même en disant vrai, vous mentiez en effet ? » (v. 1628). À ce paradoxe de la vérité mensongère Dorante répond en invoquant la temporalité du change, et en regrettant de ne pas avoir « […] le loisir / De consulter mon cœur52 […] ». L’instant propice du kairos s’inverse en un manque de « loisir ». Si le cœur n’est pas transparent et doit être consulté, il devient difficile de diagnostiquer le mensonge comme processus de falsification entre cœur et bouche. Soigneusement distingué de l’acte de dire le faux, le mensonge échappe ici à sa définition intentionnelle, reprise à l’envi depuis les deux traités Du mensonge et Contre le mensonge de saint Augustin, de parler contre son esprit (contra mentem) dans l’intention de tromper.
31Une telle définition permettait à saint Augustin d’envisager effectivement la possibilité de mentir en disant vrai, si l’effet calculé de cette vérité est trompeur53. Cette définition convient parfaitement au Tartuffe de Molière, s’accusant d’être un scélérat devant un Orgon qui prend cette vérité pour le mensonge d’un saint54. La Suite du Menteur fournit une autre variante de vérité mensongère quand, alors que Cliton commet son premier mensonge au service de son maître (v. 1505), celui-ci l’accuse sciemment de mentir (« Maraud, ne criais-tu que pour nous mettre en peine55 ? ») dans le but d’empêcher Philiste de les supposer de connivence, au risque de faire trébucher le débutant dans les détails de sa « bourde56 ».
32Mais malgré une formulation identique, le paradoxe dénoncé par Cliton à propos du change sentimental de Dorante : « Quoi ! même en disant vrai, vous mentiez en effet ? » (v. 1628) ne relève pas de ces vérités mensongères intentionnelles. Un pas supplémentaire est franchi quand l’intention elle-même n’est plus une, ou plutôt qu’elle n’est plus sûre. Car c’est bien la dissociation entre aimer et aimer en effet, mentir et mentir en effet, qui se trouve en jeu quand la question du mensonge touche au domaine des passions. Qu’est-ce qu’aimer « en effet57 » ? Que devient le mensonge contra mentem quand l’esprit n’est pas transparent à soi, ni immédiat, quand il change, comme dans les Essais de Montaigne, « non d’âge en autre, ou […] de sept ans en sept ans, mais de jour en jour » et littéralement au théâtre, « d’heure en heure58 » ?
33Grand pourfendeur du mensonge comme poison social, Montaigne refuse d’assimiler change et mensonge : « Tant y a que je me contredis bien à l’aventure, mais la vérité, comme disait Demade, je ne la contredis point59. » Il n’est donc nul besoin d’importer un discours freudien pour aborder cette division de l’esprit de Dorante, menteur sincère : ce paradoxe peut être abordé par les discours du temps dans ces années 1640, qui voit la floraison des traités des passions avant celui de Descartes, et l’omniprésence d’une réflexion sur la tromperie intérieure et le mensonge à soi.
34L’hypothèse temporelle du « change » complique donc le portrait du menteur, sans l’épuiser tout à fait. La comédie du mensonge cornélienne ouvre à la possibilité d’une multiplicité intérieure qui ne soit ni simple affabulation ni pure duplicité calculatrice.
Passions menteuses et mensonge à soi
Mensonge à soi
35L’hypothèse temporelle du « change » n’est pas incompatible avec celle du caractère non assuré, non donné, d’une vérité sur soi. La notion poétique de l’« égalité de mœurs » ne peut sans anachronisme reposer sur la cohérence passionnelle à l’âge où le jeu des passions entre elles interdit l’appréhension monolithique de l’individu. Que devient l’égalité de mœurs d’un personnage qui se trouve avoir pour caractère d’être un inconstant ? Que devient le mensonge quand il porte sur des passions ? Celles-ci ne sont pas des vérités de fait. Pire, les traités du temps ne cessent de montrer comment leur jeu multiple les rend elles-mêmes « menteuses60 ». L’instance du mensonge ne peut être assignée à une intériorité fixe, et les emplois extensifs de « mentir » dans la comédie signalent une origine flottante : les sens mentent, les visages sont de doux imposteurs, les passions mentent, les apparences mentent, les habits sont menteurs61. Il n’est pas simple, dans l’aire de jeu de la galanterie, de distinguer amour et curiosité, ou de trancher entre « aimer », vouloir aimer et aimer en effet. Dans la gamme des mensonges possibles figure en bonne place à l’époque le mensonge à soi. Les trois comédies paraissent entre La Cour sainte du père Caussin : « […] l’homme est si fait à sembler ce qu’il n’est pas, et à dissimuler ce qu’il est, si divers et plein d’essences muables, que lui-même se trompe en soi-même et se prend pour un autre62 » et La Rochefoucauld : « Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu’enfin nous nous déguisons à nous-mêmes63 ». Les monologues de Corneille donnent souvent à entendre, en temps réel, le jugement immédiat des personnages sur la succession de leurs propres volte-face ; le fameux « dilemme » tient à ces combats de passions que le développement rhétorique du monologue dénonce tour à tour comme impostures64.
36Ces dénonciations du mensonge à soi échappent au spectre de la dissimulation ou de l’hypocrisie des « politiques » machiavéliens de la tragédie. On est plus proche ici de la pluralité interne des passions « de l’intérieur de l’âme » de Descartes. Exactement comme dans le cas du veuf de l’article 147 des Passions de l’âme, partagé entre la douleur du deuil et la joie de rester maître de soi65, le César de La Mort de Pompée de Corneille, jouée durant la même saison que Le Menteur, exprime face à la tête coupée de son rival une division intérieure qui ne tombe pas sous le coup de l’hypocrisie : partagé entre la joie (d’être maître de l’univers face à son ennemi mort) et la tristesse ou la colère (de voir le grand Pompée lâchement assassiné), il ne dissimule pas l’une sous l’autre, mais choisit66.
La leçon de Phylis
37Le vertige propre à la pièce du Menteur avait été rapproché par Louis Marin de la Pensée « Qu’est-ce que le moi ? » de Pascal, où la dissociation en qualités périssables rend le moi inassignable67 ; à cette lumière, on peut envisager d’un autre œil la doctrine insolente énoncée par Phylis dans La Place Royale des divers appas des mille amants virtuels entre lesquels il s’en trouvera bien quelques-uns à aimer, plaisanterie qui a été lue comme un avatar de la notion philosophique de liberté d’indifférence68. Prendre au sérieux la dissémination des « traits » qui font qu’on aime telle ou telle personne, selon Phylis, peut justifier d’une autre façon le flottement de Dorante dans Le Menteur, perdu de fait durant toute la pièce entre un nom, un visage, une voix et une personne qui ne coïncident pas.
38Or, quand il s’agit de définir ce je ne sais quoi qui fait qu’on aime, le même Pascal renvoie précisément à Corneille, le Corneille de Médée ou de Rodogune et de l’origine insondable et absolue de l’amour69. Loin de cette définition quintessencielle, Le Menteur comme L’Illusion comique suggèrent plutôt une qualité par laquelle Phylis définit dans la scène finale de La Place Royale l’humaine (ou la féminine) condition : notre « fragilité », corrigée en 1660 en « notre instabilité70 ». Clindor, Phylis ou le Dorante du Menteur sont des figures de cette instabilité : le je ne sais quoi de leur sentiment amoureux est un véritable je ne sais. En ce sens, le choix de la pièce de Lope de Vega intitulée Aimer sans savoir qui pour La Suite du Menteur offre une variation nette : Aimer sans savoir qui constitue la réversion et la résolution parfaite du aimer je ne sais qui qui fait la trame du Menteur.
Mensonge, songe, équivoque
39Mensonge et quiproquo, outils logiques du nouement de l’action, touchent aussi à la matière sensible du théâtre, l’espace et le temps d’un côté (avec les tours de passe-passe des corps, des portes et des fenêtres, et des contre-temps), de l’autre la parole, grâce à cet équivalent du quiproquo dans le langage qu’est l’équivoque. Comme le quiproquo, l’équivoque a partie liée avec le mensonge, et Corneille ne la condamne pas. En 1660 encore, il s’enorgueillit au contraire des « scènes artificieuses » de La Veuve, qui sont un exemple spectaculaire de dialogues entièrement équivoques et de vérité mensongère. Les personnages eux-mêmes s’applaudissent de leur ingéniosité dans la double-entente, et Doris en fait le principe d’une représentation de comédie : « Vous n’eussiez pu m’entendre et vous tenir de rire71. »
40La Veuve date de 1632. En 1645, l’équivoque n’a pas disparu. La syllepse menaçante de Philiste sur le mot « prison », dans La Suite du Menteur, produit une scène entière de quiproquo en jouant à trois reprises sur le sens littéral du cachot (« Rentrez dans la prison dont vous vouliez sortir72 ») avant de rassurer ses auditeurs sur le sens figuré des fers de l’amour (« On nomme une prison le nœud de l’hyménée73 »). Par l’intention de tromper, cette équivoque entre dans le champ du mensonge et ressemble à une forme discrète de vengeance. La distance entre « mensonge » et « sens figuré » tient à peu de choses : la même figure de la prison amoureuse avait été utilisée à l’acte I par Mélisse dans sa lettre à Dorante, qui y comprenait sans difficulté la métaphore amoureuse : « […] mon cœur est allé dans la même prison que vous, / et n’en veut point sortir tant que vous y serez74. »
41Autre forme jubilatoire d’équivoque, qui joue cette fois sur ce que Corneille a nommé l’illusion comique, la méta-théâtralité propre au diptyque du Menteur et de sa Suite : celle par laquelle Cliton, joué par l’acteur Jodelet, s’indigne qu’à la suite du succès de la représentation du Menteur à Paris, on le prenne dans la rue pour Jodelet et qu’on le désigne du doigt comme « le valet du Menteur75 ». Cette forme de distanciation76, qui est littéralement un qui-pro-quo, ouvre au miroitement de l’énoncé et l’énonciation, et pointe l’équivoque, entre comédien et personnage, de ce qu’à l’époque on désignait par le même mot, l’acteur.
42Le plaisir pris à ce spectacle de la parole, et à l’énergie que lui confère le mensonge, apparaît à travers un dernier couple de notions attendu au moins par la rime, le mensonge et le songe. Cette rime inverse l’adage usuel qui affirme que le songe n’est que mensonge. La comédie cornélienne pose que le mensonge est une forme de songe, et Cliton se permet de renouveler la rime : « J’appelle rêverie / Ce qu’en d’autres qu’un maître on nomme menterie77. » Mentir, c’est « se flatter dans une illusion78 », s’oublier un temps ou se cacher à soi-même, et « sortir de soi79 ». C’est ce qu’Octave Nadal trouvait admirable dans le panache de Dorante – métamorphosant les extravagances du Matamore de L’Illusion comique, grand guerrier et grand séducteur lui aussi, mais que personne jamais ne croyait. C’est également ce que Mélisse dans La Suite du Menteur qualifie de « jolie folie » dans la mythomanie de sa suivante Lyse, grande lectrice de L’Astrée s’imaginant descendante d’Astrée et de Céladon. L’affabulation n’est pas la fourbe, elle peut même être gratuite et de pure connivence, comme toutes les fois où un personnage cite textuellement la réplique antérieure d’un autre80. Les affabulations de Dorante, qui le délivrent de sa défroque d’écolier provincial, sont un éloge de l’art du dramaturge aussi bien que de celui de l’acteur. Ses mensonges constituent des morceaux de bravoure qui ne sont donc pas sans rapport, dans leur composition par la fin, qui seule compte (« Je suis donc marié, puisqu’il faut que j’achève81 ») avec la composition dramaturgique de Corneille82. Mais ils intègrent aussi l’improvisation poétique du rebondissement, les effets de tempo liés au fait que l’aventure continue de plus belle : tout cela vise ce que Corneille nommait l’enjouement. Si la comédie de Corneille n’est pas en premier lieu comique, c’est une comédie qui a de l’humour.
1 Corneille, La Veuve, v. 1522.
2 Si la comédie d’Alarcón, La Vérité suspecte, désigne le mensonge par une des conséquences, celle de Lope de Vega, Aimer sans savoir qui (Amar sin saber a quién) ne privilégie pas le mensonge. Sur la construction du diptyque, voir ici-même l’article de Bénédicte Louvat.
3 Cette opposition est esquissée dans un article de Danielle Chaperon, « Le mensonge sur scène : la performance infinie », 2003, en ligne : https://www.fabula.org/ressources/atelier/?Mensonge_dramatique.
4 Octave Nadal, Le Sentiment de l’amour dans l’œuvre de Corneille, Paris, Gallimard, 1948.
5 Louis Marin, « Le Menteur ou la variation des noms et des corps », Comédie Française, nos 145-146, février 1986, repris dans Lectures traversières, Albin Michel, 1992, p. 147-154. Cette analyse a donné l’impulsion à notre étude.
6 Corneille, La Place Royale, éd. Marc Escola, Paris, GF Flammarion, DATE, Examen, p. 73.
7 En deux temps : Alidor n’enlevait pas lui-même Angélique (IV, 6), il n’avait pas signé le billet (IV, 7).
8 Dans Le Menteur (IV, 6, v. 1774), l’expression dans la bouche de Clarice désigne les mensonges de Dorante.
9 La Place Royale, III, 2, v. 644.
10 Le Menteur, I, 4, v. 197-198.
11 Ibid., III, 2, v. 783.
12 Comme l’indique la didascalie initiale : « Clarice, faisant un faux pas, et comme se laissant choir » (ibid., I, 2).
13 La Place royale, II, 1.
14 Le Menteur, IV, 2, v. 1156-1167.
15 Cliton souligne l’ironie de la chose dans Le Menteur, V, 4, v. 1633.
16 L’invention est de la suivante de Clarice, Isabelle, ibid., II, 3, v. 450-458.
17 Le Menteur, III, 5, v. 1009.
18 Ibid., III, 6, v. 1080.
19 Montaigne, Essais, I, 9, « Des Menteurs », éd. Villey-Saulnier, Paris, PUF, 2004, p. 36 B.
20 Où l’on trouve aussi la leçon de la vérité suspecte : « […] avec un méchant calomniateur, détracteur, ou faussaire (car ce sont tous menteurs) on est toujours en doute et incertitude s’il ment ou dit la vérité : ses paroles, ses écrits, ses gestes, sa contenance, ses promesses assurées même par serment nous sont toujours suspectes et nous tiennent en suspens sans nous pouvoir résoudre, d’autant que les menteurs portent toujours avec eux (disait Aristote) la peine de leur faute : qui est qu’on se défie tant d’eux, que même lorsqu’ils disent la vérité on ne les peut croire. […] » Dupleix, Les Lois militaires touchant le duel, Paris, Dominique Salis, 1602, livre II, chapitre IX, « De l’indignité et laideur du mensonge, et comment le démentir intéresse l’honneur », p. 110 (italique dans le texte).
21 Le Menteur, V, 3, v. 1519-1520.
22 Ibid., V, 2.
23 Ibid., V, 2, v. 1496.
24 Ibid., V, 4, v. 1612.
25 La chose est vraie jusqu’à la fin de La Suite du Menteur, puisque Mélisse, placée devant le noble sacrifice de Dorante, retombe un instant dans le soupçon : son amant l’abandonnerait pour « les dames de Paris » (V, 3, v. 1761) comme il avait abandonné Lucrèce pour partir en Italie ; à quoi Dorante répond par un « serment inviolable » (v. 1777).
26 Les détails biographiques sur Lucrèce glanés par Cliton sont récités par Dorante. Le Menteur, III, 5, v. 1025-1031.
27 Le motif de la « place » est central dans les trois pièces, et pas seulement dans le titre de La Place Royale : prendre la place, céder la place, « la place est prise » (Le Menteur, v. 1637), « vous quitter la place » (La Suite du Menteur, v. 1833), ces expressions renvoient au jeu des quatre coins qui structure les comédies.
28 Sur cette alternance, voir Yohann Deguin, La Désillusion comique, Rouen, PURH, 2024.
29 Le Menteur, IV, 6, v. 1727.
30 « Êtes-vous aujourd’hui muettes toutes deux ? », Le Menteur, I, 7, v. 1792.
31 Ibid., V, 4, v. 1619-1624.
32 C’était le cas dans la belle mise en scène de Brigitte Jaques au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers en 1992.
33 « Impuissant ennemi de mon indifférence, / Je brave, vain amour, ton débile pouvoir » (La Place Royale, Stances d’Alidor, v. 1566-1567).
34 Corneille, La Suite du Menteur, I, 3, v. 298 : « On dit, quand quelqu’un ment, qu’il revient de Poitiers. »
35 Ibid., I, 1, v. 140. Guillaume Peureux donne en note le proverbe cité par Furetière : « Jamais cheval, ni mauvais homme, n’amenda pour aller à Rome » (Le Menteur et La Suite du Menteur, Paris, Livre de poche, 2010, p. 167, n. 4).
36 Corneille, La Suite du Menteur, II, 5, v. 679 : « Vous vous êtes instruit des cas de conscience. »
37 Ibid., III, 5, v. 1181. Cf. IV, 8, v. 1536.
38 Ibid., v. 1167-1168 : le faux témoignage pour sauver Cléandre ; le mensonge pour conserver le portrait de Mélisse ; le devoir de discrétion envers la visiteuse.
39 Ibid., III, 5, v. 1183.
40 « Il reste étranger au caractère de Dorante et à la nature même de son mensonge. Découvert, le menteur prétend qu’il a vraiment joué la comédie vis-à-vis de Clarice. C’est la première veulerie, la première laideur. Le cœur lui-même ment ; l’amour se nie. À la vérité, on ne comprend plus ». Octave Nadal, op. cit., p. 224.
41 Le Menteur, V, 3, v. 1594.
42 Ibid., v. 1601. Voir ici même l’hypothèse de Marc Escola, qui met en valeur au contraire le rôle joué par Géronte et choisit d’entendre les saisissants échos mortifères de ses propos.
43 « Mais entre vous et moi vous savez le mystère », Le Menteur, V, 6, v. 1782-1785.
44 Ibid., V, 4, v. 1607-1639.
45 Corneille, L’Illusion comique, III, 5 et V, 3.
46 « Et vous, belle Clarice, aimez toujours Alcippe. / Sans l’hymen de Poitiers, il ne tenait plus rien » (Le Menteur, V, 6, v. 1783-1784).
47 Corneille, Trois discours sur le poème dramatique, éd. Marc Escola et Bénédicte Louvat, Paris, GF-Flammarion, 1999 ; rééd. 2021.
48 La Suite du Menteur, III, 2, v. 960.
49 Prise littéralement, l’expression anodine « Sa compagne, ou je meure » pourrait étayer l’hypothèse d’une conversion amoureuse défensive !
50 Le Menteur, V, 4, v. 1607 et v. 1620-1624.
51 Comme le lui reprochait Cliton au premier de ses mensonges : « […] vous ne savez, Monsieur, ce que vous dites », Ibid., I, 5, v. 258.
52 « Que maudit soit quiconque a détrompé mon père, / Avec ce faux hymen j’aurais eu le loisir / De consulter mon cœur, et je pourrais choisir », Ibid., V, 4, v.1629-1632.
53 « […] comme il arrive, par contre, qu’on lui dise la vérité pour […] tromper. Celui, en effet, qui dit une chose vraie, parce qu’il sent qu’on ne le croira pas, trompe en la disant. Il sait ou pense, en effet, que son interlocuteur la jugera fausse, du fait seul qu’elle vient de lui ». Saint Augustin, Du mensonge, chapitre IV, « Le mensonge est-il quelquefois utile ou permis », trad. Abbé Devoille, Œuvres complètes, XII, 1866.
54 Molière, Tartuffe, III, 6, v. 1074-1086.
55 La Suite du Menteur, IV, 7, v. 1505.
56 Ibid., IV, 8, v. 1545.
57 Comme s’en inquiète Sabine. Le Menteur, IV, 7, v. 1348.
58 Montaigne, Essais, III, 2, op. cit., p. 805B.
59 Ibid.
60 « […] Ces deux principes de vérité, la raison et les sens, outre qu’ils manquent souvent de sincérité, s’abusent réciproquement l’un l’autre ; les sens abusent la raison par de fausses apparences. Et cette même piperie qu’ils apportent à l’âme, ils la reçoivent d’elle à leur tour : elle s’en revanche. Les passions de l’âme troublent les sens, et leur font des impressions fausses. Ils mentent, et se trompent à l’envi. » Pascal, Pensées, Lafuma 45, Sellier 78.
61 La Suite du Menteur, III, 3, v. 1044 ;
62 Nicolas Caussin, La Cour sainte (1624), I, II, 5, « La vie masquée, ou la dissimulation », Paris, D. Bechet, 1653, p. 63.
63 La Rochefoucauld, Maximes, 1665, Maxime 119. Le paradoxe logique de la coïncidence du trompeur et de la dupe dans le mensonge à soi, énoncé par Torquato Accetto dans son traité De l’honnête dissimulation : « pour peu que l’on admette que l’esprit ne peut dans le même temps mentir et avoir l’intelligence du fait qu’il se ment à soi-même ; car ce serait voir et ne pas voir » (chap. III) ne l’empêche pas d’évoquer une zone d’opacité effective. T. Accetto, Della dissimulazione onesta (Naples, 1641), De l’honnête dissimulation, trad. Mireille Blanc-Sanchez, Verdier, 1990, chap. XII, « De la dissimulation envers soi-même ».
64 « Vains projets, vains discours, vaine et fausse allégeance », soupire Angélique. La Place Royale, II, 3, v. 434.
65 Descartes, Passions de l’âme, II, art. 147, « Des émotions intérieures de l’âme ».
66 « Il se juge en autrui se tâte, s’étudie, /Examine en secret sa joie et ses douleurs, /Les balance, choisit, laisse couler des pleurs, / Et forçant sa vertu d’être encor la maîtresse, / Se montre généreux par un trait de faiblesse. »
67 Laf. 688, Sel. 567. Qu’est-ce que le moi ? « […] celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non : car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera plus. / Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on, moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s’il n’est ni dans le corps, ni dans l’âme ? et comment aimer le corps ou l’âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu’elles sont périssables ? car aimerait-on la substance de l’âme d’une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut, et serait injuste. On n’aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. […] »
68 La Place Royale, I, 1, notamment v. 82-85. Pierre-Alain Cahné, « La Place Royale ou la véritable indifférence », dans Pierre Corneille, actes du colloque de Rouen, éd. A. Niderst, Paris, PUF, 1985, p. 315-324.
69 « Souvent je ne sais quoi qu’on ne peut exprimer /Nous surprend, nous emporte, et nous force d’aimer » Corneille, Médée II, 5 (1634) ; ou : « Il est des nœuds secrets, il est des sympathies, / Dont par le doux rapport les âmes assorties / S’attachent l’une à l’autre, et se laissent piquer / Par ces je ne sais quoi qu’on ne peut expliquer. » Corneille, Rodogune, I, 5 (1645).
70 « Le cloître a ses douceurs, mais le monde en a d’autres, / Qui pour avoir un peu moins de solidité / N’accommodent que mieux notre <fragilité> instabilité », La Place Royale, V, 7, v. 1535-1537.
71 La Veuve, III, 4, v. 1015. Exemple de déclaration à double-entente, de la part de Doris à Alcidon : « Si tu pouvais aussi pénétrer mon courage, / Et voir jusqu’à quel pont ma passion m’engage, / Ce que dans mon discours tu prends pour des ardeurs / Ne te semblerait plus que de tristes froideurs. » Ibid., II, 5, v. 683-686.
72 La Suite du Menteur, V, 5, v. 1844, 1860, 1891.
73 Ibid., v. 1889.
74 La Suite du Menteur, I, 2. Voir aussi la syllepse sur « langue » (Le Menteur, IV, 3), ou l’écho entre l’expression d’amour : « J’idolâtre Angélique » (I, 4, v. 227) et l’insulte dans la fausse lettre : « Ce n’est qu’une Idole mouvante » (La Place Royale, II, 2, v. 364).
75 La Suite du Menteur, I, 3, v. 295-306.
76 Voir ici-même l’étude de Liliane Picciola.
77 Le Menteur, I, 6, v. 313-314.
78 Dans La Veuve, Alcidon le traître, faisant la cour à Doris alors qu’il aime la Veuve (selon le même dispositif que Cléandre dans La Place Royale) explique que mentir, c’est s’illusionner par un qui-pro-quo délibéré : « …Ainsi quand je soupire, / Je la prends pour une autre, et lui dis mon martyre, / Et sa réponse, au point que je puis souhaiter, / Dans cette illusion a droit de me flatter. » (II, 6, v.735-638).
79 Exactement à la même époque, Torquato Accetto préconise ce mensonge à soi comme « tromperie honnête » et « récréation » : « […] il faut faire montre d’une extrême prudence, dès lors que l’homme doit se cacher à lui-même, et ce pour une durée qui n’outrepasse pas celle d’un très bref intermède, autorisé par le “connais-toi toi-même”, afin de prendre quelque récréation en se promenant quasiment hors de sa personne. […] il convient que, certains jours, celui qui est misérable oublie son malheur et cherche à vivre avec au moins quelque image qui le satisfasse, de sorte qu’il n’ait pas toujours présent à l’esprit l’objet de ses misères. Dans la mesure où il est fait de cela bon usage, il y a certes tromperie, mais honnête […] il est impossible de s’en passer si l’on veut ainsi respirer » Torquato Accetto, Della dissimulazione onesta (Naples, 1641), De l’honnête dissimulation, trad. Mireille Blanc-Sanchez, Verdier, 1990, chap. XII, « De la dissimulation envers soi-même » (je souligne).
80 Voir par exemple Le Menteur, v. 1050 et 1710, ou v. 1042 et 1713, ou La Suite du Menteur, v. 1261 et 1536.
81 Le Menteur, II, 5, v. 594.
82 Sur ce point, voir les analyses de Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre, Paris, Klincksieck, 1996, passim.
sous la direction de Yohann Deguin et Bénédicte Louvat
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Revue Corneille présent », n° 3, 2024
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1927.html.
Quelques mots à propos de : Florence Dumora
Université Paris Cité
Florence Dumora, professeure de littérature française à l’Université Paris Cité, consacre ses recherches à la littérature, l’art et la pensée du xviie siècle, et à une approche interdisciplinaire de l’histoire du for intérieur (littérature, philosophie, médecine). Elle s’est particulièrement intéressée au rêve (L’Œuvre nocturne, Champion, 2005) et prépare un nouvel essai sur le rêveur. Elle publie l’œuvre de Jean Ogier de Gombauld, à commencer par Endymion (1624), édition critique et commentaire, Champion, 2024. Ses travaux portent également sur les rapports entre texte, écriture et image (la gravure avec Crispijn de Passe et Maurisset, le rébus).
