Sommaire
Journée des doctorants 2015
organisée par Guillaume Cousin à l’Université de Rouen le 27 mai 2015
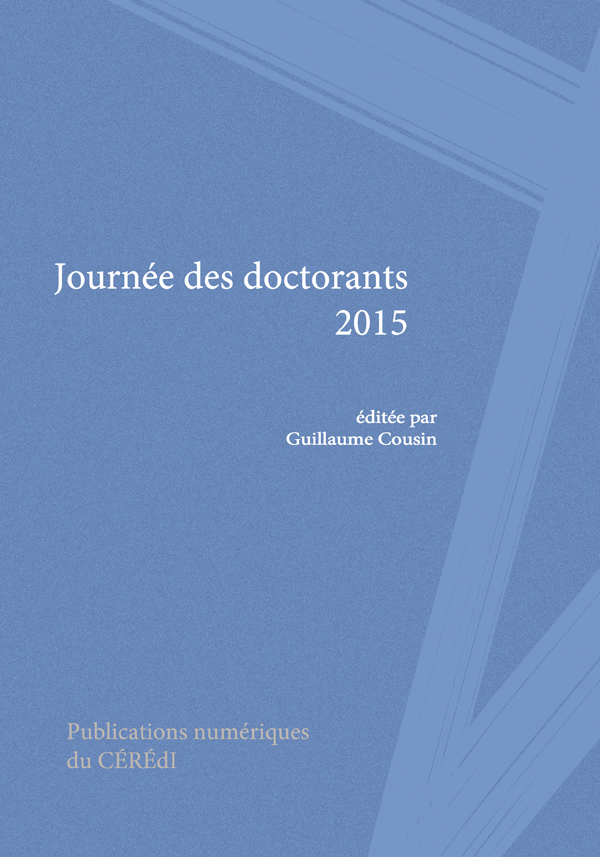
- Bernadette Jusserand-charmet Peut-on parler de genèse d’un journal ? Pour une approche du Journal de Jacques de Bourbon Busset
- Sophia Mehrbrey De la perception enfantine au « sentiment d’enfance »
- Thibault Vermot Fantastique et politique
Voir et entendre la littérature au xixe siècle
L’héroïsation des figures homicides au théâtre (1825-1848). « Entrée en scène »
Noémi Carrique
1Ces quelques pages soumettent les grandes lignes, encore sous forme d’esquisse, de l’introduction d’un travail de thèse sur les enjeux de l’héroïsation des figures homicides sur les scènes romantiques (1825-1848). Elles sont à lire avec toute la précaution et le recul qu’exige la découverte de pistes de travail qui restent encore à affiner.
2Nous soumettons l’hypothèse que l’étude de la représentation des héros meurtriers sur les scènes parisiennes entre 1825 et 1848 constitue un miroir et un baromètre des phénomènes politique et social. Les nombreux changements politiques de la période qui suit la Révolution française induisent une incertitude concernant les normes et les lois. Les régimes postrévolutionnaires tentent d’établir de nouveaux codes sur les fondements posés par la Révolution et dans le même temps la période est à la médiatisation de la délinquance et de la criminalité. Or, sur les scènes théâtrales de la monarchie de Juillet s’affirment des figures héroïques de hors-la-loi, valorisées par l’écriture, incarnées par des comédiens de renom et appréciées des spectateurs. Notre étude se concentrera sur les meurtriers, d’abord pour des raisons pratiques de nécessité sélective. Le corpus serait en effet trop étendu si l’analyse s’attachait à tous les crimes. D’autre part, l’aspect grave et spectaculaire de ce crime est intéressant, autant que les nuances juridiques qui s’y rapportent. En effet, depuis l’existence du droit pénal, l’homicide est considéré comme le plus grave des crimes contre la personne. Cependant, le code pénal de 1810 distingue les peines selon les circonstances. Par exemple, l’article 324 stipule que « dans le cas d’adultère, prévu par l’article 336, le meurtre commis par l’époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable1 ». L’homicide, en droit, n’est donc pas toujours inexcusable, ce qui en fait un crime intéressant et nuancé.
3Quels sont donc les enjeux de cette représentation dramatique des assassins, par rapport aux figures de criminels précédemment visibles sur la scène ? Cette interrogation pose la question de la fonction du théâtre. Nous concentrons l’étude sur cette manifestation publique qu’est le théâtre, notamment parce qu’en cette première moitié de xixe siècle il est un phénomène social majeur qui répond à l’appétit d’un public extrêmement large. Le théâtre compte alors plus de spectateurs que le roman ne rassemble de lecteurs. Enfin, ce sujet interroge spécifiquement le rôle du théâtre, sa fonction selon qu’elle est simplement spéculaire de la réalité ou pouvoir critique.
4Notre période d’étude commence trente-quatre ans après le premier Code, établi en 1791, alors que le système juridique défini au moment de la Révolution a eu quelques années pour se mettre en place, renforcé par le Code pénal créé par Napoléon en 1810 sur les bases déjà fermement posées par le Code révolutionnaire. En outre, c’est en novembre 1825 que paraît le premier numéro de la Gazette des tribunaux, journal qui rapporte les procès et met en scène dans ses articles passablement dramatisés les criminels après leur geste2. Ce journal quotidien constitue un symptôme de ce mouvement qui fait du xixe siècle celui de la médiatisation du crime et de l’engouement du public pour cette littérature de presse sensationnelle. Par ce choix de date de début d’étude, nous signalons que nous nous intéressons au rapport entre la représentation de la pratique de la justice et la pratique du théâtre. D’autre part, juste deux ans avant 1825 le Boulevard du Temple est rebaptisé « Boulevard du crime », à cause du foisonnement des personnages de criminels et des assassinats représentés sur les planches des théâtres qui se succèdent sur ce boulevard très fréquenté par toutes les classes sociales. Nous choisissons de faire durer l’étude jusqu’en 1848, année de la fin de la monarchie de Juillet et début de la Seconde République. Date politique, donc. La monarchie de Juillet nous intéresse car elle a constitué une période extrêmement riche de production théâtrale et de prolifération de personnages de criminels sur scène, marquée par une succession d’abolition et de rétablissement de la censure3.
5Avant de détailler le portrait de cet objet d’étude qu’est le meurtrier, nous souhaitons apporter une précision sémantique sur la notion de figure, choisie spécifiquement dans le titre de la thèse. Effectivement, on rencontre au théâtre, entre le personnage littéraire et le comédien qui l’incarne, une série de notions, comme celles de « type », « rôle » ou « emploi ». Lorsque l’on parle de « personnage de meurtrier », on stipule d’abord une idée bien précise qui fait intervenir la dialectique entre le personnage et l’action. En effet, l’assassin est, au théâtre comme à la vie, déterminé par son geste. D’autres personnages sont déterminés par leur condition sociale (le banquier), familiale (la mère) ou politique (le roi) ; le personnage homicide est déterminé par une condition juridique consécutive à une action criminelle. Plus profondément, l’idée d’un personnage de criminel présuppose une théorie philosophique qui envisage la constitution de l’être dépendamment de ses actes. Or, nous allons mettre en question la notion de criminel et sa relativité à un système de pensée. C’est pourquoi le terme de « personnage » nous a paru trop déterminant et marqué idéologiquement pour notre sujet. Les autres catégories de « type », « rôle » ou « emploi » sont également, pour diverses raisons, trop réductrices pour convenir4. J’ai donc choisi de parler de « figure », car ce terme survole toutes ces catégories du fait de sa souplesse5. Patrice Pavis, dans son Dictionnaire du théâtre, souligne également la puissance dramaturgiquement socialisante de la notion de figure, qui « formalise les relations entre les personnages et la logique des actions6 ». Cette notion est très intéressante dans la perspective de la représentation de l’assassin, socialement constitué comme tel, et puissant moteur dramatique. Interroger la figure amène également à considérer les réflexions sur les figures mythiques, auxquelles Véronique Léonard-Roque s’est intéressée7.
6Nous allons donc étudier la représentation héroïsée de la figure du meurtrier, dans toute sa dimension scénique. Pour cela nous analyserons, en complément de la présence littéraire, la présence des personnages homicides interprétés par des comédiens en chair et en os, sur les planches, accomplissant le geste d’ôter la vie. Les effets de cette représentation sur le public et les autorités nous intéressent également. Notre enquête, qui interroge un moment précis de l’histoire littéraire et les textes dramatiques, se consacre donc à l’analyse dramaturgique. Or, il est nécessaire de délimiter géographiquement l’étude, qui se consacre uniquement aux représentations parisiennes des pièces. Les sources étant plus abondantes et plus aisément disponibles, il est ainsi plus facile de mener le travail de recherche sur cet important corpus.
7L’introduction de ce travail emprunte trois directions, qui consistent à mieux cerner les traits de cet « assassin » qui constitue notre objet d’étude. Nous détaillerons d’abord le profil juridique de la figure homicide, nous envisageons ensuite son image médiatique, pour enfin esquisser son visage dramatique.
Le meurtrier juridique et judiciaire
8Au xixe siècle, le mot « meurtrier » ne désigne initialement ni une figure, ni un rôle, ni un type, ni un personnage. Il désigne une catégorie juridique. Nous souhaitons observer comment, à travers cette figure, l’art joue avec l’idée de justice au xixe siècle : l’explose-t-il ? La conforte-t-il ? Enfin, comment interroge-t-il « sa légitimité au nom du juste absolu et la fonction qu’elle a dans la société8 » ? En effet, la figuration esthétique de la représentation sociale ou politique peut aussi bien conforter la légitimité de la délégation en l’illustrant, qu’en dévoiler les limites et démontrer le doute sur le simulacre lui-même. Mais avant de confronter la représentation juridique à sa concrétisation scénique, voyons à quoi tient l’existence juridique du criminel en France.
Nullum crimen, nulla poena sine lege9, ou la relativité de la notion de crime
9Sous l’Ancien Régime, les jurisconsultes « définissent le crime comme un comportement contraire à la loi révélée par Dieu10 ». Le crime sous l’Ancien Régime est donc soumis à une conception religieuse à laquelle se juxtaposent des considérations d’ordre social. Cette idée tend ensuite à se laïciser au cours du xviiie siècle, sous l’influence des Lumières qui présentent le crime comme une violation de la volonté générale, et par conséquent comme une rupture du contrat social. Au xixe siècle, cette définition s’impose. Au début du xxe siècle, Émile Durkheim définit le crime comme « un acte qui offense les états forts et définis de la conscience collective », ajoutant qu’« il ne faut pas dire qu’un acte froisse la conscience commune parce qu’il est criminel, mais qu’il est criminel parce qu’il froisse la conscience commune11 ».
10La criminalité apparaît alors comme le produit d’une entreprise de moralisation, de normalisation, de sorte que ce n’est pas tant l’infraction qui, en elle-même, est constitutive du fait criminel, que les réactions sociales qu’elle est susceptible d’entraîner, ainsi que l’activité des institutions de police et de justice qui en découle. Cette théorie souligne avant tout la relativité de la notion. La malléabilité de l’appellation est également sensible si l’on observe l’étymologie du mot « crime », qui vient du latin crimen, criminis, et signifie « accusation ». Étymologiquement, la notion d’incrimination n’est donc pas immédiatement évidente : l’accusation n’implique pas la culpabilité. Un criminel le deviendrait donc une fois que la justice – une certaine justice, en un certain pays, à un certain moment de l’Histoire – en aurait décidé ainsi, et la condition de « criminel » ne serait en aucun cas ontologique, mais attribuée à un citoyen par la justice. À ce propos, le Code pénal est fondé sur l’idée, restée coutumière jusqu’en 1982, puis introduite dans le code, qu’il ne peut y avoir d’infraction sans loi la définissant et précisant la peine qu’elle entraîne (nullum crimen, nulla poena sine lege)12. Le droit français précise donc que le crime ne peut exister en dehors de la loi, et admet ainsi que le criminel n’est autre qu’une création légale. Dans cette perspective, tous les articles de l’ouvrage Représentations du procès : droit, théâtre, littérature, cinéma dirigé par Christian Biet et Laurence Schifano, insistent sur l’aspect théâtral et procédurier de la justice, son aspect artificiel, et permettent de penser le criminel comme une élaboration au sein d’une justice représentative, comme une construction procédurale, qui n’a rien à voir avec l’authenticité d’une personnalité. Être coupable ou innocent veut simplement dire : être passé au travers d’un certain processus au terme duquel on est qualifié tel. Ce système ne prétend pas rendre équivalentes la vérité et la justice. Il accepte le deuil de l’une et la requalification de l’autre, en se calant sur les garanties de procédés de justice, afin que ce que produit la justice soit le moins mauvais possible du point de vue procédural13. Devenir un criminel reviendrait à endosser un rôle judiciaire, et n’importe qui pourrait avoir à endosser ce rôle un jour. Le criminel serait donc un personnage inventé et mis en scène par ce grand dramaturge désincarné qu’est la justice, au cours d’une pièce appelée « procès ». Avant cela, le « criminel » ne serait qu’un pauvre acteur social sans emploi recruté, souvent malgré lui, pour jouer cette sombre pièce.
11À notre période d’étude, quel est le statut du meurtrier au sein de la justice ?
Aperçu juridique du criminel au début du xixe siècle, continuité et assouplissement avec l’Ancien Régime14
12Sous l’Ancien Régime, la justice pénale relève des grandes ordonnances15. Ces textes ont une faible influence dans la définition des déviances, qui est plutôt le fait de lois ponctuelles publiées par édits ou déclaration royales. Il n’existe pas en France de codification générale, à la différence du Saint Empire Romain Germanique qui a son ordonnance criminelle « caroline », élaborée sous Charles Quint en 1532. Jusqu’au xvie siècle, la législation royale française se cantonne à la défense des droits du roi ou de l’ordre public : la prostitution en 1258, la monnaie royale en 1263, le crime de lèse-majesté en 1439 et le vagabondage en 1493. Puis les textes se multiplient, si bien qu’au xviiie siècle, il existe des lois du roi sur presque tous les crimes. Le principe de légalité des infractions n’était pas inconnu de l’ancien droit. On constate une forme de continuité avec le droit d’Ancien Régime, lors de la Révolution et au xixe siècle. Ainsi, la Révolution ne représente pas, juridiquement, une rupture aussi importante que l’on peut avoir tendance à le croire. La hiérarchie des infractions est la seule grande nouveauté révolutionnaire. En effet, même si les codes alors élaborés se présentent comme des réalisations novatrices et non comme des œuvres de consolidation des lois antérieures, ils ne sont que très incomplètement novateurs, surtout le code civil. Le premier Code pénal est adopté par l’Assemblée constituante le 25 septembre 1791, et il présente une hiérarchie claire des infractions, classées par ordre de gravité croissante en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes. Cette hiérarchie est encore valable en droit aujourd’hui. On trouve aussi formulées les peines correspondantes aux infractions. Le xixe siècle se déroule, en matière pénale, sous le signe de la continuité. Le Code pénal napoléonien de 1810 manifeste effectivement une relative stabilité de l’ensemble des intérêts protégés. D’une manière générale, ce code achève le processus de rationalisation du droit pénal. Au xixe siècle, c’est donc l’absence de réformes générales qui prévaut. Il faut attendre 1993 pour qu’une refonte du Code pénal soit entreprise. Seules quelques réformes partielles sont publiées en 1824, 1832 et 1863. Elles portent plus sur les pénalités que sur les incriminations et la technique privilégiée pour adoucir les sanctions est celle de la correctionnalisation. Ces remarques sont tirées de l’analyse des textes, elles concernent donc les sources juridiques. Les études des sources judiciaires sont plus rares. Il semble que les documents de l’application réelle du crime, les arrêts des tribunaux et autres sources, sont plus difficiles à appréhender. Il existe cependant quelques analyses : quelle est donc la place du crime de sang selon les sources judiciaires ?
Le crime de sang dans les sources judiciaires : nuances
13Deux chercheurs ont travaillé sur des sources judiciaires afin de connaître l’application du droit lors des procès au xixe siècle. Michelle Perrot consacre son article à la « double obsession : propriétaire et sexuelle16» du xixe siècle et Gabriel Désert consacre le sien à l’étude sérielle du Compte général de l’administration de la justice criminelle17. À partir de ces analyses, on constate que dans la première moitié du siècle, la justice pénale s’occupe en priorité des délits ruraux et surtout forestiers18. Elle s’oriente à partir du Second Empire « vers la répression du vol devenant de plus en plus astucieux […] et des affaires de mœurs (outrages et attentats à la pudeur, violences sexuelles contre les enfants notamment) alors que semblent décliner les violences les plus graves (recul de l’homicide) mais se maintenir sinon progresser les formes plus atténuées de violence19 ». Le crime de sang est donc beaucoup moins présent sur la scène judiciaire, et c’est alors paradoxalement que naît la mise en place des conditions qui favorisent la politique sécuritaire de la fin du xixe et du début du xxe siècle, c’est-à-dire la représentation systématique des faits divers et crimes odieux.
14Benoît Garnot suppose que cette prolifération d’images de criminels qui augmentent le sentiment d’insécurité au xixe siècle passe par « la publication des statistiques judiciaires, en particulier pénales (à partir de 1826) et à la fin du xxe siècle par celle des statistiques policières (à partir de 1982). La criminalité supposée ainsi mise en chiffre sans précaution méthodologiques ni analyses critiques, devient le baromètre du nouveau fléau des sociétés : bien que les chiffres de la violence la plus brutale reculent, le sentiment contraire ne cesse de se répandre et d’envahir le débat public20 ». Cette prééminence de la figure largement fantasmée du criminel au xixe siècle, malgré son absence remarquée de la scène de la justice pénale, est donc imputable, comme aujourd’hui, à la force des représentations du crime. Cette représentation passe par les médias, alors réductibles aux journaux, aux livres et au théâtre.
Mise en scène médiatique du meurtrier : le crime de sang « sous presse »
Ambiguïtés et approximations de la représentation médiatique du crime
15Les trois thèses majeures relevant de l’analyse du crime dans la presse montrent bien que les faits divers relatant les crimes sont très sélectifs. En effet, les ouvrages de Dominique Kalifa21, Anne-Claude Ambroise-Rendu22 et Marine M’Sili23, concentrés sur la fin du xixe siècle et le xxe siècle, montrent que les violences faites au corps et aux personnes sont nettement privilégiées dans la presse nationale, et que les journaux départementaux sont plus sensibles à une délinquance de proximité impliquant vols et violence mineure. L’homicide reste le grand favori des analyses, alors qu’il est le moins présent dans la réalité des procès. Le pont entre la réalité des procès et la médiatisation exagérée des crimes de sang peut être cette revue dont le premier numéro paraît en novembre 1825. La Gazette des tribunaux met en scène dans ses articles passablement dramatisés les criminels après leur geste, au moment de leur procès. Ce journal quotidien rencontre un grand succès auprès des publics et auteurs, il constitue un formidable réservoir d’intrigues et personnages. Très rapidement, la Gazette des tribunaux devient en effet la source de référence en matière de criminalité, et sa date de naissance correspond à une mutation de la société romantique ainsi qu’à une transformation du théâtre : le mélodrame affirme son inspiration plus réaliste et le drame son caractère spectaculaire et macabre. Ainsi, la presse devient petit à petit une des principales sources d’inspiration du théâtre. Elle alimente la production dramatique en fournissant un réservoir d’intrigues, de geste, de systèmes onomastiques, d’accessoires, et de personnages. Les rubriques « faits divers » des journaux apparaissent au xixe siècle. Dès 1832, Charles Maurice [rédacteur du Courrier des théâtres] abandonne le « cours de littérature » de Villemain et consacre la moitié de son quotidien à la relation de faits divers sordides. Néanmoins, dans le même temps et dans un mouvement presque contradictoire, la presse attaque le théâtre précisément pour sa violence.
L’assassin entre la presse et le théâtre : paradoxe et dénonciation
16Patrick Berthier a bien montré cette ambiguïté du rôle de la presse très sévère à l’encontre des spectacles du drame et très complaisante et crue dans les récits de crime ou les portraits d’assassins. Le xixe siècle est parcouru de ce paradoxe étonnant et tout à fait nouveau : la presse part en guerre contre les excès du drame et se complaît pourtant dans la description des vrais homicides à travers des récits sensationnels en tous genres. Dans son ouvrage sur la représentation de la mort sur les scènes romantiques24, Sylvain Ledda aborde la question des implications esthétiques de la représentation du fait divers. Cette inspiration médiatique modifie les conventions dans le domaine du réalisme des décors, des costumes, et dans l’expressionisme du jeu, et apporte ainsi une nouveauté certaine au mélodrame. Pendant la Monarchie de Juillet, représenter la figure homicide du fait divers serait une manière de concentrer les difficultés sociales, dans une relation spéculaire avec la réalité du quotidien : « Cette réalité […] modifie l’esthétique du mélodrame et politise le drame romantique. Les déboires ne s’achèvent plus dans l’espoir : désormais c’est le crime qui constitue le dénouement25. » Les parallèles entre les crimes de la scène et ceux de la rue s’expliqueraient, après 1830, par la misère sociale, l’inquiétude politique et le sentiment de désillusion qui suit les Trois Glorieuses. Encore selon Sylvain Ledda, « la représentation des meurtres fait donc écho à un contexte difficile […] et le paroxysme de cette négativité s’incarne dans la figure marginale du criminel26 ».
17L’effet d’identification du public, touché de près par cette misère sociale qui peut pousser au crime, n’en est que plus puissant. Ainsi, selon le Courrier des théâtres, le public a été très violemment ému à la représentation, en 1832, de Sophie, ou le mauvais ménage27, où la petite fille meurt empoisonnée à la fin du spectacle. Mais la soirée fut un succès. Représenter ce meurtre involontaire traduit la volonté de montrer le processus de décomposition morale à l’œuvre dans la société, et « cette nouvelle inspiration fait le procès d’une société dont les valeurs se délitent, utilisant le microcosme familial comme lieu emblématique28 ». Le public s’enthousiasme et s’émeut de la vérité des sentiments à l’œuvre dans ce mélodrame qui représente le quotidien difficile d’une modeste famille.
18Christine Marcandier-Colard voit dans l’intérêt pour l’homicide un des signes de la modernité, liée notamment à la nécessité de représenter le réalisme des situations. Cette apparition du fait réel violent au théâtre au xixe siècle procure en tous les cas de nouvelles émotions au public, extrêmement sensible à la représentation de l’ultra violence à travers des figures de criminels dont la proximité est évidente. La réaction du public au mélodrame est déjà connue pour être très intense. Elle a été décrite par Florence Naugrette dans son article sur le plaisir du spectateur romantique :
C’est le mélodrame qui donne le modèle de la contagion des émotions fortes propres à toucher le cœur du spectateur romantique, à produire ce qu’on appelait alors communément une « commotion électrique » ou « galvanique » sur le public sidéré29 […]. De nombreux témoignages de cette exacerbation du pathétique, poussée parfois, dans ses formes les plus excessives, jusqu’à l’hystérie ou à la confusion mentale, existent à l’époque romantique30.
19Ainsi la presse stimule le théâtre au début du xixe siècle, et l’entraîne à lui faire concurrence quant à la représentation terrifiante et fantasmée de l’assassin. Or, quelle est l’histoire de la présence de la figure homicide au théâtre avant 1825 ?
La lignée dramatique des assassins. Justice et théâtre : les origines communes
20Cette figure théâtrale, tout comme son homologue juridique, ne naît pas au xixe siècle, loin de là : les assassins occupent la scène depuis la naissance du théâtre. En Grèce antique, le criminel est présent dès l’origine sur la scène, il y est déjà un personnage emblématique et problématique. Il existe une homologie structurelle entre théâtre et procès, dès leurs origines à tous deux, comme le souligne David Lescot dans son « Le procès, un modèle pour le théâtre épique31 ? ». Dans le cadre de son cours donné à l’École pratique des Hautes Études, Louis Gernet a relevé et analysé le vocabulaire et les structures de nombreuses œuvres tragiques. Selon ses analyses, citées et étudiées par Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet dans Mythe et tragédie en Grèce ancienne, « la matière véritable de la tragédie, c’est la pensée sociale propre à la cité, spécialement la pensée juridique en plein travail d’élaboration32. »
21Ce qui est commun aux deux institutions, théâtrale et judiciaire, est le principe d’incertitude et de fluctuation, signalé par l’imprécision des termes, les glissements de sens, les incohérences, les oppositions et plus généralement un principe de conflit. C’est dans la lutte et l’incertitude que surgit le personnage du criminel sur la scène de la tragédie antique. Et la tragédie elle-même naît en lien étroit avec la pensée juridique balbutiante et ses incohérences. La structure naissante et indécise de la pensée juridique se trouve d’autant plus exacerbée dans la complexité de la tragédie, qui n’est pas réductible à un débat juridique, puisqu’elle « prend pour objet l’homme vivant lui-même ce débat, contraint de faire un choix décisif, d’orienter son action dans un univers de valeurs ambiguës, où rien n’est jamais stable ni univoque33 ».
22Pour exemple de cette lutte et de cette imprécision des valeurs à l’œuvre dans la naissance de la tragédie, on propose l’analyse de la tension entre les lois naturelles et les lois civiques, incarnée par plusieurs personnages de différentes tragédies. D’abord Hécube, personnage éponyme de la pièce d’Euripide, est une mère éplorée qui se fait arracher sa fille Polyxène, exigée en sacrifice par les Grecs pour le repos d’Achille. Cette exigence tout à fait légale entre en contradiction avec la loi naturelle de l’amour maternel. On retrouve ici la lutte entre Nomos et Physis, lutte qui confronte la loi institutionnelle et la loi naturelle. Hécube finit par obtenir la justice qu’elle attend, en contournant la loi de la cité pour mieux faire respecter la loi naturelle à travers une vengeance très violente : elle aveugle Polymore et égorge de ses propres mains ses deux fils pour se faire entendre d’Agamemnon. Ce geste est le même que celui d’Antigone qui, en offrant une sépulture à son frère Polynice, brave la loi de la cité décrétée par son oncle Créon pour répondre à une loi qui lui semble supérieure : celle des dieux, exigeant qu’un homme soit enterré. La valeur du crime et celle du statut de l’assassin sont également puissamment interrogées dans la trilogie de L’Orestie d’Eschyle, où le spectateur assiste à un enchaînement inexorable de meurtres commis par des personnages assurés d’être dans leur droit et de ne pas rentrer dans la catégorie des criminels. Ainsi, le sacrifice d’Iphigénie est considéré comme un meurtre par Clytemnestre qui assassine à leur retour Agamemnon et Cassandre, eux-mêmes vengés par Oreste qui tue sa mère et Égisthe. Le problème de la valeur du crime se pose déjà, car tous les meurtriers sont convaincus d’agir dans le sens de la justice.
23Malgré le caractère problématique de ces divergences essentielles représentées sur scène, Tiphaine Karsenti soutient que s’y trouve le moyen de refonder la cité, de « redonner sens et vie à une structure institutionnelle figée34 ». En effet, cette « fiction d’une anti-cité35 », où apparaît le conflit qui traverse chaque individu-citoyen entre dimension privée et dimension publique aboutirait, « plutôt qu’à une purgation des passions, […] à un renouvellement du pacte entre les individus-spectateurs et la cité36 ». Tiphaine Karsenti remet en cause l’effet cathartique du théâtre pour privilégier son effet politique bénéfique pour l’ordre de la cité. La représentation des assassins qui met en doute les structures juridiques permet aussi de rendre vivantes ces structures, et donc d’en rapprocher les citoyens.
24Dans la tragédie antique, il n’existe pas de personnages de criminel-type, comme le traître dans le mélodrame ; mais toutes les tragédies interrogent la valeur de la justice, et l’on pourrait défendre l’idée que ce motif est structurel du schéma tragique, tant il se retrouve dans chaque pièce.
25L’enjeu de ces prémisses consiste à mieux cerner la figure de meurtrier au xixe siècle, et indiquent bien que l’orientation de notre étude des figures théâtrales d’homicides ne s’intéresse pas du tout à la détermination psychologique et « mentale » du geste. Le meurtrier sera appréhendé comme celui qui, sur la scène, enfreint la loi et détruit le tissu social en lui retranchant un citoyen, dans un contexte esthétique et public. Néanmoins, nous prendrons aussi en compte le sens moral de l’assassinat. Tuer son prochain est considéré comme un péché capital par les textes religieux. L’étymologie du mot « criminel » invite également à considérer cet aspect de la question. Le mot a d’abord deux sens selon le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey. Le premier emploi du mot se rencontre dans les textes de droit, où « criminel » s’oppose à « civil ». Le second se trouve dans les textes chrétiens sous le sens de « spécialement blâmable », car criminatia peccata désigne les péchés mortels. Cette double acception morale et juridique invite à interroger également le rapport du théâtre au sacré, au religieux.
26La thèse comportera trois mouvements afin d’éclairer au mieux ces interrogations sur la figure scénique de l’assassin entre 1825 et 1848. Une première partie s’occupera de catégoriser, selon une approche typologique, les diverses représentations théâtrales des assassins. Ces représentations seront classées selon les origines d’inspiration de l’auteur (histoire, quotidien, imagination) et selon les types d’homicides. La deuxième partie s’attachera aux enjeux esthétiques de la question, selon une approche dramaturgique. Y seront détaillées les lois de représentation selon les genres (drame, tragédie, mélodrame, comédie), ainsi que les enjeux de l’assassinat comme clou de mise en scène. La troisième partie de la thèse sera consacrée aux enjeux idéologiques et politiques de l’étude de la figure de l’assassin en scène, selon une perspective anthropologique. Nous y explorerons les sens sociaux, politiques et ontologiques donnés à la représentation du geste meurtrier.
1 Code pénal de 1810, livre III : « Des crimes, des délits et de leurs punitions », titre II : « Crimes et délits contre les particuliers », chapitre 1 : « Crimes et délits contre les personnes », Section III, § 2 : « Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés », article 324, http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_de_1810.htm.
2 Voir les actes à paraître du colloque « Gazette des tribunaux, laboratoire et miroir de la littérature (1825-1870) », organisé par Sylvain Ledda et Sophie Vanden Abeele-Marchal les 10 et 11 février 2015 à Rouen.
3 Abolie en juillet 1830, la censure est rétablie en 1835, puis supprimée en 1848 pour reparaître en 1850 et s’assouplir en 1859. Supprimée en 1870, la censure refait ultimement surface en 1874.
4 Je développe le raisonnement dans le corps de la thèse.
5 Le terme allemand Figur, qui signifie à la fois silhouette et personnage, souligne l’inconsistance de la notion.
6 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Dunod, 1996, p. 141.
7 Véronique Léonard-Roques (dir.), Figures mythiques. Fabrique et métamorphoses, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, coll. « Littératures », 2008.
8 Christian Biet et Laurence Schifano (dir.), Représentations du procès : droit, théâtre, littérature, cinéma, Nanterre, Université Paris X-Nanterre, coll. « Représentation », 2003, « Introduction », p. 11.
9 « Nul crime, nulle peine sans loi ».
10 Christian Biet et Laurence Schifano (dir.), op. cit., p. 43.
11 Émile Durkheim, De la division du travail social, Paris, PUF, 1930, p. 48.
12 Christian Biet et Laurence Schifano (dir.), op. cit., p. 34.
13 Daniel Soulez-Larivière, « Un système inquisitoire qui s’ignore, une scène judiciaire que personne ne voit », dans Représentations du procès : droit, théâtre, littérature, cinéma, op. cit., p. 48.
14 Ces réflexions s’appuient sur deux ouvrages : celui de Jean-Claude Farcy, L’Histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Trois décennies de recherches, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2001. Ainsi que l’ouvrage de Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, xvie-xxie siècle, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire-inédit », 2009.
15 Blois en 1498, Villers-Cotterêts en 1539 et Saint Germain en Laye entre 1667 et 1670.
16 Michelle Perrot, « Délinquance et système pénitentiaire en France au xixe siècle », dans Annales ESC, janvier-février 1975, p. 67-91.
17 Gabriel Désert, « Aspects de la criminalité en France et en Normandie », dans Cahier des Annales de Normandie, no 13, Marginalité, déviance, pauvreté en France, xve-xixe siècles, 1981, p. 221-316.
18 Les délits de chasse et pêche concernent près de 70 % des prévenus entre 1826 et 1835.
19 Gabriel Désert, op. cit., p. 77.
20 Benoît Garnot, op. cit., p. 80-81.
21 Dominique Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle époque, Paris, Fayard, 1995.
22 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Les Faits divers dans la presse française de la fin du xixe siècle. Étude de la mise en récit d’une réalité quotidienne (1870-1910), thèse d’histoire, Paris, Université de Paris 1, 1997.
23 Marine M’Sili, Histoire des faits divers en République (1870-1992). Une approche de laïcisation de la Providence, thèse d’histoire, Université de Provence, 1996.
24 Sylvain Ledda, Des feux dans l’ombre. La représentation de la mort sur la scène romantique (1827-1835), Paris, Honoré Champion, 2009.
25 Ibid., p. 462.
26 Ibid.
27 Merville et Cornu, Sophie, ou le mauvais ménage, [Paris, Ambigu-Comique, 2 août 1832], Paris, Barba, 1832.
28 Sylvain Ledda, op. cit., p. 464.
29 L’image est très courante à l’époque. Dans la lettre à Flaubert du 10 avril 1874, George Sand écrit : « […] le mystère, s’il y en a un, c’est de provoquer un courant électrique », Correspondance, Georges Lubin (éd.), Garnier, 1964-1991, t. XXIV, p. 18.
30 Florence Naugrette, « Le plaisir du spectateur romantique », dans Olivier Bara et Barbara T. Cooper (dir.) « L’Autre théâtre romantique », Revue d’Histoire du Théâtre, 2012.
31 David Lescot, « Le procès, un modèle pour le théâtre épique ? », dans Représentations du procès : droit, théâtre, littérature, cinéma, op. cit., p. 262.
32 Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, La Découverte, 1972, p. 15.
33 Ibid., p. 16.
34 Tiphaine Karsenti, « Les scènes de procès dans Hécube et Les Troyennes d’Euripide. L’institution à l’épreuve de la tragédie », dans Représentations du procès : droit, théâtre, littérature, cinéma, op. cit., p. 318.
35 L’expression est empruntée par Tiphaine Karsenti à Nicole Loraux et Florence Dupont.
36 Tiphaine Karsenti, op. cit., p. 321.
organisée par Guillaume Cousin à l’Université de Rouen le 27 mai 2015
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Séminaires de recherche », n° 9, 2015
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/185.html.
