Sommaire
Corneille et la pensée du fleuve
sous la direction de Yohann Deguin et Liliane Picciola
no 2, 2024
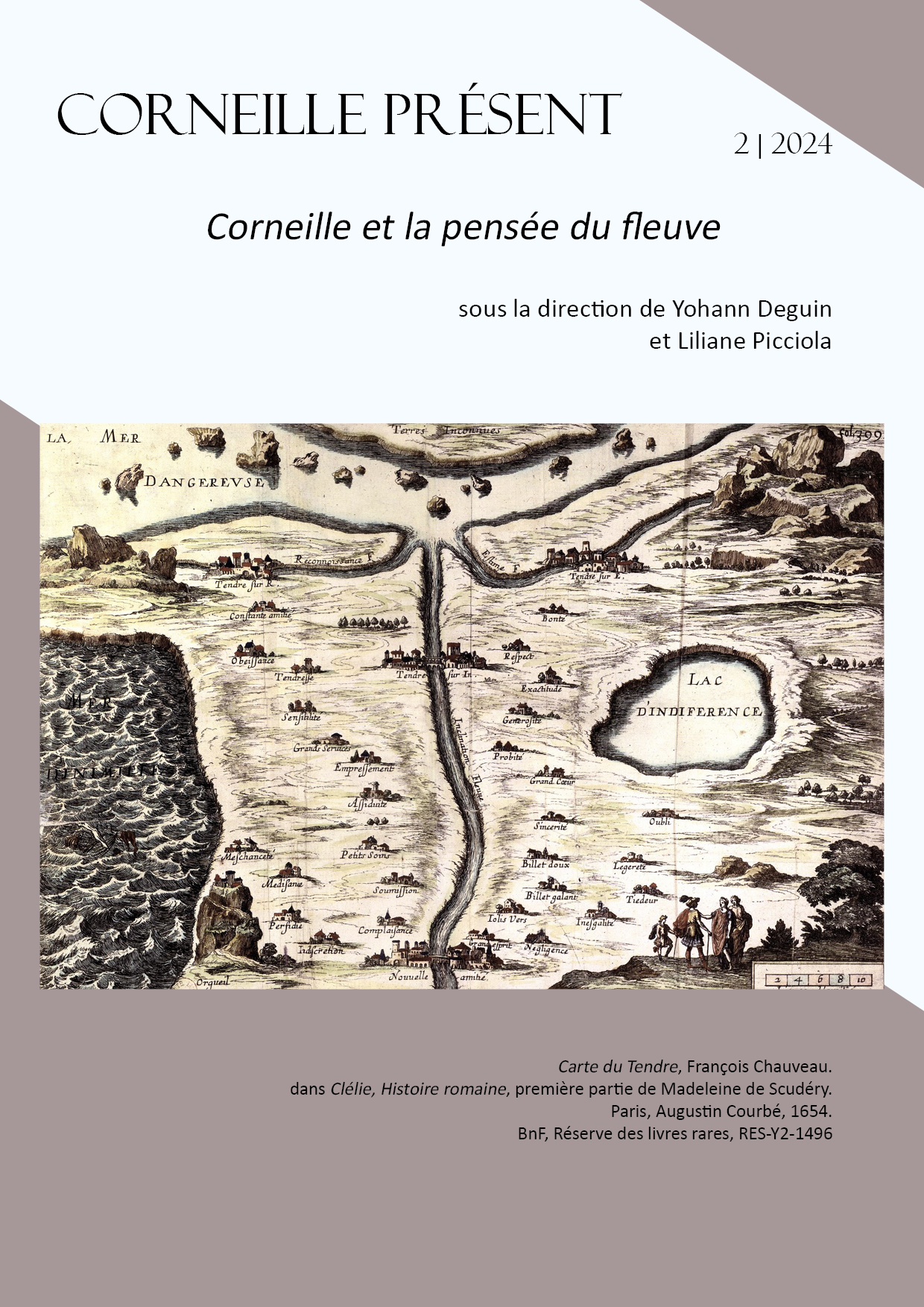
- Liliane Picciola Préface
La pensée du fleuve dans l’œuvre de Pierre Corneille et son frère : contexte dramaturgique et présentation des articles - Julia Gros de Gasquet Le fleuve cornélien comme modèle interprétatif
- Yasmine Loraud De la participation des mentions potamographiques au dynamisme de l’action dans les tragédies cornéliennes
- Tiphaine Pocquet L’image des « fleuves de sang » chez Corneille : quelle figure du passé ?
- Caroline Labrune Les sanglots de Sophonisbe. Tragédie et aridité dans la Sophonisbe de Corneille (1663)
- Liliane Picciola De la Seine de Pierre à la Marne de Thomas : de la familiarité avec les images fluviales à leur utilisation dramaturgique
- Anthony Saudrais De la représentation de la mer à celle du fleuve : une approche technique des tragédies à machines de Pierre Corneille, Andromède et La Toison d’or
- Adrien Bourget, Michaël de Bonnechose et Lucile Martin Anthologie des textes cornéliens lus lors de la journée d’études consacrée à Corneille et la pensée du fleuve
Corneille et la pensée du fleuve
De la participation des mentions potamographiques au dynamisme de l’action dans les tragédies cornéliennes
Yasmine Loraud
Il y a des choses sur qui le poète n’a jamais aucun droit : […] il ne peut pas […] changer la situation des lieux, ou les noms des royaumes, […] de montagnes et des fleuves remarquables1.
1C’est ainsi que Corneille, dans ses Discours, range les fleuves parmi les réalités géographiques intemporelles qui relèvent du savoir commun entre le dramaturge et son public, et par là-même ne peuvent faire l’objet d’aucun changement, pour que soit respectée la vraisemblance caractéristique de la conception régulière du théâtre. Les références à ceux-ci ancrent la fiction dans la réalité connue du spectateur. Par ailleurs, le terme de « fleuve », sans être fréquent, n’est pas rare sous la plume de notre auteur, de même que les noms de plusieurs fleuves célèbres. Il admet dans les dictionnaires du xviie siècle une définition proche de celle de la géographie contemporaine, puisque le Dictionnaire de Furetière dit que ce substantif masculin désigne une « abondance » ou un « amas » « d’eaux douces qui coulent dans un lit, et qui se rendent à la mer », et précise : « Quand ces eaux sont en médiocre quantité, on les appelle rivières. Quand il y a plusieurs rivières jointes ensemble, on les appelle fleuves2 ». Le sens figuré, appelant « fleuve » un abondant écoulement, ne fait pas l’objet d’un traitement lexicologique, mais existe dans les textes, et notamment chez Corneille où il implique des enjeux particuliers. L’auteur recourt aux noms de fleuves comme métonymies des territoires dans lesquels ils s’écoulent, et donne à ces derniers une importance symbolique particulière dans certaines de ses œuvres. Dans ces circonstances, il est intéressant d’étudier comment la référence au fleuve se conjugue aux diverses dimensions données par le théâtre sérieux cornélien à la représentation de l’héroïsme, qu’il l’exalte sur le mode épique, le confronte à l’incertitude tragique, ou souligne la facticité de ses trompeuses imitations.
2Nous verrons tout d’abord que le fleuve emblématise le lieu de la conquête héroïque, opposée à l’engrenage tragique causant le péril de mort du héros ; conquête effective, projetée ou seulement virtuelle, selon le degré de fatalité de l’action représentée. Hors-scène dont la vraisemblance régulière interdit la représentation, il figure l’espace offert à l’action salvatrice ou glorieuse. Cependant, emblème du territoire sur lequel l’héroïsme impose sa marque, il l’est aussi des apories et des difficultés du projet héroïque. Nous verrons donc ensuite comment sa mention se conjugue avec la représentation de la fragilité de l’Empire romain (dont la division menace le héros), de la tyrannie d’une souveraineté faussement héroïque, ou encore de l’incertitude éthique née du conflit des devoirs statutaires ; lieu d’exercice du pouvoir, le fleuve, dans les pièces à machines, sert le déploiement de l’illusion d’une maîtrise du monde marin et fluvial dans un contexte de tromperie généralisée, sans place pour l’héroïsme véritable. Enfin, le fleuve, enjeu territorial, est également symbole, celui d’une Nature dangereuse dont l’héroïsme triomphe, comme il permet d’assurer la domination sur un territoire : le héros de tragédie est ainsi confronté aux fleuves porteurs de mort de la guerre civile.
Des fleuves comme images de l’héroïsme guerrier
3Le mode le plus évident d’association entre la référence au fleuve et la représentation de l’héroïsme consiste à faire de cette réalité géographique le lieu où le héros acquiert son statut par un combat glorieux.
Un lieu pour l’acte héroïque
4C’est le cas dans Le Cid, lorsque Rodrigue, qui vient de mettre à mort le Comte et se désespère d’être à jamais séparé de Chimène, se voit proposer par son père le défi de mettre en déroute les « Mores3 » qui cherchent à attaquer Séville par le Guadalquivir : « La flotte qu’on craignait, dans ce grand fleuve entrée, / Vient surprendre la ville et piller la contrée4. » Ce faisant, don Diègue cherche à dissiper la tristesse de son fils par l’accomplissement d’un devoir patriotique, mais aussi à rétablir sa situation politique et peut-être amoureuse, en lui donnant l’occasion de mettre en éclat son exceptionnelle vaillance. Le cadre fluvial de la bataille est une innovation de Corneille, par rapport à la pièce source de Guillén de Castro5, dans laquelle Rodrigue triomphe de ses ennemis au cours d’une expédition sur terre, dans les montagnes autour de Burgos. On peut expliquer ce changement par un souci de vraisemblance de notre auteur ; devant, contrairement au dramaturge espagnol, limiter à vingt-quatre heures la durée de son action, il n’aurait pas voulu montrer son personnage s’héroïser dans un combat de plusieurs mois, voire de plusieurs années, tels que peuvent l’être les batailles rangées. Cependant, cette transformation est déjà présente dans la tragi-comédie de 1637, moins soumise aux contraintes de la régularité que la version définitive du texte.
5Il faut donc trouver d’autres justifications à cette modification, en lien avec les enjeux politiques et la tension pathétique de la pièce. En effet, l’admiration du spectateur est d’autant plus mobilisée que Rodrigue triomphe d’un danger imminent pour sa patrie et son souverain, et établit une domination incontestée sur un lieu menacé, comme l’attestent ces vers par lesquels il conclut le récit de ses exploits qu’il fait au roi : « Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port, / Sont des champs de carnage où triomphe la mort6. » Si, par modestie, le jeune homme insiste sur la débâcle de ses ennemis plutôt que sa victoire, le spectateur n’en est pas point invité à admirer sa gloire et sa puissance, qui contraste avec l’état pathétique dans lequel l’avait paradoxalement réduit sa victoire sur le Comte. L’attaque maure, bien qu’annoncée un peu auparavant, crée « un effet de deus ex machina sur les personnages et les événements déjà en jeu », elle « produit une crise politique à la cour du roi de Castille don Fernand et facilite la transformation de Rodrigue en héros7 » (M. Longino). Le fleuve envahi est un hors-scène dans lequel le premier acteur peut paradoxalement échapper à l’engrenage tragique de la transgression politique et morale (un duel interdit et un meurtre intrafamilial) imposée par l’honneur, en démontrant une valeur exceptionnelle qui force le roi à lui appliquer une législation d’exception, et rend envisageable le pardon de Chimène. Dans ce contexte, le motif du fleuve emblématise un territoire-rive que Rodrigue sauve in extremis alors que les décisions du souverain ne suffisaient pas à en assurer la défense. En effet, ce dernier était conscient du danger représenté par les Maures, disant à don Arias : « Vers la bouche du fleuve on a vu leurs vaisseaux8 », mais n’avait donné que l’ordre de faire « bonne garde9 ».
6Si Scudéry et Chapelain critiqueront Corneille en jugeant cette relative négligence comme indigne de l’ethos d’un monarque, étant choqués de voir don Fernand « prendre le parti le moins assuré, dans une nouvelle, qui ne lui importait pas moins que de sa ruine10 », elle sert surtout à mettre en exergue la fragilité du pouvoir du roi, et le besoin qu’il a de l’appui et de la fidélité du jeune héros pour maintenir l’intégrité de son royaume. L’argument du bien public justifie ainsi l’indulgence dont il fait preuve envers lui. De fait, les compétences militaires du monarque sont sujettes à caution, puisqu’il semble mal évaluer la rapidité avec laquelle des navires de guerre peuvent se déplacer sur un fleuve ; Rodrigue et surtout don Diègue, eux, ont bien pris cette mesure, et la vaillance du jeune homme comme la prudence de son père sont indispensables à la sauvegarde du royaume.
Un lieu de projet héroïque
7Si le théâtre tragique et tragi-comique cornélien figure des héros triomphants, dont les exploits hors scène permettent un dénouement heureux, il peut également attirer la pitié envers des héros scandaleusement trahis, et mis à mort au faîte de leur gloire. Dans ces œuvres, le tragique naît de l’aveuglement du personnage sur ce qu’il sera en mesure d’accomplir ; le guerrier victorieux projette d’autres conquêtes, en vue de réaliser son devoir d’État, inconscient de l’imminente mort sans gloire qui mettra un terme à son destin. La conquête étant à l’état d’idée, le fleuve n’est plus alors une réalité aussi concrète de l’univers fictionnel que dans Le Cid. Le personnage y fait référence pour désigner par synecdoque le territoire dans lequel il s’écoule ; cette référence « au tout par la partie » est un trope caractéristique de l’écriture poétique des xviie-xviiie siècles qui n’est pas propre à Corneille.
8L’intrigue de Sertorius est caractéristique de cette évocation vaine d’un hors-scène, qui concentre l’attention du premier acteur, alors que tout près de lui, son lieutenant Perpenna fomente son assassinat. De fait, à son entrée en scène, le général romain a déjà une stature de héros qui le met au-dessus des rois (comme l’atteste le désir de Viriate de l’épouser), mais n’a pas achevé sa quête héroïque, car il n’est pas encore parvenu à libérer Rome de Sylla. Dans l’entrevue qui le met en présence de Pompée à la scène 1 de l’acte III, il dépeint « l’image glorieuse » du « retour triomphant » à Rome « qui le pousse à continuer à se battre11 » (Cynthia B. Kerr), en présentant ainsi sa confrontation projetée avec le dictateur : « Et sur les bords du Tibre, une pique à la main, / Lui demander raison pour le peuple romain12 ». La référence fluviale confère une dimension visuelle à l’évocation du futur exploit de Sertorius, où il ne s’agit pas tant de sa gloire que de la dignité de Rome, humiliée par la tyrannie. La « pique », arme du légionnaire qui se substitue ici à l’épée du héros, participe de la même isotopie de la romanité ; c’est moins en chef de guerre exceptionnel qu’en défenseur de son « peuple », que le général espère défaire le tyran. Face aux compromissions de Pompée (M. Prigent) qui compose avec la dictature et l’incite à faire de même, il revendique son devoir de « héros d’État13 ». Le tragique vient du fait qu’il « ne parviendra cependant jamais à franchir l’abîme entre le rêve et la réalité14 » (Cynthia B. Kerr), et que l’intelligence politique dont il fait preuve devant le discours tentateur de Pompée ne se double pas d’une prudence égale face au ressentiment de Perpenna. En effet, le caractère de Sertorius associe à des capacités de raisonnement dignes d’un grand général une sensibilité exacerbée, marquée par un attachement pathétique à la terre natale. S’il est sensible à la proposition d’Aristie, malgré son amour pour Viriate, c’est que l’épouse répudiée de Pompée veut le ramener à Rome ; son cœur est déchiré entre sa passion amoureuse et la nostalgie de sa patrie, ce qui laisse peu de place à une attention soutenue aux dangers immédiats comme la jalousie de son lieutenant. Dans ces circonstances, la thématique fluviale prend une dimension affective, elle confère un aspect concret à l’image de rêve qui emblématise, dans l’esprit et le discours de Sertorius, le mirage de la reconquête républicaine. Cet exploit envisagé est, avant même que la tragédie débute, devenu inutile. En effet, Aristie reçoit à la scène 2 de l’acte V une lettre de son frère l’avisant du fait que Sylla a renoncé de lui-même à la dictature : « Sylla marche en public sans faisceaux et sans haches, / Prêt à rendre raison de tout ce qu’il a fait15 ». La reprise du terme « raison » souligne la vacuité de la démarche de Sertorius, qui veut exposer par force au jugement de Rome un tyran qui s’y soumet de lui-même, d’autant plus que, si l’on tient compte du temps qu’il faut pour que la nouvelle en parvienne en Lusitanie, la démission de Sylla était déjà actée alors que le général présentait son projet à Pompée.
9Cependant, non pertinente dans la réalité fictionnelle de la pièce, la reconquête projetée apparaît possible au spectateur, et la référence au fleuve participe de son caractère grandiose.
Un lieu de conquête fantasmatique
10Il n’en est pas de même de la conquête virtuelle, fantasmée mais impossible à réaliser, tout au moins dans le présent de l’action. Ainsi, le début d’Horace montre Sabine souhaiter que Rome épargne Albe en réalisant à la place d’autres conquêtes. Dans les vers : « Va jusqu’en l’Orient pousser tes bataillons, / Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons16 », la référence fluviale confère une dimension visuelle à l’évocation glorieuse de la jeune femme. Elle exprime ainsi un rêve d’expansion salvatrice, qui effacerait la tragédie familiale et le scandale de la quasi guerre civile opposant les deux cités italiques. Exprimés par une figure que caractérise le tragique de son impuissance à modifier le cours de l’action, ces propos sont marqués par l’ironie tragique, car les guerres victorieuses imaginées par Sabine auront lieu, mais seulement après le passage d’Albe sous domination romaine ; c’est d’ailleurs l’unification du Latium sous l’égide de Rome qui les rendra possible. En effet, c’est l’obligation faite aux citoyens des villes conquises de « suivre en tous lieux les drapeaux du vainqueur17 », qui fournira les soldats nécessaires à l’édification de l’Empire romain. Sa construction suit en effet une logique qui va de la conquête du plus proche au plus lointain. De plus, l’expansion n’est en rien un remède aux conflits internes, contrairement à ce qu’espère Sabine. De fait, la solution apaisée au conflit entre Romains et Albains, substituant à une guerre visant l’asservissement d’une ville à l’autre, un duel (entre les Horaces et les Curiaces) imposant un chef à l’ensemble politique constitué par les deux villes associées, génère un tragique intra-familial plus affreux : les frères de Sabine périssent des mains de son mari, et ce combat le conduit au meurtre de Camille qui le fait passer du statut glorieux de défenseur de Rome à celui de criminel épargné pour raisons politiques. Par la suite, les triomphes militaires de Rome seront doublés par les horreurs des guerres civiles décrites dans les imprécations de Camille, souhaitant à Rome : « Qu’elle-même sur soi renverse ses murailles, / Et de ses propres mains déchire ses entrailles18. » Ces souhaits apportent la sanction du rêve non accompli, d’autant que les divisions de Rome vont favoriser l’hostilité à son égard d’autres territoires et finalement sa chute. Le rêve de Viriate, dans Sertorius, cherchant à rendre « son Espagne en lauriers si féconde », « [q]u’on voie un jour le Pô redouter ses efforts, / Et le Tibre lui-même en trembler pour ses bords19 », exprimant (là encore par des références fluviales) son désir de revanche contre Rome, appuyé sur l’aide que lui fournissent les proscrits romains, ne sera certes pas réalisé par elle. Cependant, l’Empire tombera sous les coups des Germains dont il avait voulu conquérir le Rhin, miné également par des dissensions internes.
11Ces conflits, qui divisent les familles romaines, comme le montrera Cinna, apparaissent ainsi comme un redoublement et un châtiment du fratricide du héros éponyme de la tragédie.
Fleuves et images de pouvoir
Des fleuves pour dire les rivalités intérieures et extérieures de pouvoir
12Si le nom d’un fleuve peut par synecdoque désigner un territoire qui deviendrait un possible lieu d’héroïsation guerrière pour un personnage ou de gloire militaire pour un État, il peut tout aussi bien référer à un lieu d’exercice du pouvoir, constituant une entité politique, plus ou moins délimitée ou autonome. À ce titre, il s’associe, dans les intrigues, à la représentation des difficultés que rencontre le projet héroïque, menacé par les divisions politiques, les conflits de devoirs ou les fausses apparences. Ainsi, pour reprendre les termes de l’Examen de Nicomède, si le fleuve s’inscrit dans l’évocation de la manifestation de la « grandeur de courage », il sert aussi à la figuration du pouvoir, de « la politique20 », ennemie des valeurs héroïques.
13Tout d’abord, les mentions fluviales viennent fréquemment montrer l’extension de l’Empire romain, mais également la fragilité de son unité, qui menace le héros. Ainsi, la Rome de Pompée aura connu la division induite par les guerres civiles opposant aux partisans du personnage éponyme ceux de son ennemi César. Le jeune général romain est constamment présenté comme victorieux et vertueux. Le tragique qui s’attache à lui réside dans l’impossible héroïsation politique que constituerait sa réconciliation avec Pompée, que l’assassinat de ce dernier par Ptolémée empêche définitivement. Le dénouement apparemment heureux de la pièce est ainsi assombri par les menaces qui pèsent sur l’avenir politique de César et son union avec Cléopâtre, dangers annoncés à plusieurs reprises dans l’œuvre. Une de ces prolepses, particulièrement caractéristiques, participent des provocations ironiques de Ptolémée à l’encontre de sa sœur, avec qui il rivalise pour le trône d’Égypte, et réfère à deux fleuves significatifs. Les vers : « Mais César, à vos lois soumettant son courage, / Vous va faire régner sur le Gange et le Tage21 » sont, bien sûr, une manière de détourner l’attention de la princesse des « bords du Nil22 » qu’elle dispute à son frère, en la flattant sur la souveraineté que son hymen avec César va lui apporter, et celle-ci ne s’y laisse pas prendre. Les propos, cependant, mis en réseau avec d’autres éléments de la pièce, ont une portée d’ironie tragique aisément perceptible. En effet, au moment où le roi parle, César domine déjà le « Tage », ayant conquis l’Hispanie sur Pompée ; il ne règnera en revanche jamais sur le « Gange », et cette mention ne sert qu’à le comparer implicitement à Alexandre, dont les conquêtes s’étendront jusqu’aux Indes et avec qui il est souvent mis en parallèle au xviie siècle, souvent pour souligner la qualité plus parfaite de son héroïsme par rapport à l’impétuosité du conquérant macédonien. Le Romain n’aura pas en effet le temps d’étendre à ce point son Empire, et, loin de pouvoir régner avec Cléopâtre, il sera politiquement mis en danger par sa liaison avec celle-ci, la « jeunesse romaine / se [croyant] tout permis sur l’époux d’une Reine23 », selon les vers, partiellement prophétiques, prononcés par Cornélie au dénouement.
14Si les références fluviales contribuent à la figuration par la tragédie des divisions de l’Empire romain en territoires possiblement ennemis et des limites de son étendue, et par là à celle des difficultés menaçant le projet héroïque des personnages positifs, elles peuvent aussi s’intégrer à la figuration d’un faux héroïsme, orgueilleux et criminel sous les apparences de la valeur militaire ou de l’excellence politique. Le fleuve vient alors emblématiser un lieu de pouvoir associé à l’exercice de la tyrannie. Pompée présente ainsi en Ptolémée un souverain à la légitimité certes contestable, car il usurpe la part de pouvoir due à sa sœur, mais qui surtout se laisse entraîner dans la criminalité tyrannique (meurtre de Pompée, puis tentative d’assassinat de César), par les mauvais conseils de Photin. Ce ministre, en effet, constatant la désapprobation par César de la mise à mort de Pompée, et la menace de partage du pouvoir avec Cléopâtre que le Romain compte imposer au roi, préconise de faire assassiner le jeune général romain par la suite de la veuve de Pompée, désireuse de venger son maître. Le roi croit s’imposer à Rome en souverain héroïque par ces décisions, mais ne fait qu’exciter l’horreur de ceux dont elles servent les intérêts (César, puis Cornélie), ce qui le conduira à sa perte. L’Égypte sur laquelle il règne, ces « bords du Nil24 », qui délimitent sa puissance et ses devoirs, sans qu’il puisse prétendre arbitrer le destin de Rome, devient le lieu par excellence du pouvoir corrompu qui menace la grandeur romaine, en suggérant successivement aux camps en présence la tentation d’une aide infâme. À l’indignation de César devant un crime dont il bénéficie pourtant involontairement, répond le refus de Cornélie, plus méritoire encore, de laisser un meurtre venger son époux et faire triompher sa cause ; elle prévient César de l’attentat fomenté contre lui. Elle justifie sa démarche par le respect des valeurs de Rome, qui déteste avant tout les criminels « [e]t tiendrait à malheur le bien de se voir libre, / Si l’attentat du Nil affranchissait le Tibre25 ». La formule suggère toutefois la possibilité d’une action salvatrice qui serait éthiquement condamnable, ce dont atteste par ailleurs le cours de l’action : en effet, la domination héroïque de César à la fin n’est permise que par la contribution honteuse de Ptolémée.
15Si la référence fluviale s’associe à l’évocation de la tyrannie d’exercice, elle contribue ailleurs à celle de la tyrannie d’usurpation potentielle qui menace le pouvoir de l’empereur légitime et oriente ses décisions. L’intrigue de Tite et Bérénice26 montre ainsi la séparation du couple éponyme, héroïquement choisie pour répondre au défi politique posé conjointement par Domitian et Domitie, apparemment insoluble. Celle-ci, figure faussement héroïque, soutient son « droit imaginaire27 » à l’Empire (son père Corbulon ayant été, avant son suicide, élu empereur par les troupes d’Orient) par un courage véritable, menaçant de soulever Rome contre Tite s’il épouse Bérénice. Jeune frère de l’empereur, Domitian s’était révolté contre son père Vespasien et pourrait le faire à nouveau contre son successeur, si ce dernier le privait de la main de Domitie. Dans le discours de Philon, qui dépeint à Bérénice sa difficile situation à la scène 1 de l’acte IV, la référence fluviale vient souligner, dans les vers : « Il se faisait le chef de la rébellion, […] / Et les deux bords du Rhin l’auraient pour Empereur28 », le danger politique réel représenté par Domitian, qui aurait pu causer une scission de l’Empire dans le passé et serait capable de déclencher une guerre civile. Ainsi, la séparation des amants éponymes n’est pas seulement obéissance à une loi abstraite de Rome, mais résolution glorieuse d’un conflit politique réel ; Tite y répond héroïquement en renonçant à la main de celle qu’il aime et en associant à son pouvoir ses deux opposants.
Un fleuve pour dire l’autosuffisance
16Emblèmes des lieux de pouvoir qui menacent la vie des héros ou accueillent le déploiement d’un faux héroïsme, les fleuves viennent souligner les difficultés du projet héroïque mis en péril par les manœuvres de la politique. Mais ils peuvent aussi figurer les patries qui dictent leurs devoirs aux généreux, dont la pluralité et les exigences concurrentes menacent les alliances qu’ils sont susceptibles de conclure. L’héroïsme cornélien, en effet, est rarement la réponse à un impératif catégorique universalisable, mais se comprend plutôt comme le respect des normes de comportement attachées à un statut social élevé, correspondant à un emploi de théâtre, dans une situation de crise qui oblige le personnage à exposer sa vie ou à vaincre sa passion. Même alliés, les généreux peuvent ainsi avoir des devoirs distincts, et cela constitue une part du tragique de Sertorius. En effet, le couple formé par Viriate et le Romain est divisé par des projets politiques incompatibles. La reine souhaite en effet assurer la liberté de sa Lusitanie face à Sylla sans l’exposer par la poursuite de la guerre. Dans le vers 1333 : « Affranchissons le Tage, et laissons faire au Tibre29 », elle use de deux références fluviales pour distinguer l’espace de son royaume qu’elle souhaite préserver, et le reste de l’Empire (dont la ville de Rome elle-même), pour lequel elle affiche son désintérêt. En tant que reine, elle est tenue de ne pas exposer ses sujets pour des enjeux politiques qui ne sont pas les leurs, mais, ce faisant, elle détourne Sertorius de son devoir héroïque de Romain, et cela d’autant plus que le retour de la liberté à Rome menacerait l’indépendance des autres peuples. Ses obligations de souveraine l’amènent ainsi à suggérer au général qu’elle aimerait accepter une forme de compromission passive avec la tyrannie. Dans les vers : « Pour les enchaîner tous sur les rives du Tage, / Nous n’avons qu’à laisser Rome dans l’esclavage30 », la référence fluviale, associée au champ lexical de la contrainte, souligne le caractère paradoxal de l’« asile31 » qu’elle offre aux proscrits, qui pourrait devenir « une prison ressemblant paradoxalement à la ville que ces citoyens ont quittée par amour de la liberté32 » (Cynthia B. Kerr), ou tout au moins une entité politique ne tirant sa valeur que de l’asservissement de la patrie d’origine des bannis. Le tragique de Viriate réside dans sa volonté paradoxale de faire un roi héroïque d’un général romain s’étant illustré par sa défense de la République, car elle ne peut, sans lui, répondre pleinement à ses devoirs politiques. Corneille montre ainsi le camp des opposants à Sylla traversé de projets héroïques incompatibles, avant que la trahison n’en détruise le poids politique, et que la démission du dictateur ne le vide de sa raison d’être. Viriate, sans appui au dénouement, n’obtient de Pompée qu’une paix généreuse qui maintient la liberté de ses sujets, mais prévoit leur intégration à terme dans l’Empire romain.
Un fleuve pour symboliser la maîtrise des éléments
17Tragédie à machines obéissant à une autre esthétique, La Conquête de la Toison d’Or présente une version complexe du lien entre réflexion sur le pouvoir et figuration du fleuve. Cette dernière est effet étroitement associée à la suggestion d’une domination héroïque des dangers et des forces qu’il représente, spectaculaire à première vue, mais s’avérant par la suite résulter d’un pouvoir fuyant, insaisissable et peu pérenne. L’une des héroïnes, semblant maîtriser le Phase, n’a en fait pas sur lui de réelle puissance, et cette illusion, que la suite de l’action détruit, participe de la « dégradation de l’image du héros33 » (N. Akiyama), caractéristique de la pièce. En effet, le spectateur est confronté, à l’acte II, à une figuration scénique de « la rivière du Phase » et du « paysage qu’elle traverse34 », comme l’indique la didascalie d’ouverture, tandis qu’à la scène 3, l’arrivée en majesté de la reine de Lemnos met en évidence les soutiens divins dont elle dispose, dont Glauque qui « commande […] au fleuve de retirer une partie de ses eaux pour laisser prendre terre à Hypsipyle35 », comme l’indique la didascalie, et, se revendiquant de l’autorité de « Neptune36 », permet à la Lemnienne de s’attribuer le prestige de l’univers fluvial et maritime aux yeux du spectateur comme d’Absyrte qu’elle éblouit. Ce triomphe contraste avec le désespoir de la jeune femme devant l’indifférence de Jason et sa faiblesse lorsque Médée la plonge dans un « palais d’horreur37 », dont elle n’est sauvée que par une intervention du prince de Colchide, planifiée par la magicienne pour servir les intérêts amoureux de son frère. Aux yeux du public, Hypsipyle perd assez rapidement son statut de « rivale sérieuse38 » (S. Seibel) de Médée, pour n’apparaître plus qu’en victime pathétique de l’inconstance de Jason. Son illusoire domination sur le fleuve contribue cependant à ce qu’Aète la croit complice du vol de la Toison, lui supposant, du fait de « [c]e pompeux appareil que soutenaient les vents », et de « [c]es tritons tout autour rangés comme suivants », un « art plus fort que celui de Médée39 », et se laissera prendre à la ruse de sa fille, qui prétend défendre la Toison pour mieux la dérober au profit de son amant. Hypsipyle est ainsi caractérisée par l’apparente facilité d’une maîtrise sur les éléments qui masque son impuissance réelle ; comme son navire glisse sur le fleuve, son pouvoir lui échappe lorsqu’elle est face à une adversité réelle. Cette puissance factice lui dénie tout véritable héroïsme et fait écho au pouvoir paradoxal de Médée, qui « commande » « les machines40 » (S. Seibel) au plan scénique, et dans l’univers fictionnel, domine magiquement les éléments naturels, mais qui est elle-même « victime d’une machination divine qui est la cause de ses propres ruses et intrigues », en suivant les conseils de Junon déguisée en sa sœur Chalciope, et surtout des « illusions verbales, rhétoriques41 » (S. Seibel) du discours amoureux persuasif de Jason. Son pouvoir, qui ne la préserve pas plus qu’Hypsipyle de l’inconstance du jeune premier, est presque aussi illusoire que la maîtrise du Phase par la Lemnienne. Sans aptitude à dominer ses passions, il n’y a pas de véritable héroïsme, ni de pouvoir suffisant pour échapper à la condition de victime.
L’eau « noire » des fleuves et la faute héroïque
18Nous venons de voir que, s’ils peuvent désigner par synecdoque les territoires que le héros conquiert, les fleuves matérialisent également, sous la plume de Corneille, les lieux où le pouvoir s’exerce, entités politiques qui, par les moyens d’action qu’elles offrent ou les exigences qu’elles impliquent, manifestent les apories et difficultés du projet héroïque. À rebours de l’exaltation épique de la conquête, la géographie fluviale peut ainsi contribuer à la dénonciation tragique de la tyrannie d’exercice ou d’usurpation qui menace l’héroïsme politique, à l’évocation pathétique des projets héroïques concurrents, supportés par des devoirs statutaires dissemblables, et frappés d’impossibilité, ou encore à la mise en exergue des limites et de la facticité d’un pouvoir qui se limiterait à la maîtrise des éléments naturels.
19Cependant, l’évocation du fleuve s’inscrit aussi chez notre auteur dans un imaginaire qui se rattache au « symbole de l’eau hostile, de l’eau noire42 » (G. Durand), associée, parmi les « symboles nyctomorphes », à la mort et au « sang […] qui s’échappe avec la vie par la blessure43 ». Il figure ainsi le danger tragique par excellence dont triomphe la valeur véritable du héros, ou que feint de vaincre le faux héroïsme. En effet, s’il peut référer par synecdoque à un territoire, le terme de « fleuve » admet également un emploi métaphorique, associé à celui de « sang », pour référer à un très grand nombre de morts violentes simultanées.
Fleuves de sang : la faute
20L’image est surtout mobilisée dans l’évocation des guerres civiles, et Corneille enrichit volontiers cette métaphore lexicalisée pour la faire participer de « l’hypotypose classique44 » (M. Dufour-Maître), dont les « images “illusionnistes” » « déploient une puissance à la mesure de l’imaginaire, et décuplée encore par la frustration45 » qu’impose le rejet hors de la scène des actes violents par les bienséances. Ainsi, dans la description par Ptolémée de la bataille de Pharsale, qui ouvre Pompée, les vers : « Ses fleuves teints de sang, et rendus plus rapides / Par le débordement de tant de parricides46 » confèrent une dimension concrète à l’image usuelle. Ce ne sont plus seulement les combats qui ont fait couler de symboliques flots de sang, mais la rivière Énipée, affluent du fleuve Pénée qui baigne Pharsale en Thessalie, qui prend la couleur du sang des soldats morts et voit son cours accéléré par leurs cadavres. Pareillement, dans Cinna, le monologue d’Auguste file cette métaphore, dans le vers : « Songe aux fleuves de sang où ton bras s’est baigné47 », pour ajouter à l’évocation des massacres des guerres civiles ayant assuré son pouvoir à Rome, celle de sa propre participation cruelle à ces crimes. L’emploi de ces images influence la perception par le spectateur des deux figures dont l’héroïsme lui est donné à admirer au cours de l’action. Dès le début de La Mort de Pompée, l’exceptionnelle valeur guerrière de César, rendue plus admirable encore par la générosité morale que manifeste sa compassion envers son ennemi tué, est pourtant vue sous le prisme du crime, et notamment de celui qui constitue la faute tragique par excellence dans la théorie aristotélicienne, le « surgissement de violences au cœur des alliances48 ». En effet, les guerres civiles, séparant Rome en deux camps, divisent aussi les familles, et notamment le « beau-père » César, de son « gendre49 » Pompée, comme précisé au vers 2. Corneille renforce ainsi la coloration tragique du sujet épique qu’il reprend de Lucain, en présentant le héros (qu’il idéalise pourtant par rapport à l’image qu’en donne l’auteur antique) comme le responsable et le bénéficiaire involontaire de la mort d’un parent. Le spectateur est conduit à s’interroger sur la capacité du premier acteur à dépasser héroïquement le conflit avec le parti adverse pour établir la paix à Rome ; cette héroïsation supérieure se révèlera difficile à mettre en œuvre au dénouement.
21En revanche, dans Cinna, la référence aux « fleuves de sang » du monologue d’Auguste s’inscrit dans une évocation du passé tyrannique du souverain et de la menace qu’il fait peser sur le présent. La scène dans laquelle il prend place est en effet à mettre en regard avec le tableau des proscriptions dressé par le personnage éponyme à Émilie, qui dès le début amène à se demander si « un passé qu’on n’a pas vécu et qu’il est besoin de faire (re)vivre par le moyen violent et partial de l’hypotypose » peut « gouverner le temps présent50 » (M. Dufour-Maître), en faisant du châtiment des crimes commis un devoir moral. En effet, Auguste entre dans une démarche inverse de celle du jeune homme ; en rappelant les meurtres qui l’ont porté au pouvoir, il se rend compte de l’aporie dans laquelle il se trouve, qui semble ne lui laisser plus d’autres choix que de massacrer ses amis et lui-même, pour mieux mettre à distance son passé. Il « joue sur une scène mentale des catastrophes ensanglantées afin de mieux les conjurer51 » (C. Thouret). Sa méditation sur celles-ci lui suggèrera l’acte d’une qualité héroïque supérieure qui permettra un dénouement heureux, et le fera reconnaître « vrai Monarque52 », pour reprendre l’expression de Livie.
Noyades infamantes
22Significativement, les deux pièces mettent en lien le motif du fleuve sanglant avec un autre relevant de la même symbolique, celui de la noyade. Motivée par le désespoir, elle peut avoir lieu dans des univers aquatiques différents selon les pièces, fleuve ou mer. Cette mort relativement infamante est le péril par excellence couru par le personnage le plus coupable (parmi les principaux), celui dont la dégradation éthique est la plus affirmée au cours de l’action : Ptolémée, dans Pompée, et Maxime, dans Cinna. Dans les deux cas, leur sort final contribue à la caractérisation de l’héroïsme de celui contre qui ils complotent sans succès.
23D’une part, le frère de Cléopâtre, qui, une fois sa tentative d’assassinat découverte, se bat vaillamment et refuse de se rendre, croyant que César le destine au supplice, meurt effectivement dans le naufrage du bateau dans lequel il fuit en dernier recours, que « la mer […] engloutit avec tout son fardeau53 ». Certes, le discours d’Achorée insiste sur le courage du roi d’Égypte et, en affirmant que « sa mort lui rend toute sa gloire54 » à Cléopâtre cherche à consoler cette dernière ; cependant, si le quasi suicide de Ptolémée conforte la victoire de César et le règne de Cléopâtre tout en leur conservant les « mains pures55 », et la sympathie entière du public, force est de constater que le roi périt dans des conditions humiliantes et indignes de son rang. En outre, César se retrouve à nouveau responsable et bénéficiaire de la mort d’un proche, qu’il ne parvient pas à empêcher alors qu’il fait tous les efforts possibles pour cela. L’expression « du roi l’invincible malheur56 » met en exergue les limites de l’héroïsation de César. Pas plus qu’il ne parvient à se réconcilier avec Cornélie, il ne réussit à convaincre Ptolémée de sa générosité, et plus généralement à s’affirmer en figure salvatrice.
24La configuration est étrangement similaire dans Cinna, tout en ayant une issue contraire. Le spectateur est amené à croire que Maxime, traître à ses amis et à son souverain, puisqu’il dénonce le complot non par repentir, mais par déception amoureuse, a voulu se noyer par culpabilité. Cette action est d’abord évoquée par Euphorbe : « soudain dans le Tibre il s’est précipité57 », qui la relate à Auguste, puis par Fulvie : « On parle d’eaux, de Tibre, et l’on se tait du reste58 », qui la raconte à Émilie. Dans les deux cas, l’imprécision des discours conduit à penser que le jeune homme est mort. À la scène 1 de l’acte IV, le récit est l’occasion pour Auguste de manifester son ethos de souverain en affirmant : « Il n’est crime envers moi qu’un repentir n’efface59 » ; cependant, les « bontés60 » du souverain semblent ne rien pouvoir contre le fleuve mortifère. Si cette noyade se révèle bien vite n’être qu’un mensonge d’Euphorbe, pour favoriser la fuite d’Émilie et Maxime hors d’Italie, Maxime est ensuite montré désespéré et voulant se tuer après avoir été repoussé par celle-ci. Le traître n’est certes pas « sauvé des eaux61 », comme le croit Auguste, mais la symbolique n’est pas invalidée pour autant : Maxime connaît un péril de mort réel et le fait qu’il soit en vie et pardonné au dénouement contribue au rayonnement de l’héroïsme du souverain.
25Ainsi, dans le théâtre tragique et tragi-comique de Corneille, le fleuve emblématise tout d’abord le lieu de la conquête héroïque, réalisée, projetée ou rêvée, qui vient démontrer la valeur du personnage et/ou le prestige de l’État qu’il sert, et qui, dans le déroulement de l’action, est susceptible de s’opposer à l’engrenage tragique. Cependant, si le fleuve symbolise l’espace offert au triomphe militaire, il peut désigner aussi un lieu où s’exerce un pouvoir, une entité politique qui sert la puissance d’un personnage et lui impose des devoirs. La référence fluviale contribue alors à la représentation des apories et difficultés du projet héroïque, qu’il s’agisse des divisions territoriales à l’origine des rapports de force menaçant le héros, de l’exercice d’un pouvoir injuste masquant sa tyrannie sous un faux héroïsme, ou encore de l’incompatibilité de devoirs statutaires minant l’alliance des généreux. Dans la tragédie à machines, le fleuve, figuré sur la scène, contribue à la mise en évidence de la facticité d’un héroïsme qui n’est que domination sur les éléments sans victoire sur soi-même. Outre cette fonction de support à l’exercice d’un pouvoir, politique ou magique, le motif du fleuve dans le théâtre sérieux cornélien s’intègre également dans une symbolique, celle de la domination du héros sur « l’eau hostile62 » (G. Durand) du fleuve porteur de danger et de mort. La vertu héroïque propre au souverain s’atteste ainsi dans sa capacité à fonder une paix durable malgré les fleuves de sang des conflits passés et à sauver de la mort par engloutissement ses opposants qu’il réconcilie avec lui. Qu’il s’agisse de l’évocation d’une réalité du monde fictionnel, ou du déploiement d’un imaginaire, la référence au fleuve participe ainsi du double regard demandé par Corneille sur l’héroïsme qu’il représente, mobilisant l’admiration du public par le spectacle d’une valeur extraordinaire, mais l’incitant à la réflexion sur les limites posées à l’héroïsation par des situations complexes et sur le caractère illusoire d’une fausse vertu politique ou d’une puissance sans maîtrise de soi.
1 Pierre Corneille, Discours de la tragédie, dans Œuvres complètes, t. III, textes établis, annotés et présentés par Georges Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984.
2 Antoine Furetière, Dictionnaire Universel [Ressource électronique], dans Paris, Classiques Garnier Numérique, « Dictionnaires des xvie et xviie siècles », p. 8806 / 19245.
3 Pierre Corneille, Le Cid, éd. L. Picciola dans Pierre Corneille, Théâtre, t. II, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du théâtre français », 2017, p. 575-901, III, 6, v. 1085.
4 Ibid., III, 6, v. 1083-1084.
5 Guillén de Castro y Bellvis, Les Enfances du Cid, traduction de R. Marrast, dans Théâtre espagnol du xviie siècle, tome 1, éd. publiée sous la dir. de Robert Marrast, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1994, p. 859-923.
6 Pierre Corneille, Le Cid, éd. citée, IV, 3, v. 1309-1310.
7 Michèle Longino, « Politique et théâtre au xviie siècle : les Français en Orient et l’exotisme du Cid », dans Littérature et exotisme, xvie-xviiie siècle [en ligne], Paris, Publications de l’École nationale des chartes, 1997, http://books.openedition.org/enc/1041, page consultée le 3 janvier 2024.
8 Pierre Corneille, Le Cid, éd. citée, II, 6, v. 609.
9 Ibid., II, 6, v. 637. En 1660, Corneille corrige son texte et le roi demande de faire doubler la garde.
10 Jean Chapelain, Les Sentiments de l’Académie française sur la tragi-comédie du Cid, dans La Querelle du Cid, 1637-1638, édition critique intégrale par Jean-Marc Civardi, Paris, Honoré Champion, « Sources classiques », 2004.
11 Cynthia B. Kerr, « Temps, Lieux et Paradoxes dans Sertorius », Revue d’Histoire Littéraire de La France, vol. 83, no 1, 1983, p. 15-28, p. 23.
12 Pierre Corneille, Sertorius, éd. G. Couton, dans Corneille, Œuvres complètes, t. III, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1987, III, 1, v. 815-816.
13 Michel Prigent, Le Héros et l’État dans la tragédie de Pierre Corneille, Paris, PUF, « Quadrige », 2006.
14 Cynthia B. Kerr, ouvrage cité, p. 23.
15 Pierre Corneille, Sertorius, éd. citée, V, 2, v. 1631-1632.
16 Horace, édition critique de Laura Rescia, dans Pierre Corneille, Théâtre, t. II, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du théâtre français », 2017, p. 903-1043, I, 1, v. 49-50.
17 Ibid., I, 3, v. 314.
18 Ibid., IV, 5, v. 1311-1312.
19 Pierre Corneille, Sertorius, éd. citée, V, 1, v. 1602-1604.
20 Examen de Nicomède, dans Nicomède, édition critique de Sandrine Berrégard, dans Corneille, Théâtre, t. IV, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du théâtre classique », 2024, p. 1137-1138.
21 La Mort de Pompée, édition critique de Liliane Picciola, dans Corneille, Théâtre, t. III, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du théâtre français », 2023 (p. 415-603), II, 3, v. 625-626.
22 Ibid., II, 3, v. 624.
23 Ibid., V, 4, v. 1753-1754.
24 Ibid., II, 3, v. 624.
25 Ibid., IV, 4, v. 1417-1418.
26 Dans la perspective de l’étude de la thématique du fleuve, Tite et Bérénice, que Corneille qualifie de « comédie héroïque » du fait de l’absence de péril de mort immédiat, peut être assimilée aux tragédies.
27 Tite et Bérénice, éd. G. Couton, dans Corneille, Œuvres complètes, t. III, éd. citée, II, 1, v. 419.
28 Ibid., IV, 1, v. 1096-1101.
29 Sertorius, éd. citée, IV, 2, v. 1333.
30 Ibid., IV, 2, v. 1361-1362.
31 Ibid., I, 1, v. 51.
32 Cynthia B. Kerr, ouvrage cité, p. 20.
33 Nobuko Akiyama, « Corneille et ses pièces à machines », Dix-septième siècle, 2010/3 (no 248), p. 403-417.
34 La Toison d’Or, éd. G. Couton, dans Corneille, Œuvres complètes, t. III, éd. citée, II, « Décoration du second acte ».
35 Ibid., II, 3.
36 Ibid., II, 4, v. 918.
37 Ibid., III, « IIe Décoration du troisième acte ».
38 Selina Seibel, « Machines et machinations dans La Conquête de la Toison d’or de Corneille », Littératures classiques, 2021/2 (no 105), p. 159-171.
39 Pierre Corneille, La Toison d’Or, éd. citée, V, 2, v. 1908-1911.
40 Selina Seibel, ouvrage cité.
41 Ibid.
42 Gilbert Durand, « Chapitre II : Les symboles nyctomorphes », dans Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Introduction à l’archétypologie générale, Dunod, « Hors collection », 2016, p. 80.
43 Ibid.
44 Myriam Dufour-Maître, « Chapitre 4. “Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée” », dans La Clémence et la grâce : Étude de Cinna et de Polyeucte de Pierre Corneille, Mont-Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014. Disponible sur Internet à l’adresse : https://books.openedition.org/purh/3111, page consultée le 4 janvier 2024.
45 Ibid.
46 La Mort de Pompée, éd. citée, I, 1, v. 5-6.
47 Cinna ou la clémence d’Auguste, édition critique de Liliane Picciola, dans Pierre Corneille, Théâtre, t. III, Paris, Classiques Garnier, « Bibliothèque du théâtre français », 2023 (p. 47-242), IV, 2, v. 1132.
48 Aristote, La Poétique, texte, traduction, notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot, Paris, Éditions du Seuil, 1980, p. 81.
49 La Mort de Pompée, éd. citée, I, 1, v. 2.
50 Myriam Dufour-Maître, ouvrage cité.
51 Clotilde Thouret, « Une fidélité moderne : de quelques usages de l’histoire dans la tragédie cornélienne (Cinna, Sophonisbe) », Littératures classiques, 2011/2 (no 75), p. 109-123.
52 Cinna ou la clémence d’Auguste, éd. citée, IV, 3, v. 1266.
53 La Mort de Pompée, éd. citée, V, 3, v. 1660.
54 Ibid., V, 3, v. 1661.
55 Georges Forestier, Essai de génétique théâtrale. Corneille à l’œuvre, Paris, Droz, 2004, p. 215.
56 La Mort de Pompée, éd. citée, V, 3, v. 1668.
57 Cinna ou la clémence d’Auguste, éd. citée, IV, 1, v. 1112.
58 Ibid., IV, 4, v. 1290.
59 Ibid., IV, 1, v. 1117.
60 Ibid., IV, 1, v. 1116.
61 Ibid., V, 3, v. 1664.
62 Gilbert Durand, ouvrage cité.
sous la direction de Yohann Deguin et Liliane Picciola
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Revue Corneille présent », n° 2, 2024
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1814.html.
Quelques mots à propos de : Yasmine Loraud
Université de Créteil
