Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
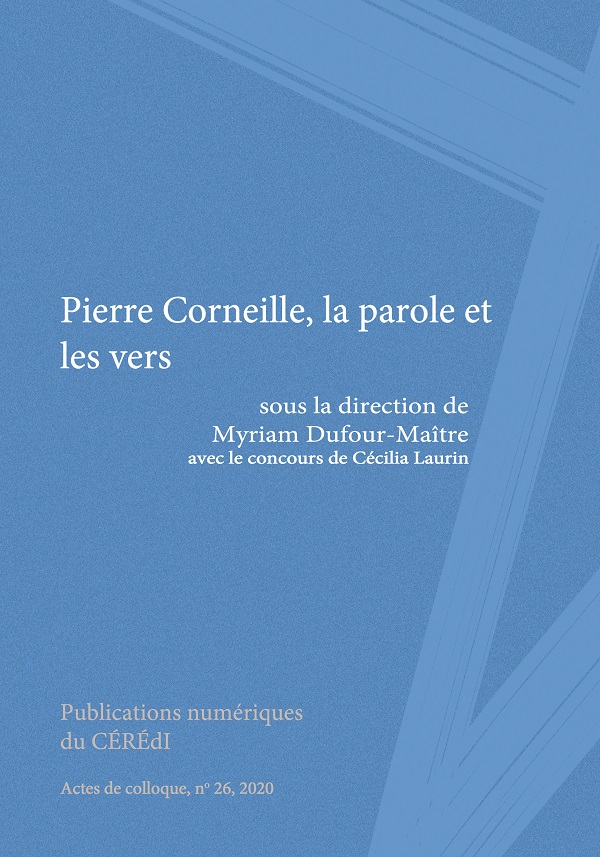
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Pierre Corneille, la parole et les vers
Introduction
Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola
1On a abondamment parlé, on parle encore de la « poésie racinienne », et très peu au fond de la « poésie cornélienne », notamment depuis que les Commentaires de Voltaire ont fixé la topique du « poète froid1 ». On retrouve jusque naguère encore l’idée d’un Corneille peu apte ou peu enclin aux chatoiements du vers : ainsi Georges Couton estimait que le « secret » de la poésie de Corneille restait à trouver, ajoutant que l’« un de ses éléments pourrait être l’austérité2 ». C’est même le soupçon d’une sécheresse qu’a véhiculé l’imagerie cornélienne, à travers la légende de la trappe par laquelle Thomas Corneille aurait soufflé des rimes à son prestigieux aîné3. Le mythe critique de « Corneille penseur », opposé à « Racine poète » (lyrique), a pu enfin largement occulter le travail du vers chez Corneille, et la réduction de son œuvre à une morale pour lycéens a parachevé l’éloignement pour « ce paquet d’alexandrins dont on m’a gavé dans ma jeunesse », comme s’en plaint Claudel qui conclut : « Non, Corneille n’est pas un poète4. » Supposé reconnaissable entre tous, presque réduit à la seule frappe des fameuses sentences, le « vers cornélien » est en effet aussi une (re)construction de l’histoire littéraire, qui lui fait place entre le vers supposé archaïque de Hardy (Sylvain Garnier) et celui réputé novateur de Hugo (Jean-Yves Vialleton).
2Corneille de surcroît n’a guère fourni de théorie en forme de sa versification5 : après Aristote et avec les écrivains de son temps, il tient l’elocutio pour une partie seconde de l’écriture. Dans l’élaboration du « poème dramatique », la versification est conçue – ou du moins présentée – comme une étape tardive et de moindre importance que l’invention du sujet, le seul moment qui relève de la poétique au sens propre : parmi les six parties « intégrantes » du poème, qui sont « le Sujet, les Mœurs, les Sentiments, la Diction, la Musique, et la Décoration du Théâtre […] il n’y a que le Sujet dont la bonne constitution dépende proprement de l’Art Poétique6 ». Au moment où il achève la rédaction de ses Discours, Corneille en résume le plan à Michel de Pure, et ajoute : « […] après cela, il n’y a plus guère de question d’importance à remuer et […] ce qui reste, n’est que la broderie qu’y peuvent ajouter la rhétorique, la morale, et la politique7 ». La versification relève-t-elle aussi de la « broderie », ornement ajouté ? Corneille aurait-il pu dire, comme Racine ayant achevé le plan d’une tragédie, disposé les scènes et construit leurs liaisons, « ma tragédie est faite8 » ?
3Corneille cependant, lorsqu’il évoque son œuvre, la présente aussi en nombre de vers9 : il mentionne ainsi en 1660, dans l’Examen de Nicomède, les quelque « quarante mille vers » qu’il a déjà composés pour le seul théâtre10, auxquels il faut ajouter ceux de L’Imitation, et tous ceux qui suivront. Si la versification constitue un « ornement », un « fard11 », celui-ci est indispensable et Corneille y veille avec le plus grand soin. Dans les escortes de ses œuvres, Corneille manifeste en effet une attention constante à l’économie du vers, au réglage de sa « force », à ses effets escomptés et constatés sur le spectateur ou le lecteur. Le vers s’offre non comme beauté ajoutée à un canevas prosaïque, mais comme forme même d’une parole, et d’une parole fondamentalement dialogique, y compris dans la poésie de dévotion.
4Le sentiment qui domine, dans la critique cornélienne, paraît certes celui d’une fusion parfaite des axes de la dramaticité et de la poéticité, tout particulièrement réalisée et durablement imprimée dans les mémoires par la frappe de la sentence dans le moule de l’alexandrin, et l’on saurait malaisément distinguer la « force des vers » de la « force des pensées » (Jean-Marie Villégier, 1996). Mais dans ce creuset de la forme-sens, peut-on repérer des signes de dialectique voire de tension entre la linéarité et le retour, entre d’une part la dynamique discursive et son allure spécifique, et d’autre part les effets propres à la versification ? L’objet de l’étude n’est donc pas tant, dans cette œuvre entièrement versifiée, « le vers cornélien » que la relation au discours des vers, dans leur diversité comme dans leur masse. Diversité, car si Corneille a surtout écrit des alexandrins, il a montré aussi sa virtuosité dans l’emploi de mètres très variés, tant au théâtre que dans sa poésie religieuse. Masse, car la parole s’inscrit rarement dans un seul vers ni même un distique à rimes plates, mais plus souvent dans des ensembles de vers qui peuvent avoir leurs lois propres, mais qu’organisent aussi la phrase, les articulations du discours et les mouvements de la rhétorique : répliques, tirades, stances et strophes. Le dramaturge n’écrit pas, le comédien ne dit pas des vers isolés ni des distiques ou des quatrains, mais imite une action discursive portée par des « colonnes d’alexandrins », dont Jean-Marie Villégier rappelle qu’elles sont « tout sauf rectilignes, sauf monolithiques », mais bien plutôt « torses et polychromes12 ».
5Le vers cornélien ne saurait encore s’appréhender indépendamment des genres, dramatiques ou dévotionnels, où il se déploie : nous verrons qu’entre le théâtre et la poésie religieuse, les similitudes sont plus nombreuses que les écarts. Néanmoins, un article mis à part, le volume s’attache ici au seul théâtre, tâchant d’explorer la question que posait Pierre Larthomas : « Pourquoi et de quelles façons les vers d’un Corneille, d’un Racine, d’un Molière, sont, en tant que vers, dramatiques13 ? ». William D. Howarth notait en 1986 la rareté des travaux consacrés à la « contribution que fait le vers dramatique à l’économie totale de la pièce », la rareté même des études s’occupant « exclusivement de l’emploi du vers dans un texte dramatique14 ». La question reste surtout abordée, aujourd’hui, du côté de l’histoire et de la pratique de la prononciation et de la déclamation, ainsi que du côté du rapport, certes essentiel, du vers à la phrase et à la langue.
6Une première partie de ces réflexions s’attache donc à la fabrique du vers cornélien, examinant successivement les principes poétiques de cette élaboration à travers les nombreuses remarques sur le vers que livre Corneille au fil de ses Préfaces, Examens et Discours, ou déduisant de l’analyse des comédies ou des narrations une poétique partiellement informulée, mais très rigoureuse, de l’emploi du vers. L’aisance de Corneille dans la versification latine, l’adaptation très fine du vers espagnol qu’il propose avec Le Cid participent encore de cette fabrique inventive : l’alexandrin cornélien s’avère tout sauf uniforme. Le dramaturge et poète recourt certes à des matrices d’engendrement du vers : la sentence, l’hémistiche, les figures, le travail du rythme offrent autant de formes-sens capables de produire une versification qui cependant évolue considérablement, au fil de l’œuvre comme de ses variantes successives.
7La seconde partie de l’ouvrage se penche plus précisément sur le vers dramatique dans son rapport au dialogue : conversation, duo ou duel, interruptions et silences sont parmi les interactions du vers et de la parole celles qui peuvent signaler l’ethos des personnages et concourir à l’éclat de l’univers cornélien, ou marquer son assombrissement. Ces modulations sont enfin particulièrement sensibles dans le lyrisme cornélien : les stances et leur mise en musique, les vers mêlés des tragédies à machines, les strophes de L’Imitation manifestent encore, s’il en était besoin, la virtuosité d’un Corneille autant « poète » sensible que puissant dramaturge. Un mot enfin sur la méthode : le vers est certes un objet technique, mais dans la plupart des cas il est abordé ici dans cette démarche de lecture rapprochée, d’élaboration du sens « au ras du texte » que les chercheurs pratiquent dans leur enseignement, et les comédiens dans leur travail « à la table ».
8Quelques lignes de force peuvent être alors dégagées de cet ensemble de réflexions : praticien attentif plus que théoricien du vers, Corneille subordonne toujours sa versification dramatique, souvent virtuose, à l’effet du poème et de sa représentation, et cette vision globale lui permet de faire de la versification un moteur de son innovation dramaturgique. Corneille aborde en effet de façon originale la convention que représente la parole versifiée sur la scène, pour tirer de cette convention même, tantôt atténuée et tantôt soulignée, une palette étendue de manifestations éthiques : le vers paraît ainsi la « forme optique de l’ethos » (Jérôme Lecompte).
9Poète dramatique, Corneille n’est donc pas un théoricien a priori du vers, mais un praticien extraordinairement intuitif et remarquablement réflexif à la fois. La quantité des vers d’une scène, d’une tirade ou d’une réplique, la recherche des effets, les qualités du vers, « simple » ou « pompeux », demeurent toujours strictement subordonnées chez Corneille à des raisons plus hautes : l’adaptation au genre, l’équilibre global entre le sujet, le spectacle et la « force » des vers (Bénédicte Louvat), le fin réglage de cette « thermodynamique » de la représentation (selon le mot de Gilles Declercq), au cours de laquelle le spectateur se trouve, à l’image souvent de l’interlocuteur sur scène, tantôt « chaud », animé de passions vives et d’une curiosité pour la suite qui ne laisse pas de place aux ornements, tantôt plus « froid » et mieux disposé à écouter de longs développements (Jean de Guardia). Cette considération du poème dans sa globalité se marque encore, note Benoît de Cornulier, dans le suivi rigoureux de l’alternance, « observée même aux frontières d’actes malgré la discontinuité d’action qui peut leur correspondre. Cette régularité justifie, dans ce corpus, de considérer comme un poème la suite des paroles proférées dans une pièce. »
10Penser la versification chez Corneille oblige ainsi à partir, non du vers, mais bien du poème15. C’est d’abord la rhétorique, rappelle Jean-Yves Vialleton, qui permet de penser le vers, et en particulier le genus dicendi : un vers éclatant ou pompeux est un vers digne du style élevé ; un vers « faible » n’est pas un vers irrégulier, mais un vers qui convient au « style naïf ». Mais ce que révèle l’examen des escortes mené par Bénédicte Louvat, c’est que la « force » des vers chez Corneille ne suit nullement de façon mécanique la hiérarchie des genres dramatiques, et que se met en place au fil de la création et de la réflexion un système autrement plus complexe de « compensation » entre le sujet, le spectacle et le vers. De même, l’engendrement de la quantité de vers dans les discours persuasifs et les narrations répond à une règle implicite, en apparence contre-intuitive, mais qui subordonne étroitement l’ampleur du discours à l’assiette des personnages, et indirectement donc à celle du spectateur (Jean de Guardia).
11Certes, on ne compose pas, comme Corneille, des dizaines de milliers de vers sans recourir à des techniques d’engendrement, dont le dictionnaire de rimes (y compris le dictionnaire vivant qu’est supposé avoir été Thomas pour son aîné !) est la plus connue mais pas nécessairement la plus importante. Mais l’étude de ces procédés montre à quel point ils demeurent chez Corneille fortement subordonnés aux exigences du discours théâtral. Marc Douguet, en étudiant ici la récurrence d’un certain nombre d’hémistiches, de formules préexistantes voire figées dont peut se composer, partiellement, un alexandrin, attire d’abord notre attention sur la matrice que représente, en effet, cette suite accentuée de six syllabes : unité syntaxique et rythmique, l’hémistiche offre le cadre minimal pour cette congruence, ou cette tension, de la parole et du vers, du moule rhétorique et du langage dramatique, des idiomatismes et de l’invention. Il ne s’agit en effet que rarement de chevilles chez Corneille, mais plus souvent de moyens choisis pour accentuer le pathos d’une situation (« en cette extrémité »), pour dynamiser le dialogue (« je vous le dis encor ») ou, plus nettement cornélien encore, pour marquer le choix devant lequel se trouve le personnage (« en cette conjoncture »). S’élabore ainsi, au fil de chaque pièce comme autant d’expériences risquées, un système sans rigidité cependant, mais dont l’esprit général montre à quel point le dramaturge subordonne toujours sa versification à l’effet global, et chaque fois nouveau, non seulement de l’intrigue et de la composition, mais aussi de la représentation et de ses agréments.
12Créer des vers, c’est aussi au xviie siècle en imiter d’autres, parfois dans une langue étrangère. Corneille s’appuie, pour réfléchir à sa versification française, sur sa pratique du vers néo-latin, étudiée ici par Jean-Marc Civardi, comme sur les adaptations qu’il a faites des vers espagnols du Cid et qu’analyse Liliane Picciola. Capable de puiser avec pertinence dans « l’énorme catalogue antique de rythmes » pour composer ses poèmes encomiastiques, note Jean-Marc Civardi, Corneille privilégie toujours sur l’érudition l’adaptation la plus fine à son destinataire, le roi le plus souvent. On retrouve cette manière très personnelle dans sa façon d’adapter pour la scène française les vers latins épiques ou dramatiques. Admirateur de Sénèque et de Lucain, il ambitionne de fondre aux siens les vers latins qu’il imite parfois très étroitement en les traduisant, au point que le spectateur voire le lecteur ne puisse faire la différence : dans Médée, pense-t-il, le style encore « fort inégal » ne laissait pas de doute sur ce qui revenait à Sénèque, et à lui. « Le temps, ajoute-t-il, m’a donné le moyen d’amasser assez de forces pour ne laisser pas cette différence si visible dans Pompée, où j’ai beaucoup pris de Lucain, et ne crois pas être demeuré fort au-dessous de lui quand il a fallu me passer de son secours16. » Mais ce que le vers cornélien emprunte au vers latin, et plus particulièrement à ces deux auteurs, c’est avant tout une énergie, et l’étude de Liliane Picciola montre qu’il en va de même dans son imitation du Cid espagnol. Contrairement aux accusations portées contre lui, Corneille est très loin d’effectuer un simple plagiat ni même une traduction littérale de Guillèn de Castro, mais cherche, avec une grande variété de moyens et sans perdre de matière, à restituer dans le cadre du vers français les effets puissants du vers espagnol, son élégance et surtout sa dramaticité. « Langue installée dans la langue, à la fois familière et étrange » (Brigitte Jaques-Wajeman, 1996), le vers français de Corneille se souvient de ces influences de versifications étrangères, parfaitement assimilées cependant : déplacement, condensation, amplification, reformulation, transposition des sonorités et des rythmes obéissent, dans ce mouvement de « réinvestissement créateur », aux mêmes lois que la création, qui subordonnent chaque effet à son utilité dramaturgique, à sa raison scénique et à sa densité sémantique. L’étrangeté du vers n’est pas escamotée, mais portée à sa plus haute puissance d’expression, en accord étroit avec l’ethos des personnages et la palette des émotions, fortes ou délicates, poignantes ou enjouées.
13Cette poétique intuitive, cette vue globale des équilibres du poème et cette fine écoute de la salle, qui règlent la force et la masse des vers, permettent de comprendre comment, chez Corneille, le rapport de la versification au genre dramatique constitue non une règle a priori mais au contraire un élément, voire un moteur de l’innovation. Sylvain Garnier montre ainsi que Corneille au début de sa carrière, tout en prétendant ignorer la position des réguliers, les suit voire les précède en réalité en promouvant, au nom de la vraisemblance ou de la convenance stylistique, un dialogue théâtral marqué par la simplicité et le naturel plutôt que par les blandices du lyrisme fleuri. C’est le choix de ce style naïf lui-même, avance Françoise Poulet, qui permet à Corneille de s’affranchir des modèles italiens et espagnols et d’éliminer de son théâtre comique, en même temps que leurs rôles, les basses plaisanteries des bouffons et le langage ampoulé des capitans. L’enjouement propre à la comédie est alors obtenu par d’autres moyens, principalement discursifs : la vivacité du dialogue, la « parole neuve » qu’évoquait jadis Gabriel Conesa17 et le plaisir du miroir qu’offre la scène à un public confirmé dans son « honnêteté », voire élevé à celle-ci, par une langue élégante et une versification coulée.
14« La question – […] récurrente – est toujours pour un poète de se rapprocher du langage parlé », note François Regnault, y compris ici du langage de l’héroïsme, que Corneille a si magistralement séparé de la grandiloquence. D’emblée, Corneille comprend et applique le principe même de l’écriture dramatique, à savoir que sur la scène ce sont les personnages qui doivent parler, et non le poète : dès Mélite, sa versification s’éloigne du style fleuri alors en vogue, qui multipliait les traits ingénieux faisant valoir l’esprit de l’auteur, au profit d’une imitation plus naturelle de la « conversation des honnêtes gens » (Sylvain Garnier, Françoise Poulet). Ce principe dramaturgique fondamental donc selon lequel « ceux que le Poète fait parler ne sont pas des Poètes18 » fait du vers sur la scène une convention. Les vers de théâtre sont certes « moins vers », « sont présumés être prose » ou tiennent « nature de prose19 », c’est-à-dire que les personnages qui les prononcent ne sont pas censés parler en vers, et cette convention, rappelle François Regnault, se rapproche de celle qui permet de faire parler en français sur la scène les personnages de l’Antiquité. Analyser le rapport des vers à la parole, c’est donc interroger aussi cette perception du vers « comme prose », la sensibilité éminemment variable du spectateur à cette convention. Au rebours de ses contemporains, d’Aubignac au premier chef20, Corneille estime en effet que le distique d’alexandrins à rimes plates est le plus artificiel : « […] les vers de stances sont moins vers que les alexandrins, parce que parmi notre langage commun il se coule plus de ces vers inégaux, les uns courts, les autres longs, avec des rimes croisées et éloignées les unes des autres, que de ceux dont la mesure est toujours égale, et les rimes toujours mariées21. » Pour Corneille, on ne parle pas en alexandrins, illusion qu’il faut cependant donner au spectateur.
15Moins paradoxalement qu’on ne pourrait le penser, la contrainte s’avère plus forte dans la comédie peut-être. Françoise Poulet rappelle que le spectateur, en entendant parler les personnages de la comédie, « doit presque oublier qu’il s’agit d’alexandrins » et avoir « l’illusion mimétique d’une parole fluide et naïve ». Le vers comique cornélien multiplie ainsi les procédés d’oralisation et les jeux de discordance rythmique à tous les niveaux de la composition (scène, dialogue, réplique), l’ensemble de ces procédés ne devant néanmoins mettre en danger ni la régularité de la versification, ni la vraisemblance de la conservation honnête : plus que les phénomènes de rupture et d’accident, qu’il réserve aux scènes d’affrontement, Corneille privilégie les effets de « concordance différée » qui conservent au vers son allure à la fois vive et « coulante », et les marques de régulation qui ponctuent l’échange poli.
16À l’opposé, le dramaturge exploite pleinement dans la tragédie les effets de discordance que peuvent créer les vers brisés, les enjambements, les interruptions, les suspensions et silences, les vers inégalement partagés. Comme le montre Jean-Yves Vialleton, l’alexandrin chez Corneille peut présenter des césures rares (« Ciel, à qui voulez-vous désormais que je fie », s’écrie Auguste), des effets d’accélération ou d’attente qui dynamisent les échanges, théâtralisent la parole, accentuent le pathétique, soulignent les enjeux tragiques et manifestent l’éclat des personnages. Étudiant les points de suspension dans trois tragédies, Fabien Cavaillé montre que Corneille fait de l’interruption « un des caractères de la parole du pouvoir », tandis que la suspension marque souvent de son côté la parole retenue, la maîtrise des émotions, le choix du silence : « Corneille invente une manière dramatique, théâtrale, de faire parler les rois, non seulement par la “pompe des vers”, mais aussi par la force des actes de discours, par des paroles qui claquent et foudroient, d’autant plus et d’autant mieux qu’elles tordent et disloquent les alexandrins. »
17L’effet de « prose rimée » recherché dans les alexandrins des premières comédies, l’exploitation au contraire dans les tragédies de toutes les virtualités éclatantes de ce mètre le révèlent ainsi infiniment plus ductile qu’on ne le croit parfois, y compris dans sa réalisation classique (Jean-Yves Vialleton) : capable de « pompe », de « force », de « puissance » d’« élévation », d’« éclat », de « faste », de « majesté », aussi bien que de « naïveté », de « douceur » et de « facilité », tantôt ample et souple, tantôt aiguisé et « épigrammatique » (Marc Fumaroli, 1996), l’alexandrin cornélien s’élève toujours au-dessus du « langage ordinaire des hommes22 », sur un ample clavier qui exclut néanmoins les deux valeurs extrêmes, négatives, de la « bassesse » et de « l’enflure ». La minutieuse étude des variantes menée par Ludivine Rey montre à quel point Corneille a travaillé au fil des éditions à lisser l’énonciation, le lexique et les parlures de ses personnages, de sorte que le spectateur de 1660 ou le lecteur de 1682 n’entende pas la langue, le vers et l’auteur de 1630…
18La perception du vers, et donc de l’auteur, peut s’aiguiser encore à ces moments critiques que sont le changement de mètre, l’insertion en prose, ou encore le recours à des formes particulièrement saillantes comme le sont les sentences ou les stichomythies. La convention peut être sensible en effet aux moments où l’alexandrin dramatique laisse place aux stances en vers mêlés, et plus encore à une insertion en prose, dans le cas des lettres lues en scène. Or, remarque Benoît de Cornulier, « la suite métrique de fond semble […] enjamber et ignorer la lecture de la lettre ; à cet égard, celle-ci est traitée comme une action, un bruit ou un objet extérieur ou transparent à la conversation ». L’insertion de la lettre en prose ne transforme donc pas la versification dramatique en prosimètre, qui accuserait la différence des langages et qui rappellerait inopportunément au spectateur que le vers signale non le personnage, mais bien l’auteur.
19Ce risque se trouve accentué encore dans le recours à toutes les formes de virtuosité rhétorique que permet, qu’encourage même la versification : pointes, sentences, formules oraculaires, stichomythies, etc. du côté de la condensation ; périphrases, énumérations, anaphores, expolitions, etc. du côté de l’amplification. « Greffe éthique » sur le discours dramatique, comme le montre Gilles Declercq, la sentence peut ainsi être perçue comme une parole de l’auteur directement adressée au spectateur, ou comme un effet oratoire, spectaculaire, qui met en valeur le comédien. Dans le cas de la stichomythie, note Michèle Rosellini, la facticité du procédé se fait entendre à tous les niveaux, syntaxique, lexical, rythmique et rimique, et l’on se souvient des « pointes parricides » qu’on accuse Chimène de prononcer, au détriment de la bienséance. Il ne s’agit pas néanmoins pour Corneille de se passer de ces brillants, mais de les coudre étroitement à l’ensemble et de les justifier par leur fonction dramatique et leur effet scénique, au point que cette parole formulaire ne se limite nullement à un « schème prosodique et oratoire » illuminant de quelques points vifs la trame du texte, précise Gilles Declercq, mais « investit massivement le discours théâtral cornélien pour conférer au raisonnement sa forme à la fois décisive et mémorable ». Michèle Rosellini montre qu’il en va de même pour la stichomythie : duel des amants qui s’achève parfois en duo, la forme brillante se propose comme une véritable matrice dramatique de l’ensemble de la scène d’affrontement. Afin d’en atténuer l’artificialité, Corneille prend soin le plus souvent néanmoins de ménager des paliers vers l’échange stichomythique strict, l’agôn vers à vers, voire hémistiche à hémistiche marquant alors le moment de tension maximale, avant d’exprimer parfois l’accord retrouvé ou la plainte partagée. La « broderie » s’avère forme-sens et schème créateur.
20Cette étroite couture des brillants poétiques et rhétoriques au fort tissu du drame entraîne d’abord des conséquences importantes pour la diction du vers. En caractérisant le vers, avant tout, par sa discrépance avec la phrase, manifestée par l’enjambement et l’inversion, François Regnault propose d’entendre et de faire entendre, par la justesse de la diction, dans les alexandrins de Corneille, « la prose qu’ils ne sont pas » : de faire surgir à l’oreille du spectateur la conscience simultanée de la parole et du vers. Il ne s’agit pas seulement d’éviter l’écueil, signalé depuis le xviie siècle, d’une déclamation « enflée et chantante » : Jean-Yves Vialleton rappelle que dès l’époque, les textes sur le jeu de l’acteur préconisent de ne pas toujours s’arrêter « ni à la rime ni à la césure », voire de marquer une césure ailleurs qu’au milieu du vers (Grimarest, 1707). Il s’agit, comme le montre Pierre-Alain Clerc, de respecter un débit assez rapide tout en faisant entendre l’enchaînement des mouvements rhétoriques qui organisent le discours et les passions qui animent le personnage. Mais il s’agit surtout de faire éclater précisément le personnage, par l’éclat que donne le vers à sa parole, sans rompre l’attachement du spectateur.
21« Les vers, écrit Liliane Picciola, épousent la pensée d’un ethos exigeant, qui entend se communiquer, et ils en demeurent accidentés ; ils peuvent aussi marquer la rétractation, le refus de s’ouvrir à la pensée d’autrui, que l’on complète parfois d’avance, par refus ou lassitude. Il arrive que sans interruption typographiquement sensible, des formules soient comme jetées en avant et se détachent du reste avec d’autant plus de force qu’elles ont déjà été entendues et révèlent avec ostentation bien qu’en très peu de mots un personnage. » Théâtre « des coups et des éclats de voix » (Fabien Cavaillé), le théâtre de Corneille dit l’ethos en même temps qu’il le montre, par l’image énergique, aux deux sens du terme, que projette le vers : force et lumière, puissance et évidence (Jérôme Lecompte). Littéralement épiphanique, l’ultime monologue de Cléopâtre dans Rodogune (V, 1) « évoque les profondeurs de l’être pour les projeter sur scène, dans des vers éclatants, à destination des auditeurs » (Gilles Declercq). Le sujet cornélien, analyse Cécilia Laurin, est « volonté de théâtre », apocalyptique : « Le personnage, qui ne se connaît qu’en tant qu’il se représente, lève le voile et fait lumière sur soi pour s’offrir en spectacle. »
22Profondément éthique, le vers n’est dramatique que parce qu’il est aussi agonistique, et que sa facture même participe du rapport de forces et de son évolution. Ainsi, montre Michèle Rosellini, « l’altercation » pleine d’ironie et de sarcasmes entre la jeune première et l’amant importun est portée à son comble par la stichomythie : mais la forme même de l’affrontement entre amants ou époux, l’initiative féminine le plus souvent de ce duel, sa résolution possible ou impossible en duo amoureux ou élégiaque construisent une « anthropologie du couple cornélien », marquée par la singulière égalité des partenaires et l’autonomie de leur moi.
23On retrouve ainsi, au niveau du personnage cette fois, le pouvoir créateur du vers, sa puissance proprement novatrice et quasi démiurgique23. Ce pouvoir néanmoins peut d’une certaine façon s’inverser en un « pouvoir de décréer24 » ou du moins d’ombrer l’épiphanie du sujet et de rappeler subrepticement l’artifice du vers et la présence de l’auteur : marqué par l’auto-parodie et l’exhibition de la convention, le « style tardif » (Edward Said) des dernières tragédies de Corneille ironise l’énonciation héroïque, en la plaçant dans des bouches infâmes, ou en défaisant le vers qui la portait (Myriam Dufour-Maître). Les innovations métriques d’Agésilas viennent ainsi scander le nœud du drame : le forçage rhétorique du 4‑4‑4 en contrepoint du 6‑6 vient confirmer la triple dépendance de l’héroïne, tandis que le trimètre fameux de Suréna laisse en suspens, comme un écho infini, le « toujours » irrémédiable de l’amour, de la souffrance et de la mort (Benoît de Cornulier). Moteur dramatique et image de l’ethos, le vers cornélien se fait ainsi chant, modulation lyrique capable d’inspirer des musiciens comme Marc-Antoine Charpentier.
24En dépit des déclarations de Corneille, et de cette recherche d’équilibre entre sujet, spectacle et vers mise au jour par Bénédicte Louvat, il n’est pas si certain en effet que les pièces à machines soient tout entières pour les yeux seuls, et que n’agisse pas aussi sur le spectateur ébloui le charme des vers tendres (Stella Spriet). De même, le paradoxe d’une traduction de L’Imitation en vers français présentée comme dépourvue des ornements de la poésie25 tient-il bien à la lecture ? Claire Fourquet-Gracieux montre combien se tiennent, au cœur de L’Imitation, théâtre et poésie. Dans ce poème qui est, pour l’essentiel, un grand dialogue entre l’homme et Dieu, c’est par un moyen non pas discursif mais prosodique, le changement de strophe, que Corneille distingue les énonciateurs : un type de strophe cependant n’est pas mécaniquement assigné aux interlocuteurs, et c’est le renouvellement des effets de contraste qui permet de rappeler, souplement mais sans cesse, « la double nature de l’homme-Dieu, mais aussi la destination du pécheur à se convertir » et à s’unir à la divinité (Claire Fourquet-Gracieux). C’est au contraire, a priori, la dimension monologique des stances qui sous-tend leur musicalité, souligne Sarah Nancy. Mais seule peut-être la musique, celle ici de Charpentier sur les stances du Cid, est-elle capable de prolonger la résonance de cette fusion en apparence parfaite de la parole bouleversée et du vers harmonieux, et de faire vibrer, sans mots, le mal « infini » qui immobilise le héros. Les vers dramatiques de Corneille, eux, poursuivent dès l’acte suivant leur course et leur combat.
25Ainsi s’esquissent, à partir de ces quelques approches de la dialectique du discours et du vers, quelques conséquences (plutôt que conclusions), quelques questions nouvelles, et quelques projets tentants. La première conséquence touche à nos démarches d’analyse et à nos pratiques d’enseignement du théâtre de Corneille : si le vers est bien, comme ce volume tend à le conclure, ce creuset où s’inventent le sens dramaturgique et l’évidence théâtrale, le travail de la diction, quelles qu’en soient les écoles, devient une priorité critique, didactique et pédagogique. Forme mémorielle, le vers soutient non seulement le travail du comédien, mais la réception par le spectateur : mal dits, les « paquets d’alexandrins » qui ennuyaient Claudel ne laissent émerger pour l’auditeur qu’une mécanique rythmique, même pas musicale. La parole est alors engloutie par la versification mal comprise, et la tentation est grande en réaction de dire les alexandrins comme de la prose, dans l’illusion de faire comprendre un discours qui est précisément détruit par cette pseudo-facilité.
26Ainsi, au fil du colloque dont est né cet ouvrage, un spectacle et trois ateliers ont permis au public d’éprouver le vers tour à tour comme auditeur, acteur ou diseur26, et de faire émerger une question centrale : qu’entend-on, et qu’entendaient les contemporains de Corneille ? « Le moyen de connaître le beau vers, si le comédien ne s’y arrête […] ? », fait dire Molière à Mascarille : la question est peut-être moins rhétorique et ridicule qu’on ne croit, et l’on sait que l’écoute au théâtre est aussi fondamentalement trouée que le texte. À l’intérieur de chaque pièce, les dénivellations peuvent être plus ou moins sensibles entre la perception d’une « prose rimée » et les moments esthétiques des « beaux vers », véritables « zones érogènes » du texte (Julia Gros de Gasquet). Comment s’articulent alors, ou coïncident, dans l’expérience du spectateur, le « transport » que suscite l’avancée du drame, et le plaisir esthétique qui pèse la formule ou perçoit les articulations subtiles entre vers et discours ?
27Lié à ce premier impératif donc d’apprendre à dire les vers pour les comprendre, un second serait de mieux saisir encore la façon dont le vers non seulement soutient la mémoire du spectateur, mais participe aussi à son attachement au drame et à ses héros. Car c’est bien « du dedans », dit François Regnault, que le poète comprend les personnages qu’il invente, et nous invite à nous identifier à eux. Ainsi, en préférant l’application et l’enthymème à la formule sentencieuse générale, Corneille entend préserver cette « chaleur » du spectateur, qu’une parole doxale abstraite risquerait de refroidir (Gilles Declercq). Le tempo de la représentation ou de la lecture se règle aussi sur ces variations constantes et subtiles, que masque l’apparente régularité de l’alexandrin.
28Les quelques lois et techniques d’engendrement du vers explorées par les contributions ont fait naître enfin ce qui n’est pas tout à fait un projet encore, mais une idée, joyeuse et à coup sûr féconde : celle, imaginée par Bénédicte Louvat, de travaux pratiques, sous la forme d’un séminaire collaboratif ou d’une école d’été, dont le titre pourrait être « Écris toi-même ta tragédie de Corneille ». Un atelier oulipo-cornélien, à partir des hémistiches, vers, tours typiquement cornéliens ou qui plus simplement véhiculent un imaginaire du théâtre classique. À ce défi ludique et très sérieux, on a bien envie de répondre : chiche ? Comment mieux comprendre en effet la pratique du vers dramatique chez Corneille, que par l’essai, concret et tâtonnant, de ses exigences ? Un tel atelier permettrait, entre autres, non certes de fabriquer des tragédies cornéliennes mais de saisir mieux encore ce qui distingue le vers dramatique du vers lyrique, et de combler peut-être au passage un des manques de ce volume : l’examen de la relation paradoxale de Corneille à la poésie galante, qu’il produit tout en y refusant son génie, comme il le proclame dans la fameuse « Excuse à Ariste ».
29« Il n’y a rien de si commun qu’un faiseur de vers, de si rare qu’un Poëte27 », note Furetière après bien d’autres, et plus rare encore un poète qui invite à lire et à dire, selon cette belle formule en tension que François Regnault emprunte à un hétéronyme de Pessoa, « la prose de [s]es vers ». Corneille est décidément de ceux-là.
Remerciements
30Tout travail est collectif, et celui-ci peut-être plus que tout autre. Il n’aurait pas vu le jour sans la réflexion commune du comité scientifique, menée notamment lors d’une journée d’étude accueillie le 26 mars 2016 à Paris III-Sorbonne Nouvelle. Que Gilles Declercq, qui en fut le principal artisan, mais aussi Julia Gros de Gasquet, Bénédicte Louvat, Liliane Picciola, Florence Naugrette, Stella Spriet, Guillaume Peureux et Jean-Yves Vialleton trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance. Ma gratitude va aussi à l’IRET (Paris III-Sorbonne Nouvelle), à l’IRCL (Montpellier III) et au CÉRÉdI, à son directeur d’alors, Jean-Claude Arnould, et à sa directrice actuelle, Françoise Tenant : comme pour chacun des « colloques Corneille », le soutien financier du centre de recherche de Rouen s’est accompagné de ces encouragements qui donnent des ailes aux projets, et qui ont permis de tresser cette rencontre savante avec un prestigieux festival, gratuitement ouvert aux étudiants et au public local. Le Mouvement Corneille-Centre international Pierre Corneille s’est enfin pleinement associé, une fois encore, à cette manifestation, par sa contribution généreuse à la représentation de Pulchérie et par l’engagement de ses bénévoles : m’ont accompagnée et soutenue, comme toujours, l’amitié et la belle énergie d’Évelyne Poirel, la vigilance et le dévouement de Sandrine Berrégard. Rappelons encore l’accueil du spectacle par la faculté des Lettres et Sciences humaines de l’université de Rouen, en la personne de son doyen Jose Vicente Lozano, le prêt du clavecin par l’Opéra de Rouen, et saluons le talent des artistes du festival (Brigitte Jaques-Wajeman, Bertrand Suarez-Pazos, Lionel Brun et tous les acteurs de la compagnie des « Lunes errantes », Florian Carré, Sarah Nancy, Olivier Bettens et Pierre-Alain Clerc). C’est un volume à plusieurs mains qui résulte enfin de ces riches journées : Liliane Picciola et Bénédicte Louvat, en dressant au soir du colloque des conclusions nourries, ont fourni la charpente de l’introduction, élaborée ensuite avec le concours de Cécilia Laurin, qui a également relu avec moi la totalité des contributions, qu’Hélène Hôte, avec compétence et minutie, a mises en ligne. À tous les auteurs donc de ce livre, merci.
1 Voir Carine Barbafieri, « Corneille vu par Voltaire : portrait d’un artiste en poète froid », dans Corneille après Corneille, 1684-1791, textes réunis par M. Dufour-Maître, xviie siècle, no 225, octobre 2004, p. 605-616.
2 Georges Couton, Corneille, Paris, Hatier, 1958, p. 215.
3 Il s’agit d’une légende tardive, rapportée par l’abbé de Voisenon en 1781 : « Thomas travaillait bien plus facilement que Pierre et, quand celui-ci cherchait une rime, il levait une trape [sic] et la demandait à Thomas qui la lui donnait aussitôt. L’un était un dictionnaire de rimes, l’autre un dictionnaire d’idées et de raisonnements. » (Anecdotes littéraires, IV, 35, rééd. Paris, É. Dentu, 1885, p. 278 ; repris par Édouard Fournier, Histoire de la Butte des Moulins suivie d’une étude historique sur les demeures de Corneille à Paris, Paris, F. Henry et J. Lepin, libraires, 1877, p. 265-266). L’origine de l’anecdote suffit à la rendre suspecte, estime Georges Couton (La Vieillesse de Corneille (1658-1684) [1949], rééd. Paris, Eurédit, 2003, p. 11).
4 Paul Claudel, lettre à Brasillach, 10 juillet 1938, citée par Georges Couton, Corneille et la tragédie politique, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1984, p. 122-123.
5 Si ce n’est, note Stella Spriet, dans le long Examen d’Andromède, qu’on pourrait tenir pour l’ébauche d’un quatrième Discours.
6 Corneille, « Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique », dans Trois Discours sur le poème dramatique, éd. B. Louvat et M. Escola, Paris, GF, 1999, p. 71. Antoine Furetière, Dictionnaire universel, sv. Poëte : « Pour être Poëte, ce n’est pas assez de faire des vers, il faut encore inventer, & faire des fictions. », et sv. Versificateur : « Qui fait des vers. Celuy qui ne fait point de fictions n’est pas Poëte, il n’est que versificateur. »
7 Pierre Corneille, lettre à l’abbé Michel de Pure du 25 août 1660, dans Œuvres complètes, éd. Georges Couton, 3 vol., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1980-1987, t. III, p. 7.
8 « […] quand il entreprenait une Tragédie, il disposait chaque Acte en prose. Quand il avait ainsi lié toutes les scènes entre elles, il disait : Ma Tragédie est faite, comptant le reste pour rien. » (Louis Racine, Mémoires contenant quelques particularités sur la vie et les ouvrages de Jean Racine, dans Racine, Œuvres complètes, éd. Georges Forestier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, p. 1148).
9 Ainsi font également les comédiens, fait remarquer J. de Guardia : le « bon » rôle se détermine objectivement à son nombre de vers.
10 Corneille, OC, éd. citée, t. II, p. 641.
11 À propos des stances, Corneille écrit : « Je demeure d’accord que c’est quelque espèce de fard, mais puisqu’il embellit notre ouvrage, et nous aide à mieux atteindre le but de notre art qui est de plaire, pourquoi devons-nous renoncer à cet avantage ? » (Examen d’Andromède, 1660, OC, éd. citée, t. II, p. 454).
12 Jean-Marie Villégier, « La force des pensées, la force des vers », Cahiers de la Comédie-Française, no 21, Paris, POL, automne 1996, p. 29-32, citation p. 31.
13 Pierre Larthomas, Le Langage dramatique. Sa nature, ses procédés [1972], Paris, PUF, 2012, p. 405. Nos italiques.
14 William D. Howarth, « L’alexandrin classique comme instrument du dialogue théâtral », dans Dramaturgies, langages dramatiques. Mélanges pour Jacques Scherer, Paris, Nizet, 1986, p. 341-354, citation p. 341.
15 Ce qui ne signifie pas que la critique ne puisse, à rebours, partir du vers, voire de la rime, comme le propose Charles Péguy lorsqu’il bâtit son interprétation du « faîte » que représente Polyeucte à ses yeux à partir d’une réflexion sur la rime en -ort (Charles Péguy, Victor-Marie, comte Hugo, dans Œuvres en prose complètes, éd. R. Burac, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 222-223).
16 Corneille, Examen de Médée (1660), OC, éd. citée, t. I, p. 540.
17 Gabriel Conesa, Pierre Corneille et la naissance du genre comique (1629-1636), Paris, SEDES, 1989, p. 99 et passim.
18 Corneille, Discours de l’utilité et des parties du poème dramatique (1660), dans Trois Discours…, éd. citée, p. 84-85.
19 Corneille, Examen d’Andromède, OC, éd. citée, t. II, p. 455.
20 « […] il faut présupposer, Que les grands vers de douze syllabes, nommés Communs dans les premiers Auteurs de la Poésie Française, doivent être considérés au Théâtre comme de la prose » (Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. Hélène Baby, Paris, Champion, « Classiques », 2011, p. 383).
21 Corneille, Examen d’Andromède, OC, éd. citée, t. II, p. 455. Sur la perception de l’artificialité de la rime, voir Frédéric Briot, « La rime au xviie siècle : l’aiguë, l’ambiguë et l’aguicheuse », Revue des sciences humaines, 2004, no 276, p. 63-79.
22 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, sv. Prose : « est le langage ordinaire des hommes, qui n’est point gesné par les mesures & les rimes que demande la Poësie, qui est le mot opposé. »
23 « L’invention d’abord verbale du moi glorieux […] lui propose d’avance une forme à accomplir, l’appelle à l’effort et à l’existence. » (Jean Starobinski, L’Œil vivant : Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal, édition augmentée, Paris, Gallimard, 1999, p. 53).
24 Sur cette notion, on renverra au colloque récemment paru intitulé Le Négatif de l’écriture. Enquêtes sur le pouvoir de décréer, dir. Jean-Louis Jeannelle et François Vanoosthuyse, Fabula / Les colloques, https://www.fabula.org/colloques/sommaire6804.php, consulté le 10 décembre 2020.
25 « […] c’est ce qui m’a fait choisir la traduction de cette sainte morale, qui par la simplicité de son style ferme la porte aux plus beaux ornements de la poésie » (L’Imitation de Jésus-Christ, Épître dédicatoire au S. P. Alexandre VII, 1651, dans Corneille, OC, éd. citée, t. II, p. 789) ; « Les matières y ont si peu de disposition à la Poésie que mon entreprise n’est pas sans quelque apparence de témérité » (Au Lecteur, 1651, ibid., p. 791).
26 Trois démarches ont été présentées lors de ce colloque-festival tenu à Rouen, en mai-juin 2017 : celle théorisée par François Regnault et Jean-Claude Milner, avec une master-classe animée par Brigitte Jaques-Wajeman, Bertrand Suarez-Pazos et François Regnault ; celle initiée par Eugène Green et mise en œuvre lors de la représentation de Pulchérie par la compagnie des « Lunes errantes », dans la mise en scène de Lionel Brun ; celle dite « historiquement informée », proposée dans deux master-classes animées par Olivier Bettens et Pierre-Alain Clerc.
27 Furetière, Dictionnaire universel, sv. Vers.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1084.html.
