Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
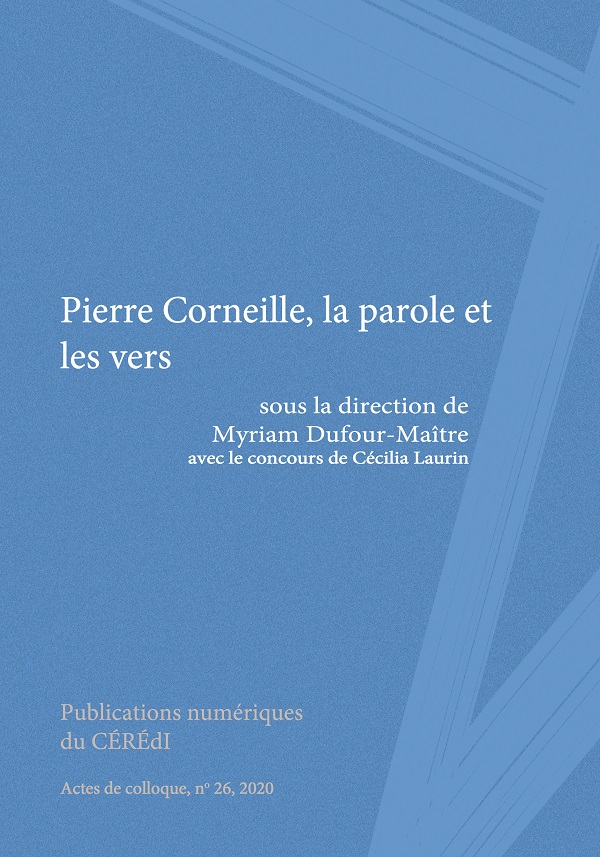
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Poétique
La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
Sylvain Garnier
Au début de sa carrière dramatique, Corneille compose des comédies écrites dans un style simple, proche de la prose, au moment même où les penseurs réguliers prônent l’emploi d’une langue plus simple et naturelle au théâtre au nom de la vraisemblance. Pourtant, si Corneille cherche à rattacher après coup son esthétique comique à ces réflexions critiques, il affirmait ne pas les connaître au moment de l’écriture de ses pièces et le choix du style simple pourrait en réalité relever chez lui d’une logique concurrente de celle de la logique régulière sur la question de la convenance stylistique. De fait, si les réguliers réclamaient l’emploi d’un style plus simple pour la tragédie, ils admettaient, contrairement à Corneille, que la comédie utilise un style plus orné.
1Les années 1628-1634 constituent une période charnière pour le théâtre français : la publication du dernier volume du Théâtre d’Alexandre Hardy marque l’abandon de la vieille tragédie humaniste en 1628, tandis que l’année 1634 voit le retour de la tragédie sous une forme rénovée qui impose la régularité dramatique. Entre ces deux dates, l’éviction momentanée du genre tragique permet le développement très important des genres modernes que sont la tragi-comédie et la pastorale et occasionne un foisonnement de débats sur la dramaturgie. C’est ainsi durant cette période, alors que triomphent des genres irréguliers dont l’élocution est encore très marquée par le modèle de la poésie lyrique, que va s’ébaucher l’idée selon laquelle il serait nécessaire de distinguer le vers dramatique du vers lyrique ou épique. C’est dans ce contexte marqué par l’expérimentation et la théorisation de nouvelles pratiques d’écriture dramatique que Corneille commence à composer pour le théâtre en faisant représenter Mélite en 1629. Or, alors que rien ne distingue encore a priori le futur auteur du Cid des autres dramaturges de sa génération, Corneille manifeste dès cette première pièce une double originalité générique et stylistique puisqu’il écrit une comédie et qu’il le fait dans un style simple en employant un vers qui se veut une sorte de « prose rimée1 » comme il l’affirmera plus tard. Cette originalité mérite d’être interrogée à l’aune des débats dramatiques contemporains afin de déterminer comment Corneille et son œuvre comique ont pu contribuer aux réflexions qui ont présidé à l’élaboration du vers dramatique classique. Il semble ainsi nécessaire de confronter les discours critiques tenus par Corneille sur ses premières comédies aux réflexions dramatiques propres aux penseurs réguliers afin de questionner le lien que le dramaturge a lui-même cherché à établir entre ses choix esthétiques personnels et la pensée classique en matière de style dramatique.
2Dès sa toute première pièce, Corneille développe une esthétique comique fondée en grande partie sur l’emploi du style « familier », se démarquant ainsi de la production dramatique de son temps. Il n’est cependant pas certain que cette originalité ait d’emblée été pensée en tant que telle par le dramaturge dans la mesure où Mélite, pièce qualifiée de « coup d’essai2 » par Corneille, fut écrite loin de Paris alors que l’auteur était encore jeune, inexpérimenté et peut-être ignorant de la mode du temps. Les différents textes liminaires, laissés par Corneille, qui témoignent de la genèse et de la réception de Mélite, vont tous dans ce sens. Dès 1633, lors de la publication de sa pièce, le dramaturge devait reconnaître que sa comédie venait « d’un homme qui ne pouvait sentir que la rudesse de son pays3 ». Plus tard, lors de l’édition de son théâtre complet en 1660, Corneille confirmera le fait que, au moment de composer Mélite, il ignorait tout des débats alors en cours à Paris sur la question de la régularité. Il déclare ainsi dans l’Examen de la pièce que celle-ci « n’a garde d’être dans les Règles, puisqu[’il] ne savai[t] pas alors qu’il y en eût4 », idée qu’il confirme dans l’Examen de Clitandre où il soutient que c’est durant « un voyage qu[’il] fi[t] à Paris pour voir le succès de Mélite » qu’il « apprit qu’elle n’était pas dans les vingt-quatre heures5 ». Selon ses dires, Corneille aurait ainsi composé sa première comédie en n’ayant « pour guide qu’un peu de sens commun, avec les exemples de feu Hardy […] et de quelques Modernes qui commençaient à se produire et qui n’étaient pas plus Réguliers que lui6 ». Certes, lorsque Corneille écrit ces lignes, il s’agit d’abord pour lui de justifier l’irrégularité de sa pièce à une époque où les principes réguliers se sont imposés à tous. Ce témoignage permet néanmoins d’expliquer l’originalité de la première comédie de Corneille : la pièce se distinguerait de la production contemporaine parce que l’auteur n’aurait pas été totalement au fait des spectacles alors en vogue. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Corneille ne semble pas avoir immédiatement pris la mesure de la spécificité du modèle comique qu’il proposait puisqu’il ne la soulignait pas dans la préface de la pièce en 1633 alors qu’il insistait lourdement dessus dans l’Examen de 1660 :
La nouveauté de ce genre de comédie, dont il n’y a point d’exemple en aucune langue, et le style naïf qui faisait une peinture de la conversation des honnêtes gens, furent sans doute cause de ce bonheur surprenant, qui fit alors tant de bruit. On n’avait jamais vu jusque-là que la comédie fît rire sans personnages ridicules, tels que les valets bouffons, les parasites, les capitans, les docteurs, etc. Celle-ci faisait son effet par l’humeur enjouée de gens d’une condition au-dessus de ceux qu’on voit dans les comédies de Plaute et de Térence, qui n’étaient que des marchands7.
3Corneille explique ainsi s’être éloigné des formes comiques connues jusqu’alors – les personnages de la commedia, ceux de la comédie latine – afin de mettre en scène les discours des personnes de la bonne société de son temps, discours qu’il aurait cherché à retranscrire avec le plus de « naïveté » – c’est-à-dire de naturel – possible.
4Si la nouvelle formule comique proposée par Corneille semble avoir tout de suite gagné la faveur du public, le dramaturge témoigne néanmoins de la réception mitigée qu’aurait eue sa pièce auprès des auteurs de théâtre et autres gens de lettres. Or l’un des points qui semble avoir le plus focalisé la critique serait précisément la question du style adopté par Corneille. En effet, en voulant imiter au plus près les conversations ordinaires des honnêtes gens, l’auteur aurait écrit dans un style jugé trop simple. Corneille s’en justifie ainsi dans la préface de sa pièce en déclarant que sa « [s]a façon d’écrire étant simple et familière, la lecture fera prendre [s]es naïvetés pour des bassesses8 ». Plus tard, lorsqu’il commentera son œuvre passée, il confirmera la critique qui visait alors son style d’écriture dramatique en racontant : « J’entendis que ceux du métier la blâmaient de peu d’effets, et de ce que le style en était trop familier9 ». De fait, il s’avère que Corneille a fait le choix de composer sa pièce en adoptant le style simple au sein de la tripartition rhétorique traditionnelle des styles. En effet, le style familier est, si l’on se réfère à Furetière, un style « de la conversation ordinaire, sans affectation des ornements d’éloquence10 », ce qui correspond tout à fait aux caractéristiques du style simple11. Or ce choix constituait une forme de rupture avec la production dramatique contemporaine. Les pièces créées à l’époque étaient essentiellement des pastorales et des tragi-comédies écrites en style fleuri qui imitaient les grands poètes lyriques du temps : Malherbe, Théophile, Marino… Autrement dit, ces pièces étaient composées en style moyen dont la principale caractéristique était l’ornementation ; elles étaient ainsi émaillées de pointes, de métaphores, de paradoxes et de jeux de mots fondés sur les lieux communs mignards du langage poétique. Une femme alors ne peut rougir dans une tragi-comédie sans que son amant déclare sur le champ que « Sa joue est un parterre où dans les fleurs écloses / Les lys en se mourant font renaître les roses12 », elle ne peut pleurer sans se voir dire que c’est « merveille de voir / Du feu jeter des eaux et deux soleils pleuvoir13 », etc. Mélite présente bien quelques traits de cette nature, mais ceux-ci sont présents dans une proportion bien moindre que dans les pièces de la même période et, surtout, ils n’interviennent qu’au tout début de la pièce pour caractériser le personnage d’Éraste, l’amant rejeté par l’héroïne éponyme et dont se raillera Tirsis, celui qui gagnera l’affection de la belle en se passant de tels artifices lyriques. Un bon point de comparaison pour comprendre la différence entre la pièce de Corneille et la production de son temps reste L’Esprit fort, une comédie de Claveret représentée en 1630, peu après Mélite. Cette pièce relève du même genre que la comédie de Corneille et se veut également une imitation de la langue de la bonne société puisque l’auteur affirmait que « les conversations les plus polies […] doivent être une même chose avec ce genre d’écrire14 ». Cependant, force est de constater que la pièce de Claveret est plus fleurie et mignarde que celle de Corneille qui présente en retour quelques traits grivois absents de la comédie de Claveret.
5Il est donc probable que Mélite ait été critiquée lors de sa création parce qu’elle était écrite dans un style relativement simple et familier alors que la plupart des pièces de cette époque tiraient leur gloire de leur élocution fleurie et ingénieuse. Il est difficile de savoir si cette divergence esthétique était voulue et acceptée en tant que telle par Corneille ou s’il s’agissait juste d’une maladresse due à son éloignement des lieux de création. Quelles que fussent ses raisons initiales, Corneille devait cependant assumer cette originalité, la défendre et la prolonger puisque l’emploi du style simple restera la marque de fabrique des comédies qui suivront : La Veuve, représentée en 1632, La Galerie du Palais, en 1633, puis La Suivante et La Place Royale créées en 1634. Le dramaturge devait par ailleurs profiter de la publication de deux de ces comédies pour défendre son emploi du style simple. Dans la préface de La Veuve, publiée en 1634, il s’adressait en effet au lecteur en ces termes : « Si tu n’es homme à te contenter de la naïveté du style et de la subtilité de l’intrique, je ne t’invite point à la lecture de cette pièce : son ornement n’est pas dans l’éclat des vers15. » De même, dans la préface de La Suivante, parue en 1637, il estimait que sa pièce était « d’un genre qui demande plutôt un style naïf que pompeux16 ». Lorsqu’il reviendra sur ces pièces dans la série d’Examens de 1660, Corneille analysera toujours les vers de ces pièces au prisme du style simple, qu’il s’agisse de relever un vice, comme pour La Suivante dont le style est jugé trop « faible17 », ou une vertu, comme pour La Veuve dont le style est jugé plus « net18 ». Ces différents Examens témoignent en outre de l’effort progressif de Corneille pour se débarrasser des pointes qui sont de moins en moins présentes entre Mélite, La Veuve et La Galerie du Palais. Toutes ces comédies témoignent donc de la volonté de Corneille de développer une esthétique comique fondée sur le style simple et, en fin de compte, le dramaturge réussira à faire valoir cette esthétique auprès des gens de lettres qui, après avoir critiqué Mélite, finiront par louer La Veuve. Lors de la publication de la pièce, en 1634, Corneille obtiendra de nombreux témoignages d’estime qui reconnaîtront la qualité de son entreprise. Rotrou écrit par exemple :
Je vois que ton esprit unique de son art
A des naïvetés plus belles que le fard19.
6Tandis que David Du Petit-Val, un libraire, soulignera l’originalité de Corneille :
Ce style familier non encore entrepris,
Ni connu de personne, a de si bonne grâce
Du Théâtre Français changé la vieille face,
Que la Scène Tragique en a perdu le prix20.
7Le « sens commun » qui aurait servi de « guide » quasi unique à Corneille pour l’écriture de Mélite lui a donc fait choisir le style simple plutôt que le style moyen alors à la mode. Corneille confirmera et approfondira ce choix initial dans ses comédies suivantes jusqu’à faire triompher et reconnaître sa formule comique. Si l’originalité de Corneille est indéniable, elle doit néanmoins être interrogée à l’aune des débats de son temps sur la question du style dramatique : en délaissant une forme de dialogue dramatique encore très marquée par l’expression lyrique au profit d’un dialogue plus naturel, Corneille se distinguait certes des pratiques d’écriture de la plupart des dramaturges contemporains mais, ce faisant, il adoptait ou rattrapait en réalité les positions théoriques alors en cours d’élaboration chez les réguliers. Or ces principes réguliers, qui devaient amener la rénovation du genre tragique avec la Sophonisbe de Mairet créée en 1634, étaient précisément ceux que Corneille affirmait ignorer au moment de la rédaction de Mélite et dont il se moquait ouvertement dans l’écriture de Clitandre21.
8Si l’emploi du style simple au théâtre pouvait apparaître comme une nouveauté lors de l’écriture de Mélite, cela allait rapidement devenir l’un des aspects récurrents des principes réguliers. La clé de voûte de ces principes était en effet la question de la vraisemblance. Or, au nom de la vraisemblance, l’idée selon laquelle les œuvres dramatiques devaient être composées en style simple allait rapidement se répandre. Les réguliers suivaient un raisonnement très logique : les personnages qui s’expriment dans une pièce de théâtre n’étant pas des poètes il ne fallait pas les faire s’exprimer comme des poètes si l’on voulait les imiter le plus parfaitement possible. Partant, il était nécessaire d’éviter d’employer des ornements lyriques ou rhétoriques trop marqués, comme le faisaient les tragi-comédies, et d’adopter un style plus simple. Cette idée apparaissait déjà au xvie siècle dans les Discours poétiques du Tasse, qui expliquait :
Dans la tragédie, ce n’est jamais le poète lui-même qui parle, mais toujours ceux qu’on met sur scène pour être les acteurs ; et à ceux-là il faut attribuer une façon de parler qui ressemble au langage ordinaire, afin que l’imitation soit le plus vraisemblable possible22.
9Et c’est précisément au tournant des années 1620 et des années 1630, soit au moment où Corneille commence à écrire, que ce raisonnement sera repris et développé par les théoriciens français de l’art dramatique. L’idée selon laquelle le poète doit s’effacer devant les discours de ses personnages devient ainsi un motif récurrent dans de très nombreux textes. C’est Honoré d’Urfé qui, en 1627, commence à introduire en France les réflexions italiennes sur le style dramatique en proposant d’abandonner la rime pour approcher au plus près du langage ordinaire :
Le but principal que se proposent les poèmes que nous nommons dramatiques, c’est de représenter, le plus parfaitement qu’il leur est possible, le personnage qu’ils font parler sur le théâtre ; que si cette parfaite représentation est la fin principale où ils tendent, n’est-il pas vrai que les Italiens ont eu raison de bannir les rimes de leurs tragédies, comédies, pastorales, et semblables, puisqu’aussitôt que l’on les fait parler en rime, l’on sort incontinent de cette vraisemblance qui est leur principal but ? Car qui serait celui qui se pourrait empêcher de rire, s’il oyait un roi à la tête de son armée parler en rime à ses soldats, ou bien un marchand faire ses comptes avec son facteur en vers rimés ? Et n’est-ce pas commettre cette même faute que de rimer les tragédies et les comédies23 ?
10L’idée selon laquelle la spécificité des poèmes dramatiques est de rendre invisible la trace de l’écrivain reparaît ensuite en 1631 dans la préface de la Silvanire de Mairet : « L’ouvrage Dramatique, autrement dit Actif, Imitatif, ou Représentatif, est celui-là qui représente les actions d’un sujet par des personnes entreparlantes, et où le Poète ne parle jamais lui-même24 », puis dans La Poétique de La Mesnardière parue en 1640 :
Il est certain que les fautes dont le Théâtre est chargé contre l’Article du Langage, procèdent principalement de ce que ses Écrivains ne comprenant pas comme ils doivent la nature de leur Poésie, font parler leurs Personnages comme parle un Poète Héroïque, lorsqu’agissant de soi-même dans une pleine liberté de mouvements et de pensées, il divertit son esprit par les Descriptions fleuries dont il pare ses Épopées, capables de tous ornements. Il faut donc considérer que le poète dramatique ne parle jamais de soi-même ; qu’il est toujours sur la scène, et jamais dans le cabinet ; que toutes ses productions sont des discours perpétuels des personnes introduites25.
11Cette idée devient ainsi un véritable lieu commun que l’on retrouve chez d’Aubignac, Racan et un très grand nombre d’auteurs dans le deuxième tiers du xviie siècle. L’ennemi implicite de l’ensemble de ces discours était la tragi-comédie de style fleuri qui s’était développée dans le premier tiers du siècle et qu’illustraient encore tous les dramaturges à l’époque de Mélite avec des pièces comme la Madonte d’Auvray, l’Arétaphile de Du Ryer ou encore Lygdamon et Lidias de Scudéry. On reprochait désormais à ces pièces de privilégier l’élocution sur la constitution de la fable. Dans son Discours sur la tragédie paru en 1639, Sarasin pouvait ainsi affirmer : « Il n’y a pas encore fort longtemps que la Fable était ce qui leur [les poètes] faisait le moins de peine ; ils n’étudiaient que la versification26 ». Le changement de paradigme impliqué par l’instauration des principes réguliers devait ainsi modifier en profondeur la manière d’envisager la nature du style au théâtre. En effet, depuis la dramaturgie humaniste, on estimait que le style d’un poème devait être adapté à la matière traitée par ce poème. Comme la tragédie traitait de sujets élevés en mettant en scène des personnages nobles et royaux, on estimait qu’elle devait être écrite elle-même dans un style élevé voire grandiloquent. C’est pourquoi, par exemple, Jacques Peletier ne faisait pas de différence entre le style de l’épopée et celui de la tragédie puisque l’une et l’autre imitaient les mêmes sujets : « La Tragédie est sublime, capable de grandes matières tant principales que dépendantes : en somme, ne différant rien de l’Œuvre Héroïque, quant aux personnes27. » De même, c’est pourquoi Alexandre Hardy demandait au style tragique d’être « un peu rude28 », c’est-à-dire de s’inscrire dans le registre véhément, afin de respecter ce principe de convenance. L’instauration des principes réguliers devait modifier cette conception de la convenance stylistique puisque, désormais, celle-ci était appliquée non plus à la matière imitée mais au mode de l’imitation : l’épopée se devait de relever du style élevé puisque le poète s’y exprimait directement tandis que la tragédie devait employer le style simple puisque les personnages qui s’y exprimaient n’étaient pas des poètes.
12Les principes réguliers défendaient donc l’usage du style simple au théâtre au moment même où Corneille, guidé par son petit « sens commun », développait une esthétique comique fondée elle aussi sur l’emploi du style simple. Il semble donc nécessaire de s’interroger sur la manière dont le théâtre comique de Corneille pouvait interagir avec ces principes réguliers. L’étude chronologique des différents textes laissés par le dramaturge laisse en effet penser que le choix stylistique de Corneille ne correspondait aux principes réguliers que par une forme de coïncidence et que ce n’est qu’après coup, sans doute par opportunisme, qu’il a cherché à inscrire son esthétique dans les pas de la dramaturgie régulière.
13Corneille n’a pas cherché à théoriser d’entrée de jeu sa manière originale. Les préfaces de Clitandre et de Mélite, parues respectivement en 1632 et 1633, mettaient l’accent sur les goûts personnels de Corneille et ne cherchaient pas à développer une véritable réflexion théorique sur le style au théâtre. Le dramaturge soulignait simplement son rejet de l’imitation dans Clitandre et il se contentait de dire que « [s]a façon d’écrire [était] simple et familière » dans Mélite. Comme nous l’avons vu, Corneille prétendait ne pas connaître les principes de la nouvelle dramaturgie lors de l’écriture de Mélite et il avouait n’avoir eu pour modèle que les œuvres d’Alexandre Hardy et des modernes irréguliers. Or Corneille pouvait tout à fait déduire le choix d’écrire des comédies en style simple de ces modèles. En effet, ces différentes œuvres, en dépit de leurs divergences esthétiques manifestes, partageaient toute la même vision traditionnelle de la convenance stylistique : les tragédies étaient écrites en style sublime ou véhément car elles mettaient en scène une matière elle-même sublime et véhémente ; les tragi-comédies et les pastorales étaient composées en style moyen et fleuri car elles mettaient en scène une matière plaisante. En suivant cette logique, il pouvait donc sembler logique d’écrire des comédies en style simple. Si Corneille aboutit en apparence aux mêmes conclusions que les principes réguliers, il aurait en réalité pu le faire en suivant la logique de la convenance opposée à celle des réguliers. Rien ne semble en tout cas indiquer à ce moment-là que Corneille se soit fondé sur les réflexions théoriques alors en cours d’élaboration pour définir son premier style d’écriture au théâtre.
14Tout change cependant en 1634 lorsque Corneille va faire publier La Veuve. Le dramaturge profite en effet de cette édition pour donner son premier texte théorique sur la question du style comique. Or il va le faire en reprenant tous les lieux communs critiques développés par les penseurs réguliers sur la question du style. Il écrit ainsi :
Si tu n’es homme à te contenter de la naïveté du style et de la subtilité de l’intrigue, je ne t’invite point à la lecture de cette pièce : son ornement n’est pas dans l’éclat des vers. C’est une belle chose que de les faire puissants et majestueux : cette pompe ravit d’ordinaire les esprits, et pour le moins les éblouit ; mais il faut que les sujets en fassent naître les occasions, autrement c’est en faire parade mal à propos, et pour gagner le nom de poète, perdre celui de judicieux. La comédie n’est qu’un portrait de nos actions et de nos discours, et la perfection des portraits consiste en la ressemblance. Sur cette maxime je tâche de ne mettre en la bouche de mes acteurs que ce que diraient vraisemblablement en leur place ceux qu’ils représentent, et de les faire discourir en honnêtes gens, et non pas en auteurs. Ce n’est qu’aux ouvrages où le poète parle qu’il faut parler en poète ; Plaute n’a pas écrit comme Virgile, et ne laisse pas d’avoir bien écrit. Ici donc tu ne trouveras en beaucoup d’endroits qu’une prose rimée, peu de scènes toutefois sans quelque raisonnement assez véritable, et partout une conduite assez industrieuse29.
15Affirmation du primat de la fable sur la versification, défense du style simple au nom de la vraisemblance dramatique, théorisation de l’effacement de la figure du poète, idée de prose rimée… Cette préface concentre en quelques lignes tout l’argumentaire et toutes les expressions caractéristiques de la théorie régulière concernant le style dramatique. Ce n’est sans doute pas un hasard si c’est à ce moment précis que Corneille fait le choix de rattacher aussi explicitement son esthétique comique originale à la nouvelle théorie dramatique. L’année 1634 constitue en effet un tournant dans la carrière du dramaturge : il participe au mouvement de rénovation de la tragédie en composant Médée, il rejoint la société des Cinq Auteurs et il fait placer dans son édition de La Veuve plus d’une vingtaine de poèmes d’hommage composés par des dramaturges et des hommes de lettres. Tout semble indiquer une volonté de la part de Corneille de se « normaliser » vis-à-vis de ses confrères et c’est sans doute dans ce contexte qu’il faut comprendre la rédaction de cette préface.
16Le choix a priori original de Corneille d’écrire des comédies en style simple semble tout à fait logique au regard de la nouvelle théorie dramatique qui, en se fondant sur la vraisemblance, demande au théâtre de se rapprocher du style simple ou, tout du moins, de fuir les ornements lyriques et rhétoriques trop marqués. Corneille place lui-même résolument son œuvre sous le signe de la nouvelle théorie dramatique à l’occasion de la publication de La Veuve en 1634 et, de fait, il ne faisait finalement que rénover le genre comique sur des bases stylistiques semble-t-il similaires à celles qui présidaient à la rénovation de la tragédie. Pourtant, son rattachement à la nouvelle théorie régulière, qu’il affirmait ne pas connaître lorsqu’il commence à écrire, apparaît tout à fait opportuniste dans sa carrière et, en réalité, la reprise à l’identique, pour le genre comique, d’un discours théorique conçu à l’origine pour la tragédie n’allait pas vraiment de soi.
17Dans la préface de La Veuve, Corneille semble reprendre à son compte tous les apports de la dramaturgie régulière concernant la défense du style simple au théâtre. Cependant, l’horizon d’attente de cette dramaturgie restait la tragédie bien plus que la comédie. Il s’agissait en effet de faire la promotion d’un style plus prosaïque dans la tragédie, ce qui constituait un véritable paradoxe au regard de la tradition dans la mesure où l’on avait tendance à considérer qu’un genre présentant une matière noble se devait d’être écrit dans un style noble. En revanche, faire usage d’un style simple pour la comédie ne posait pas de problème théorique particulier puisqu’une matière basse pouvait souffrir un style familier. Aussi convient-il de se demander quelle était la position de la dramaturgie régulière pour ce qui regardait le style comique. Cette position était a priori la même que pour la tragédie puisque la question de la convenance stylistique était pensée en fonction du mode dramatique et non du sujet traité. La tragédie et la comédie étant deux genres dramatiques, il était logique qu’elles partagent les mêmes principes stylistiques. Les choses étaient cependant plus complexes. Le choix du style simple dépendait en effet du mode de l’imitation dramatique mais aussi, et peut-être surtout, du but que se proposait le poème. Or, sur ce point, comédie et tragédie différaient radicalement puisque l’une cherchait à réjouir, l’autre à émouvoir. De fait, si la tragédie devait fuir les ornements du style et rechercher la simplicité, c’était justement parce qu’on estimait que cela convenait mieux au pathétique. Cette idée avait également été formulée par Le Tasse dans le même texte qui prônait l’effacement du poète dans l’œuvre dramatique. Il écrivait en effet :
[…] le pathétique requiert dans les pensées pureté et simplicité, et dans l’expression la propriété des mots, car c’est de la sorte que doit discourir, pour la vraisemblance, quelqu’un qui est plein de tourments, ou de crainte, ou de pitié, ou de toute autre agitation ; quant à l’excès d’éclat et d’ornement dans le style, non seulement il rend obscur, mais il empêche et diminue le pathétique30.
18Cette idée sera introduite en France lors des débats sur la question du style tragique. On la retrouve ainsi par exemple sous la plume de Vion d’Alibray, un traducteur du Tasse, dans sa version de l’Aminte parue en 1632. Il s’agissait alors pour lui de critiquer l’excès d’ingéniosité de Pyrame et Thisbé :
Tu ne liras pas non plus ici ces pointes si étudiées et si recherchées, qui sont les délices de notre siècle : aussi ne faut-il guère d’artifice pour exprimer la naïveté d’une passion ; il ne faut point tirer de l’esprit ce qui doit venir du cœur, ni songer à une belle conception lors que l’âme ne demande qu’à enfanter […] Ces trop grands rechercheurs de subtilités sont les plus grands ennemis qu’aient les Muses […]. Ils font encore chercher des pointes à ceux qui sont tous prêts de se tuer, dont ils les arment davantage que de leur poignard.
Ah voici le poignard qui du sang de son maître
S’est souillé lâchement, il en rougit le traître.
Je trouve qu’elle-même devrait rougir, et que ces paroles l’accusent plus qu’elles ne font ce poignard, d’avoir trahi Pyrame. Car comment une personne vraiment touchée aurait-elle de semblables pensées, qui tant s’en faut qu’elles percent, qu’elles ne piquent pas seulement, mais ne font que nous chatouiller l’âme, et nous exciter à rire en nous-même, qui est un mouvement bien léger, principalement pour une action tragique31.
19Cette idée – le fait que l’excès de recherche stylistique nuit au pathétique et donc que la tragédie doit cultiver la « naïveté » – va innerver de nombreux textes théoriques sur le sujet. C’est elle qui explique que, à rebours de la position de Corneille, auteurs et théoriciens vont estimer que le style moyen serait plus propre à la comédie puisque celle-ci ne cherche pas à faire pleurer mais à faire rire. C’est pourquoi, par exemple, L’Esprit fort de Claveret se veut davantage fleuri que la Mélite de Corneille. Lors de la publication de sa pièce, à sept ans de distance de sa création, Claveret devait en effet revenir sur l’usage important qu’il avait fait des pointes dans sa pièce alors que cet ornement était désormais moins apprécié. Or il défend précisément leur usage en opposant le style simple et sérieux de la tragédie au style moyen et plaisant de la comédie :
Au reste, si, pour blâmer les pointes que j’ai laissées dans cet ouvrage, tu me fais la faveur de m’apprendre que le style du temps commence à devenir plus sérieux, apprends aussi toi-même qu’elles étaient en vogue quand il sortit de ma plume, il y a près de sept ans ; que l’on s’en sert encore aujourd’hui dans les conversations les plus polies, qui doivent être une même chose avec ce genre d’écrire ; que les naïvetés comiques tirent toutes leurs grâces de ces ornements, et que de semblables roses ne sauraient être belles, ni conserver une odeur qui dure, que parmi de si douces épines. Comme la plupart des dames à qui les pierres précieuses manquent, ou qui ne sont pas d’une condition assez relevée pour s’en parer, empruntent l’éclat des faux diamants, afin que leur beauté se produise avec plus de succès dans les assemblées ; ainsi les ouvrages comiques, où la gravité des sentences et la force des raisonnements ne peut entrer, ont recours à ces faux brillants pour s’insinuer dans les esprits avec plus de plaisir32.
20Cette idée n’est pas propre à Claveret puisqu’on peut la retrouver chez un théoricien comme d’Aubignac qui, dans sa Pratique du théâtre, distinguait les figures de style propres à la tragédie et celles propres à la comédie :
Comme il y a beaucoup de différence entre la Tragédie et la Comédie, elles ont aussi leurs figures particulières. Comme la Tragédie ne doit rien avoir que de noble et de sérieux, aussi ne souffre-t-elle que les grandes et illustres Figures, et qui prennent leur force dans les discours et les sentiments ; et sitôt qu’on y mêle des Allusions et des Antithèses qui ne sont point fondées dans les choses, des Équivoques, des jeux de paroles, des locutions proverbiales, et toutes ces autres figures basses et faibles qui ne consistent que dans un petit agencement de mots ; on la fait dégénérer de sa Noblesse, on ternit son éclat, on altère sa Majesté, et c’est lui arracher le Cothurne, pour la mettre à terre. Au contraire la Comédie qui n’a que des sentiments communs et des pensées vulgaires, souffre toutes ces bassesses, voire même elle les désire33 […]
21Si le vocabulaire axiologique employé par d’Aubignac peut donner l’impression qu’il opposerait ici la tragédie de style élevée à la comédie de style simple, il n’en est rien. L’appréciation « morale » n’a rien à voir avec les registres stylistiques et, ce que d’Aubignac oppose ici, ce sont les figures fondées sur les choses aux figures fondées sur les mots ; or les unes peuvent relever du style simple alors que les autres relèvent davantage du style moyen. Partant, lorsque Corneille reprend dans la préface de La Veuve l’ensemble de l’argumentaire des réguliers pour défendre le style simple de ses comédies, il ne s’inscrirait qu’en apparence dans le sillon de cette nouvelle dramaturgie qui opposait bel et bien la nature du style comique et du style tragique en dépit du fait que l’un et l’autre relevaient du poème dramatique.
22Sur la question du style, les premières comédies de Corneille entretiennent un rapport pour le moins ambigu avec les principes théoriques réguliers qui devaient modifier en profondeur la perception du vers dramatique en le distinguant des autres formes de poésie. Le dramaturge a en effet commencé à écrire pour le théâtre des comédies en style simple, prosaïque, à une époque où la forme qui triomphe est la tragi-comédie de style fleuri. S’il affirme dans un premier temps avoir composé Mélite, sa première comédie, dans l’ignorance complète des débats dramatiques contemporains qui allaient imposer les principes réguliers, Corneille profite néanmoins de la publication de La Veuve, sa troisième pièce, pour rattacher sa démarche stylistique à ces réflexions régulières qui invitaient elles aussi à développer un nouveau vers dramatique plus proche de la prose. Mais ce rattachement tardif semble quelque peu opportuniste dans la carrière du dramaturge. En réalité, Corneille aurait parfaitement pu déduire le principe de l’écriture en style simple de la conception traditionnelle de la convenance stylistique qui définissait le style en fonction de la matière du poème et non de son mode d’imitation ; ce qui était précisément la conception que cherchait à réfuter la nouvelle dramaturgie pour la tragédie. Le choix du genre comique aurait ainsi pu masquer ce malentendu théorique et permis à Corneille de se raccrocher après coup aux théories régulières. Ce décalage entre les pratiques d’écriture de Corneille dans le domaine de la comédie et la théorie dramatique régulière apparaît d’ailleurs lorsque l’on considère les quelques remarques des contemporains de Corneille qui nous sont parvenues sur la question du style de la comédie. Si les réguliers semblaient en effet prôner un style plutôt simple pour la tragédie – au nom de la vraisemblance et afin que l’éclat de la langue ne nuise pas à l’émotion – ils toléraient en revanche très facilement que la comédie reprenne à son compte certains éléments du style brillant et ingénieux de la tragi-comédie afin de soutenir son caractère enjoué. Est-ce donc le « sens commun » suivi par Corneille qui lui aurait fait adopter le style simple au nom d’une conception de la vraisemblance que ne réclamait pas encore le genre comique ou bien le respect d’une conception de la convenance stylistique alors en voie de disparition ? La question semble difficile à trancher. Il n’en demeure pas moins que, in fine, l’œuvre comique de Corneille apparaît bel et bien rétrospectivement comme fondatrice de la comédie classique et que Corneille pourra, avec trente années de recul, se targuer d’avoir rénové la comédie et défini son style propre avant même que celui de la tragédie ne le soit.
1 Pierre Corneille, La Veuve ou le traître trahi, « Au lecteur », dans Œuvres complètes, éd. Georges Couton, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1980, p. 202.
2 Pierre Corneille, Mélite ou les fausses lettres, « Au lecteur », dans Œuvres complètes, éd. citée, p. 4.
3 Pierre Corneille, Mélite ou les fausses lettres, « À monsieur de Liancourt », dans op. cit., p. 3.
4 Ibid., « Examen », p. 5.
5 Pierre Corneille, Clitandre ou l’innocence délivrée, « Examen », dans Œuvres complètes, éd. citée, p. 101.
6 Pierre Corneille, Mélite ou les fausses lettres, « Examen », dans op. cit., p. 5.
7 Ibid., p. 5-6.
8 Ibid., « Au lecteur », p. 4.
9 Pierre Corneille, Clitandre ou l’innocence délivrée, « Examen », dans op. cit., p. 101.
10 Antoine Furetière, Dictionnaire universel […], « Familier », La Haye, A. et R. Leers, 1690.
11 Sur les caractéristiques des trois styles rhétoriques, voir Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence : rhétorique et « res literaria » de la Renaissance au seuil de l’époque classique, Genève, Droz, 1980, p. 54-55.
12 Du Rocher, L’Indienne amoureuse ou l’heureux naufrage, Paris, J. Corrozet, 1631, p. 36.
13 Jean Auvray, Madonte, Paris, A. de Sommaville, 1632, p. 137-138.
14 Jean Claveret, L’Esprit fort, « Avertissement au lecteur », Paris, F. Targa, 1637, n. p.
15 Pierre Corneille, La Veuve ou le traître trahi, « Au lecteur », dans op. cit., p. 202.
16 Pierre Corneille, La Suivante, « Épître », dans Œuvres complètes, éd. citée, p. 387.
17 Ibid., « Examen », p. 388.
18 Pierre Corneille, La Veuve ou le traître trahi, « Examen », dans op. cit., p. 218.
19 Jean de Rotrou, « À monsieur Corneille », dans La Veuve ou le traître trahi, op. cit., p. 206.
20 David Du Petit-Val, « À monsieur Corneille », dans La Veuve ou le traître trahi, op. cit., p. 210.
21 Dans l’Examen de Clitandre, Corneille affirme avoir volontairement voulu faire une pièce régulière « qui ne vaudrait rien du tout » (Pierre Corneille, Clitandre ou l’innocence délivrée, « Examen », dans op. cit., p. 102).
22 Le Tasse, Discours de l’art poétique, Discours du poème héroïque, éd. et trad. Françoise Graziani, Paris, Aubier, 1997, p. 119. Nous soulignons.
23 Honoré d’Urfé, La Sylvanire ou la Morte-vive, « Au lecteur », éd. Laurence Giavarini, Toulouse, Société de littératures classiques, 2001, p. 6.
24 Jean Mairet, La Silvanire ou la Morte-vive, « Préface en forme de discours poétique », Paris, F. Targa, 1631, n. p. Nous soulignons.
25 Jules-Hippolyte de La Mesnardière, La Poétique, éd. Jean-Marc Civardi, Paris, Honoré Champion, 2015, p. 435-436. Nous soulignons.
26 Jean-François Sarasin, Discours de la tragédie, ou remarques sur l’Amour tyrannique de Scudéry (1639) ; repris dans Les Œuvres de M. Sarrasin, II, Paris, N. Le Gras, 1683, p. 76.
27 Jacques Peletier du Mans, Art poétique, éd. Francis Goyet dans Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance, Paris, Le Livre de poche, 1990, p. 304.
28 Alexandre Hardy, Le Théâtre d’Alexandre Hardy, III, « À monseigneur Le Premier », Paris, J. Quesnel, 1626, n. p.
29 Pierre Corneille, La Veuve ou le traître trahi, « Au lecteur », dans op. cit., p. 202.
30 Le Tasse, op. cit., p. 119.
31 Charles de Vion d’Alibray, « Avertissement », dans L’Aminte du Tasse, Paris, Pierre Rocolet, 1632, n. p.
32 Jean Claveret, L’Esprit fort, « Avertissement au lecteur », éd. citée, n. p. Nous soulignons.
33 François Hédelin d’Aubignac, La Pratique du théâtre, éd. Hélène Baby, Paris, Honoré Champion, p. 474-475. Nous soulignons.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1053.html.
Quelques mots à propos de : Sylvain Garnier
Sorbonne-Université
Doctorant à l’Université Paris-Sorbonne depuis 2011, Sylvain Garnier a soutenu une thèse intitulée Érato et Melpomène ou les sœurs ennemies : langage poétique et poétique dramatique dans le théâtre français de Jodelle à Scarron (1553-1653). Ses travaux de recherche portent sur l’influence de la poésie lyrique sur l’écriture et la poétique dramatiques.
