Sommaire
Pierre Corneille, la parole et les vers
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
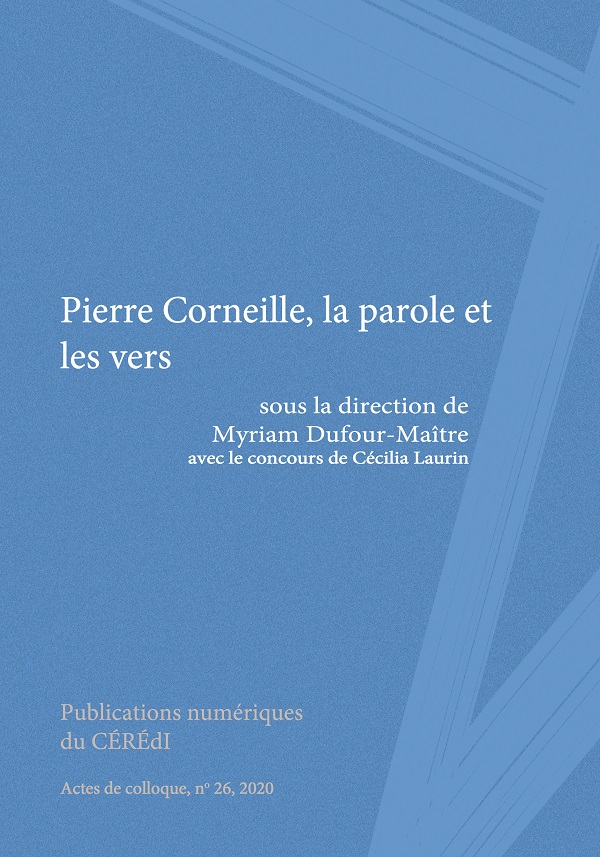
- Myriam Dufour-Maître, de Cécilia Laurin, de Bénédicte Louvat et avec le concours de Liliane Picciola Introduction
- Bénédicte Louvat Le vers cornélien selon Corneille : parcours des paratextes
- Sylvain Garnier La comédie cornélienne et l’élaboration du vers dramatique classique
- Jean de Guardia Combien de vers ? Ornement et dramaticité chez Corneille
- Jean-Marc Civardi Corneille poète néo-latin
- Liliane Picciola Des vers espagnols aux vers cornéliens du Cid : modalités et intentions des réécritures
- François Regnault La prose de mes vers
- Gilles Declercq Résilience de la sentence cornélienne. Enjeux et tensions d’une forme-sens
- Marc Douguet Les hémistiches répétés chez Corneille
- Jean-Yves Vialleton « Ils ne sont pas venus, nos deux rois ? » : le vers brisé chez Corneille
- Pierre-Alain Clerc Déclamer Corneille
- Ludivine Rey La génétique du vers cornélien : les rapports complexes de la parole et des vers
- Françoise Poulet Les comédies de Corneille ou la mise en vers de l’honnête conversation
- Michèle Rosellini Du duo au duel : la stichomythie, marqueur de violence dans le dialogue des amants
- Fabien Cavaillé Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna
- Jérôme Lecompte Formes de l’ethos héroïque : l’exemple de Cinna
- Cécilia Laurin « Connais-moi tout entière » : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne
- Myriam Dufour-Maître Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
- Benoît de Cornulier Stances périodiques et inscriptions rythmiques dans les pièces de Corneille de Mélite au Cid (1629-1637)
- Stella Spriet Quels vers pour Andromède (1650) et La Conquête de la Toison d’or (1660) ?
- Claire Fourquet-Gracieux « Je n’ai pas cru à propos que l’homme parlât le même langage que Dieu ». Strophe et énonciation chez Corneille
- Sarah Nancy Vers, parole, musique. Les Airs sur les stances du Cid de Marc-Antoine Charpentier
Parole, ethos et vers
Allures du vers et obscurcissement du discours : le « style tardif » de Corneille
Myriam Dufour-Maître
L’article examine quelques tragédies du « vieux Corneille » à la lumière de la notion de « style tardif » proposée par T. Adorno, et développée par E. W. Said : la catastrophe de la grandeur va ici de pair non avec une subjectivité plus librement affirmée du dramaturge, mais avec au contraire une mise à nu délibérée des conventions, une auto-parodie sensible et un obscurcissement du discours. La rhétorique du conseil ou de l’éloge semble souligner sa propre vanité, tandis que l’alexandrin, maintenu dans sa « frappe » toute cornélienne, abrite ironiquement l’indécision, la familiarité et le cynisme.
Le « style tardif »
1Si persuadé qu’on soit que les pièces de la vieillesse de Corneille ne sont ni faibles ni illisibles, elles peuvent paraître néanmoins rebutantes, au sens premier : elles ne nous accueillent pas avec facilité. La réticence face à ce Corneille « nouvelle manière » (Georges Couton) que forment Othon, Agésilas, Attila, Tite et Bérénice, Pulchérie et Suréna est-elle liée au sentiment que ces pièces donnent en effet de la vieillesse, sous les auspices peu réjouissants du « déclin », de la « faillite » et de la « catastrophe » ? Je voudrais éclairer cette impression en empruntant la notion de « style tardif » qu’Edward W. Said développe dans un essai posthume sous ce titre On Late Style, et dans lequel il évoque longuement un article d’Adorno à propos de Beethoven :
Chez les grands créateurs, écrit Adorno, la maturité des œuvres tardives ne se compare pas à celle d’un fruit. Elles sont rarement rondes et lisses, mais pleines de rides, voire déchirées ; […] D’habitude, l’opinion courante explique cela par le fait qu’elles seraient les produits d’une subjectivité, ou plutôt d’une « personnalité » qui se manifesterait sans scrupules et qui, pour sacrifier à l’expressivité, briserait la rondeur de la forme […]. On renvoie ainsi l’œuvre tardive vers les frontières de l’art, pour la rapprocher du document ; et en effet, il manque rarement dans les commentaires du dernier Beethoven quelque allusion à sa biographie et au Destin1.
2Il en va de même, très largement, pour le « vieux Corneille », dont le vieillissement a paru expliquer longtemps celui de son génie et de ses œuvres, vieilles elles aussi dès leur naissance si l’on peut dire, au regard de la jeunesse éternelle du Cid. Cette lecture documentaire s’est autorisée de surcroît de la peinture supposée de Corneille en vieillard dans son œuvre même (comme l’a si bien analysé Bénédicte Louvat2). Le topos de l’usure du créateur se trouvait encore accordé à celui d’une dévitalisation historique, et le déclin du poète était en même temps celui de l’Histoire, notamment romaine, dont il donnait la peinture : « Othon était aussi une manifestation de la lassitude de l’histoire. Le théâtre de Corneille éprouve les effets du temps et de la fatigue3. »
3Adorno souligne néanmoins l’insuffisance de cette explication :
la loi formelle des œuvres tardives est ainsi faite qu’elles ne se résument aucunement à la notion d’expression. […] en déclarant que la subjectivité mortelle est la cause de l’œuvre tardive, [l’interprétation psychologique] espère pouvoir saisir sans reste la mort dans l’œuvre d’art ; voilà le couronnement trompeur de sa métaphysique.
4Adorno propose de voir au contraire dans le style tardif la marque d’une désertion de la subjectivité :
Dans les œuvres tardives, la violence de la subjectivité, c’est ce geste de sursaut avec lequel elle quitte les œuvres. Elle les fait exploser non pour s’exprimer, mais pour se défaire de manière inexpressive de l’apparence illusoire de l’art. […] En vérité, mortelle elle-même et au nom de la mort, la subjectivité disparaît de l’œuvre4.
5Cette désertion de la subjectivité est alors particulièrement sensible dans le recours aux conventions, comme s’il ne fallait pas « tant purger le langage des formules toutes faites que libérer celles-ci de l’illusion que le sujet les maîtriserait […]. Dans l’histoire de l’art [conclut Adorno], les œuvres tardives sont les catastrophes5 ».
Le vers cornélien
6La transposition de cette proposition théorique au théâtre tardif de Corneille impose qu’on examine la façon dont la subjectivité peut habiter une œuvre dramatique, et qu’on imagine à quoi repérer que cette subjectivité quitte la forme en l’illuminant, une dernière fois, de son attention. Cette forme, je propose de la voir dans l’alexandrin, comme expression et comme convention, dont Corneille, plus que tout autre dramaturge de son temps, a une conscience critique et « active ».
7À propos de L’Imitation, Corneille précise le sens de sa versification : « Je ne l’ai réduite en vers que pour soulager la mémoire, où leur cadence imprime les sentiments avec plus de facilité6 […]. » Mais cette forme, impressive donc avant tout au regard de son rythme, est aussi expressive, en ce sens qu’elle est une forme de la pensée. On peut ainsi faire l’hypothèse d’un « alexandrin cornélien », d’une façon toute cornélienne d’occuper, d’habiter cette forme conventionnelle, de lui imprimer une marque subjective – en même temps qu’une force impressive. Je tâcherai montrer en quoi le style tardif qui semble caractériser les œuvres de la fin de sa carrière travaille (au sens étymologique…) plus que jamais l’alexandrin dans les deux sens simultanés de son éclat (lumière et fragmentation), et de son allure, dans les deux sens du terme aussi : sa façon d’aller, sa dramaticité donc, mais aussi sa tenue, son tonus, la « noblesse dans le maintien7 » du vers cornélien au moment où sa forme nette, si caractéristique, saisit notre écoute quasi charnellement. Dans ce théâtre tardif de Corneille, se dégagent trois caractéristiques dans le travail de la forme :
8– un obscurcissement du discours parallèle à la catastrophe de la grandeur,
9– une exhibition des conventions marquée par l’auto-parodie et l’artificialité assumée de « blocs fragmentés »,
10– le travail de la mort au cœur même de ce recours aux conventions.
Catastrophe de la grandeur et obscurcissement du discours
11Dans l’univers cornélien, Othon représente la catastrophe véritable, la première tragédie quasi totalement dépourvue de grandeur, de cette « noblesse dans le maintien ». Dans cette « tragédie de l’équivoque8 », le mystère des personnages reste entier au dénouement : qui sont-ils vraiment ? aiment-ils vraiment ? Ce règne du mensonge de tous à tous, cette catastrophe de l’héroïque dans la politique se disent dans un discours que Corneille prive délibérément à la fois de clarté et d’allure. Non que les personnages manquent de maîtrise : Othon est un orateur accompli, mais hors scène. Flavie rapporte la cour mensongère qu’il a faite à Camille, nièce de l’empereur, avec une « éloquence accorte » au sens premier de l’épithète, déclaration trop parfaite dont Camille se fait la dupe volontaire9.
12Pour le reste et en scène, le discours des personnages se caractérise d’abord souvent par la densité sémantique – d’aucuns ont dit le galimatias – l’abstraction allusive, l’abondance des périphrases, la complexité des anaphores pronominales. La densité des formules repose encore sur des effets de redoublement, de paronomase qui troublent la compréhension plus qu’ils ne la permettent, sans du moins que soit accordé au spectateur le temps de la réflexion pour « tourner la formule » dans son esprit. Cet effet est très net dans le duel entre Camille et Plautine, où les répliques en miroir redoublent l’abstraction et la difficulté :
Camille
Votre exemple ne laisse à personne à douter
Qu’à moins de la Couronne on peut le mériter.
Plautine
Mon exemple ne laisse à douter à personne
Qu’il pourra vous quitter à moins de la Couronne10. (Othon, IV, 4, v. 1367-1371)
13Cette densité n’est cependant pas tant concentration, que refus de l’explication. La pièce est marquée encore en effet par l’interruption11, remarquablement fréquente (plus de cinquante), les ruptures de construction :
Plautine (persiflant Martian)
Avoir brisé ces fers, fait un degré de gloire
Au-dessus des Consuls, des Préfets du Prétoire,
Et si de cet amour je n’ose être le prix,
Le respect m’en empêche et non plus le mépris ; (Othon, II, 2, v. 525-528)
14La réticence encore caractérise le discours d’Othon, tant dans le lyrisme amoureux que dans l’évocation du pouvoir (Othon, II, 4). On notera enfin, dans cette « défaite » énonciative, la manière ostensiblement familière avec laquelle s’expriment désormais princesses et ministres :
Camille
Mais quant à cet époux, vous me ferez plaisir
De trouver bon qu’enfin je le puisse choisir.
Je m’aime un peu moi-même, et n’ai pas grande envie
De vous sacrifier le repos de ma vie. (Othon, II, 5, v.735-738)
15Et Lacus à la scène suivante « […] laissons-la discourir, / Et ne nous perdons pas de crainte de périr » (II, 5, v. 751-752). Est-ce à dire que le « vers cornélien » disparaît ? Non, et sa forte accentuation demeure, celle que les auditeurs ont dans l’oreille dès qu’ils viennent écouter du Corneille. Mais l’impression surgit que ce moule ne sert à présent qu’à accuser la faillite de son contenu sémantique, à en souligner le statut d’apparence. Othon lâche dès les premiers vers ce distique aussi « cornélien » dans sa construction que peu héroïque : « À moins que notre adroite et prompte servitude / Nous dérobe aux fureurs de leur inquiétude » (Othon, I, 1, v. 49-50). Et s’il reste des bribes d’énonciation héroïque, elles sont désormais placées dans les bouches indignes, comme celle de l’affranchi Martian qui, à propos de sa naissance infâme, reprend comme sur un mode parodique le « je suis » si typiquement cornélien : « C’est ce crime du sort qui m’enfle le courage ; / Lorsqu’en dépit de lui je suis ce que je suis, / On voit ce que je vaux voyant ce que je puis12. » (II, 2, v. 494-496).
Auto-parodie et exhibition de la convention
16Adorno évoque, comme caractéristique du style tardif, ces morceaux de convention laissés à nus, comme tels. Stricto sensu, on peut ainsi repérer dans ce théâtre tardif des blocs conventionnels qui semblent posés sans souci apparent de leur vraisemblance, même si thématiquement et symboliquement ils trouvent leur justification. Il en va ainsi par exemple des deux tirades moralistes et didactiques placées dans la bouche du confident Albin, dans Tite et Bérénice : l’une de tonalité très La Rochefoucauld sur l’amour-propre source de toutes les passions (I, 3), l’autre sur la jalousie féminine (IV, 4). L’artifice de ces insertions n’a d’égal que l’artifice même du personnage, qui invite Tite à appliquer à la lettre, cyniquement, les leçons de cette vision morale. Ayant dévoilé les ressorts de l’âme, il les fait marcher, exhibant ainsi la mécanique humaine dont il joue lui-même en « âme libre » (v. 338), c’est-à-dire sans amour ni scrupule. Mais le dénouement lui donne tort, conférant ainsi rétrospectivement un statut étrange à cette explication psychologique qui n’explique rien.
17Du même procédé relève semble-t-il l’insertion totalement artificielle de l’éloge de Méroüée dans Attila, où l’on veut voir dans le portrait du légendaire roi franc celui de Louis XIV (II, 5). Cette artificialité est évidemment délibérée, puisque que Corneille a ménagé auparavant une insertion beaucoup plus naturelle du même éloge dans la bouche d’Attila lui-même (I, 1). Cette convention laissée à nu souligne la solution de continuité, la disjonction des temps que soupçonne Ardaric s’adressant à Attila, à propos de Rome et du royaume franc : « Et ce qu’on vous prédit touchant ces deux États / Peut être un avenir qui ne vous touche pas » (I, 2, v. 172-173). Littéralement intempestif, l’éloge s’exhibe comme morceau conventionnel, où l’auto-parodie le dispute au rétrécissement. Comment en effet ne pas lire « du Corneille » auto-cité dans des vers tels que :
Je l’ai vu tout couvert de poudre et de fumée
Donner le grand exemple à toute son armée,
Semer par ses périls l’effroi de toutes parts,
Bouleverser les murs d’un seul de ses regards […]
18avant que l’éloge épique ne s’achève, non sur un ultime accord en ut majeur, mais sur le mignard d’un tableautin consacré au dauphin, petit soldat gracieux13.
19Autre façon d’afficher la convention, l’auto-parodie traverse toutes les pièces tardives, au point que Georges Couton a pu lire ces pièces comme autant de répliques en miroir à celles de la jeunesse ou de la maturité, de part et d’autre de la ligne de faille de Pertharite : Suréna répondrait à Nicomède, Othon à Cinna, etc., et « Agésilas paraît une parodie discrète et amusée des comédies de jeunesse14. »
20Les scènes de conseil notamment semblent toutes des parodies de celle de Cinna, qui était déjà d’ailleurs une imitation de celle d’Auguste avec Mécène et Agrippa. Au pathétique « Ou laissez-moi périr, ou laissez-moi régner » d’Auguste (Cinna, IV, 2, v. 1192) succède le froid constat de Vinius « Il faut, quoi qu’il arrive, ou périr ou régner » (Othon, I, 2, v. 234) qui devient dans la bouche de Flavian « En un mot il vous faut la perdre ou l’épouser » (Tite et Bérénice, II, 1, v. 426), et enfin « Ou faites-le périr, ou faites-en un gendre » dans la bouche du conseiller d’Orode (Suréna, III, 1, v. 730) : sensible à la dégradation du dilemme, le public rit à ce dernier vers.
21Parodique, le langage cornélien se trouve « délocalisé » dans la bouche d’abord des héroïnes, puis dans celle des confidents. Flavian fait la leçon à Tite, qui répond « Je sais qu’un empereur doit parler ce langage […]. / Je le dis seulement, parce qu’il le faut dire, / Et qu’étant au-dessus de tous les Potentats, / Il me serait honteux de ne le dire pas15 » : le langage héroïque, creux désormais à ses yeux, ne contient plus que des « duretés », qui le brisent au dénouement (V, 1). Othon comme Tite et Bérénice paraissent à ce titre une sorte d’auto-réfutation, une démonstration rageuse et dédaigneuse à la fois de ce que donne la poursuite des « tendresses de l’amour content16 », de ce que devient l’amour dès lors qu’il n’est plus lié aux exigences de la gloire : amour de soi et agrippement à la vie, exprimés dans ce langage déshabité, dont l’allure corsetée n’est maintenue par moments que pour mieux accuser la corruption de toutes les valeurs qu’il portait, et travaillé par la mort.
Le travail de la mort
22Ce travail de la mort se manifeste, de façon inattendue peut-être, dans Agésilas. Le recours au vers libre donne certes l’impression que la pièce est, comme on l’a dit, une pastorale, un opéra-comique sans musique (qu’on va jusqu’à comparer à La Belle Hélène), une comédie héroïque plutôt qu’une tragédie, comme l’indique pourtant son sous-titre et comme le confirment toutes les données de l’intrigue politique17. Dans un univers sans laideur, la pièce n’offre pas de péril de mort, et marque une forme d’enjouement et de grâce sensible. Le sacrifice de Mandane y a une simplicité empreinte de grandeur que n’avait pas celui de Plautine dans Othon, que les circonstances atroces (devoir se livrer à l’affranchi Martian pour sauver Othon) obligeaient à une forme de raidissement plein d’amertume, à la violence du chantage affectif.
23Mais Georges Couton voit juste quand il repère dans Agésilas un « tragique devenu intime », touchant selon Saint-Evremond « de plus secrètes douleurs18 ». Ce tragique, dit Couton, c’est « le spectre de vies ratées, dans la vision de bonheurs proches et pourtant en danger d’être inaccessibles19 ». La tragédie ne pare plus la mort des prestiges de l’imaginaire héroïque, mais, un ton au-dessous, en mineur, ce spectre des vies ratées manifeste la menace toute proche de la déliaison. Serge Doubrovsky compare ainsi le refus de vivre d’Horace au rejet de l’engagement vital chez Bérénice, et ajoute :
Il y a toutefois, entre elle et lui, une différence, à vrai dire, essentielle : Horace conclut qu’il faut mourir, Bérénice, qu’il faut partir. Là où, pour sauver l’exigence héroïque dans sa pureté, Horace envisageait (et Polyeucte pratiquait) le sacrifice suprême de la vie, Bérénice se contente d’un sacrifice symbolique. La solution héroïque n’est plus désormais la mort, mais la retraite. Il faudrait méditer ce changement20.
24On ne peut rapporter ce changement à une plus grande pusillanimité, puisque cette suspicion à l’égard de la mort héroïque est le fait précisément des héros et surtout des héroïnes capables de ce sacrifice : Plautine dans Othon (I, 4) Ildione dans Attila (IV, 6), Palmis dans Suréna (V, 5). Mais les héros sont les premiers désormais à reconnaître le caractère imaginaire de la gloire posthume face à la présence pressante de la mort, dépouillée désormais de toute aura. Plus question de réussir sa mort, ce qui est le fantasme du vivant ; il ne s’agit que de laisser s’épuiser la vie, en-deçà même du suicide. Tite « lâche prise », se démettant par avance de l’empire au profit de Domitian. Ni Tite, ni Pulchérie, ni Suréna, dans la certitude où ils sont de la dégénérescence à venir, ne veulent se soumettre au devoir de prolonger la dynastie ou la lignée et il s’agit même, chez Pulchérie, de fermer dès à présent « l’auguste monument » : on entend dans cette pièce, comme dans Suréna, le bruit de la dalle qui scelle la tombe, et surtout le silence qui suit. Même l’espoir que subsiste le nom désormais individuel est démenti ultimement par la mort de Suréna, liquidé anonymement au coin d’une rue.
25Là encore, l’inventivité créatrice et destructrice du style tardif joue de la convention mise à nu, ainsi dans le fameux trimètre de Suréna : « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir ». Non qu’il faille surévaluer l’importance de cet hapax, mais il semble que quelque chose se passe, en raison même de cette rareté absolue :
Vivez, Seigneur, vivez, afin que je languisse,
Qu’à vos feux ma langueur rende longtemps justice ;
Le trépas à vos yeux me semblerait trop doux,
Et je n’ai pas encore assez souffert pour vous.
Je veux qu’un noir chagrin à pas lents me consume,
Qu’il me fasse à longs traits goûter son amertume,
Je veux, sans que la mort ose me secourir,
Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. (I, 3)
26Hissé au-dessus des alexandrins réguliers comme le drapeau noir de la mélancolie, ce trimètre ne manque certes pas d’allure toute cornélienne21. Cette « dureté » héroïque, à laquelle ne se résignait pas Tite et qui le brise, la voici délibérément mise en œuvre au service de la mort : « La tendresse n’est point de l’amour d’un héros, / Il est honteux pour lui d’écouter des sanglots, / Et parmi la douceur des plus illustres flammes, / Un peu de dureté sied bien aux grandes âmes22 », et elle trouve son pendant dans le silence obstiné, et littéralement létal, d’Eurydice. Mais tout en altérant fugitivement la cadence, ce trimètre ne clôt pas la tirade et demeure ainsi pris dans le rythme des alexandrins dont le pattern sonore reste présent, entre rémanence et attente : dans ce trimètre en effet, on pourrait presque entendre aussi une césure fantôme à « toujours », et c’est bien ce mot qui se trouve à l’hémistiche lorsque Suréna le reprend, au dernier vers de la scène : « Ô Ciel, s’il faut toujours aimer, souffrir, mourir ». L’équation mortifère entre les trois termes est travaillée par ce « toujours » : la mort travaille l’être, et l’être résiste à la mort dans l’adynaton « toujours mourir ». Au chef d’œuvre mélancolique des personnages, Corneille oppose, par la forme, non pas l’espoir de la survie, mais cet ultime éclat de la subjectivité divisée, au moment précis où elle s’enfuit.
Conclusion
27Revenant quarante ans après sur le film qu’il a tiré d’Othon23, Jean-Marie Straub note ceci à propos des intrigues supposées « pas très compréhensibles » du vieux Corneille : « […] C’est justement ça qui est intéressant. Si l’intrigue est peu compréhensible et impénétrable, ça l’est également pour les personnages eux-mêmes. C’est ça qui fait la tragédie, “moderne” entre guillemets24. »
28Et la diction précipitée, totalement inexpressive d’Adriano Aprà (Othon) et d’Anne Brumagne (Plautine) fait entendre, littéralement, cette désertion de la subjectivité qui met en évidence cet obscurcissement, le fait comprendre en tant que tel. Le film, mais aussi le texte, « exigent du spectateur une intelligence sans une seconde de défaillance […] », et Straub ajoute : « tant pis pour les autres spectateurs ; les films qui prétendent leur mâcher la besogne ne leur servent quand même de rien : ils se retrouvent tout aussi désarmés dans la vie à la première occasion25. »
29Cette rugosité salvatrice, on pourrait l’appeler chez le « vieux Corneille » le refus du frisson. Corneille semble ne plus vouloir obtenir de succès fondés sur ce qui précisément a fait son succès et sa gloire, les magnifiques tirades parfaitement arrondies et pleines d’allure qui font « frissonner » Sévigné26 et dont on ne peut avec d’Aubignac que constater le morcellement, l’inachèvement, la rupture délibérée, ou la désertion intérieure27. Son ultime silence, Eurydice l’oppose en effet aussi bien au spectateur qu’à Palmis. L’explication se dérobe, comme si Corneille prenait à son propre piège la volonté d’élucidation portée par l’écriture moraliste, et choisissait de montrer au contraire l’impuissance de l’analyse, telle qu’elle est exprimée par Albin dans Tite et Bérénice, face à cette obscurité constitutive.
30Il ne s’agit donc pas de dénier au « vieux Corneille » la capacité à construire une intrigue fortement liée ni de la mener à son dénouement avec l’habileté nécessaire, bien au contraire. Le sentiment d’être face à un « style tardif » naît du constat non d’une impuissance sénile, mais d’une brisure délibérée, d’une forme de destruction volontaire de ce qui emblématisait « le Corneille », d’une mise à mal paradoxale de cette « classicisation » par ailleurs activement poursuivie. Ce refus de répondre aux attentes d’un public à reconquérir pourtant, cette manière de faire à la mode de l’amour des concessions apparentes et en réalité d’une ironie ravageuse, témoigne peut-être plutôt de la nécessité intérieure d’une écriture qu’en effet la critique jugera « froide ». L’allure du vers est ainsi profondément discursive, portée par une subjectivité divisée et la portant aussi, au moment de son congé à la fois brutal et prolongé. Le rythme des vers, leur allure, paraissent se définir moins par une « mécanique de la mesure et du comptage » que par, dit Benveniste, « une compréhension des modes de subjectivation dans le temps28 ». J’ajoute : des modes de subjectivation et de désubjectivation dans le temps.
1 Edward W. Said, Du Style tardif. Musique et littérature à contre-courant [On late style, 2006], traduit de l’américain par M.-V. Tran Van Khai, Arles, Actes Sud, 2012 ; Theodor Adorno, « Le style tardif chez Beethoven, Transmutations », Beethoven, L’Arc no 40, 1970, p. 27-31, repris dans Moments musicaux, Genève, Éditions Contrechamps, 2003, p. 9-12.
2 Bénédicte Louvat, « Le vieillard amoureux, de la comédie à la tragédie », dans Héros ou personnages ? Le personnel du théâtre de Pierre Corneille, dir. Myriam Dufour-Maître, Rouen, PURH, 2013, p. 51-61.
3 Michel Prigent, Le Héros et l’État dans la tragédie de Pierre Corneille, Paris, PUF, 1986, p. 459.
4 Theodor Adorno, art. cité.
5 Ibid.
6 Pierre Corneille, L’Imitation de Jésus-Christ, Avis au Lecteur, 1651, dans Œuvres complètes, éd. Georges Couton, Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 3 vol., 1980-1987, t. II, p. 791. Mes italiques. Les références à l’œuvre de Pierre Corneille dans cet article renvoient toutes à cette édition.
7 Selon une des définitions de « Allure » dans le Robert.
8 Serge Doubrovsky, Corneille et la dialectique du héros, Paris, Gallimard, « Tel », 1963, p. 365.
9 Othon, II, 1, v. 401.
10 Les affrontements de femmes rivales, moments quasi obligés dans le théâtre de Corneille depuis Pertharite, sont des passes d’armes rapides et étincelantes, trop pointues parfois pour être saisies au vol dans toute leur subtilité : l’éblouissement du spectateur prime sur la compréhension fine du discours, comme si Corneille faisait confiance ici à la situation et à la qualité des personnages pour « tenir » la scène, dans le même temps où le discours dédaigne de se clarifier.
11 Sur les effets que Corneille tire des interruptions, voir dans ce volume l’article de Fabien Cavaillé, « Le pouvoir de parler, l’occasion de se taire. Interruptions de vers, paroles royales et violence dans Cinna, Héraclius, Suréna ».
12 Voir Anne Ubersfeld, « “Je suis” ou l’identité héroïque chez Corneille », Actes du colloque Pierre Corneille, Rouen, 1984, dir. Alain Niderst, Paris, PUF, 1985, p. 171-180 ; Cécilia Laurin, Admirables criminels. Éthique et poétique du spectaculaire dans le théâtre de Pierre Corneille, thèse sous la dir. de Gilles Declercq, Sorbonne Nouvelle-Paris 3, soutenue le 16 décembre 2019, et article dans ce volume, « “Connais-moi tout entière” : parole apocalyptique et dramaturgie cornélienne ».
13 Attila, II, 5, v. 555-589.
14 « Il écrit avec Agésilas un “à quoi rêvent les jeunes filles” avec de si fugaces échos de ses anciennes œuvres, un si discret stoïcisme qu’on croirait l’entendre faire sa propre parodie », Georges Couton, La Vieillesse de Corneille (1658-1684), Paris, Maloine, 1949, rééd. Eurédit, 2003, p. 128.
15 Tite et Bérénice, V, 1, v. 1443-1450.
16 Attila, « Au Lecteur », dans Corneille, O. C., éd. citée, t. III, p. 642.
17 Les données de l’intrigue sont très semblables en effet à celles de Nicomède, de Pertharite, de Suréna : le général a fait le roi, qui ne semble ici qu’un « monarque en peinture » (Agésilas, III, 1). Comme dans Tite et Bérénice, le Sénat ne laisse pas le monarque épouser une reine étrangère, et comme dans Othon les conseillers ont plus de cour que l’empereur lui-même.
18 Saint-Évremond, Lettres, cité par G. Couton, dans Pierre Corneille, O. C., éd. citée, t. III, p. 1524.
19 Georges Couton, éd. citée, t. III, p. 1524. Mes italiques.
20 Serge Doubrovsky, op. cit., p. 409.
21 Voir dans ce volume l’analyse de ce trimètre par Benoît de Cornulier.
22 Suréna, V, 3, v. 1675-1678.
23 Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour (Othon), film, 1969 ; Huillet et Straub, Paris, Éditions Montparnasse, DVD, vol. 6, 2011.
24 Jean-Marie Straub, « Après Othon », Le Portique [En ligne], 33, 2014, document 6, mis en ligne le 5 février 2016, consulté le 20 juillet 2020. http://leportique.revues.org/2763.
25 Jean-Marie Straub, cité par Claude Rieffel, https://www.avoir-alire.com/othon-la-critique-le-test-dvd-integrale-huillet-straub-volume-6, consulté le 20 juillet 2020. Les Straub, analyse C. Rieffel, évitent soigneusement tout ce qui, dans le tout-venant du cinéma, vise à créer une impression de continuité (raccords dans l’axe, zoom, etc.), pour privilégier au contraire les techniques de rupture : cadrages fragmentant l’espace, champs contre-champs brutaux, focales fixes, etc.
26 Marie de Sévigné, lettre du 16 mars 1672, dans Correspondance, éd. Roger Duchêne, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 3 vol., 1972-1978, t. I, p. 459.
27 François Hédelin d’Aubignac, Première dissertation concernant le poème dramatique, dans Sophonisbe, éd. Dominique Descotes, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2008, p. 211 et 216.
28 Selon l’analyse que propose Émile Benveniste de l’étymologie de « rythme », et que rappelle Marielle Macé dans Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard, « NRF Essais », 2016, p. 263-264.
sous la direction de Myriam Dufour-Maître, avec le concours de Cécilia Laurin
© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 26, 2020
URL : https://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/1011.html.
Quelques mots à propos de : Myriam Dufour-Maître
Université Rouen Normandie
CÉRÉdI – EA 3229
Myriam Dufour-Maître a enseigné à l’université de Rouen-Normandie et animé le Mouvement Corneille de 2000 à 2018. Elle a consacré à Pierre Corneille un ouvrage (La clémence et la grâce, PURH, 2014) et six colloques, dont le plus récent, Appropriations de Corneille, est paru en 2020 sur le site des publications du CÉRÉdI (http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/797.html).
